« Vouloir dire », est-ce une question d’intention ? (1)
Cet article fait suite à la série d’articles sur « Devons-nous vouloir dire ce que nous disons ? » de S. Cavell in Dire et Vouloir dire. (Dire et Vouloir Dire, Le fondement rationnel de la philosophie du langage ordinaire, Le type d’affirmation produite par la philosophie de l’ordinaire)

Roman Bonnery - http://www.romanbonnery.net/
La question du « vouloir dire » résiste à une lecture purement sémantique et n’est guère plus explicitée par la distinction sémantique-pragmatique. Il y a une sorte de « logique de l’ordinaire » sur laquelle repose la rationalité des procédures du langage ordinaire. Nous sommes autorisés à énoncer des énoncés du premier et du second type[1], parce que nous partageons une même communauté linguistique, sur laquelle nous nous fondons pour dire ce que nous disons. Nous nous fondons sur cette dernière parce que « apprendre un langage », c’est apprendre le monde : le langage est notre forme de vie. J. Bouveresse souligne que
Nous n’aurions pas de raison suffisante d’appeler un langage quelque chose qui ressemble à un langage, mais dont il est intrinsèquement exclu que nous puissions l’apprendre. En ce sens un langage est quelque chose qui est essentiellement humain ; car “le mode de comportement humain commun est le système de référence à l’aide duquel nous interprétons un langage qui nous est étranger ”[2].
L’apprentissage du langage est un apprentissage social, car que faisons-nous quand nous apprenons à parler[3] ? L’idée de Bruner est que l’enfant commence à apprendre à parler dès qu’il entre en relation avec autrui. Il y a une volonté (un désir) de faire quelque chose avec autrui et cela se fait avec des mots. Apprendre un langage, c’est apprendre à faire des choses avec les mots – pas seulement les utiliser de manière correcte (connaître les « règles », ne pas faire une erreur de nomination ou de syntaxe par exemple) – mais avec pertinence (l’application de ces « règles », bien se faire comprendre par exemple). On juge en effet les progrès de l’apprentissage chez un enfant suivant son « efficacité », son « savoir-faire ». Si un enfant ne continue pas à compter[4] si on lui fait le geste (de le faire), il s’en trouve marginalisé, on le considère comme « aliéné ». Apprendre à parler, c’est en fin de compte ingérer des normes (et les digérer). Et c’est justement ce savoir-faire qui nous « donne droit à… ».
C’est la justification du chirurgien, dont le droit à ouvrir les gens se fonde sur son savoir-faire et ses diplômes, et dont le droit à présenter ses cas aux autres se fonde sur sa fonction et sur l’obligation de transmettre son savoir à ses pairs[5].
Et envisager ce que nous disons en termes « d’efficace », de pertinence, c’est là tout l’objet d’Austin. Si « Une chose que nous faisons toujours quand nous discutons d’un mot, c’est nous demander comment nous l’avons appris[6] » et « Comme nous ignorons en fait à peu près tout de l’histoire réelle de l’apprentissage du langage et que nous sommes incapables, dans la plupart des cas, d’indiquer comment nous avons appris tel ou tel mot, [alors] l’explication par l’enseignement est essentiellement une explication par la règle dont la maîtrise est considérée comme le résultat de l’enseignement »[7]. Il nous faut dès lors envisager ce qu’est cette notion de règle. C’est pourquoi, pour examiner les raisons de dire que nous « devons » vouloir dire par nos paroles et ce que ces paroles veulent dire d’ordinaire, Cavell se livre à une recherche grammaticale[8] (au sens wittgensteinien) de la notion « règle ».
La dimension « éthique » du langage.
Ce qui est normatif, c’est précisément l’usage ordinaire lui-même[9].
Pour Ryle[10], ce qui distingue use et usage est justement qu’« il y a des règles à suivre ou à ne pas suivre ». Mis-usage n’existe pas, parce qu’une coutume ne peut pas être mal suivie en quelque sorte, alors que use est ce qui est soumis à des règles qu’il nous faut découvrir. C’est aussi pourquoi l’opposition normatif-descriptif est infondée, parce que faire une description présuppose que nous ayons appris à la faire (des manières normatives pour le faire). Mais ces normes ne sont pas pour autant, ou pas uniquement, des commandements. Lorsque l’on regarde une notice d’emploi (d’un jeu par exemple), on ne trouve pas des énoncés au mode impératif. On nous explique une marche à suivre :
Si un énoncé normatif est un énoncé utilisé pour créer ou instituer des règles ou des standards, alors les énoncés prescriptifs ne sont pas des cas d’énoncés normatifs. Établir une norme, ce n’est pas nous dire comment il faudrait que nous exécutions une action, mais comment l’action est faite, ou comment elle doit être faite[11].
« Établir » ici est à entendre dans sa double dimension, à savoir mettre au jour, trouver (finding) ce qui se fait, les standards effectivement en vigueur, mais aussi mettre en place, fonder (founding) ce qui doit être standard dans certains cas. Que fait le philosophe du langage ordinaire lorsqu’il établit une norme ?
On peut considérer qu’il est en train de confirmer ou de prouver l’existence de normes quand il rapporte ou décrit comment nous parlons (comment parler), c’est-à-dire quand il dit (dans des énoncés du deuxième type) ce qui est normatif pour des énonciations dont les exemples sont fournis par des énoncés du premier type. Confirmer et prouver constituent d’autres zones de ce que c’est qu’établir[12].
Le philosophe ne crée pas, il montre et confirme l’existence de normes que nous suivons dans certains cas. En ce sens, « La philosophie ne peut en aucune manière intervenir dans l’usage effectif du langage ; au bout du compte, elle ne peut que le décrire. Car elle ne peut pas non plus le fonder. Elle laisse toutes choses en état »[13]. Il faut entendre par là qu’elle est « descriptive » de notre grammaire, des critères que nous partageons « quand il s’agit pour nous de nous comprendre les uns les autres, de connaître le monde et d’être en possession de nous-mêmes »[14]. Il existe un nombre indéfini de façons de transformer le langage (ordinaire), mais l’activité philosophique en tant que telle ne le transforme pas. Elle le met en évidence suivant des procédures elles-mêmes normatives. Et les philosophes s’octroient ce droit en tant qu’ils sont des locuteurs expérimentés de leur propre langue.
À la recherche du normatif…
Pour voir cela de plus près, il nous faut mieux circonscrire ce qu’est le normatif. Qu’est ce « nous dire ce qu’il faudrait (ought to) que nous fassions » ? Ce n’est pas instituer une norme, comme nous venons de le voir, mais plutôt en présupposer l’existence – y faire appel.
Nous nous attendrons peut-être à nous entendre répliquer ici que c’est justement cet appel qui constitue le point normatif sensible, car ce que nous faisons réellement quand nous faisons appel à une règle ou un standard, c’est dire aux autres qu’il faudrait qu’ils y adhèrent[15].
Ce problème est tout à fait fondamental, parce que, en effet, rien ne nous oblige. On peut ne pas reconnaître, c’est-à-dire accepter une norme ou convention ; reprenons un exemple d’Austin : « Sur une île déserte, vous pouvez me dire : “allez ramasser du bois” ; et je puis vous répondre : “Je n’ai pas d’ordre à recevoir de vous”, ou “Vous n’avez pas qualité pour me donner des ordres”. Je n’accepte pas d’ordres de vous quand vous essayer d’imposer une autorité sur une île déserte (une autorité que je peux reconnaître, certes, mais seulement si je le veux bien) ; et cela contrairement au cas où vous êtes le capitaine du bateau et possédez de ce fait une autorité authentique »[16].
Le problème de la reconnaissance, de ce qui fait que nous nous accordons dans et par le langage, est ce à quoi s’achoppe Cavell quand il soutient que nous n’avons d’autre autorité que nous (que « moi ») pour dire « ce que nous disons quand ». Mais ici, il aborde cette question sous un angle différent, car nous parlons de la norme « en général » et non pas dans un « cas précis », en situation, comme le fait Austin. C’est pourquoi il ironise de la sorte :
nous ne saurions faire suivre chaque énoncé, pour éviter de transgresser les bornes d’une relation, de la formule : “…si vous acceptez les faits et la logique que j’accepte”, ni chaque évaluation, de la formule : “…si vous acceptez les standards que j’accepte”. De telles précautions finiront par suggérer d’accoler à tout ce que nous disons “…si vous voulez dire par vos paroles ce que je veux dire par mes paroles”. Ici s’achève la pantomime de la précaution[17].
Si l’on se place dans le mode d’une conversation normale, nous n’avons pas à « clarifier » ce que nous disons de la sorte… Discuter ensemble, c’est agir ensemble[18] ; ce qui nous ouvre la sphère du langage comme un lieu où nous avons certaines responsabilités. Mais d’ordinaire, nous y arrivons de manière assez satisfaisante, même si nous pouvons y échouer. Le fait est que le langage de tous les jours ne dépend pas d’une structure relevant de la clarté du calcul, de la « pureté de la logique », et que cette absence n’entrave en rien son fonctionnement. Le lieu où nous trouvons des entraves est celui où nous échouons, non pas à nous faire comprendre totalement, mais à nous faire comprendre tout court. Cavell examine les différentes manières que nous avons d’y échouer (en reprenant les procédures austiniennes).
Tout d’abord, on peut ne pas « reconnaître » la norme invoquée, c’est-à-dire ne pas l’identifier comme norme à suivre. On ne voit pas trop si c’est un standard, ou quel standard cela peut être. Par exemple, s’il est d’usage, dans un appartement donné et avec des colocataires donnés, de lever le poing pour se saluer, il n’est pas assuré qu’un élément extérieur à ce microcosme comprenne ce que font ces colocataires quand ils lèvent ainsi le poing. Le même problème d’identification de norme se pose parfois quand on est à l’étranger, et que l’on ne voit pas trop si une démarche particulière est rituelle ou si elle est le fait d’un petit groupe donné de personnes, comme dans cet appartement.
Un autre échec serait « l’abus », comme quand des gens « nous disent parfois ce qu’il faudrait que nous fassions alors que tout ce qu’ils veulent dire, c’est qu’ils veulent que nous fassions cela »[19]. Mais ce qui est sûr, c’est que nous ne pouvons pas soutenir que chacun aurait un système de normes privées, qui lui serait propre. La preuve en est que nous pouvons discuter ensemble sans présupposer que toute énonciation a des conséquences dramatiques parce qu’en fin de compte, je n’ai jamais été entièrement compris, ou du moins que je ne peux pas m’en assurer totalement.
Alors, si ce n’est pas en disant quelles actions il faudrait exécuter, comment donc établissons-nous (ou justifions-nous ou modifions-nous ou abandonnons-nous) effectivement des règles ou des standards ? Quelle autre réponse générale peut-on faire à cette question générale que “De diverses manières, selon le contexte” ?[20]
Les règles ne sont pas « un milieu homogène[21] », il y a « dans chaque cas différentes manières qui sont normatives pour l’accomplissement des tâches normatives particulières en question ». Il ne peut pas y avoir de réponse générale, unique et univoque. C’est justement parce que nous croyons qu’une telle réponse peut exister que nous avons négligé la complémentarité règle-énoncé que Cavell met en évidence. Et cette négligence a en partie à voir avec la conception que nous nous faisons de l’action[22]. Le cœur du problème est l’idée que nous avons de ce qui est normatif ou non. Pourquoi associons-nous règle et impératif ? Cavell y trouve une source chez Kant (comme Austin l’avait fait pour la distinction entre descriptif et normatif, position que Cavell creuse et explique ici) et développe le parallélisme (et l’asymétrie) entre « il faudrait » et « (je) dois » (must).
Le « Déclaratif catégoriel ».
Kant nous dit qu’un être parfaitement rationnel se conforme en réalité (nécessairement) au “principe suprême de la moralité”, mais que nous qui sommes des créatures imparfaitement rationnelles, nous sommes mis par ce principe dans une situation de nécessité, si bien que pour nous c’est (cela semble toujours) un impératif. Mais si je comprends bien la différence perçue ici par Kant, elle se situe dans le cadre de la conduite d’animaux rationnels. Tant que Kant parle de (la logique de) l’action, son Impératif catégorique peut se formuler comme un Déclaratif catégoriel (règle-description), autrement dit la description de ce que c’est qu’agir moralement : quand nous agissons (vous agissez) moralement, nous agissons d’une manière que nous considèrerions comme justifiée de façon universelle, justifiée quelle que soit la personne qui ait fait l’action. (Cette formulation catégorielle ne nous dit pas comment déterminer ce qui a été fait ; pas plus que la formulation catégorique de Kant, bien qu’elle fasse semblant de le faire en parlant de “la” maxime d’une action, ou qu’elle donne l’air à la chose d’être moins problématique qu’elle ne l’est.)[23].
Si descriptif et normatif ne s’opposent pas, et qu’au contraire, le premier présuppose le second, nous comprenons ce que peut être le « déclaratif catégoriel » que présente ici Cavell. La règle indique quelle est la marche à suivre, elle décrit ce qui doit être fait quand vous la suivez, quand vous jouez à un jeu par exemple. C’est pourquoi la maxime kantienne n’est pas vraiment un « commandement ». Refuser de « reconnaître la norme » suivant le mode : « Mais supposez que je ne veuille pas être moral ? », n’a pas de sens, c’est-à-dire pas de pertinence. Le « Déclaratif catégoriel » est une description de ce qu’on fait effectivement quand on est moral et pas ce qu’il faudrait faire (dans telle ou telle situation) si on veut être moral (agir moralement).
La description présuppose la norme. « Il ne saurait assurer – pas plus que ne saurait l’assurer aucune parole prononcée par un philosophe – que vous n’agirez pas immoralement ; mais rien de ce que vous voulez ou ne voulez pas ne l’affecte»[24]. La règle-description n’a pas d’effets dans le sens où elle ne dit rien de ce qu’il faudrait que je fasse si je veux agir moralement (dans cette situation). Pour reprendre la métaphore du jeu, les règles d’un jeu nous disent ce que nous devons faire en jouant, pas ce qu’il faudrait que nous fassions si nous voulons jouer. Rien, mis à part nous, ne peut faire en sorte que nous agissions moralement, et le déclaratif catégoriel existe indépendamment du fait que nous le « suivions » ou non. Il existe des conventions et il ne tient qu’à nous de nous y conformer. Il ne dépend que de nous de trouver comment agir moralement, c’est-à-dire mettre en application le déclaratif catégoriel. C’est à nous qu’en incombe la responsabilité.
Règles et impératif.
Pour autant, Cavell ne nie pas que « les règles ne sont jamais associées avec des impératifs : je nie seulement que ce soit toujours le cas »[25]. Il ne retombe pas dans le type d’erreur de Ryle, il y a une impossibilité « à généraliser » ce qu’il dit, puisqu’il est évident que certaines règles sont bien impératives, sans quoi la confusion n’aurait pas lieu d’être… En ce sens, il se montre tout à fait attentif face aux risques d’un propos trop « général ». Cependant, nous faisons bien une différence entre règle et impératif : dans la règle, il y aurait quelque chose de « facile » (que l’on fait naturellement), alors que l’impératif me « force » à faire quelque chose d’une certaine manière. On doit ici souligner une différence considérable portant sur les modes de l’impératif. Il y a un gouffre entre les « impératifs modaux » («devoir», «être censé», etc.) et les « commandements purs » (« garde à vous !» par exemple[26]). La question de savoir si je peux commander dépend seulement de savoir si j’ai du pouvoir ou de l’autorité sur la personne à qui j’ordonne ; et cela demande « la récognition d’une action ou d’une position d’arrière-plan où se place l’action pertinente ».
Toutefois, pour employer un “impératif” modal, il faut que je reconnaisse l’objet comme une personne (quelqu’un qui fait quelque chose, ou qui est dans une certaine position) et je fais appel à son caractère raisonnable (à sa raison) en utilisant la deuxième personne. (…) C’est une des raisons pour lesquelles les commandements, les purs impératifs, loin d’être les paradigmes de l’énoncé moral, en sont les rivaux[27].
Ils sont justement rivaux, car les « purs impératifs » ne m’engagent pas. Ils n’ont pas de « tu » (dois), ils ne me visent pas personnellement (en tant qu’être raisonnable). Ma responsabilité n’est pas mise en cause, il n’y a donc pas de dimension « morale » (ou éthique) dans ce cas-là, ou du moins, la question (peut) se pose(r).
La question de la responsabilité.
Mais de quelle responsabilité suis-je donc le sujet quand je communique ? De quelle manière ma parole m’engage-t-elle ? Par ma parole, en disant et par le fait de dire, j’agis. « Discuter ensemble, c’est agir ensemble ». J’ai donc une responsabilité dans ce que je dis, par le fait de le dire ; j’en suis imputable, de la même manière que je suis imputable de ne pas avoir fait (ou d’avoir mal fait) quelque chose que je devais (que j’avais l’obligation de) faire. Les excuses sont révélatrices de ce fait. Et comme le souligne Cavell :
Ce dont nous avons l’obligation, c’est d’éviter de faire quelque chose en un temps et lieu, ou d’une manière, qui ait des chances d’aboutir à quelque malheur, ou d’éviter d’être négligent dans les cas où il est facile de l’être, ou d’être particulièrement prudent dans les cas où l’action est dangereuse ou délicate, ou d’éviter la tentation de sauter une étape nécessaire quand sur le moment elle semble ne pas faire grande différence. Si pour toutes les excuses il y avait des obligations pertinentes, alors il n’y aurait pas d’excuses et l’action deviendrait intolérable[28].
Inversement, nous devons ajouter que si tout était excusable, il n’y aurait pas de morale. Il y a des choses à faire et d’autres à ne pas faire, sans quoi nous ne pourrions pas comprendre ce phénomène (récurrent) que sont les excuses. Mais comment savons-nous ce qui doit être fait ou non et surtout comment cela doit être bien fait, c’est-à-dire comment ne pas être imputable ? Pour montrer cela, Cavell a recours à une situation où l’on joue à un jeu de cartes, et souligne que « bien jouer » est affaire de (bonne) stratégie, que cela relève des principes que l’on adopte.
On pourra éclairer cette différence en considérant une des manières dont les principes diffèrent des règles. Les règles vous disent quoi faire quand vous faites simplement la chose ; les principes vous disent comment faire la chose bien, avec habileté ou compréhension. […] Les principes vont avec la compréhension. (Avoir une compréhension d’un jeu, ce n’est pas connaître ses règles.) […] Comprendre un principe implique de savoir comment l’appliquer et où[29].
Les principes nous sont des maximes personnelles, car ils vont avec notre compréhension. Cette compréhension relève du domaine du « savoir-faire », qui nous l’avons vu avec l’enfant, fait partie de l’apprentissage du langage, de notre forme de vie. Nous apprenons à jouer à un jeu et pour cela, connaître les règles ne suffit pas. Il faut en faire l’expérience, y jouer – le pratiquer – et ainsi nous comprenons ce qu’il nous faut ou faudrait faire et quand. Et nous pouvons apprendre un nouveau jeu sans jamais apprendre ou formuler ses règles[30], mais jamais sans en avoir acquis la maîtrise, ou si on veut, le « concept de jeu ». Comprendre, c’est savoir appliquer (savoir faire), mais l’appliquer d’une manière appropriée au moment opportun. Il faut « la récognition d’une action ou d’une position d’arrière-plan où se place l’action pertinente » et cela s’apprend. Pour cela on peut être guidé, par exemple quand on nous indique que l’on devrait faire une chose à ce moment-là, ou qu’il faudrait la faire à ce moment-là.
Mais « Me dire ce que je dois faire n’est pas la même chose que de me dire ce qu’il faudrait que je fasse ». […] À la différence de “dois”, “il faudrait” sous-entend qu’il existe une autre solution ; “il faudrait” sous-entend que, si vous le voulez, vous pouvez faire autrement. Ceci ne veut pas dire simplement qu’il y a en votre pouvoir une autre chose à faire mais qu’il y a une autre chose à faire comprise dans le cadre de vos droits »[31]. Il nous faut souligner, dans ce parallélisme, deux choses sur cette différence de mode (et de modaux).
(1) Il est notable que les modaux (be supposed to, can, should, etc.) sont inséparables d’un verbe que justement ils caractérisent. Ils ne sont pas à proprement parler prescriptifs, mais ils sont révélateurs en tant qu’ils posent « une action qui est préalablement pertinente à ce que nous sommes en train de faire ou à ce que nous sommes – pour la poser de façon pertinente dans le contexte plus vaste de ce que nous sommes en train de faire ou de ce que nous sommes »[32]. Le problème réside ici dans la capacité que nous avons à apprécier la pertinence. Par capacité, j’entends à la fois une aptitude à juger : juger si nous en avons les moyens, si nous avons tous les éléments pour évaluer une situation, et si nous sommes en position de juger, si nous avons l’autorité pour dire « il faudrait » ou « tu dois » faire cela à quelqu’un. Il s’ajoute à cela, la possibilité à faire cela dans le monde. On ne peut pas forcément accomplir ce qui est dans nos droits.
(2) « Tu dois » exprime une « nécessité forte », alors qu’ « il faudrait » est comme une forte recommandation ; en tant que tel, l’énoncé ne m’oblige pas (il lui manque l’adresse, le « tu »[33]). Si j’ai emprunté de l’argent, « je dois » le restituer. Il le faut ou le faudrait (la convention veut que…), mais surtout je le lui dois (moi, en tant que sujet m’étant engagé dans cet échange), ce n’est pas quelque chose de conditionnel, j’y suis proprement obligé sous peine de poursuites, de forte déception, d’y perdre la face, etc. Et ici, toute la différence entre faire la chose et bien la faire se résume dans la manière dont nous l’accomplissons : si je rends cet argent avec du retard, par exemple, je ne fais qu’accomplir l’action[34]. Et l’on peut alors dire que j’ai manqué (de) quelque chose, de tact par exemple. Il manque quelque chose dans la manière spécifique dont je suis en train de faire l’action. C’est ici que la distinction entre principe et règle prend tout son relief.
Cavell souligne que « Les règles qui constituent le fait de jouer à un jeu, ainsi que les «règles» ou maximes qui contribuent au fait de bien jouer, ont leurs analogues dans la conduite morale ordinaire »[35]. Même si cette analogie est décriée, elle est méritante car le concept de règle éclaire bien le concept d’action. Cela ne veut pas pour autant dire que les règles nous disent ce que c’est qu’une action justifiée.
Dans le cas où il y a question sur ce que je fais, et que je cite une règle en ma faveur, ce que je fais c’est expliquer mon action, clarifier ce que je faisais, mais pas la justifier, dire que ce que je faisais était bien fait ou fait à juste titre. Dans le cas où mon action est en accord avec les règles pertinentes, elle n’a pas besoin de justification[36].
On ne trouve jamais rien à redire à une action réussie (heureuse), car justement, elle est réussie, elle répond à ce qui était attendu. Mais « citer une règle en sa faveur » n’est pas justifier son action, pour cela il nous faudrait invoquer des principes (qui mettent en jeu la pertinence de ce que je fais). Suivre une règle ne suffit pas, il faut qu’elle soit suivie dans un cadre de pertinence pour l’action que je suis en train de faire, et cela nécessite des principes. Il y a donc bien une pertinence à l’analogie. Néanmoins, « Ceci ne veut pas dire que promettre c’est (seulement) suivre des règles. Pourtant si quelqu’un a la tentation de ne pas tenir sa promesse, il se peut que vous disiez : “On tient ses promesses” ou “Nous tenons nos promesses (voilà ce que c’est qu’une promesse)”, en employant ainsi une description-règle – ce que j’ai appelé un déclaratif catégoriel. Il se peut que vous disiez : “Vous devez tenir cette promesse” (vous sous-estimez son importance ; la dernière fois, vous aviez oublié). Ce n’est pas la même chose que “Il faudrait que vous teniez cette promesse”, qui n’est raisonnable que dans le cas où vous avez une raison de la rompre assez forte pour vous permettre de le faire sans être blâmé (il y a une vraie alternative), mais où l’on vous enjoint de faire un effort ou un sacrifice particulier »[37]. « Il faudrait que vous teniez cette promesse », sonne faux, car cela soutient une mauvaise conception de ce qu’est une action. « Il faudrait » sous-entend que l’on peut toujours s’en excuser de le faire et a contrario que « tenir sa parole » est faire une bonne action. Or promettre, c’est s’engager (engager sa parole). Il y a bien des modalités du bien faire, par exemple si je promets de faire le ménage, mais que je ne le fais qu’à moitié ; mais avoir fait le ménage n’est pas une bonne action en tant que telle : je l’avais promis.
Tout ce que l’on peut retenir de ce parallélisme entre « il faudrait » et « (tu) dois » est qu’il sont analogues dans la mesure où ils demandent un arrière-plan d’action ou de position sur lequel est située l’action en question ; et comme “devoir”, “il faudrait” ne forme pas un commandement, un impératif pur. Toutes choses qui montrent à quel point parler, de manière générale, de “normativité” des expressions est sans espoir ». Sans espoir parce que sans la connaissance des circonstances de l’action et la position (l’autorité) du sujet énonciateur, nous ne pouvons pas nous prononcer. Et justement, « il faudrait » et « devoir » sont asymétriques parce que le premier provient d’un point d’énonciation assez neutre, alors que « tu dois » est proprement une obligation qui me vise, qui fait appel à moi, qui me rappelle mes obligations (préalablement prises). Lorsque nous discutons, nous agissons, et dans ce dire nous effectuons des actes qui nous engagent d’une manière analogue à celle où nous agissons. Le langage est performance, et ce faisant il m’engage, et j’y suis engagé. Et lorsqu’on me dit « tu dois », on me rappelle cette normativité du langage. C’est pourquoi :
La signification des déclaratifs catégoriels se trouve dans le fait qu’ils nous apprennent ou nous rappellent que les “implications pragmatiques” de nos énonciations sont des choses que nous voulons dire (ou, si nous avons envie de contredire, ou de parler inconsidérément, ou bien si cet effort pour être honnête nous irrite, disons : des choses que nous devons vouloir dire) ; le fait qu’elles constituent une partie essentielle de ce que nous voulons dire quand nous disons quelque chose, une partie essentielle de ce que c’est que vouloir dire quelque chose. Et ce que nous voulons dire (ce que nous avons l’intention de dire), comme ce que nous voulons (avons l’intention de) faire, c’est quelque chose dont nous sommes responsables[38].
Pour apprécier cette conclusion, il nous faut approcher de plus près le problème que pose la fonction de l’« intention » dans ce que nous disons.
Delphine Dubs (Université Paris 1, Phico-Execo)
Suite de l’article.
[1] Cf. « la critique de la critique » https://www.implications-philosophiques.org/implications-du-langage/ordinaire/le-fondement-rationnel-de-la-philosophie-du-langage-ordinaire/
[2] Jacques Bouveresse, Le Mythe de l’intériorité. Expérience, signification et langage privé chez Wittgenstein, 1976, Paris, Les Éditions de Minuit, 1987, p.704.
[3] Question qui a eu le mérite d’être posée (et traitée) par Jérôme S. Bruner, (Le développement de l’enfant : Savoir Faire, Savoir dire, Paris, PUF, 1983.) et qui pourrait se présenter comme une reprise de certains apports austiniens.
[4] L’exemple est de Wittgenstein, Le Cahier bleu et le cahier brun, 1958, trad. M. Goldberg & J. Sackur, Paris, Gallimard, 1969, p. 159.
[5] Stanley Cavell, « Kierkegaard : le livre sur Adler », in Must We Mean What We Say ?, [MWM], 1969, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, (trad. C. Fournier & S. Laugier, Dire et vouloir dire, Paris, Cerf, 2009), p. 164. Toutes les références à MWM renvoient à la pagination originale.
[6] Wittgenstein, Leçons et conversations sur l’esthétique, la psychologie et la croyance religieuse, Paris, Gallimard, 1971, p.16.
[7] Jacques Bouveresse, op. cit., p. 702.
[8] Il présente la grammaire de la notion de règle et pour cela, imagine des jeux de langage, comme le jeu « la Damoiselle ».
[9] Stanley Cavell, « Must We Mean What We Say? », op.cit., p.21.
[10] Gilbert Ryle, « Ordinary language », 1953, in V. C. Chappell, dir., Ordinary Language, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, Inc., 1964, pp.29-31.
[11] Cavell, Ibid., p.22.
[12] Ibid., p.32.
[13] Ludwig Wittgenstein, §124 des Recherches philosophiques, op. cit., p.87.
[14] Cavell, « The Availability of Wittgenstein’s Later Philosophy », op. cit., p. 56.
[15] Ibid., p.23.
[16] John Langshaw Austin, Quand dire, c’est faire, op. cit., p. 59.
[17] Cavell, Ibid., p. 23.
[18] Et non pas « se renvoyer mutuellement des mouvements et des bruits, transmettre des messages ou des essences indicibles de l’intérieur d’une cellule fermée à l’intérieur d’une autre cellule fermée ». p. 33.
[19] Ibid.
[20] Ibid. p.24.
[21] Elle relève du « concept d’air de famille ».
[22] Soulignons que Cavell tout au long de cet article s’appuie et discute le « Plaidoyer pour les excuses » d’Austin.
[23] Ibid. pp.24-25.
[24] Ibid. p.25.
[25] Ibid. p.25.
[26] Cavell prend pour exemple « Open, Sesame ! » («Sésame, ouvre!») et «Tu dois t’ouvrir, Sésame», qui ne portent pas sur une personne. Mais j’aimerais considérer ici le soldat à qui on dit « garde à vous !» comme « un objet » et non pas un homme, en tant que dans le cadre de l’armée, la soumission est acceptée, lorsque le soldat s’y engage (volontairement) et qu’il sait à quoi il s’engage. Il me semble que le problème moral souligné par la suite se pose, en témoignent les « justifications » des généraux nazis face aux accusations : « ils n’ont fait que suivre des ordres », de ce fait leur responsabilité n’était pas engagée.
[27] Ibid. p.31.
[28] Ibid. p.26.
[29] Ibid. pp.28-29.
[30] Cf. Ludwig Wittgenstein, Recherches philosophiques, op. cit., § 31.
[31] Cavell, Ibid. p.28.
[32] Ibid. p.27.
[33] Que l’on trouve dans « il faudrait que tu fasses » qui est plus « fort » « qu’il faudrait faire », mais moins que « tu dois ».
[34] Mais si cette nécessité est contraignante, il se peut que je ne puisse pas remplir à mon obligation, et ce de manière justifiée. Par exemple, si la personne à qui je dois de l’argent me l’offre, ou encore la question se pose si elle meurt entre-temps, ou si je meurs… Les vicissitudes du monde font qu’accomplir cet acte ne dépend pas que de moi.
[35] Ibid. p.29.
[36] Ibid.
[37] Ibid. p.30.
[38] Ibid. p.32.








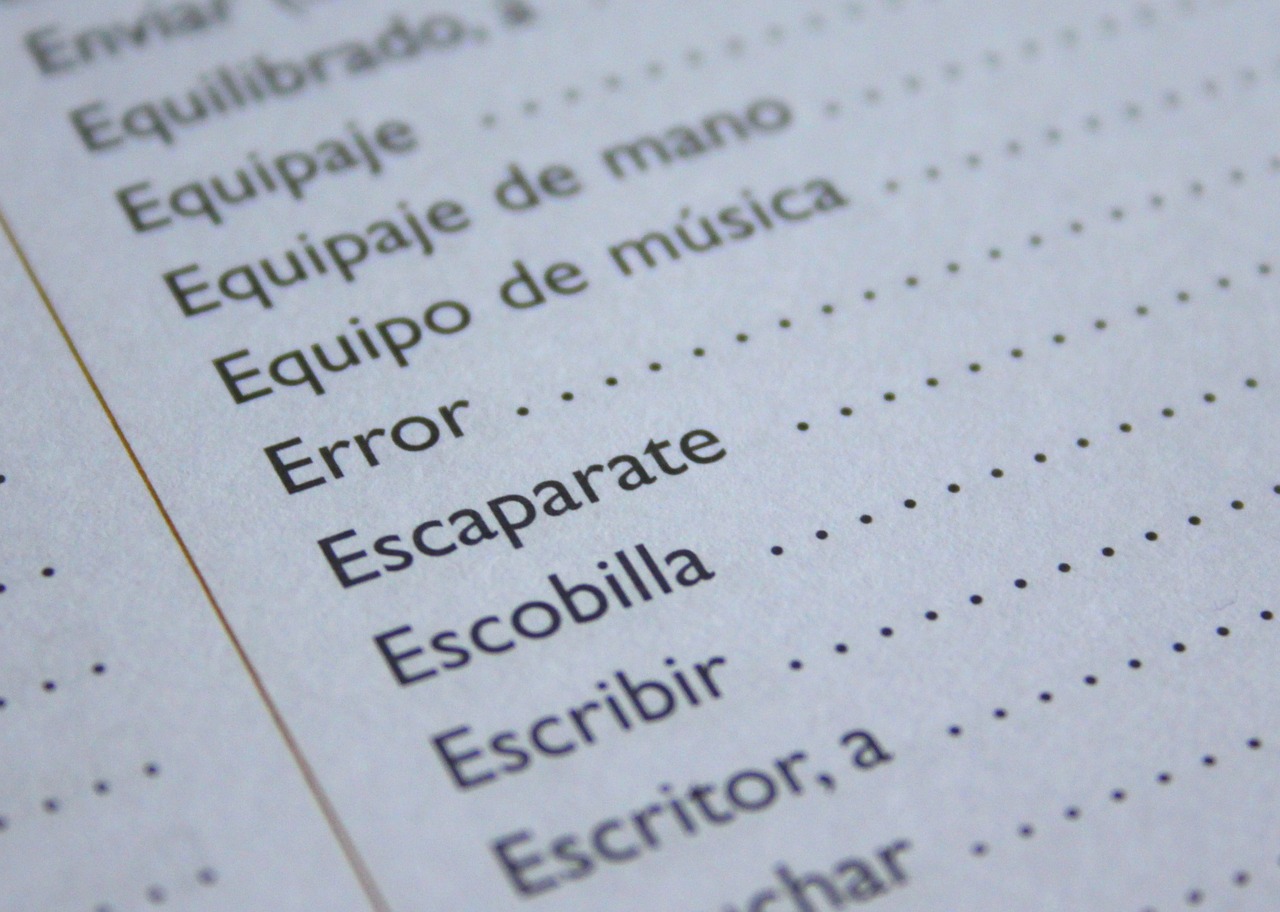


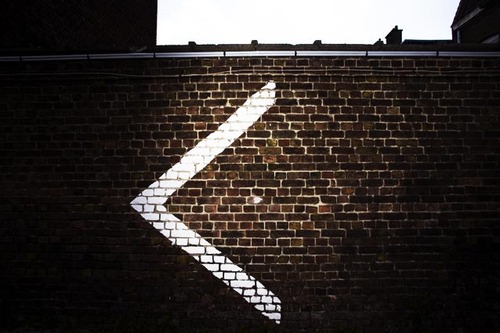
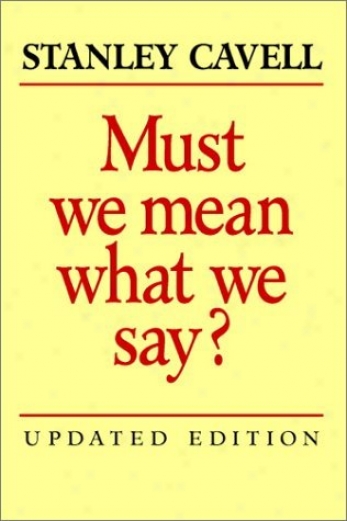

comment se fait-il que personne ne parle des mauvais doublages en français qui ridiculisent les dialogues originaux ? Peut-être que cela fait partie du mauvais goût des amateurs de série.