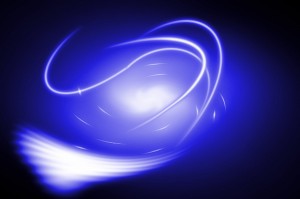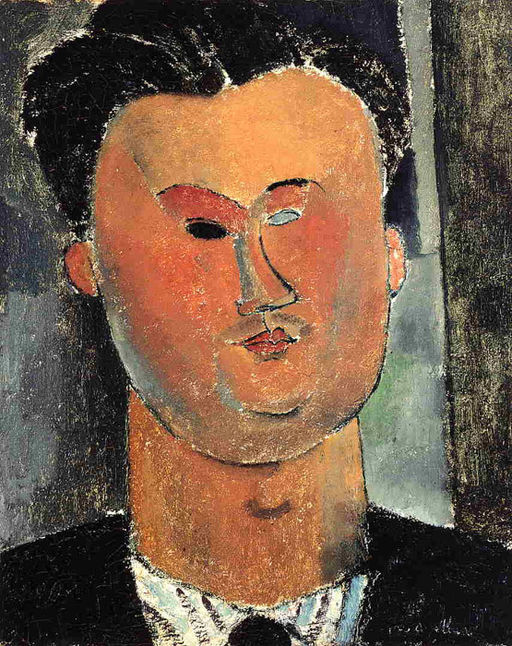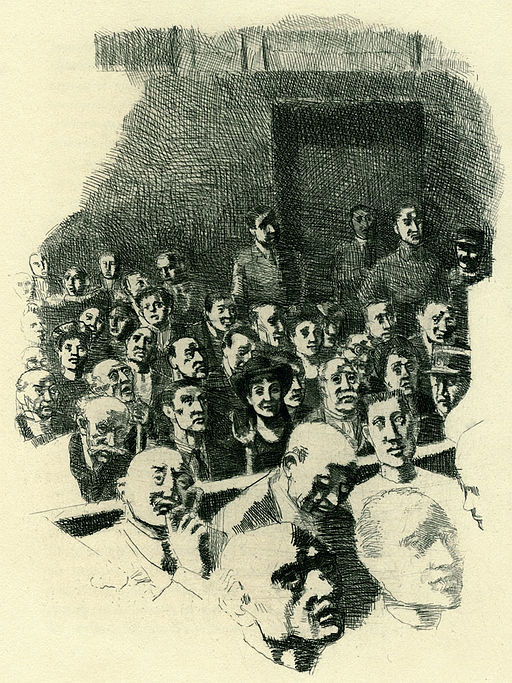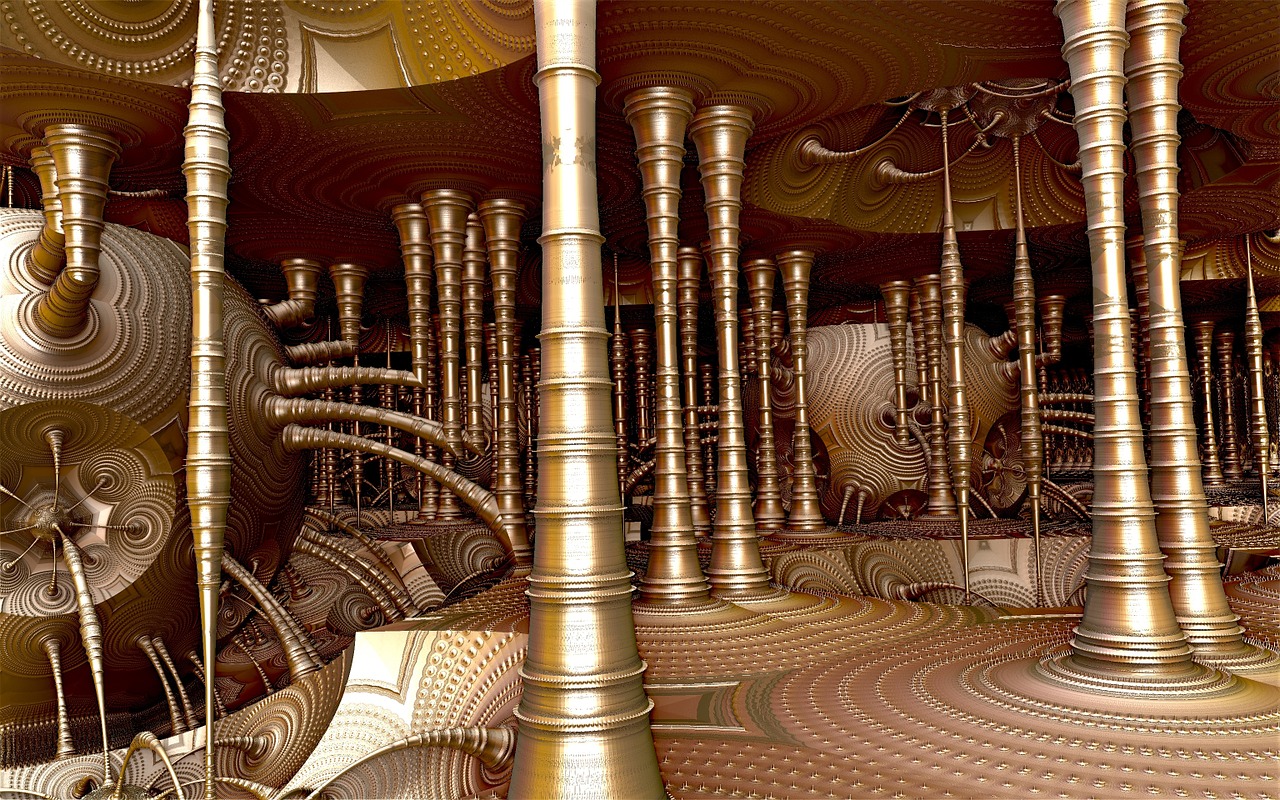Un saut vers la communauté. Traces existentielles dans La Horde du Contrevent
Colin Pahlisch, doctorant en littérature à l’Université de Lausanne.
Résumé : Quelles sont, aujourd’hui, les créations littéraires qui prennent encore part au questionnement et à la lutte contre l’absurde ? Le présent article tente de répondre à cette question en proposant une lecture philosophique d’un roman contemporain, d’une fiction-fleuve : La Horde du Contrevent d’Alain Damasio. Il s’agira tout d’abord d’élucider les rapports que l’intrigue de ce roman entretient avec la pensée de l’absurde. Nous nous pencherons ensuite sur la manière dont ce texte prolonge et approfondit les jalons posés par Albert Camus dans Le Mythe de Sisyphe, notamment au travers de la question de l’altérité. Cette étude se conclut sur la proposition d’une conception spécifique du rapport communautaire, sous la forme d’un « saut », fondée sur le dénouement du récit épique damasien, et en référence à la notion existentielle convoquée par Kierkegaard.
Abstract: Is literature still interrogating the absurd? In which of its productions does it so, and by which means? This contribution analyses the representation and treatment of this philosophical notion in a contemporary French novel: Alain Damasio’s La Horde du Contrevent. First, we elucidate the means by which the fiction illustrates the aspects and dilemmas that are the ones of Camus’s existential conception. Then we focus on the perspectives that the author develops in order to further and deepen the philosophical reflexion conducted by the existentialist writer. This very perspective, as we show, is related to the elaboration of social relations, more specifically to the question of community. Finally, this article suggests to consider the creation of a community as a “leap”, both in reference to Kierkegaard’s term and to the final twist of Damasio’s novel.
…ceux qui, sans conclure, interrogent toujours.
Albert Camus, Le mythe de Sisyphe
L’absurde nous est-il encore contemporain ? Poser cette question, c’est d’abord s’inscrire dans une lignée qui, de Schopenhauer et Rensi, remonte par méandres vers Cioran, jusqu’au fameux Mythe de Camus. C’est, surtout, interroger la possibilité pour un tel concept de déborder le cadre premier de sa diffusion. Si le contexte intellectuel et politique français de l’Occupation et de l’après-guerre s’est révélé particulièrement propre à la réception de cette notion, il semble légitime, au vu de la portée quasi universelle que lui prêtait son auteur[1], de se pencher sur sa postérité. Quelles écritures contemporaines cherchent encore à suturer cette déchirure qui sépare « l’homme et son décor » ? Qui sont, aujourd’hui, les artistes et les penseurs dont les œuvres s’édifient encore aux pieds des « murs absurdes » ? Où chercher ces invaincus qui, « sans conclure interrogent toujours », et dont il convient de « faire la part »[2] ? C’est sur l’une de ces « interrogations » que cet article portera. Il sera ici question du travail d’un romancier actuel, Alain Damasio, et plus particulièrement de son dernier opus original, La Horde du Contrevent[3], couronné en 2006 par le Grand Prix de l’Imaginaire. Nous nous proposons d’étudier ce texte au cordeau de la pensée de l’absurde. Nous observerons par quels moyens narratifs et stylistiques l’auteur parvient à rendre compte des enjeux principaux de cette pensée et à renouveler, peut-être, la vigueur des questionnements auxquels celle-ci nous invite.
Précisons, en préambule, que notre propos n’est pas très éloigné d’une réflexion touchant aux genres littéraires. Au-delà des catégorisations, la science-fiction, à laquelle appartient ce texte, apparaît comme un terreau particulièrement propice à accueillir et à permettre la croissance d’une pensée de type philosophique. Certains procédés inhérents à cette forme de création littéraire se révèlent en effet une incitation forte à la gymnastique de l’intellect ou au « façonnement de concepts[4] », comme le formulerait Gilles Deleuze. L’historien des idées Marc Angenot, souligne en effet que la particularité de la SF tient au fait qu’elle instaure un rapport au lecteur bien spécifique fonctionnant sur un principe narratif qu’il nomme « paradigme absent »[5]. Pour le critique, toute littérature fait appel chez le lecteur à la connaissance de certains codes qui s’illustrent, dans la lecture, au plan de la sémiotique. C’est sur une certaine complicité entretenue par les termes déictiques et les noms contenus dans le récit avec une réalité connue que peut se fonder la vraisemblance entre le texte de fiction et la réalité. Cette complicité contribue à renforcer également l’accord ou le « pacte » passé par le lecteur envers le texte. Ainsi nous prêtons d’autant plus de crédit aux observations du narrateur proustien que celles-ci se déroulent dans des lieux dont la consonance francophone semble vraisemblable. Nous n’avons aucune peine à croire que le hameau de Combray abrite la maison de la tante Léonie ou qu’une station balnéaire huppée de Bretagne porte bien le nom de Balbec, précisément parce que ces noms eux-mêmes renvoient le lecteur à une réalité connue. Le paradigme qui soutient l’expérience de lecture puise sa vraisemblance dans un horizon d’attente réaliste : nous cherchons, à partir des éléments d’un réel connu, à combler les inévitables brèches que l’imaginaire de l’auteur laisse en friche dans le texte de fiction. Or Angenot précise que la spécificité de la science-fiction tient en ce que ses mécanismes de référence s’articulent sur un paradigme absent. L’inexistence concrète d’univers connu censé soutenir la lecture entrave la possibilité pour le signe de s’ancrer, même partiellement, dans une réalité tangible.
Le récit qui en est offert appelle lui-même une lecture de type conjectural : le lecteur n’applique pas au récit des paradigmes préexistants dans le monde empirique et dans ses connaissances langagières, il présuppose une intelligibilité paradigmatique du texte laquelle est à la fois illusoire et nécessaire[6].
Cette absence d’appui empirique place le lecteur devant une exigence aussi jouissive que libertaire. C’est à lui qu’échoit la nécessité de créer le monde dans lequel se déroule le récit, de le peupler par ses propres images, ses références intimes. Le paradigme absent à partir duquel s’élabore tout texte de SF a pour effet de radicaliser la créativité que requiert le pacte de lecture. Ce faisant, et pour recentrer le propos sur notre sujet, il offre également à la réflexion philosophique un terreau d’une fertilité rare. Tout autant qu’à l’imagination, avec laquelle certains penseurs lui trouveraient par ailleurs des connivences vives, le texte enjoint au déploiement de la spéculation philosophique. Le caractère « irréaliste » du récit science-fictionnel fournit un tremplin aux expériences de pensée de toute sorte. Lavé du verni de la vraisemblance, le texte de science-fiction peut laisser se développer, peut-être plus librement que tout autre, les élans de la pensée. Dans cette perspective, nous aborderons l’intrigue avant tout comme une matière à penser, sans pour autant négliger les éléments proprement poétiques qui l’animent. Nous espérons, en ceci, être fidèle aux mots d’Albert Camus selon lesquels : « On ne pense que par images. Si tu veux être philosophe, écris des romans »[7]
La Horde initiatique
La Horde du Contrevent peut être lu comme un roman initiatique de l’absurde. L’action se déroule dans un monde constamment balayé par le vent. L’auteur situe l’origine intertextuelle de cette idée dans une nouvelle de Ray Bradbury intitulée « La Pluie », racontant le combat que quatre terriens mènent, sur Vénus, pour échapper à cet élément déchainé. Le monde possible dans lequel prend place le récit d’Alain Damasio se trouve donc divisé en deux pôles : l’Extrême-Aval et sa capitale, Aberlaas, où aboutit le souffle des vents, et l’Extrême-Amont, origine supposée de la houle. Depuis des siècles, vingt-trois intrépides sont sélectionnés à Aberlaas afin de remonter le cours du vent vers l’Extrême-Amont pour en découvrir l’origine. Cruciale entre toutes, cette élucidation devra permettre la compréhension de la cosmogonie globale qui a donné au monde dans lequel se déroule le récit sa forme, et offrir un but et un sens à la vie des hommes qui la peuplent. Cette tâche porte un nom : « remonder » c’est-à-dire remonter le cours du monde. Elle est celle que se sont justement jurés de poursuivre les compagnons de La Horde du Contrevent, 34e et sans doute dernière du nom. L’intrigue à laquelle nous convie le récit semble présenter, même brossée ainsi à gros traits, au moins deux connivences majeures avec la pensée de l’absurde. En premier lieu, elle s’articule toute entière autour d’une quête de sens. La découverte de l’origine du vent à laquelle le périple des protagonistes se veut voué ne vise pas seulement à établir une meilleure compréhension topographique du monde dans lequel ils progressent. Elle contient dans le roman l’ambition d’une explication plus vaste, touchant à la signification de leur présence au monde. Le voyage qui modèle l’intrigue se révèle guidé par une volonté de réconciliation, entre connu et inconnu (Aval et Amont), entre les doutes, les angoisses du soi, et la révélation de son utilité ou de son rôle attendu dans le monde. Selon cette optique, la « trace » que le trajet des hordiers file entre les deux extrémités de leur terre peut être appréhendée comme l’illustration d’une tentative d’unification ou de totalisation des sources de savoir disparates et lacunaires qui composent la connaissance et la signification de leur environnement. L’individualité de chaque protagoniste constitue également le terrain de cette recherche de connaissance. Le lecteur apprend en effet dès son entrée dans le texte que le vent et l’être ne font qu’un. Le livre s’ouvre par la mention d’une phrase que l’on peut attribuer au troubadour Caracole (en témoigne le sigle caractéristique qui l’accompagne[8]) : « Nous sommes faits de l’étoffe dont sont tissés les vents ». L’emplacement de cette phrase dans le péritexte indique sa fonction de cadre pour l’ensemble du récit. L’usage de la deuxième personne du pluriel souligne, par ailleurs, le rôle personnalisant de cette assertion vis-à-vis du lecteur, comme des personnages du roman. La quête de sens entreprise par les hordiers les implique ainsi eux-mêmes. Chacun d’entre eux est le terrain de sa propre découverte, l’objet de sa recherche intérieure. Le monde dans lequel se déploie la course des héros apparaît ainsi non seulement comme le reflet, mais encore comme une perpétuelle et exigeante incitation à cette introspection subtile. Le lien avec l’absurde nous semble se faire jour ici par le biais du caractère essentiellement intime de la révélation décrite par Camus, de même que sa manifestation sous la forme d’une quête de sens, d’un appel éperdu adressé au « silence déraisonnable du monde[9] ».
Notons de plus que le choix du registre initiatique n’est pas sans effets sur la mise en valeur de la teneur philosophique du roman. Le recours au motif de la quête, ainsi que la mise en place de techniques narratives propres au genre initiatique, favorise ce type de lecture. Selon Xavier Garnier, le propre d’un tel récit consiste en effet à placer ses personnages dans un univers à la topographie volontairement rudimentaire et incertaine (la brousse par exemple, concernant les récits africains) afin de centrer l’attention du lecteur sur le protagoniste et de faciliter son identification à celui-ci. Dans un tel cas, c’est la transformation individuelle du héros au fil de ses aventures qui constitue l’enjeu véritable de la narration :
« On pourrait précisément définir le récit initiatique comme un récit en attente de personnage, ou plutôt comme un récit tendu vers la constitution d’un personnage. Le héros de récit initiatique est une entité préindividuelle engagée dans un processus d’individuation[10]. »
Tout événement appelé à survenir dans le récit participe dès lors à cette mutation individuelle. Rien n’est laissé au hasard. De même dans La Horde chaque obstacle surmonté sur le chemin de l’Extrême-Amont, parfois au prix de la vie d’un ou de plusieurs membres du groupe, se révèle l’occasion d’affiner la recherche de sens entreprise par les hordiers. Lorsque le scribe Sov Strochnis (dont le rôle se révèlera, nous le verrons, d’une importance considérable au terme du récit) assiste par exemple à la mort de l’un de ses compagnons avalé par un siphon, l’expérience douloureuse du deuil donne lieu à une réflexion profonde touchant son rapport au groupe comme sa formation individuelle.
Après la mort de Sveziest, je m’étais juré ça : de ne plus jamais oublier qu’ils pourraient ne plus être là demain. Les conséquences de ce petit serment furent prodigieuses pour l’acuité avec laquelle je recevais ce qu’ils étaient. Je découvris une nouvelle intensité – celle que la conscience effilée d’être accoudé chaque jour au parapet branlant de la mort donne[11].
Le recours au genre initiatique renforce donc l’intimité du rapport au lecteur, et de même réaffirme à chaque étape de la narration, l’importance de la recherche de sens. Mais c’est davantage au travers des formes que prend cette recherche que le récit nous semble transcrire de manière la plus vive sa relation à la pensée de l’absurde. La poursuite de l’origine du vent comme explication totalisante du sens du monde revêt, jusqu’à l’arrivée du groupe en Extrême-Amont, un aspect essentiellement idéologique. L’aboutissement de la quête est perçu par les hordiers comme une apothéose flamboyante, révélation quasi mystique des énigmes du cosmos.
Trouver l’origine. Si on la trouve, tous nos vœux seront exaucés. On sera au paradis, avec plein de fruits partout sur les arbres, des animaux tout rond et doux, et puis on pourra libérer le monde, arrêter le vent peut-être, le mettre dans des sacs et des outres, l’apprivoiser[12] !
Les rêves et fantasmes naïfs énoncés ici par la jeune Coriolis indiquent bien la nature téléologique et presque religieuse du rapport qui relie les hordiers à leur mission. Sans doute ce voile d’images enchantées, de rêves idylliques, que l’esprit applique sur le réel n’est-il pas éloigné du « sommeil nécessaire à la vie » dont, précisément, l’absurde nous prive selon Camus[13]. Un tel réflexe n’est pas non plus étranger à cette « altération optimiste de la réalité » dont Giuseppe Rensi dénonce les incohérences dans sa Philosophie de l’absurde : « Les hommes sont, le plus souvent, obstinément et incorrigiblement optimistes. Un puissant instinct de vie et de bonheur les empêche de garder les yeux ouverts sur leurs douleurs et leurs peines[14]. » Or, comme le rappelle encore Camus : « Il arrive que les décors s’écroulent[15]. » Cet écroulement est également mis en scène dans le roman. Au terme de leur course et au prix de nombreuses pertes humaines, les héros de la Horde parviennent en Extrême-Amont : c’est une plaine grasse et nue, une lande verte, délimitée par un gouffre baigné de brumes. Ni fruits ni animaux, les hordiers n’y trouvent qu’eux-mêmes, encore, et encore cette rudesse inhérente à leur terre. Dépourvus d’appuis, leurs vibrants espoirs s’envolent. Bien vite, les lambeaux restants du groupe décimé se rendent à l’évidence et Oroshi, l’aéromaître, de lancer au scribe : « Il n’y a pas d’Extrême-Amont, Sov[16]. »
La désillusion et la violence que ressentent les protagonistes peuvent être directement rattachées aux remarques de Camus. L’inexistence de l’Extrême-Amont constitue bien une traduction narrative de la révélation absurde décrite par le philosophe. Le passage suivant, illustrant le désarroi du scribe, nous semble représentatif de cette communauté de vues.
Pendant quelques minutes, je ne sus que pleurer, sans que je puisse m’avouer, face à face avec moi, si ces larmes coulaient de l’orgueil démesuré de notre conquête, jamais égalée par aucune horde […] ou si c’était ma conscience, une maturité seconde, plus récente et plus sûre, qui face au gâchis, au dérisoire désormais manifeste de notre quête, effondrait une par une toutes les statues héroïques par-devers moi édifiées, pour ne laisser devant que cette mer blanchâtre et cette mer métallique, qui pouvaient aussi bien être celui du ciel archi-connu, que la teinte d’un cosmos neuf[17].
C’est bien une forme de lucidité qu’engendre la déception relative à l’absence d’Extrême-Amont. Elle met au jour le prétexte que masque l’adoption d’un sens appelé à guider les existences individuelles, à fournir de l’épaisseur à leurs actions (ici, déceler l’origine du vent) : celui de continuer à vivre. Placés côte à côte, tous les prétextes se valent. Ainsi, pour paraphraser un autre penseur Français : « Chacun est renvoyé à soi. Et chacun sait que ce soi est peu[18]. » La plus grande épreuve reste donc à venir pour les hordiers. Un a un, ils font face à la plus pernicieuse forme du vent, la neuvième, définie par l’aéromaître comme « l’envers de la quête ».
Elle est ce que vous avez fui et conjuré, à force d’énergie et de combats, votre vie durant […]. La neuvième est la mortalité active en chacun, à chaque âge de l’existence. Je ne parle pas ici de la déchéance de nos corps ni de l’entropie qui nous dégrade, non : plus simplement d’une forme puissante de la fatigue[19].
Le péril que cette « fatigue » intérieure fait courir aux individus qui composent le groupe se traduit dans le texte par la tentation de la mort volontaire. En réalisant que leur quête était vaine, chaque membre de la Horde se trouve ramené à la vacuité, au caractère irréductiblement personnel et infondé de leurs espérances. L’aboutissement de leurs aventures révèle dans toute sa nudité l’inconsistance tangible de l’acte d’espoir. Rensi propose par ailleurs de faire de l’acceptation de cette terrible irrationalité l’un des socles de la philosophie absurde. Il précise dans son ouvrage, en pessimiste avoué : « L’espoir est une induction qui, à partir de ce qui n’est pas, conclut que ce qui n’est pas sera, et à partir de ce qui n’a pas lieu conclut que ce qui n’a pas lieu aura lieu[20] ». Le suicide apparaît donc bien comme le nerf ou la ligne de fuite du questionnement philosophique posé par le récit. Le dépouillement dans lequel la faillite téléologique et métaphysique de leur entreprise abandonne les protagonistes aboutit au choix cornélien qui guide la perspective camusienne dès le mythe de Sisyphe : « Faudrait-il mourir volontairement ou espérer malgré tout[21] ? » Dans le roman, seul le scribe acceptera ce « malgré tout ». Ultime survivant après que ses compagnons aient succombé de manière flamboyante ou pathétique à leur « mortalité active[22] », Sov se voit longuement tenté par le suicide, longeant la falaise, parcourant l’arête jour après jour, se forçant à ne pas y deviner une issue salvatrice.
Il n’y avait plus rien ni personne en moi, aucun son ni onde, une coque vide enfilée sur une vertèbre, moins que ça, la chute devant, coulante et facile, juste relâcher la colonne, coulisser de l’échine, s’affaisser un peu, partir enfin. Rejoindre le matelas des nuages… Rejoindre Oroshi[23]…
Aux prises avec sa « neuvième forme », balançant entre une vie qu’aucune idée ne suffit plus à légitimer et un néant incontournable, le scribe de la Horde endosse au terme du roman la situation de l’homme absurde. En faisant tout autant du vent l’élément configurateur de la topographie et des caractères, Alain Damasio enjoint son lecteur à lier, d’un même élan imagé, les hommes à la terre qu’ils habitent, à ses changements, nourriciers ou destructeurs. La vérité philosophique que ce stratagème narratif permet d’amener à la conscience puise sans doute sa force et sa vivacité à la source de ces « vérités métaphoriques » qui témoignent, selon Paul Ricoeur, du « pouvoir de certaines fictions de redécrire la réalité[24] ».
À ce stade de notre propos, nous espérons avoir pu poser les jalons d’une lecture de La Horde du Contrevent sous l’angle d’une initiation à l’absurde. Une telle lecture permet d’insérer le texte dans la veine des fictions contemporaines qu’imprègne encore la pensée de l’absurde. L’auteur s’exprime par ailleurs sur le rôle que son travail romanesque poursuit vis-à-vis de la philosophie : « Pour moi, les plus beaux moments d’un livre sont ceux où une idée philosophique a priori très abstraite prends corps et devient ressentie[25]. » Cependant, si le dilemme inhérent à la condition de l’homme absurde est fait corps avec le lecteur par la désillusion qu’entraîne l’absence de but pour la quête et la tentation du suicide qui tenaille le scribe, le récit avance-t-il des solutions ? Le texte ménage-t-il dans sa trame des échancrures par lesquelles s’engouffrerait l’espoir, ou tout au plus, les raisons de vivre ? Peut-on s’inscrire à contrario de Camus lui-même et dépasser ce fait, que l’intrigue de La Horde soutient pourtant : « Ainsi cette science qui devait tout m’apprendre finit dans l’hypothèse, cette lucidité sombre dans la métaphore, cette incertitude se résout en œuvre d’art[26]. »
Un savoir sensuel de lutte
Car, tout de même, le scribe ne cède pas. Arrivé au terme du parcours de ses protagonistes le texte dégage un nouvel éclairage. Son questionnement se déplace, et prend deux nouveaux visages. Le premier, auquel participe le processus d’écriture lui-même[27], est celui de la vitalité. Tout au long du roman, la question de la vie, de son bouillonnement et de son expansion, de la diversification de ses formes plutôt que d’une vocation idéologique à laquelle la vouer, taraude le personnage de Sov. Le lecteur en trouve plusieurs traces, par exemple lors du séjour de la Horde dans la ville perchée d’Alticcio, où le scribe rencontre, parmi les méandres d’une immense bibliothèque, un ermite ou « aérudit » qui, d’un regard, capte sa plus intime interrogation : « Vous, jeune scribe, vous venez chercher une chose très étrange et très difficile. Vous venez chercher ce que signifie “être en vie”[28]. » La démarche intime que nous avons évoquée, faisant écho à la quête plus vaste menée par le groupe, se réoriente ainsi, non plus vers une spéculation téléologique portant sur l’extérieur du monde (ce monde, dont on sait pourtant qu’il est muet ou irrémédiablement « silencieux » selon Camus[29]) mais bien vers une compréhension de l’intériorité. La quête d’une expansion et d’une analyse de la vitalité, une fois disparus tous supports théoriques ou objectifs visant à la perpétuer, se donne à penser dans le texte comme une forme alternative de lutte contre la perte de l’espoir et corrélativement, une voie d’évitement du suicide. Cette étude des modes vitalistes d’effervescence du soi rejoint également, on s’en doute, un intérêt non seulement esthétique mais également politique[30] situé au cœur de la pratique d’écriture d’Alain Damasio.
Au fond, j’essaie de répondre à une question toute simple dans mes livres, et je crois que je n’en finirais jamais. Cette question c’est quelque chose comme : qu’est-ce que ça veut dire, en tant qu’homme, être vivant ? Comment être – dans son cœur, dans son quotidien, dans sa tête et ses tripes, dans ses moindres mouvements, dans ses fatigues mêmes – vivant[31] ?
L’étude de la vitalité se déploie sur un double versant dans l’œuvre, de manière intra et extra diégétique. Au sein du texte, sur le fil de l’intrigue, elle prend les traits d’une question épistémologique. Le savoir mûri par les hordiers tout au long de la quête se base en effet sur un rapport direct et prioritairement organique avec leur environnement. Ce privilège du corps comme outil d’interaction avec le monde représente l’un des principes incontournables de la quête, il est à la base de l’éthique respectée par le groupe. Ce précepte comportemental trouve l’occasion d’une énonciation claire lors d’un épisode du roman. La Horde croise le chemin d’une escouade de « Fréoles », corsaires passés maîtres dans l’ingénierie de pointe, fendant la houle à bord de navires sophistiqués, astreints à la même tâche que nos protagonistes : « remonder ». Caracole, le troubadour, manifeste immédiatement pour lui-même, l’aspect prioritairement intellectuel du savoir à l’origine de leurs capacités : « Toujours cette imperceptible morgue fréole, bombée comme un gonfalon, ce sentiment de supériorité, né du plaisir de jouer, né d’une liberté sue […][32]. » De même Golgoth, traceur et fer de lance du groupe dans les nœuds du vent, réagit violemment face à l’amiral aux commandes du navire lorsque celui-ci lui suggère d’emprunter l’un de leurs véhicules pour poursuivre leur route :
Impossible d’utiliser un autre moyen de transport pour remonder, vous le savez bien. Code de la Horde. Sur les mains, sur les pieds, en rampant, en nageant peu importe. Mais le corps seul[33].
La technologie, qui donne aux Fréoles leur avantage sur le vent, est ici assimilée, par des détours quelque peu rousseauistes, à une forme de corruption relationnelle. Cette distance qui sépare les pratiques Fréoles et celles de la Horde est présentée sous l’aspect d’un refus de tout substitut instrumental dans le rapport au monde. Une telle radicalité se justifie dans le roman par une volonté de cohérence ou d’équité entre les actions individuelles et les règles qui régissent l’environnement physique dans lequel ces actions ont court. Ce pragmatisme interactionnel se trouve donc guidé, d’abord, par une volonté d’adéquation entre les hommes et leur terre : l’effort à fleur de peau s’équilibrant à la rudesse du relief et de la houle.
Les Fréoles ne respectent pas le vent : ils s’en servent, ils l’exploitent. Ils le canalisent et le recyclent. Pour eux, le vent est matière première, un ami docile et maniable. Pour nous, il est l’ennemi qui s’affronte. Ce qui nous tient debout. Nous redresse. Et nous fait[34].
La légitimation d’un tel rapport ne reste pas enchaînée à des contraintes prescriptives. Dans le texte, elle puise sa valeur dans l’affinement qu’elle permet vis-à-vis du décryptage et de la compréhension des lois, codes et signes, qui composent et régissent l’environnement. Il y a bien une sensualité du savoir qu’apporte tout refus d’instrumentalisation ou d’intellectualisation de la relation au monde. Au cours du périple, elle se transcrit, au sens propre, par la capacité de sentir et de traduire les aléas du vent sous forme de signes typographiques. Chaque sorte de vent, en termes d’intensité et de rythme, peut ainsi faire l’objet d’une notation. C’est naturellement le scribe Sov qui assume cette tâche pour le groupe. Celle-ci consiste essentiellement durant la quête à recenser de manière écrite dans un carnet les formes du vent rencontrées.
) Du sac, je sors le carnet de contre et le pose sur mes genoux. Je plisse les feuilles fines jusqu’à la page d’hier et j’ouvre. Je sens la peau de Coriolis contre mon épaule nue.
“ˆ : “ˆ“ˆ“ˆ… ! º … ; (…) ‘ˆ “ˆ! !!º !! o !!!!…. ! – ! ? O O O
– C’est le furvent !
– Oui, avec tous ces points d’exclamation, difficile de le rater… Retenez au passage comment on note la vague : « ! – ! » suivi de la contre-vague « ? » et des vortex « O »[35].
L’usage des signes typographiques n’est ici pas anodin. Il signale les rapports étroits qui unissent la connaissance sensuelle du monde et l’écriture. La culture introspective de soi basée sur l’attention aux choses et la sensualité est présentée dans le roman comme un mode d’expression et d’entretien d’un rapport vitaliste à la terre, et de fait, comme terrain de lutte contre cette « mortalité intime » qu’est la neuvième forme du vent, illustrant, nous l’avons vu, la tentation du suicide. La connaissance sensuelle ne permet cependant pas simplement de refléter le monde. Elle permet aussi de le créer. Au terme du texte, le personnage de Sov apprend en effet que son métier de scribe portait autrefois un autre nom, celui de « glyphier », dont la fonction était éminemment poétique.
Le glyphier avait des pouvoirs bien plus étendus que ceux d’aucun scribe Sov ! […] Le gylphier était une fonction orale, éminemment orale qui ne consistait pas à relater sur un carnet ce que la horde faisait, mais à créer et à proférer des glyphes […][36]
La pratique de l’écriture n’apparaît donc pas seulement sous l’aspect d’un reliquat du rapport vitaliste au monde, mais revêt bien un potentiel créateur. Source de vie car source de vent, la captation sensuelle de la dynamique cosmique par l’écriture se donne comme premier mode de lutte contre la tentation de la mort volontaire dans le récit damasien. Le scribe, de part la sensibilité relative à sa fonction, apparaît bien comme le porteur de message du texte, protagoniste central car ultime survivant de la Horde. Il est cette « entité préindividuelle », « engagé » selon Xavier Garnier par le récit initiatique dans un « processus d’individuation »[37]. Cependant la littérature ne suffit pas, puisqu’elle s’y apparente, à conjurer l’aporie de l’œuvre d’art dans laquelle échouerait la tentative de résolution de la condition absurde, selon la citation relevée plus haut. Toute création, même perspicace et vive, condamne encore le créateur à une forme de solitude que la « mort-vive » peut mordre à tout moment, ne serait-ce que sous la forme de la page blanche. L’oscillation qui hante Sov au bord du gouffre de l’Extrême-Amont en rend adéquatement compte. C’est pourquoi la lutte contre l’absurde se prolonge dans le récit de Damasio par la problématique de l’altérité.
Résister par la communauté
Fidèle à l’assertion énigmatique qui lui donne son impulsion (« Nous sommes faits de l’étoffe dont sont tissés les vents »), le récit donne encore à l’élément aérien un potentiel configurateur touchant à l’intimité des caractères dépeints. La huitième forme du vent, dont la neuvième est l’exact envers, porte le nom de « vif ». Il symbolise la force de vie qui relie tout habitant de cette étrange terre venteuse aux lois qui façonnent son milieu physique. Et l’aéromaître Oroshi de préciser : « Le vif est vraisemblablement la première forme consistante et automotrice. L’apparition du vif ne fait qu’un avec celle de la vie organisée[38]. » Chaque protagoniste contient « son » vif, support sans cesse modelé et trace d’une sculpture du soi, vestige de la singularité individuelle. La sensibilité esthétique du scribe lui octroie ainsi, de par la nature aérienne de cet élément personnifiant, la possibilité de percevoir et de « porter » les vifs de ses amis disparus. Lire et écrire le vent, pour le poète et dans l’optique romanesque de Damasio, c’est donc aussi « lire » la présence d’autrui, capter et préserver le noyau de vitalité qui croît, se réduit ou se modifie en chacun. D’un point de vue philosophique, le scribe apparaît comme porteur et garant d’un différentiel au sein du tissu social. Son rôle parmi la communauté lui confère la possibilité de ménager un espace alternatif au sein duquel les individualités vives de ses compagnons seraient préservées et avec lesquels le scribe se trouve même capable de converser. Le roman laisse apparaître cet espace dialogique sous la forme d’apartés en italique insérés entre les prises de paroles monologiques du scribe[39]. Or cet espace de parole par-delà la disparition est précisément ce qui donne au scribe la force de renoncer au suicide, de triompher du néant auquel le condamnerait sa neuvième forme. Perché au sommet de la falaise l’avachissement fatal qui le précipiterait dans l’abîme est interrompu par le timbre « léger » et « tintant » de son ami Caracole qu’un souvenir ressuscite à point nommé.
Pense à moi ce jour là et rappelle toi de ce moment que nous vivons ici même, rappelle-toi de cette phrase que je prononce à haute voix, de chaque mot qui la compose. Tu m’écoutes Sov ?
– Oui.
Ce qui me sauva du suicide, ce fut ce souvenir précis[40].
La résistance à l’abdication face à l’absurde n’apparaît donc pas, dans l’œuvre de Damasio, comme capacité de l’artiste seul. La perspective romanesque que déroule La Horde du Contrevent nous propose, bien plus, de considérer la prévalence du lien communautaire que suscite toute création artistique sur l’élaboration solitaire de l’œuvre elle-même. Les procédés linguistiques, techniques narratives et inspirations philosophiques, dont est pétri le récit damasien convergent ainsi vers une considération de l’altérité. Au regard du registre initiatique, l’autre, dans sa singularité la plus vive, constitue donc cette « Rencontre ultime » à laquelle, sous des airs faussement disparates, tout récit de ce type prépare la figure héroïque qui en est le centre : « La Rencontre ultime, parce qu’elle correspond à la fin du récit, révèle l’identité de toutes les rencontres. » Elle éclaire le sens de l’ensemble des obstacles rencontrés sur le chemin. Ainsi : « sa position de dernière rencontre dans l’ordre du récit lui confère-t-elle un rôle de mise en perspective[41]. » Triomphant de sa neuvième forme, le scribe n’apparaît plus seulement comme celui qui relate ou recense dans ses carnets les événements qui égrènent la quête. Il se révèle, depuis le début, celui auquel la trace de la Horde était dédiée[42]. Au terme du récit, il glisse alors le long de la falaise, s’accrochant à des cordages qui, comme par magie s’élèvent au bout d’énormes baudruches surgissant à travers la brume. Il parvient au terme d’une longue chute, exténué et en sang, à Aberlaas, en Extrême-Aval. « Tu viens de naître ou quoi ? » lui lance un ouvrier goguenard. Le récit peut recommencer, fort des expériences, des échecs et des triomphes du périple parcouru. L’aventure fait place à la transmission. Le lecteur, au terme du texte, endosse le différentiel.
Conclusion : sceller par le saut
La mise en valeur du lien communautaire comme résistance à la volonté de la mort individuelle constitue, tel que nous avons essayé de le montrer, l’une des voies par lesquelles la littérature contemporaine prolonge le questionnement de l’absurde. L’altérité se donne à penser à la fois comme la frontière et comme la source d’une force sans cesse renouvelable : celle de creuser des fissures dans les murs absurdes. Le vaste roman d’Alain Damasio nous enjoint ainsi à faire de la présence nourricière et singulière de l’autre un perpétuel mode de création, de recréation du soi. Cette brève étude peut cependant encore se doter d’un complément. Les images convoquées par l’auteur nous autorisent en effet à émettre une hypothèse quant à la forme du rapport exprimé par l’ouvrage vis-à-vis de la communauté. Nous proposons, sur la base de ce texte et dans le cadre de cette étude, d’envisager ce rapport sous la forme du saut. L’utilisation d’un terme issu de la pensée kierkegaardienne ne nous semble pas dissonant. Cette référence se veut entrer en résonnance avec le ton existentialiste qui fournit à cet article son socle réflexif L’appellation de saut, permet ensuite de penser en même temps le registre initiatique dans lequel s’inscrit le récit, et d’apporter une certaine fécondité aux représentations que suscite le rapport concret à la communauté.
Concernant le premier aspect, le mouvement du saut peut être appréhendé comme la dynamique même de cette individuation à laquelle aspire la figure centrale de la narration initiatique. Le saut constitue ce mouvement qui lie les différents obstacles rencontrés par le protagoniste (ceux-ci étant, selon Xavier Garnier, la condition du critère initiatique, non déterminés a priori). De même, cette image illustre la transformation, le changement d’état soudain et radical, auquel est promis le héros dans un tel contexte littéraire. De manière plus prosaïque, tout rapport à l’altérité nécessite une prise de risque, un mouvement sinon de foi, du moins de confiance à l’égard d’autrui. Cet engagement du soi en face de l’autre, nous semble coïncider aussi avec une forme de saut. Dans son Post-scriptum définitif aux Miettes philosophiques, Kierkegaard voyait en effet dans le concept de « saut », dont il souligne la clairvoyance chez Lessing, l’expression exemplaire de l’acte de décision. Cet acte s’inscrit, chez l’auteur du Traité du désespoir, en opposition à la passion dialectique caractérisant l’abord hégélien du monde. Et c’est précisément ce qui lui donne sa valeur. Kierkegaard, en ayant recours à la métaphore, déclare en effet que : « ce n’est certes pas la largeur matérielle du fossé qui empêche le saut, mais bien la passion dialectique intérieure qui donne au fossé sa largeur infinie. Avoir été tout près d’une chose, cela a déjà son côté risible ; mais avoir été tout près d’effectuer le saut ce n’est rien du tout, justement parce que le saut est la catégorie de la décision[43]. » En suivant cette image, la prise de risque qu’implique, dans sa quotidienneté la plus crue, la confrontation à l’autre, constituerait justement ce qui confère à la volonté communautaire sa valeur d’acte concret, son caractère radical de décision. Ainsi la valeur de la communauté apparaît-elle avant tout dans le franchissement qu’elle implique, dans cette impulsion à laquelle elle invite le soi. Jamais close, elle se tient constamment vis-à-vis de ses constituants dans un inachèvement, un « à-construire », un « à-franchir ». Il nous faut ainsi davantage nous figurer la communauté sous l’aspect d’un effort, d’une volonté où prime la réciprocité, où le soi est envisagé dans son retrait, où l’autre est avant tout perçu comme potentiel ou apport du collectif avant d’être sujet. Dans le contexte du roman, l’oscillation du scribe au bord du gouffre serait le prix même de la transmission et de la perduration des leçons du périple, l’enjeu des enseignements de la quête. Notre conception d’une communauté scellée par un rapport conçu comme « saut » trouve encore de stimulants échos chez Roberto Esposito, notamment lorsque l’auteur réhabilite l’antique notion de « munus » et en fait l’espace d’un donné perpétuel entre membres d’un même ensemble social : « En définitive, ce qui prévaut dans le munus, c’est la réciprocité du don, ou « mutualité » (munus – mutuus), qui livre l’un à l’autre par un engagement commun, disons même, un serment commun […][44]. »
L’acte d’écriture n’est pas non plus étranger au partage. Il participe tout entier du saut vers la communauté. Nous en avons travaillé les représentations dans le récit de Damasio, au travers de la tâche du scribe. Jean-Luc Nancy évoquait déjà, dans son ouvrage de 1986[45], cette question d’une communauté désœuvrée que chaque constituant était sommé de réactualiser sans cesse par la parole offerte en commun, c’est-à-dire, selon le philosophe, par la « communication ». Dans cette veine, l’acte de l’auteur est bien un saut perpétuellement répété dont l’éphémère célèbre et refonde sans cesse l’occasion du partage : « L’écriture en ce sens viendrait inscrire […] la durée collective et sociale dans l’instant de la communication, dans le partage[46]. » L’importance du pas, du saut franchi par l’écrivain vers autrui, ne cessant de se nouer sur la page, par le texte, et jusqu’au sein du tissu social, se retrouve encore chez Albert Camus. Dans son Discours de Suède, le philosophe souhaitait en effet que son œuvre puisse « faire resplendir fugitivement la vérité toujours menacée que chacun, sur ses souffrances et sur ses joies, élève pour tous[47]. »
À cet appel répondent aujourd’hui, c’est certain, le bruissement de dizaines de créations contemporaines qui opposent à l’absurde la construction du lien social. La Horde n’est que l’un de ces cas, de ces pas vers la lutte. Nous espérons seulement en avoir ici amorcé l’élan.
[1] Comme en témoigne, entre autres, la citation suivante : « Le sentiment de l’absurdité au détour de n’importe quelle rue peut frapper à la face de n’importe quel homme. » (Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, Paris, Gallimard, [1942] 2003, pp. 26-27)
[2] Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, op. cit., p. 21.
[3] Alain Damasio, La Horde du Contrevent, Paris, Gallimard, « Folio SF », 2007 [2004].
[4] « La philosophie, plus rigoureusement, est la discipline qui consiste à créer des concepts. » (Gilles Deleuze, Qu’est-ce que la philosophie ? Paris, Minuit, 2011 [1991], p.10)
[5] Marc Angenot, « Le paradigme absent. Eléments d’une sémiotique de la science-fiction », in Les Dehors de la littérature, Paris, H. Champion, 2013.
[6] Marc Angenot, art. cit.
[7] Albert Camus, Carnets I : Mai 1935 – février 1942, Paris, Gallimard, [1962] 2013, p. 18.
[8] Dans le roman de Damasio chaque hordier est symbolisé par un sigle qui signale, placé en lettrine, sa prise de parole au sein du récit.
[9] Albert Camus, op. cit. p. 46.
[10] Xavier Garnier, « À quoi reconnaît-on un récit initiatique ? », in Poétique, nov. 2004, p. 450.
[11] Alain Damasio, La Horde du Contrevent, op. cit., p. 382.
[12] Ibid., p. 635.
[13] Albert Camus, op. cit., p. 20.
[14] Giuseppe Rensi, La philosophie de l’absurde, Paris, Allia, [1996] 2014, p. 38.
[15] Albert Camus, op. cit. p.29
[16] Alain Damasio, La Horde du Contrevent, op. cit., p. 49 (il est sans doute utile de préciser ici que la pagination du roman suit un ordre déchronologique : le texte débute à la page 700 et se termine à la première page).
[17] Ibid., p. 48.
[18] Jean-François Lyotard, La condition postmoderne, Paris, Minuit, 1979, p. 30.
[19] Alain Damasio, op. cit., p. 39.
[20] Giuseppe Rensi, op. cit., p.40.
[21] Albert Camus, op. cit., p. 33.
[22] Au registre des exemples de cette flamboyance nous trouvons la mort du traceur Golgoth, littéralement consumé par sa propre puissance intérieure dans une tentative désespérée de créer une parcelle de terre supplémentaire à parcourir, après avoir découvert (c’était là sa neuvième forme) qu’il n’était pas le premier à arriver en Extrême-Amont.
[23] Alain Damasio, op. cit., p. 9.
[24] Paul Ricoeur, La métaphore vive, p. 11.
[25] Olivier Noël, « Entretien avec Alain Damasio », in Galaxies 42, 2007, p. 135.
[26] Albert Camus, op. cit., p. 37.
[27] Pour une étude en profondeur de cet aspect de la question, voir Stéphane Martin : « Une poétique sensuelle », in La Croisée des souffles. La Horde du Contrevent d’Alain Damasio, Lausanne, Archipel Essais, 2013.
[28] Alain Damasio, op. cit., p. 273.
[29] Dans son ouvrage, le philosophe convie par exemple son lecteur à se rendre compte « avec quelle intensité la nature, un paysage peut nous nier » (Albert Camus, op. cit. p.30).
[30] L’aspect politique de cet intérêt est surtout développé dans le premier roman de l’auteur, La Zone du Dehors (Cylibris, 1997), et nous ne nous y étendrons pas ici (voir : Olivier Noël, art. cit. p. 129).
[31] Olivier Noël, art. cit., p. 132-133.
[32] Alain Damasio, op. cit., p. 500.
[33] Ibid., p. 498.
[34] Ibid., p. 489.
[35] Ibid., p. 633.
[36] Alain Damasio, op. cit., p. 66.
[37] Voir Xavier Garnier, art. cit., p. 446.
[38] Alain Damasio, op. cit., p. 74.
[39] De tels phénomènes d’écriture courent tout au long du chapitre de l’antépénultième chapitre du roman, consacré précisément au « vif » : p. 93 – 58.
[40] Alain Damasio, op. cit., p. 8.
[41] Xavier Garnier, art. cit., p. 452.
[42] L’auteur prend d’ailleurs soin de disséminer au cours du texte plusieurs passages significatifs qu’une seconde lecture permet de faire saillir. Le scribe confesse souvent avoir « besoin de cette énergie fluante du groupe, de sentir les tensions et les fusions qui nous traversent, chacun et tous » ; ou encore, comble la parole suspendue d’Aoi, la sourcière : « On est liés les gars, je sais pas dire mieux…/ Noués… / Noués, ouais Sov, noués dans un nœud de boyaux à nous. » (Alain Damasio, op. cit., p. 610 ; p. 693)
[43] Sören Kierkegaard, Post-scriptum définitif et non scientifique aux Miettes philosophiques, Paris, Oronte, [1846] 1977, p. 94 (nous soulignons).
[44] Roberto Esposito, Communitas. Origine et destin de la communauté, Paris, Puf, 2000, p. 18.
[45] Voir supra.
[46] Jean-Luc Nancy, La communauté désœuvrée, Paris, Christian Bourgeois, [1986] 2004, p. 97.
[47] Albert Camus, Discours de Suède (1957) : http://classiques.uqac.ca/classiques/camus_albert/discours_de_suede/discours_de_suede_texte.html, (consulté le 1er juillet 2015) (nous soulignons).