The object view (2)
Le retour en force du paradigme de l’objet dans la philosophie de la perception (2)
Ces publications sont une reprise de certaines interventions prononcées dans le cadre des journées d’études « L’objet de la perception », à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne , École Doctorale de Philosophie (ED 280), Philosophies contemporaines (PhiCo EA3562) EXeCO – CEPA, organisées par Roberta Locatelli et Pauline Nadrigny

Lucian Freud: Rabbit on chair, 1944
Michael Martin affirme que perception et hallucination ne partagent pas le même caractère phénoménal, parce que, à strictement parler, les hallucinations n’ont aucun caractère phénoménal. Si le caractère phénoménal d’une perception est défini et constitué par l’objet vu et ses propriétés, le caractère phénoménal d’une hallucination est défini seulement de manière négative: comme un état indiscriminable d’une perception.
«What links the case of hallucination to the case of veridical perception is the seeming presence of Naïve Realist phenomenal properties [les propriétés déterminées et constituées par la présence d’objets physiques] » (the Limits of self awareness, p. 282)
De cette manière, l’hallucination est définie en référence à une perception. On n’a donc besoin de postuler aucune expérience sensible, qui serait commune à la perception et à l’hallucination (le fameux facteur commun). Si l’on peut, bien sûr, parler d’expérience dans les deux cas, on enlève à la notion d’expérience toute fonction explicative autonome dans l’économie de l’esprit. La notion d’expérience est elle-même expliquée à l’aune de la perception: avoir une expérience, c’est se trouver dans une situation dans laquelle quelque chose semble se présente (qui a les caractères phénoménaux de la perception) mais dont nous ne sommes pas sûrs que ce soit une perception.
Or, dire que l’hallucination est définie de manière purement négative, sans caractère phénoménal, et que l’on n’a pas besoin de postuler un état commun entre perception et hallucination, à savoir une apparence, qui se réalise indépendamment du fait qu’il y ait quelque chose à voir ou pas, ne pose, à mon sens, aucun problème.
Il ne s’agit, au fond, que d’une remarque grammaticale, à laquelle on peut consentir sans hésitation, concernant la priorité du concept de perception sur celui d’expérience (et tous ses synonymes: apparence, apparaître, sembler…). Cela revient à refuser, simplement, l’idée que, pour comprendre ce que c’est que voir un chat, on a d’abord besoin de savoir ce que c’est que voir quelque chose qui apparaît comme si un chat était là. Le contraire semble beaucoup plus plausible: pour expliquer la notion d’apparaître, ou de sembler (disons, il semble qu’un chat est là), on a besoin de comprendre d’abord ce que signifie que voir un chat. En d’autres termes, on doit abandonner l’idée que pour comprendre la perception, il faut se retourner vers une apparence purement interne: pour savoir ce que l’on perçoit, on doit faire attention à ce dont on est conscient, c’est-à-dire aux objets réels qui se présentent dans la perception.
C’est une remarque très proche de celle qui fait Sellars dans «Empiricism and the Philosophy of Mind», quand il souligne la priorité du verbe être sur celui d’apparaître :
« When I say « X looks green to me now » I am reporting the fact that my experience is, so to speak, intrinsically, as an experience, indistinguishable from a veridical one of seeing that x is green.» (§16)
Cependant, l’interprétation que je viens de formuler est une version déflationniste (et charitable) de la proposition de Martin, en ce qu’elle fait entièrement l’économie de la notion de caractère phénoménal. Mais Martin utilise bien cette notion, qui rend sa position beaucoup plus difficile à accepter, voire à comprendre.
En effet, je ne vois pas comment on peut à la fois nier toute valeur explicative à l’expérience, en tant qu’état commun à la perception et à l’hallucination, et en même temps charger d’une valeur explicative la notion de caractère phénoménal. On rappellera ainsi que Martin parle de manière insistante du caractère phénoménal de la perception (il parle de «Naïve Realist phenomenal properties»), comme ce qui distingue cette dernière de l’hallucination.
Or, il me semble qu’accepter de parler de propriétés phénoménales signifie admettre subrepticement ce que l’on veut nier, soit l’expérience en tant que facteur fondamental commun entre perception et hallucination. En effet, ainsi que je l’ai précisé tout à l’heure, le caractère phénoménal spécifie, dans une perception, ce qui est purement sensible, le caractère intrinsèque de l’expérience, ce à quoi, dans l’expérience, on a accès par la voie de la simple introspection. Mais ceci est précisément l’image de l’expérience que le disjonctiviste affirme vouloir refuser : l’idée que l’expérience est fondamentalement définie de manière internaliste, sur la base de l’introspection, de ce qu’un sujet peut dire en regardant ce qui se passe dans son esprit, de manière indépendante de ce qui se passe dans le monde.
Dès lors que le disjonctiviste accepte l’idée qu’il fait sens de dire que la perception a un caractère phénoménal, il ne peut pas s’étonner du fait que son adversaire ne soit pas satisfait par sa caractérisation de l’hallucination et insiste à lui demander : comment est-il possible que l’hallucination (qui n’a à proprement parler aucune propriété phénoménale) peut apparaître comme une perception, qu’elle a des propriétés phénoménales définies par les objets perçus?
Là encore, le disjonctiviste accepte trop rapidement un paradigme que l’on ferait mieux de refuser dès le début. L’erreur du disjonctiviste est en amont, dans le fait de se demander comment concilier la différence de caractère phénoménal avec l’indiscriminabilité de la perception et de l’hallucination. En fait, pourquoi devrait-on accepter l’idée que perception et hallucination sont indiscriminables ? Cette idée est un exemple de monstre conceptuel généré par la distorsion philosophique des termes du langage ordinaire.[1]
Généralement, les disjonctivistes affirment qu’il est indéniable qu’une hallucination peut être indiscriminable d’une perception, car cela tient à sa définition même : l’hallucination est telle précisément parce qu’on ne la distingue pas d’une perception, parce qu’on la prend pour une perception.
Cependant, dire que quelqu’un peut prendre une apparition hallucinatoire d’un oasis pour une perception d’un oasis est une chose, alors que dire que halluciner une oasis et percevoir une oasis sont deux choses indiscriminables en est une autre. Dans le langage ordinaire, prendre une chose pour une autre chose et ne pas distinguer deux choses ont deux grammaires différentes: le premier cas est une erreur d’identification (je prends une poupée pour en enfant), alors que parler de discriminabilité (ou d’indiscriminabilité) implique une comparaison, et donc deux termes à comparer, deux choses présentées au même moment (ou, éventuellement, avec un écart temporel limité). Je regarde deux objets devant moi (disons, un citron et un savon en forme de citron) et je ne suis pas capable de les distinguer (par exemple, je crois que ce sont deux citrons) ou encore, je vois un citron dans un panier, puis quelques temps après je regarde dans le même panier et je ne me rends pas compte que le citron a été remplacé par un savon qui en imite la forme.
Cependant, si l’on parle d’expérience perceptive, le problème est que l’on n’a pas idée des termes qu’il faut comparer. Imaginez que je sois en train d’halluciner un chimpanzé et que je doive établir si mon expérience hallucinatoire est indiscriminable d’une expérience véridique. Avec quoi vais-je la comparer? Certainement pas avec une expérience que j’ai au même moment, car je ne peux pas, au même temps et au même endroit, voir et halluciner un chimpanzé. Mais la comparaison ne peut même pas être faite avec une expérience passée, car je n’ai jamais eu auparavant l’expérience d’un chimpanzé sautant dans mon bureau. Donc la comparaison ne se fait pas dans ces termes. Ce que l’on pense quand on dit qu’une hallucination est indiscriminable d’une perception est une comparaison entre l’expérience hallucinatoire et une perception véridique contre-factuelle. Ceci est bien problématique, car il n’est pas évident de comprendre ce que signifie confronter quelque chose d’actuel avec quelque chose de contre-factuel.
On voit bien que la notion de caractère phénoménal fait surgir beaucoup de problèmes. Pourquoi des partisans de la object view, qui se présente comme une position radicalement éxternaliste, acceptent-ils si aisément des notions internalistes, comme celle de caractère phénoménal, d’introspection? On peut penser qu’il s’agit d’une difficulté marginale, attribuable aux termes du débat préexistant, dans lequel le disjonctiviste doit prendre position: le réaliste disjonctiviste serait conduit, par convenance, à utiliser l’outillage conceptuel de son adversaire, sans vraiment l’endosser. Il serait alors possible d’expurger du disjonctivisme ce bagage conceptuel pour le formuler de manière non problématique.
Cependant, il me semble que, au moins dans le cadre de l’object view, le problème est plus profond. En effet, comme on l’a vu, la notion de caractère phénoménal est là dès le début, dans la formulation de ce que c’est que percevoir pour l’object view.
«On a relational view, the phenomenal character of your experience, as you look around the room, is constituted by the actual layout of the room itself: which particular objects are there, their intrinsic properties, such as colour and shape, and how they are arranged to one other and you.». (p. 116).
Si cela est le cas, c’est parce que, me semble-t-il, le partisan de la object view, tout comme le représentationnaliste, est obsédé par la possibilité de perdre le contact avec la réalité, et s’empresse alors d’établir que la perception est bien un contact avec les choses. Et il veut établir cela à partir du champs du phénoménal, pour ainsi dire, à partir de ce qu’on peut introspecter. Un paragraphe de l’article «The Limits of Self-Knowledge» de Martin a le titre éloquent de «Reflective Knowledge and The Loss of The World». Martin et Brewer le disent clairement à plusieurs reprises : leur but est d’assurer que nous voyons des objets physiques à partir du peu de connaissances que l’on peut tirer de l’introspection de notre expérience.
Le disjonctiviste, au moins dans la version que je viens de présenter, accepte le défi du sceptique, qui demande de démontrer – si vous en êtes capable ! – que ce qu’il nous semble voir existe vraiment. Le problème, comme toujours, dans ce type de menace sceptique, tiendrait dans le fait que l’expérience puisse nous tromper. Le disjonctiviste est donc, pas moins que le représentationnaliste, obsédé par les hallucinations : il a peur que le manque de sérieux, pour ainsi dire, de ces expériences défaillantes puisse affecter la validité des autres perceptions. Si la stratégie (à juste titre très contestée) des partisans des sense data était d’isoler une classe de connaissance minimale, portant sur de simples impressions sensibles, dans lesquelles l’erreur serait impossible, la solution des disjunctivistes est de mettre en quarantaine les expériences incriminées, responsables du doute sceptique. Ils font cela en les enfermant dans un compartiment mental différent. Si cette stratégie est plutôt nuancée chez Martin, elle est en revanche très nette chez Fish, qui se réclame de Martin et dit le suivre sur ce point: les hallucinations ne sont pas des perceptions. Dans la taxinomie du mental, elles sont à ranger dans une autre case, elle sont un autre type mental, de même que l’imagination est différente du souvenir.
Il répond donc à un souci d’ordre épistémologique avec un réaménagement de l’ontologie de l’esprit, une stratégie qui, dans le contexte du tournant ontologique dont j’ai fait mention au début, est assez courante, mais qui, me semble-t-il, relève d’une confusion de niveaux conceptuels. D’ailleurs, ce n’est qu’une apparence de solution, car toute tentative de réfuter le scepticisme est par là-même défaite, car le scepticisme est irréfutable. Prétendre le faire, c’est le prendre trop au sérieux, et se vouer à l’échec.
On doit plutôt ignorer le scepticisme, dire que ses questions sont mal posées, incompréhensibles – répondre à la manière de Wittgenstein, quand, face à la demande «crois tu que la table est encore là alors que tu ne le regarde pas ?» il répond «je ne crois pas que quelqu’un l’ait déplacée entretemps.»
Bien sûr, les hallucinations posent des problèmes philosophiques, mais ce ne sont pas des problèmes sceptiques. Elles ne mettent pas en doute la validité de notre expérience (en quoi pourrait-elle être valide ou invalide, au juste?), ne menacent pas de nous couper du monde.
Je crois que cette peur de la perte de la réalité dérive aussi du fait d’avoir trop rapidement identifié la réalité avec les objets, et – qui plus est – les objets physiques. La object view a raison dans son refus du paradigme propositionnaliste du contenu. Cependant, il passe trop rapidement de ce refus à une identification irréfléchie du réel avec le format de l’objet physique.
Cette démarche amène tout de suite à concevoir l’hallucination comme quelque chose de mystérieux, qui requiert une ontologie ad hoc, qui présenterait quelque chose de différent du domaine du réel. Au contraire, je crois que beaucoup d’hallucinations, sinon toutes, peuvent être conçues comme faisant entièrement partie, de plein droit, de notre rapport avec le monde, même si, évidemment, on ne peut pas dire qu’on voit des objets physiques. Pensez au cas du mirage dans le désert. Ce n’est certes pas un objet physique, mais c’est bel et bien un morceau de réalité: l’effet d’un phénomène physique, un fait que nous pouvons étudier et dont nous pouvons connaître le fonctionnement.
Roberta Locatelli – Paris I – Phico
Références bibliographiques
Austin, J.L., 1962, Sense and Sensibilia, Oxford: Oxford University Press. Trad. Fr: Les Langages de la perception, Paris: Vrin.
Brewer, Bill, 2000, Perception and Reason, Oxford: Oxford University Press.
–––, 2004, “Realism and the Nature of Perceptual Experience”, Philosophical Issues, 14(1): 61–77.
–––, 2006, “Perception and Content”, European Journal of Philosophy, 14(2): 165–181.
–––, 2008, “How to Account for Illusion”, in Disjunctivism: Perception, Action, Knowledge, Fiona Macpherson and Adrian Haddock (eds.), Oxford: Oxford University Press, pp. 168–180. Broad, C. D., 1923, “The Theory of Sensa”.
–––, 2011, Perception and its Objects, Oxford: Oxford University Press.
Campbell, J., 2002a, Reference and Consciousness, Oxford: Oxford University Press.
–––, 2002b, “Berkeley’s Puzzle”, in Conceivability and Possibility, Tamar Szabo Gendler and John O’Leary Hawthorne (eds.), Oxford: Oxford University Press, pp. 127–144.
–––, 2005, “Précis of Reference and Consciousness, and Replies to Neil Manson and Georges Rey”, Philosophical Studies, 126: 103–114, 145–153, 155–162.
Dummett, Michael (1993) Origins of Analytical Philosophy, Cambridge, MA, Harvard University Press. Trad: Les origines de la philosophie analytique. Paris: Gallimard.
Locatelli, Roberta (2010) « La perception est-elle intentionnelle ? », Europaea, Actes du Workshop international “Acte, langage, Inconscient”, 2/2010, Cluj-Napoca.
Heil, John, 2003, From an Ontological Point of view, Oxford : Oxford University Press. Trad. Fr. Du point de vue ontologique, Paris : Les Editions d’Ithaque.
Martin, C. B.; Heil, John, 1999, The Ontological Turn, Midwest Studies in Philosophy 23 (1):34–60.
Martin, M.G.F., 1992, “Sight and Touch” in Crane (ed.) 1992
–––, 1992a, “Perception, Concepts and Memory” Philosophical Review 101:745–63.
–––, 1995, “Perceptual Content” in Guttenplan (ed.) 1995.
–––, 1998, “Setting Things Before the Mind” in A. O’Hear (ed.) Contemporary Issues in the Philosophy of Mind, Cambridge: Cambridge University Press.
–––, 2000, “Beyond Dispute: Sense-Data, Intentionality and the Mind-Body Problem” in Crane and Patterson (eds.) 2000.
–––, 2002, “The Transparency of Experience” Mind and Language 17, 376–425.
–––, 2003a, “Particular Thoughts and Singular Thought” in A. O’Hear (ed.) Thought and Language, Cambridge: Cambridge University Press.
–––, 2003b, “Sensible Appearances” in T. Balwin (ed.), The Cambridge History of Philosophy, Cambridge University Press.
–––, 2004, “The Limits of Self-Awareness”, Philosophical Studies 103
–––, 2006, “On Being Alienated”, in Perceptual Experience, Tamar S. Gendler and John Hawthorne (eds.), Oxford: Oxford University Press, pp. 354–410.
McDowell, John, 2007, «Préface à l’édition française», L’esprit et le Monde, Vrin, Paris, 2007.
–––, 2008, « Avoiding the Myth of the Given », dans Lindgaard 2008. Lindgaard, Jakob (dir.) 2008 : John McDowell. Experience, Norm, and Nature, Oxford,
Blackwell Publishing.
Nagel, Thomas, 1974, «What is it like to be a bat?», Philosophical Review 83 (October):435-50.
Nef, Frédérique, 2004, Qu’est-ce que la métaphysique?, Paris: Gallimard.
Peacocke, Christopher, 1983, Sense and Content. Oxford: Oxford University Press.
Putnam, Hilary, 1999, The Threefold Cord New York: Columbia University Press.
Sellars, Wilfrid, 1956, Empiricism and the Philosophy of Mind In Minnesota Studies, The Philosophy of Science Volume 1, edited by H. Feigl and M. Scriven, Minneapolis: University of Minnesota Press. Reprinted by Harvard University Press, Cambridge MA, 1997.
Travis, Charles, 2004, “The Silence of the Senses”, Mind, 113(449): 57–94.
[1] Cf. Austin (1962).












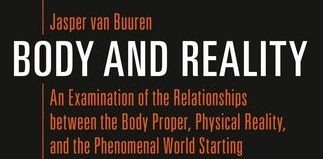


Merci pour cette analyse stimulante montrant l’intérêt de dépasser certains clivages traditionnels de la philosophie de la perception, tels que celui du réalisme direct et du représentationnalisme. Il est intéressant de noter l’identification qui est faite ici (dans l’article précédent particulièrement) entre le représentationnalisme et la thèse du contenu conceptuel, propositionnel ou « proto-propositionnel » de la perception. Il semble toutefois que ce ne soit pas toujours le cas. La dénonciation du « mythe du donné » par Sellars ou McDowell est celle d’un phénoménalisme où le contenu de la perception est compris comme non conceptuel, bien que justifiant les énoncés empiriques. Des penseurs comme Gareth Evans et Peacocke, par exemple, semblent adopter une thèse totalement non conceptualiste du contenu perceptif. Inversement, McDowell, qui s’oppose en ce sens radicalement à Evans, soutient dans Mind and World une thèse directement réaliste, et disjonctive, de l’expérience véridique tout en adoptant un point de vue conceptualiste et propositionnaliste de la perception (cf. « espace des concepts »).
Autre point avec lequel j’émettrais des réserves. Faut-il vraiment concevoir le « caractère phénoménal » de la perception comme un donné introspectif ? On peut fortement en douter. Observer un objet dans ses aspects qualifiés de « phénoménaux », sa couleur par exemple, c’est observer quelque chose qui, clairement, n’est pas soi ou n’apparaît pas comme tel. Lorsque j’éprouve une douleur, je reconnais cette douleur comme étant mienne. Nous sommes bien là dans le registre de l’introspection. Mais lorsque j’observe la couleur bleue d’un ciel dégagé, je ne perçois pas cette couleur comme étant mienne, mais comme étant celle du ciel qui se trouve au-dessus de moi, à l’extérieur de moi. Il ne s’agit donc pas ici d’introspection. La perception n’est en aucune manière introspective, car elle ne relève pas de l’égologie (discours sur soi). Elle nous présente au contraire, y compris dans ses aspects phénoménaux (quels autres aspects a-t-elle d’ailleurs ?), quelque chose qui n’est pas soi, qui n’est pas du moins perçu comme tel.
Dénoncer l’idée même de phénoménalité ou celle de contenu perceptif comme manifestation « coriace » du représentationnalisme, compris lui-même comme internalisme introspectif, me parait donc assez problématique. N’est-ce pas plutôt le réalisme métaphysique, sous ses formes directe ou indirecte, qu’il faudrait dénoncer comme manifestation coriace des « arrières-mondes », ceux dont on parle toujours pour en dire qu’ils existent indépendamment de notre discours ?
Merci de votre commentaire stimulant, Nadji.
Permettez-moi de solliciter des clarifications sur vos suggestions intéressantes et d’essayer d’y répondre.
L’affirmation que la content view a une conception propositionnelle ou proto-propositionnelle du contenu vous parait injustifiée, car, vous dites, il y a plusieurs partisans de la content view tout qui ont une conception non conceptuelle et non propositionnelle du contenu.
Cependant indiquer qu’il existent des partisans de la content view pour qui le contenu n’est pas stricto sensu propositionnel, n’empêche pas que la notion de contenu soit dès le début structuré sur un modèle sémantique, donc propositionnel: la caractéristique principal du contenu est qu’il soit sémantiquement évaluable, donc passible d’être vrai ou faux. On doit pouvoir juger si le contenu correspond ou non à ce qu’il représente. Puisque ce sont les proposition, qui,
à proprement parler, sont vraies ou fausses, je prend la content view pour être tributaire du modèle linguistique, y compris si la plupart d’entre eux (il ne s’agit certes pas que de Peacocke et Evans, mais d’une partie certes majoritaire des philosophes travaillant sur la perception, dont j’en liste quelques uns dans la note 5) essaye de contourner les difficultés du modèle linguistique en introduisant le contenu non conceptuel. Et là toute la difficulté est monter comment un contenu non conceptuel peut néanmoins être vais ou faux.
J’ai été trop rapide sue ce point dans l’article, mais mon but n’était pas ici celui de critiquer la content view, quant pluôtot celui de montrer les tentions au sein de la object view.
Quant à McDowell, vous avez raison: il défend une thèse réaliste et disjonctiviste, à ce point que Mike Martin, par exemple, ne le considère pas comme un représentationnaliste, malgré le langage qu’il utilise, puisque, chez lui, le contenu n’est un intermédiaire qui peut correspondre ou non à la réalité, mais, dans le bon cas, il est la réalité. Cependant, une telle position est tenable seulement dans le cadre de la théorie de l’identité entre vérité et fait de McDowell, qui ne va pas de soi. (Encore une fois, c’est la sémantique qui l’emporte).
Quant au caractère phénoménal, je suis d’accord avec vous: le caractériser comme introspectif est pour peu dire fourvoyant. Cependant, c’est de cette manière qu’il est utilisé dans le débat courant (et j’ai tenu en effet à préciser qu’il s’agit de jargon technique).
D’ailleurs, les partisans de la object view affirment que, même si on pense au caractère phénoménal comme introspectif (comme ce qui émerge quand on dirige l’attention à l’expérience elle-même en tant qu’état mental), ce dont on est conscient est encore le monde extérieur.
Quant à la conclusion que vous tirez, je ne vois bien en quoi il serait contradictoire (si c’est bien cela votre reproche) d’affirmer (dans un discours) que ce dont on parle existe indépendamment de nos discours. Cela m’intéresserait beaucoup si vous pouviez articuler mieux cette critique.
Merci de votre réponse que je n’ai malheureusement pas eu l’occasion de lire plus tôt.
Je crois mieux saisir maintenant l’un des points centraux de votre position : celui de la valeur sémantique (V/F) de tous les énoncés empiriques relevant de la « content view », et donc, en ce sens, du caractère nécessairement propositionnel des contenus de perception. Toutefois, je ne suis pas totalement convaincu par l’idée qu’un contenu de perception, y compris dans son expression linguistique, ait une valeur sémantique, soit nécessairement bipolaire, bien que l’argument de l’illusion puisse nous conduire dans cette direction. Pour reprendre G. Evans (je m’en réfère ici à la lecture qu’en fait Jérôme Dokic), la formulation d’un jugement empirique peut être comprise comme le passage d’un état mental non conceptuel, celui de l’expérience perceptive, à un état mental conceptuel, lorsqu’est formulé le jugement. Elle implique donc un « processus de conceptualisation » de ce qui est perçu sans lequel il ne peut y avoir de croyance empirique, et donc de jugement susceptible d’être vrai ou faux. Préalablement à ce processus, nous ne sommes donc pas dans le registre du propositionnel. Certes, le contenu même de l’expérience, avant toute conceptualisation, est exprimable dans une proposition minimale du type « il y a du bleu », quand j’observe la mer par exemple. Cette proposition implique déjà une identification conceptuelle, celle de la couleur bleue en l’occurrence. Mais, si je ne me trompe pas sur le sens du mot « bleu », il n’est pas possible que je me trompe dans l’expression de mon contenu perceptif : je ne peux pas dire par erreur que je vois du rouge alors que je vois du bleu, car il n’est pas question ici de croyance, mais de fait empirique. Je peux en revanche me tromper dans l’identification des objets du monde, lorsque je dis voir une mer bleue alors que j’ai affaire à un mirage. Car il s’agit ici de croyance empirique. Contrairement, donc, à ce qu’affirme McDowell, il semble qu’on puisse distinguer, au moins en droit, le jugement empirique (conceptuel) du contenu perceptif dont l’expression n’est pas une croyance, n’est pas bipolaire et n’est donc pas à proprement parler propositionnel (n’a pas de valeur sémantique). C’est pourquoi je suis tenté de remettre en cause l’idée que la « content view » est nécessairement tributaire du modèle linguistique.
Concernant McDowell, ce que vous dites confirme ce que j’avais cru comprendre de son livre sur l’Esprit et le monde, qui défend la thèse bien étrange de l’identité du fait et du contenu (conceptuel!) de l’expérience véridique .
Enfin, il est vrai que ma dernière question, trop vague, doit être précisée. Je voulais pointer du doigt la thèse implicite qui semble motiver la critique du contenu intentionnel (perceptif ou autre), thèse métaphysique selon laquelle, pour le dire très simplement, la réalité « extérieure » est, par elle-même, absolument indépendante du sujet, et se situe en tant que telle au-delà des phénomènes et des concepts « subjectifs ». Si l’on admet cette idée, il devient possible de percevoir des choses qui existent indépendamment de notre perception ou de parler de choses qui existent indépendamment de notre discours ou de l’idée que nous nous en faisons. Mais si on refuse cette idée, on doit également rejeter cette possibilité. Or, je ne vois pas bien comment il est possible de concevoir une relation d’extériorité où les deux termes de la relation seraient coupés l’un de l’autre, totalement indépendants au sein même de cette relation… Certes, Russell a argumenté ce point de vue, affirmant la « réalité » ou l’ « extériorité » des relations entre les choses pour justifier le réalisme (indirect dans son cas). Mais s’il est vrai que a et b peuvent être pensés séparément dans la relation « a extérieur à b », un tel schéma ne semble pas applicable aux attitudes propositionnelles. Si, en effet, j’affirme qu’il y a un ordinateur en face de moi, j’affirme à la fois son extériorité par rapport à moi et le fait que je le perçois. Ces deux affirmations sont indissociables, ce que confirme le fait que si je me contente de dire qu’il y a un ordinateur sur la table, extériorité et perception cessent d’être signifiées du même coup. Ce que je perçois ou conçois comme extérieur à moi est nécessairement intentionnel, car dans une attitude propositionnelle, le sujet « je » de la proposition est en quelque sorte « inéliminable », donc nécessaire. Cela revient à dire que la réalité extérieure l’est nécessairement par rapport à moi, dans le cadre d’une relation intentionnelle. Mais cela ne veut surtout pas dire qu’il n’y a pas de réalité extérieure, et que la réalité serait mentale. En bref, la dialectique de l’externalisme (object view ?) et de l’internalisme (content view ?) me semble devoir être dépassée.