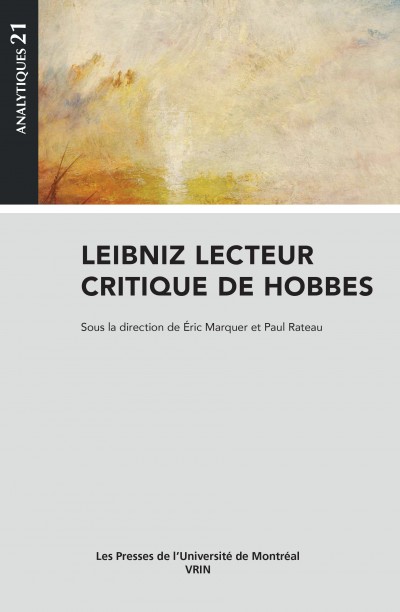Souveraineté et interprétation dans la philosophie de Spinoza
Souveraineté et interprétation dans la philosophie de Spinoza
Marc Lamballais, juriste et philosophe.
Résumé
Dans la philosophie de Spinoza, la souveraineté est envisagée comme la puissance du corps politique en tant qu’elle s’incarne dans la parole d’un petit nombre qui reçoit le pouvoir d’exprimer une certaine parole sur laquelle tous doivent se régler. L’objet de cet article est de montrer que l’interprétation en est alors un attribut fondamental puisque c’est en grande partie au travers d’elle que cette parole s’exprime, et, d’en tirer toutes les conséquences, jusqu’à proposer une nouvelle théorie de la souveraineté, centrée autour de la notion de « chaînes interprétatives ».
Mots-clefs : Spinoza, Souveraineté, Droit, Interprétation, Politique, Kelsen
Abstract
In Spinoza’s philosophy, sovereignty is viewed as the power of the political body as it is exercised by a particular authority which defines certain standards with which the whole group must comply. The aim of this paper is to show that legal interpretation plays a crucial role in that process and to propose, on that basis, a new theory of sovereignty built around the notion of « interpretive chains ».
Introduction
Dans son Traité politique[1], Spinoza envisage la souveraineté (imperium) comme la puissance du corps politique en tant qu’elle s’incarne dans une parole qui fait autorité. Et, de la nature de l’instance dont la parole doit être obéie, dépend le régime d’exercice de la souveraineté. Ainsi, lorsque ce pouvoir revient à un seul homme, le régime est monarchique ; lorsqu’il revient à un petit groupe d’individus choisis, il est aristocratique ; enfin, lorsqu’il échoit à la multitude entière réunie en assemblée, il est démocratique. Dans tous les cas, la souveraineté se construit dans un rapport entre l’instance souveraine et le corps politique, dans lequel le second investit le premier d’une certaine autorité et le premier détermine l’ensemble des contenus normatifs qui s’imposent au second.
 Cette conception est particulièrement intéressante car elle permet d’expliquer l’origine du pouvoir politique et de l’impérativité des lois dans le cadre de la causalité immanente, sans recourir à l’idée d’un fondement transcendant ou à quelque fiction juridique. Pour autant, elle n’est pas sans soulever certaines difficultés, car la simplicité des formes dans lesquelles Spinoza enferme l’exercice de la souveraineté est difficilement conciliable avec le phénomène de multiplication des instances participant au processus de production normative, que nous connaissons aujourd’hui. En effet, si la production juridique émane d’une diversité d’autorités, alors cela doit signifier que chacune de ces autorités participe, à un degré ou à un autre, à la constitution de la parole souveraine. Dès lors, la souveraineté ne peut plus être appréhendée dans le cadre d’un rapport entre le corps politique et un organe unique, et, il devient nécessaire de construire un modèle théorique plus sophistiqué, à même de rendre compte de la place occupée par chaque autorité dans son exercice.
Cette conception est particulièrement intéressante car elle permet d’expliquer l’origine du pouvoir politique et de l’impérativité des lois dans le cadre de la causalité immanente, sans recourir à l’idée d’un fondement transcendant ou à quelque fiction juridique. Pour autant, elle n’est pas sans soulever certaines difficultés, car la simplicité des formes dans lesquelles Spinoza enferme l’exercice de la souveraineté est difficilement conciliable avec le phénomène de multiplication des instances participant au processus de production normative, que nous connaissons aujourd’hui. En effet, si la production juridique émane d’une diversité d’autorités, alors cela doit signifier que chacune de ces autorités participe, à un degré ou à un autre, à la constitution de la parole souveraine. Dès lors, la souveraineté ne peut plus être appréhendée dans le cadre d’un rapport entre le corps politique et un organe unique, et, il devient nécessaire de construire un modèle théorique plus sophistiqué, à même de rendre compte de la place occupée par chaque autorité dans son exercice.
Toutefois, cette entreprise n’est pas chose aisée car, dans la pensée de Spinoza, la souveraineté est envisagée comme un absolu qui ne souffre aucun partage : soit il existe un être souverain qui la détient en totalité, soit la souveraineté n’existe pas. Ainsi Spinoza peut-il écrire que :
Le droit du souverain, qui n’a d’autre limite que sa puissance, consiste principalement en ce qu’il y a une pensée qu’on peut dire être celle du pouvoir public, sur laquelle tous doivent se régler, qui seule détermine le bien, le mal, le juste, l’injuste, c’est-à-dire ce que tous, pris à part ou réunis, doivent faire ou ne pas faire[2].
Par conséquent, une théorie de la souveraineté qui admettrait l’existence de plusieurs organes participant à son exercice ne pourrait être concevable, dans le cadre conceptuel du spinozisme, que si cette théorie admettait l’existence de certaines relations entre ces différents organes, de telle sorte que ceux-ci ne forment pas une simple collection d’autorités disparates mais s’articulent en un tout complexe.
Pour ce faire, une première approche, d’inspiration kelsenienne, pourrait consister à envisager la production normative comme un édifice pyramidal ordonné selon une structure hiérarchique. Selon cette vision, chaque énoncé normatif serait valide par l’effet d’un autre énoncé préexistant, et, corrélativement, chaque producteur d’énoncés recevrait son pouvoir en vertu de textes produits par une instance supérieure et ainsi de suite jusqu’au législateur ordinaire qui produit les lois les plus générales. Le souverain serait alors envisagé comme un ensemble hiérarchisé d’organes chacun pourvu d’une compétence normative dont la portée serait fonction de la position qu’il occupe dans la hiérarchie.
Ce modèle de la pyramide est séduisant mais il rencontre une objection de taille : l’accepter impliquerait d’admettre une certaine conception de l’interprétation qui semble difficilement acceptable – et qui, d’ailleurs, n’est pas celle à laquelle Spinoza lui-même semble se ranger. Si, en effet, l’interprétation est l’acte consistant à déterminer la signification d’un texte normatif en vue de son application à un cas donné, alors elle peut être envisagée de deux manières : soit comme un acte de connaissance – c’est-à-dire, un acte par lequel la signification véritable du texte est simplement retrouvée ou mise en lumière – ; soit comme un acte de volonté – c’est-à-dire, un acte par lequel cette signification est, dans une large mesure si ce n’est en totalité, créée par l’interprète. Et si la première possibilité s’accorde bien avec le modèle pyramidal, il est évident que la seconde tend à le fragiliser considérablement : comment maintenir l’idée d’une hiérarchie bien réglée par des textes normatifs si le contenu de ces textes échappe, en tout ou partie, à leurs auteurs ? Or, les nombreux travaux qui ont été consacrés à la question de l’interprétation par les philosophes du droit, au cours du XXe siècle, ont montré que cette seconde conception de l’interprétation est beaucoup plus vraisemblable que la première[3]. Dans ces conditions, le modèle de la pyramide devient donc difficile à défendre et il devient nécessaire de disposer d’une autre théorie de la souveraineté, à même d’intégrer en son sein la fonction créatrice de l’interprétation. C’est donc la recherche d’une telle théorie alternative qui fera l’objet de cet article.
Pour la construire, il nous faudra d’abord étudier la place respective que le spinozisme peut reconnaître à l’interprétation (1) et à la production législative (2) dans la définition de la parole du souverain. Ceci fait, nous pourrons cheminer vers une nouvelle théorie de la souveraineté centrée autour de la notion de « chaînes interprétatives » (3).
I. La place de l’interprétation dans l’expression de la parole souveraine
1.1. La définition spinoziste de la souveraineté
Pour comprendre la place que Spinoza réserve à l’interprétation dans l’exercice de la souveraineté, il est nécessaire de définir cette dernière notion de façon plus précise que nous ne l’avons fait jusqu’à présent. Dans l’œuvre politique du philosophe, la souveraineté (imperium) est appréhendée comme un droit que la puissance de la multitude confère à un être particulier – le souverain – par lequel celui-ci peut exprimer une parole s’imposant à tous, par la force s’il en est besoin[4]. Cette définition, simple d’apparence, ne peut toutefois être parfaitement comprise que si l’on s’attarde quelques instants sur le vocabulaire du spinozisme. Le premier mot qu’il convient d’expliciter est celui de « droit ». Sous la plume de Spinoza, ce terme revêt un sens radicalement différent de celui que nous lui prêtons habituellement : il n’est ni la contrepartie d’une obligation juridique ou même morale à la charge d’un tiers, ni un avantage profitant à celui qui en est titulaire ; le droit d’un individu n’est nulle autre chose que sa puissance. Droit et puissance entretiennent ainsi, comme le souligne Etienne Balibar, un rapport d’identité stricte dans le sens où « le mot droit (jus) exprime la réalité originaire de la puissance (potentia) dans le langage politique. Mais cette expression n’introduit aucun écart : elle ne signifie ni « émaner de » ni « se fonder sur »[5] ». Ceci indiqué, le terme de « puissance » doit lui aussi être clarifié car, là encore, Spinoza lui confère une signification bien particulière qui n’est pas celle qui lui est usuellement attachée. La puissance est capacité à affecter, c’est-à-dire à produire des effets sur d’autres choses ou d’autres individus[6]. Et dans l’ontologie de Spinoza, toute puissance est nécessairement en acte, ce qui signifie qu’il n’est aucune puissance qui ne soit effectuée en totalité à chaque instant : pouvoir c’est faire et faire c’est pouvoir, et, corrélativement, un individu ne fait jamais que ce qu’il est en droit de faire. La souveraineté ne désigne donc pas un office ou un ensemble de prérogatives mais un fait : le fait par lequel le plus grand nombre accepte la parole émise par quelques-uns comme devant s’imposer à tous. En d’autres termes, l’on peut dire avec Alexandre Matheron qu’« est Souverain de droit celui qui, parce que tous l’acceptent, a le pouvoir de faire exécuter sa volonté par le corps social tout entier. Tant qu’il y parvient, il reste Souverain ; aussitôt qu’il perd ce pouvoir, il perd aussi son droit[7] ».
Cette définition conduit également à reconnaître l’existence d’un lien étroit entre souveraineté et production normative juridique puisque définir ce qui doit s’imposer à tous de gré ou de force, c’est bien déterminer le contenu des règles de droit, c’est-à-dire de toutes les règles qui sont sanctionnées par ce que Kelsen appelle un « acte de contrainte[8] », qu’il définit comme « un mal – tel que le retrait de la vie, de la santé, de la liberté, de biens économiques et autres – qui doit être infligé à celui qu’il atteindra, même contre son gré, et, si besoin est, en employant la force physique[9] ». Le souverain peut ainsi être envisagé comme l’être qui, de fait, définit le contenu des règles de droit observées au sein du groupe, c’est-à-dire celui qui est doté des trois pouvoirs principaux, que sont les pouvoirs « d’établir, d’interpréter, et d’abroger les lois[10] », desquels d’autres, plus secondaires, dérivent : pouvoirs de « défendre les villes, de décider de la guerre et de la paix, etc. [11] ». Et ces différents pouvoirs peuvent être regroupés en deux attributs fondamentaux : l’attribut législatif, détenu par celui qui exerce le pouvoir de produire, modifier ou supprimer des énoncés normatifs, et l’attribut interprétatif, détenu par celui exerce le pouvoir d’interpréter de tels énoncés.
1.2. Le poids de l’interprétation
Loin de conférer à l’interprétation une place accessoire dans ce diptyque, Spinoza lui attache, au contraire, une grande importance, comme cela transparaît clairement dans un passage du Traité politique :
Nous ne pouvons en outre concevoir qu’il soit permis à chacun d’interpréter les décrets de la Cité, c’est-à-dire ses lois. S’il avait cette licence, il serait en effet son propre juge, il n’y aurait point d’actes accomplis par lui, qu’il ne pourrait rendre excusables ou louables avec une apparence de droit, et conséquemment il réglerait sa vie selon sa complexion, ce qui […] est absurde[12].
Dans ce paragraphe, Spinoza entend démontrer que l’interprétation participe nécessairement de la souveraineté car si le souverain en est privé, si donc quiconque peut librement interpréter les lois de la Cité, alors nul n’est véritablement soumis à ces lois car tous peuvent prétendre que leurs actes y sont conformes. Par conséquent, le droit du souverain perd toute substance. Pour cette raison, « au souverain seul appartient d’établir des lois et quand une question se pose à leur sujet, de les interpréter dans chaque cas particulier et de décider si une espèce donnée est contraire ou conforme au droit[13] ». Cette démonstration a pour corollaire l’idée que l’interprétation est un mode d’énonciation de la parole souveraine, au même titre que l’établissement des lois et des autres textes normatifs. En effet, si celui qui dispose du pouvoir d’interpréter les lois dispose du pouvoir de rendre tous ses actes conforme à la loi, alors cela signifie qu’il détient le pouvoir de construire, au moins pour partie, le sens du texte qu’il interprète. Sur ce point, le spinozisme peut donc s’accorder avec les découvertes les plus récentes de la philosophie du droit.
Mais alors, il reste à déterminer la mesure dans laquelle le sens des textes procède de l’interprétation. À cette question, Spinoza n’apporte pas de réponse. Toutefois, certains théoriciens du droit comme Michel Troper ont montré[14], de façon à notre avis convaincante, que l’interprétation construit intégralement le sens du texte interprété, qui ne lui préexiste pas. Pour apporter cette démonstration, Troper met en avant une série d’arguments. En premier lieu, il fait valoir qu’une interprétation « authentique » – l’expression est empruntée à Kelsen –, c’est-à-dire une interprétation à laquelle l’ordre juridique attache des effets, ne peut jamais être contraire au sens de la loi interprétée. En effet, la particularité de l’interprétation authentique est précisément qu’elle « s’impose quel que soit son contenu[15] » et constitue donc « le seul standard juridiquement incontestable[16] » sur la base duquel on peut juger une autre interprétation conforme ou contraire au sens véritable du texte. En deuxième lieu, Troper montre que le sens des textes n’est jamais réductible à l’intention de leur auteur. D’abord, l’idée même d’une intention de l’auteur des lois soulève de nombreuses difficultés compte tenu de la complexité des processus législatifs que nous connaissons aujourd’hui. Mais même en admettant qu’une intention claire et univoque puisse être trouvée, réduire le sens de la loi à cette intention poserait un trop grand nombre de problèmes pratiques. Si, en effet, le juge ne prenait en considération que ce qu’il sait de la volonté du législateur, alors, il ne pourrait jamais appliquer le texte que dans les quelques cas ayant été envisagés par avance par celui-ci et refuser de juger dans les autres cas. Partant, dans la plupart des affaires, le juge doit se représenter ce que serait la volonté du législateur, ce qui fait dire à Michel Troper que « l’interprétation conformément à l’intention est donc toujours une construction de l’interprétation[17] ». En troisième lieu, enfin, Michel Troper montre qu’il n’existe pas de sens objectif d’un texte qui soit indépendant de l’intention de son auteur. À chaque texte, il est possible d’accoler une diversité de sens selon la méthode d’interprétation utilisée. Ainsi, l’interprétation littérale donnera le sens littéral, l’interprétation fonctionnelle le sens fonctionnel, l’interprétation téléologique le sens téléologique, etc. Rechercher la signification intrinsèque des textes normatifs ne mène qu’à des apories : où que l’on croit la saisir, elle se dérobe. Aussi, Troper nous invite-t-il à abandonner l’idée de son existence même : la seule signification véritable d’un texte est celle qui lui est conférée par l’interprétation authentique. Avant cette interprétation, « les textes n’ont encore aucun sens, mais seulement une attente de sens[18] ».
Mais est-ce à dire que le législateur n’aurait aucun rôle à jouer dans le processus de production des contenus normatifs ? Il est évident qu’on ne peut répondre par l’affirmative car cela conduirait à nier tout pouvoir souverain au législateur et à faire de l’interprétation l’attribut exclusif de la souveraineté. Or, cette conclusion ne s’accorderait pas avec la conception spinoziste de la souveraineté qui intègre l’activité législative comme l’une de ses composantes essentielles. C’est donc que le législateur a un rôle à jouer. C’est ce rôle qu’il nous faut à présent examiner.
II. L’activité législative comme détermination d’un cadre contraignant pour l’interprète
2.1. Les limites du pouvoir de l’interprète
Pour comprendre les limitations qui existent au pouvoir de l’interprète, il faut revenir à ce qui constitue l’essence même de la souveraineté chez Spinoza, à savoir, le fait de l’acceptation par le groupe d’une certaine parole exprimée par quelques-uns comme devant s’imposer à tous.
Fondamentalement, la souveraineté est donc un fait de reconnaissance sociale : reconnaissance d’une certaine autorité ou d’une certaine légitimité au profit de certaines entités. Et ceci permet de comprendre aisément la limite profonde du pouvoir de l’interprète : s’il paraît s’arroger un pouvoir qu’il n’est pas reconnu comme légitime ou ayant autorité à exercer, alors ses décisions se trouveront privées d’effet. Par conséquent, l’interprète doit donner à croire qu’il se borne à faire respecter la volonté du législateur, ce qui suppose qu’il ne s’éloigne pas au-delà d’un certain point de ce qu’il imagine être la décision que le législateur aurait lui-même prise s’il avait dû trancher, et, c’est précisément dans cette nécessité que le législateur trouve son propre pouvoir.
Bien entendu, nous n’avons fait là qu’exposer le mécanisme de reconnaissance sociale sous sa forme la plus élémentaire, comme relation directe entre la multitude et l’organe reconnu. Mais il est bien évident que ce mécanisme tendra à se présenter sous des formes plus sophistiquées dans les États dont la structure institutionnelle est très éclatée. En effet, si plusieurs institutions se sont vues reconnaître une certaine légitimité à exercer un droit souverain, alors ce qu’elles sont chacune prêtes à accepter comme s’imposant à elles en vertu de l’imperium s’intègre naturellement parmi les éléments constitutifs de la reconnaissance sociale bénéficiant aux autres institutions de l’État. Dès lors, ces différentes institutions acquièrent le pouvoir de s’opposer les unes aux autres ou de se conforter les unes les autres, pouvoir dont la mesure est constituée par ce que la multitude est prête à reconnaître, selon le cas, comme l’opposition légitime d’un organe à la tentative d’un autre organe de s’arroger une prérogative qu’il n’a pas vocation à exercer, ou comme le soutien légitime conféré par un organe à l’entreprise d’un autre organe. Et à mesure que la spécialisation normative augmentera, ce phénomène s’intensifiera, si bien que la reconnaissance tendra à s’exercer de moins en moins au travers d’une relation directe entre l’organe reconnu et la multitude elle-même, et de plus en plus d’une façon médiate, par l’intermédiaire d’autres organes. Ainsi, dans l’État moderne, la reconnaissance sociale tendra à s’exprimer non pas tant comme ce que la multitude elle-même accepte ou refuse, mais plutôt comme ce que la configuration institutionnelle de l’État autorise à chaque organe souverain à un moment donné. Dans ces conditions, les limites du pouvoir de l’interprète se manifesteront à lui sous la forme de ce que Michel Troper appelle des « contraintes juridiques[19] », à savoir, des contraintes matérielles induites par le fonctionnement même du système juridique[20], dont Troper donne quelques exemples : une contrainte juridique existe ainsi lorsqu’un individu ou un organe se trouve placé « dans une situation telle qu’il lui faut se comporter d’une certaine manière pour agir de façon raisonnable et efficace[21] » ou encore lorsque les rapports entre plusieurs autorités sont organisés « de telle manière que le pouvoir discrétionnaire des uns dissuade les autres d’exercer leur propre pouvoir discrétionnaire de façon excessive[22] ». La validité d’une interprétation se conçoit alors comme l’adéquation sociale d’un discours de justification dans le cadre duquel l’interprète met en relation sa décision avec un énoncé normatif posé comme fondement de cette décision :
Si [la] mise en relation [entre la décision et l’énoncé] est considérée comme adéquate dans la société considérée, ce qui est une question de fait, la décision est considérée comme justifiée et l’on peut dire qu’elle présente le caractère d’une norme. Le système juridique n’est alors pas autre chose qu’un système de justification[23].
Ceci peut être illustré par un exemple assez simple : imaginons que la Cour de cassation française, juridiction suprême de l’ordre judiciaire, sur la base d’une interprétation inédite d’un article du Code de la route, estime qu’un simple délit de stationnement gênant doive désormais être puni d’une lourde peine de prison. Que se passerait-il alors ? De toute évidence, cette décision serait immédiatement contestée par d’autres institutions. La Cour de cassation se heurterait à la résistance des tribunaux de première instance et des cours d’appel qui refuseraient d’adopter des solutions analogues ou interpréteraient les énoncés contenus dans sa décision d’une manière telle qu’ils seraient insusceptibles de fonder de telles solutions ; le Parlement s’empresserait de supprimer ou modifier le texte en question, de manière à priver l’interprétation de la Cour de cassation de sa base de justification, etc. À cela, il faudrait ajouter les mesures qui pourraient être prises contre les magistrats à titre personnel : ils ne verraient probablement pas leur mandat renouvelé, leurs carrières s’en trouveraient mises en péril, etc.
Fondamentalement, ces résistances que rencontreraient la Cour et ses membres ne seraient que l’expression d’une carence de reconnaissance sociale : c’est parce que la Cour ne serait pas reconnue comme légitime à interpréter le texte de la sorte que sa décision se trouverait privée de tout effet ; simplement, cette carence s’exprimerait dans un ensemble de relations interinstitutionnelles bien plus qu’au travers de la relation directe entre la Cour et la multitude.
2.2. Signification et champ de significations
Tout ceci nous permet de clarifier la nature des pouvoirs respectifs du législateur et de l’interprète. Nous l’avons dit, l’interprète détermine la signification du texte mais jusqu’à un certain point seulement : celui que définit la reconnaissance sociale dont il bénéficie et qui s’exprime au travers des contraintes juridiques qu’il rencontre. Partant, la signification du texte se conçoit comme le produit commun de l’action du législateur et de celle de l’interprète. Cependant, la cause n’en est pas, comme le pensait Herbert Hart, que le texte interprété contiendrait déjà un noyau dur sémantique entouré d’une « zone de pénombre[24] » qu’il reviendrait à l’interprétation de combler ; mais plutôt que l’auteur du texte, lorsqu’il produit ce texte, définit un certain périmètre dans le cadre duquel l’interprète devra nécessairement inscrire sa décision.
Par conséquent, le pouvoir souverain de l’auteur d’un texte normatif n’est pas pouvoir de fixer un noyau dur de signification mais pouvoir de déterminer ce qu’il convient d’appeler un champ de significations, c’est-à-dire, un ensemble contenant toutes les interprétations susceptibles d’être attachées à ce texte à un moment donné, par un interprète donné. Corrélativement, le pouvoir de l’interprète consiste à attribuer au texte un sens compris dans ce champ de significations. Bien entendu, il est impossible d’identifier a priori l’étendue du champ. Ce n’est qu’après avoir constaté qu’une interprétation a ou n’a pas été acceptée comme légitime ou faisant autorité dans une certaine configuration institutionnelle que l’on pourra juger, selon le cas, qu’elle était ou n’était pas comprise dans le champ de significations posé par le producteur du texte interprété, tel qu’il existait pour l’interprète au moment de l’interprétation.
Cette conclusion implique également une conséquence importante : chaque fois qu’un individu qui prend connaissance d’une loi pense obéir à la règle qu’elle exprime, il se trompe puisque, au moment où il lit cette loi, seule la moitié du processus normatif a été entreprise et la règle de droit – qui est la signification conférée par l’interprète au texte qui l’exprime – n’a pas encore été déterminée. À ce stade, seul existe le champ de significations qui en fixe le cadre possible et qui n’est qu’imparfaitement connaissable. Ceci explique que certaines pratiques fondées sur l’existence alléguées de certaines règles puissent être ultérieurement désavouées par une instance juridictionnelle, ce qui arrive fréquemment. L’on peut toutefois tempérer quelque peu ce propos en soulignant que les décisions des juridictions présentent généralement un certain degré de prédictibilité. En effet, le mécanisme de la reconnaissance sociale les incite à rendre des décisions cohérentes avec celles qui ont été prises par d’autres instances souveraines et avec celles qu’elles ont-elles-mêmes rendues par le passé. Partant, une étude des décisions passées a de bonnes chances d’aboutir à des estimations fiables sur ce que seront les décisions futures, bien qu’il existe de nombreux cas dans lesquels cette méthode échouera.
III. Le modèle des « chaînes interprétatives »
3.1. Le caractère relatif de la règle
À présent que nous cernons mieux la nature du pouvoir d’interprétation et les rapports qu’il entretient avec le pouvoir législatif, nous pouvons cheminer vers une nouvelle conception de la souveraineté pouvant se substituer au modèle de la pyramide que nous avons critiqué au début de cet article. Avant toutefois de formuler nos dernières conclusions, nous devons ajouter une nouvelle pierre à l’édifice. En effet, les propositions que nous avons jusqu’ici acceptées nous amènent à retenir une acception assez inhabituelle de la notion de règle de droit, et, ce n’est qu’après avoir clarifié cette dernière notion que nous pourrons achever notre démonstration.
Nous avons dit que la règle de droit était la signification conférée par l’interprète au texte interprété. Mais quelle est au juste la nature de cette signification ? Pour le comprendre, il est nécessaire d’analyser le processus d’application de la règle. Ce processus semble pouvoir être décrit comme suit : l’interprète rencontre un énoncé normatif et forme une certaine représentation de ce que cet énoncé normatif prescrit, puis, il rencontre certaines conditions qu’il identifie comme celles dans lesquelles la prescription s’applique, puis enfin, il prend une décision. La signification du texte apparaît ainsi comme une représentation de ce qui doit être ou peut être en vertu de l’énoncé rencontré par l’interprète. Elle est donc une idée, c’est-à-dire, conformément à la thèse « paralléliste »[25] de Spinoza, l’image dans l’esprit de l’interprète, des modifications produites sur son corps[26].
Cette thèse du parallélisme peut être expliquée de la façon suivante. Toute chose possède, pour Spinoza, une certaine puissance qui s’exprime simultanément dans l’attribut de l’étendue comme puissance d’agir et dans celui de l’âme comme puissance de penser, de sorte que l’enchaînement des actions suit exactement celui des pensées et inversement. Cette puissance des choses, comme nous l’avons dit plus haut, s’effectue nécessairement à tout instant et, ce faisant, produit des effets sur d’autres choses, les modifiant et participant ainsi à déterminer la manière dont elles effectueront à leur tour leur propre puissance. Partant, la conduite des hommes est toujours déterminée par les choses qu’ils rencontrent et qui les modifient ; modifications qui se présenteront à la fois comme des changements corporels et comme les idées qui leurs correspondent. En particulier, chaque rencontre induit certaines variations de la puissance du corps modifié ; c’est ce que Spinoza appelle des affects[27]. Il existe trois affects « primitifs » – dont tous les autres ne sont que des dérivations – : la joie, la tristesse et le désir. La première est augmentation de la puissance d’agir et de penser de l’individu ; la deuxième est diminution de cette même puissance ; enfin le dernier est l’effort (conatus) déployé en retour par l’individu, qui le conduit à mettre son corps en mouvement en vertu d’un mécanisme dont Spinoza décrit ainsi le processus fondamental :
Tout ce que nous imaginons conduire à la joie, nous nous efforçons de le faire se produire ; mais ce que nous imaginons lui être contraire, autrement dit conduire à la tristesse, nous nous efforçons de l’écarter ou de le détruire[28].
La nature des affects générés par le corps est bien-sûr fonction de l’action de la chose qui le modifie mais également de la nature du corps modifié. Car tout corps constitue ce que Pierre-François Moreau appelle un « complexe passionnel[29] » forgé au gré des rencontres qu’il expérimente, qui peuvent parfois le modifier de façon profonde, jusqu’à influencer la structure même du complexe et, par-là, la manière dont le corps pourra être modifié à l’avenir. Par suite, chaque individu a une manière unique d’être modifié, qui se modifie elle-même au cours du temps, et qui peut être plus ou moins proche de celles d’autres individus selon la proximité entre sa trajectoire biographique et la leur. Cette manière unique d’être affecté, Spinoza l’appelle l’ingenium.
La notion d’ingenium permet ainsi de mieux saisir la nature du mécanisme par lequel la signification du texte est produite. L’interprète a vécu un certain nombre d’expériences : il a suivi une certaine formation juridique, il a acquis certaines habitudes propres à l’exercice de ses fonctions, etc. Ces habitudes ont forgé en lui un certain ingenium, une certaine manière d’être modifié par la rencontre avec l’énoncé normatif. Puis, cette rencontre advient et génère en lui plusieurs modifications : des modifications superficielles qui lui donne une première idée très générale de la signification du texte ; mais aussi des modifications de son ingenium qui détermineront la manière dont il réagira lorsqu’il se trouvera dans les circonstances qu’il a identifiées comme celles dans lesquelles le texte s’applique. Enfin, lorsque ces circonstances se présentent, l’interprète en est modifié d’une manière qui fasse naître en lui la signification achevée du texte, c’est-à-dire, ce qui peut ou doit être dans la situation qui se présente à lui en vertu de la règle de droit. Cette signification peut être plus ou moins précise selon qu’elle se manifeste à l’interprète comme la représentation d’un pouvoir ou d’un devoir enfermé dans des modalités bien définies ou comme l’idée confuse d’une permission ou d’une obligation. Mais dans l’un ou l’autre cas, c’est bien cette idée qui constitue la signification du texte pour l’interprète, et, c’est donc à cette idée que correspond la règle de droit.
Une objection pourrait toutefois être formulée : si l’interprète était un organe collégial, nous serions conduits à appréhender la signification comme l’idée, non d’un individu, mais de plusieurs individus réunis en un groupe, ce qui semble faire naître une difficulté. Mais en réalité il n’en est rien car la philosophie de Spinoza ne fait aucunement de la pensée une spécificité du corps humain. Tout ce qui a une existence dans l’étendue existe également dans la pensée. Partant, dès lors que plusieurs corps humains composent ensemble leurs rapports pour former un complexe passionnel plus vaste, alors ce complexe a lui-même une âme qui est le reflet, dans l’attribut de la pensée, de l’état des interactions entre les individus qui le constituent. Conséquemment, lorsque les membres d’un organe expriment leurs avis sur ce que doit être la décision, en discutent puis délibèrent pour la faire advenir, ils produisent une certaine idée commune de ce qu’est la règle qui n’est pas la leur propre mais celle de l’ensemble : celle de l’organe lui-même.
Dans tous les cas, la règle de droit n’est pas un élément objectivable : puisqu’elle est une idée, elle ne peut être exprimée que par un énoncé qui la décrive et dont la signification ne pourra être établie qu’au travers d’une nouvelle interprétation. Cette interprétation ne donnerait donc pas l’idée du premier interprète mais celle du second tel qu’il serait modifié par l’effet de sa rencontre avec l’énoncé produit par le premier. En conséquence, la règle de droit est toujours relative : relative à un interprète et relative à la situation dans laquelle il l’applique. Elle ne peut pas franchir les barrières de l’expérience subjective vécue par l’interprète au moment de l’interprétation. Seuls peuvent être objectivés l’énoncé qui constitue son fondement et l’énoncé qui la décrit. Les tiers n’ont donc jamais accès à la règle de droit. Tout au plus, ils peuvent se faire une certaine représentation ce qu’elle a été par le passé et pourra être à l’avenir, à partir de l’examen des énoncés normatifs existants et des décisions qui ont été prises sur leur fondement.
3.2. Les « chaînes interprétatives »
Dès lors que nous admettons que la règle de droit est relative, la souveraineté doit se concevoir comme la production conjointe par divers organes d’un ensemble de « chaînes interprétatives ». Lorsqu’un organe produit un texte, celui-ci peut en effet avoir deux sorts possibles. Premièrement, le texte peut demeurer à l’état d’énoncé normatif. Cela ne signifie pas qu’il n’aura aucune efficacité. Il se peut que les individus composant la multitude rencontrent l’énoncé et en soient affectés d’une manière telle qu’ils chercheront à obéir à ce qu’ils imaginent être son contenu. Mais si aucun autre organe souverain ne vient interpréter le texte, alors la règle de droit qu’il décrit n’est jamais produite et la chaîne reste à l’état embryonnaire, constituée d’un seul maillon. Toutefois, le texte peut également être saisi par une autre instance souveraine qui, dans une certaine situation, estime avoir le pouvoir de l’interpréter et de l’appliquer. Dans ce cas, la règle de droit sera produite et l’interprète l’appliquera en produisant lui-même quelque chose de nouveau : soit un autre énoncé normatif – par exemple, dans le cas d’un juge qui trancherait un litige et rendrait une décision judiciaire –, soit une action matérielle – par exemple, dans le cas d’un agent de police qui procéderait à l’arrestation d’un suspect. Dans cette seconde hypothèse, une véritable chaîne interprétative – c’est-à-dire une chaîne dont les maillons sont liés entre eux par une interprétation – sera initiée ; et si le produit de l’interprète est un nouvel énoncé, alors cette chaîne pourra se poursuivre : un autre organe pourra se saisir de cet énoncé et l’interpréter à son tour et ainsi de suite jusqu’à ce qu’un énoncé normatif ultime ou une action de fait vienne clore la chaîne.
Ainsi, les pouvoirs des différents organes sont déterminés, d’une part, par ce que chacun est capable d’ajouter à une chaîne interprétative nouvelle ou préexistante et, d’autre part, par ce que les autres organes vont ajouter à leur tour à cette chaîne. Ceci signifie qu’un organe peut s’auto-attribuer une vaste compétence – voire même s’auto-instituer – pour peu qu’il parvienne à se saisir d’un texte (qu’il peut éventuellement produire lui-même), à l’interpréter de façon à se conférer les pouvoirs souhaités et à attacher au produit de son interprétation des décisions d’autres organes consolidant la chaîne. La célèbre décision « liberté d’association » du Conseil constitutionnel français de 1971[30] en livre un exemple éloquent. Dans cette décision, le conseil s’est, par un complet revirement de jurisprudence, estimé compétent pour contrôler la conformité des lois non seulement aux règles inscrites dans le corps de la Constitution de 1958, mais également dans son préambule, et, par l’effet de renvois qui s’y trouvent, dans le préambule de la Constitution de 1946 et dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Ce faisant, il a considérablement élargi ses compétences et pouvoirs sans qu’aucun changement ne soit intervenu dans la législation. S’y sont ensuite ajoutées d’autres décisions complétant et solidifiant la chaîne interprétative : les tribunaux ont rendu des décisions sur le fondement de la loi telle qu’amputée par le Conseil constitutionnel des dispositions jugées inconstitutionnelles ; le Gouvernement et le Parlement ont considéré qu’ils seraient à l’avenir privés de la possibilité de faire figurer certaines dispositions dans la loi, etc.
Ce ne sont donc pas des liens hiérarchiques qui structurent les relations entre les organes participant à la constitution de la parole souveraine mais des liens interprétatifs. C’est en liant des productions textuelles les unes aux autres par des interprétations que les organes définissent l’étendue de leur propre pouvoir et participent à la définition de celui des autres. Bien entendu, dans certains cas, la structure produite peut apparaître sous une forme très hiérarchique. Ainsi en va-t-il dans le cas où, par exemple, le Parlement adopte une loi, ensuite interprétée par l’administration qui l’applique par un décret, lui-même interprété par une autre administration qui produit un arrêté, etc. Dans ce cas, la structure hiérarchique vient du fait que chaque organe se reconnaît subordonné à l’organe dont il interprète les énoncés et agit comme tel. Cependant, il n’en va pas toujours ainsi. La décision du Conseil constitutionnel de 1971 que nous venons de citer en livre un bon exemple. Dans cette affaire, il est impossible d’identifier une relation hiérarchique entre les différents organes qui ont produit les textes interprétés – dont certains, comme l’assemblée constituante de 1789 ou le Parlement de la IVe République, n’existent plus – et l’interprète.
Les liens interprétatifs que les organes nouent entre eux remplissent ainsi la fonction unificatrice permettant la constitution du complexe souverain. En interprétant des énoncés antérieurement produits et en en produisant de nouveaux, les organes se positionnent les uns par rapport aux autres et se distribuent l’autorité qui revient à chacun. La souveraineté tend ainsi à être appréhendée comme un réseau complexe de relations entre différentes instances liées entre elles du fait que les unes se réfèrent à des énoncés produits par les autres et les interprètent pour justifier leurs propres décisions, au sein d’un cadre dans lequel chacune ne peut faire que ce qui est adéquat à la configuration institutionnelle d’ensemble.
Bibliographie
Etienne Balibar, Spinoza et la politique, éd. PUF, Paris, 1984.
Gilles Deleuze, Spinoza, philosophie pratique, éd. Les éditions de minuit, Paris, 1981/2003.
Ronald Dworkin, Le positivisme in Droit et Société, n°1, 1985, pp. 31-50.
Ronald Dworkin, La théorie du droit comme interprétation in Droit et société, n°1, 1985, pp. 81-92.
Riccardo Guastini, « Les juges créent-ils du droit ? », in Revus, n°24, 2014, pp.99-113.
Herbert L.A. Hart, The concept of law, ed. Oxford University Press, Oxford, 2012.
Herbert L.A. Hart, Le positivisme et la séparation du droit et de la morale, in Philosophie du droit, textes réunis par Christophe Béal, éd. Vrin, Paris, 2015, pp. 193-227.
Hans Kelsen, Théorie pure du droit, éd. LGDJ, Paris, 1999.
Alexandre Matheron, Individu et communauté chez Spinoza, éd. Les éditions de minuit, Paris, 1988.
Pierre-François Moreau, Spinoza. L’expérience et l’éternité, éd. PUF, Paris, 1994.
Etienne Picard, Contre la Théorie réaliste de l’interprétation juridique in Revue juridique de l’USEK, n°10, 2009, pp. 21-110.
Emmanuel Picavet, Kelsen et Hart. La norme et la conduite, éd. PUF, Paris, 2000.
Alf Ross, On Law and Justice, ed. The Lawbook Exchange Ltd., Clark, New Jersey, 2004.
Baruch Spinoza, l’Éthique, trad. Charles Bolduc, Les classiques des sciences sociales, bibliothèque numérique, Chicoutimi, Ville de Saguenay, Québec, 2013.
Baruch Spinoza, Traité politique, trad. Charles Appuhn, éd. GF Flammarion, Paris, 1966.
Michel Troper, Pour une théorie juridique de l’État, éd. PUF, Paris, 1994.
Michel Troper, La théorie du droit, le droit, l’État, éd. PUF, Paris, 2001.
[1] Baruch Spinoza, Traité politique, trad. Charles Appuhn, éd. GF Flammarion, Paris, 1966.
[2] Baruch Spinoza, Traité politique, op.cit., p. 19 (c’est moi qui souligne).
[3] Pour quelques exemples voir notamment : Alf Ross, On Law and Justice, ed. The Lawbook Exchange Ltd., Clark, New Jersey, 2004, pp. pp. 108-157 ; Riccardo Guastini, « Les juges créent-ils du droit ? », in Revus, n°24, 2014, pp.99-113 ; Ronald Dworkin, La théorie du droit comme interprétation in Droit et société, n°1, 1985, pp. 81-92 ; Michel Troper, La théorie du droit, le droit, l’État, éd. PUF, Paris, 2001, pp. 69-84.
[4] Voir Traité politique, Chapitre II, §16 et §17 (Ibid., p. 21).
[5] Etienne Balibar, Spinoza et la politique, éd. PUF, Paris, 1984, p.73.
[6] Voir l’entrée « puissance » dans l’index des principaux concepts du spinozisme de Gilles Deleuze (Gilles Deleuze, Spinoza, philosophie pratique, éd. Les éditions de minuit, Paris, 1981/2003, p.128).
[7] Alexandre Matheron, Individu et communauté chez Spinoza, éd. Les éditions de minuit, Paris, 1988, p.331.
[8] Hans Kelsen, Théorie pure du droit, éd. LGDJ, Paris, 1999, p.41.
[9] Idem.
[10] Baruch Spinoza, Traité politique, op.cit., p.21 (c’est moi qui souligne).
[11] Idem.
[12] Ibid., p. 14.
[13] Ibid., p. 19 (c’est moi qui souligne).
[14] Voir Michel Troper, La théorie du droit, le droit, l’État, op.cit., pp. 69-84.
[15] Ibid., p.71.
[16] Ibid., p.72.
[17] Ibid., p.73.
[18] Ibid., p.74.
[19] Michel Troper, La théorie du droit, le droit, l’État, op.cit., p. 94.
[20] Voir notamment, Michel Troper, La théorie du droit, le droit, l’État, op.cit., pp. 85-97 ; Etienne Picard, Contre la Théorie réaliste de l’interprétation juridique in Revue juridique de l’USEK, n°10, 2009, p.23-24.
[21] Michel Troper, La théorie du droit, le droit, l’État, op.cit., p. 95.
[22] Idem.
[23] Michel Troper, Pour une théorie juridique de l’État, éd. PUF, Paris, 1994, p.174.
[24] Herbert L.A. Hart, The concept of law, op. cit., p.123 ; cette expression est également utilisée par Hart dans son article Le positivisme et la séparation du droit et de la morale, in Philosophie du droit, textes réunis par Christophe Béal, éd. Vrin, Paris, 2015, p. 203.
[25] Même si ce terme est en réalité quelque peu impropre comme l’on fait remarquer divers commentateurs.
[26] Voir l’entrée « idée » dans l’index des principaux concepts du spinozisme de Gilles Deleuze (Gilles Deleuze, Spinoza, philosophie pratique, op.cit., p. 101).
[27] Voir l’entrée « affections, affects » dans l’index des principaux concepts du spinozisme de Gilles Deleuze (Ibid., p. 66).
[28] Spinoza, Ethique, op. cit., p.152.
[29] Pierre-François Moreau, Spinoza. L’expérience et l’éternité, éd. PUF, Paris, 1994, p.396.
[30] Décision du Conseil constitutionnelle n°71-44 DC du 01/07/1971 relative à la loi « complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ».