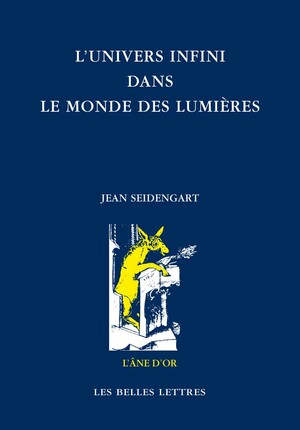Sous l’expérience esthétique – Introduction
Sous l’expérience esthétique. Introduction au dossier « Repenser l’interdisciplinarité entre esthétique et neurosciences cognitives »
Dossier coordonné par :
Donna Jung, ATER en esthétique à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, rattachée à l’Institut Acte.
Bruno Trentini, maître de conférences en esthétique et théorie des arts plastiques, Université de Lorraine, ÉCRITURES, F-57000 Metz, France
Résumé
Que se passe-t-il sous l’expérience esthétique ? Si une partie de la neuroesthétique faite par les neuroscientifiques cherche des éléments de réponse, l’esthétique faite par la philosophie et les sciences humaines peuvent participer à impulser leurs investigations. Une telle interdisciplinarité permettrait notamment de réduire l’écart entre la neuroesthétique et l’art, notamment l’art contemporain. En effet, autant l’expérience esthétique peut s’étudier indépendamment de l’art, autant il est dommage que leur éloignement soit le fait de contingences disciplinaires. La neuroesthétique est ainsi par exemple invitée à développer encore davantage ses recherches ne portant pas sur le beau – catégorie esthétique peu investie par les pratiques artistiques contemporaines. Les articles réunis dans ce dossier proposent des pistes pour fonder une neuroesthétique apte à décrire l’expérience artistique. De l’analyse épistémologique à l’expérimentation interdisciplinaire, différentes pratiques de l’art contemporain engagent une réflexion esthétique sur le déséquilibre, l’affordance, l’empathie ou encore les états modifiés de conscience.
Mots-clés : Neuroesthétique, art contemporain, approches éco-évolutives, philosophie de l’art, expérience esthétique
Abstract What happens under the aesthetic experience? A part of neuroaesthetics, made by neuroscientists, looks for answers to that question. But aesthetics made by philosophy and humanities can help to give impulse to their investigations. Such interdisciplinarity would help reducing the gap between neuroaesthetics and art, especially contemporary art. Indeed, even if the aesthetic experience can be studied independently from art, it is a pity that their distance comes from mere academic contingencies. Neuroaesthetics is thus invited to further develop its research of other aesthetic categories than beauty (which is not so central in contemporary art). The papers gathered in this special issue propose ways to lay fundations that would enable neuroaesthetics to describe accurately the aethetic experience. From epistemological analysis to interdisciplinary experimentation, various practices in contemporary art push aesthetics to build a reflection on imbalance, affordance, empathy or altered states of consciousness.
Keywords : Neuroaesthetics, contemporary art, eco-evolutive approaches, philosophy of art, aesthetic experience
De nombreuses études épistémologiques ont porté sur les investigations des neurosciences cognitives dans le domaine de l’esthétique[1]. Plus que de prolonger la question épistémologique, ce dossier regroupe quelques pistes de réflexions, voire d’expérimentations, pour repenser une interdisciplinarité en accord avec les préoccupations de l’esthétique philosophique contemporaine. Sans perdre de vue l’étude des différentes pratiques artistiques contemporaines, il s’agit de discerner ce par quoi l’expérience esthétique advient, ce qu’il y a sous l’expérience esthétique[2].
 Depuis le tournant cognitiviste des années 1970, l’essor interdisciplinaire des neurosciences espère parvenir à expliquer les comportements humains à partir de fondements neuronaux et ainsi s’approprier les champs de recherche en sciences humaines et sociales sous l’appellation « neuro-discipline ». Les domaines de l’art et de l’esthétique n’ont pas échappé à cette vague et il semble bien que les neurosciences de la cognition n’aient pas attendu les philosophes pour faire de l’esthétique un objet d’étude : la neuroesthétique, pour emprunter l’étiquette la plus en vogue, commence alors par étudier le sentiment de beau[3]. Ceci ne poserait en soi aucun problème si l’esthétique et l’épistémologie n’y voyaient aucune imprudence méthodologique. Malheureusement, force est de constater que quelques réserves maintiennent à l’écart les deux disciplines. Les plus fréquentes consistent à voir dans la neuroesthétique un risque de réalisme objectif décrétant ce qui est vraiment beau[4]. D’autres critiques pointent un risque de réductionnisme scientifique trop radical ignorant le fait culturel et social[5] – au fond, qu’apprend-on sur l’expérience esthétique lorsque l’on sait qu’elle active telle zone cérébrale ? Le design des expériences de la neuroesthétique manifeste également une certaine ignorance des résultats esthétiques. Ainsi, le beau court le risque de se diluer parfois dans l’agréable et le plaisant alors même que l’enjeu est de caractériser sa spécificité et que les œuvres d’art présentées peuvent plaire autrement que par une expérience de la beauté[6]. Aussi, la contrainte expérimentale impose aux sujets des conditions d’appréhension tellement particulières que l’expérience esthétique est forcément déplacée, voire altérée. Qui plus est, ces conditions vont à l’encontre de l’apport des sciences de la cognition elles-mêmes, confortant de plus en plus la forte relation entre la constitution des émotions et la mobilité corporelle[7]. Ainsi, placer un sujet dans un IRMf, par exemple, et lui demander de noter les œuvres qui lui sont présentées selon son appréciation de leur beauté ou de leur laideur[8] laisse encore inexploré l’apport d’une cognition incarnée des expériences artistiques : le lieu du musée, la salle de spectacle et de cinéma ou encore le paysage urbain participent pourtant peut-être à la construction de l’expérience esthétique.
Depuis le tournant cognitiviste des années 1970, l’essor interdisciplinaire des neurosciences espère parvenir à expliquer les comportements humains à partir de fondements neuronaux et ainsi s’approprier les champs de recherche en sciences humaines et sociales sous l’appellation « neuro-discipline ». Les domaines de l’art et de l’esthétique n’ont pas échappé à cette vague et il semble bien que les neurosciences de la cognition n’aient pas attendu les philosophes pour faire de l’esthétique un objet d’étude : la neuroesthétique, pour emprunter l’étiquette la plus en vogue, commence alors par étudier le sentiment de beau[3]. Ceci ne poserait en soi aucun problème si l’esthétique et l’épistémologie n’y voyaient aucune imprudence méthodologique. Malheureusement, force est de constater que quelques réserves maintiennent à l’écart les deux disciplines. Les plus fréquentes consistent à voir dans la neuroesthétique un risque de réalisme objectif décrétant ce qui est vraiment beau[4]. D’autres critiques pointent un risque de réductionnisme scientifique trop radical ignorant le fait culturel et social[5] – au fond, qu’apprend-on sur l’expérience esthétique lorsque l’on sait qu’elle active telle zone cérébrale ? Le design des expériences de la neuroesthétique manifeste également une certaine ignorance des résultats esthétiques. Ainsi, le beau court le risque de se diluer parfois dans l’agréable et le plaisant alors même que l’enjeu est de caractériser sa spécificité et que les œuvres d’art présentées peuvent plaire autrement que par une expérience de la beauté[6]. Aussi, la contrainte expérimentale impose aux sujets des conditions d’appréhension tellement particulières que l’expérience esthétique est forcément déplacée, voire altérée. Qui plus est, ces conditions vont à l’encontre de l’apport des sciences de la cognition elles-mêmes, confortant de plus en plus la forte relation entre la constitution des émotions et la mobilité corporelle[7]. Ainsi, placer un sujet dans un IRMf, par exemple, et lui demander de noter les œuvres qui lui sont présentées selon son appréciation de leur beauté ou de leur laideur[8] laisse encore inexploré l’apport d’une cognition incarnée des expériences artistiques : le lieu du musée, la salle de spectacle et de cinéma ou encore le paysage urbain participent pourtant peut-être à la construction de l’expérience esthétique.
Ces expérimentations scientifiques du fait esthétique et artistique ne sont pas nouvelles. Leur rencontre malencontreuse ne l’est pas non plus. Déjà au XVIIIe siècle, où l’esthétique a acquis son autonomie disciplinaire, Emmanuel Kant s’opposait aux considérations physiologistes pour penser le jugement esthétique des sentiments de beau et de sublime[9]. Il ne croyait pas non plus à la possibilité de l’introspection et d’une psychologie expérimentale[10]. Le fort héritage kantien explique dans un premier temps les chemins si différents qu’ont empruntés, dès leurs débuts, l’esthétique philosophique et la psychologie expérimentale balbutiante jusqu’à sa fondation institutionnelle, en 1879, par Wilhelm Wundt[11]. Dans un second temps, les disciplines ont évolué chacune suivant les préoccupations de leur époque : pendant que l’esthétique philosophique avait vocation à comprendre les crises de la modernité, la psychologie se laissait aller aux avancées techniques et aux hypothèses visant la description de l’esprit humain par le modèle de l’ordinateur et de ses computations[12]. À ce moment, peu pariaient sur un rapprochement entre l’esthétique philosophique et la psychologie scientifique, ancêtre des neurosciences cognitives[13].
Le pari d’un avenir commun entre neurosciences cognitives et esthétique est aujourd’hui autant envisageable qu’urgent, avant que les deux approches ne s’éloignent trop et empêchent de ce fait de réelles collaborations. L’enjeu de ce dossier est d’indiquer quelques orientations possibles d’une telle discipline qui intégrerait pleinement esthéticiens et neuroscientifiques afin de compléter les rencontres interdisciplinaires qui ont déjà eu lieu[14]. Il serait en effet favorable pour l’esthétique et l’épistémologie d’œuvrer dans le sens de telles investigations en proposant aux neurosciences cognitives un programme de recherche véritablement interdisciplinaire.
I. Esthétique philosophique et neuroesthétique à l’épreuve de l’art contemporain
Le mouvement critique ayant déjà été engagé par de nombreux chercheurs, il n’est plus seulement question de pointer les lacunes de la neuroesthétique, mais de construire la réconciliation entre esthétique philosophique et esthétique expérimentale. Peut-être la question du beau est-elle trop complexe et implique-t-elle trop de processus multiscalaires pour être traitée avec toutes les précautions adéquates. Aussi ce n’est pas parce qu’elle a été une des premières questions de l’esthétique qu’elle doit marquer le début de la neuroesthétique. Elle risque enfin de creuser encore le décalage avec le milieu de l’art, qui, depuis au moins la modernité, s’est dégagé de l’hégémonie du beau.
Cette dernière remarque nécessite quelques précisions pour éviter des malentendus : les investigations de la neuroesthétique visant la compréhension des expériences esthétiques ne prétendent pas, du même élan, rendre compte de l’art, encore moins de l’art contemporain. Il serait par conséquent inconsistant de les condamner au regard de ce critère[15]. De la même manière qu’il existe une esthétique philosophique contemporaine décorrélée de l’art de son époque – mais interrogeant l’expérience esthétique dans sa relation à d’autres modalités de l’être humain – il peut exister, et il existe de fait, une neuroesthétique qui ne cherche pas à s’appliquer à l’art contemporain. Il faut ici se mettre d’accord sur le fait que l’esthétique ne puisse pas être employée comme synonyme de philosophie de l’art : une philosophie de l’art relèverait alors de l’esthétique si elle étudie l’art, les œuvres d’art ou l’expérience artistique sous un prisme sensible[16]. Une approche plus restreinte défendrait encore l’idée que l’esthétique en situation artistique relèverait uniquement de la réception des œuvres et non pas de leur création – la poïétique, telle que proposée par Paul Valéry, serait ainsi la discipline dédiée à la création des œuvres[17]. Dès lors, si ce n’est constater que l’esthétique en tant que discipline n’est pas nécessairement une théorie de l’art, il ne devrait pas y avoir de souci théorique dans les préoccupations disjointes de la neuroesthétique et de la philosophie de l’art, contemporain ou non – du moins à partir du moment où ces démarches ne sont pas une manière de décrédibiliser en creux l’art contemporain par une stratégie de passage sous silence. Aussi, le fait que toute esthétique ne soit pas une théorie de l’art devrait d’autant moins surprendre que la réciproque semble de plus en plus vraie à tel point que certaines positions vont jusqu’à défendre l’idée que l’esthétique n’est pas – ou n’est plus – apte à être une philosophie de l’art, qu’elle n’est plus apte à rendre compte de l’expérience artistique[18].
La question mériterait des développements dépassant largement les relations entre la neuroesthétique et l’esthétique philosophique, mais, synthétiquement, il y a deux principales manières d’aborder la question. Radicalement, la première, proposée par Jean-Marie Schaeffer, serait de défendre une distinction de droit entre l’artistique et l’esthétique : ce ne serait que culturellement, et ce ne serait donc pas logiquement, que certaines pratiques artistiques auraient été faites en vue de susciter une expérience esthétique[19]. Il n’y a donc pas d’impératif, ni même d’évidence, à ce qu’une discipline cherchant à décrire l’expérience esthétique dise quelque chose des œuvres d’art. Ce n’est donc peut-être qu’accidentellement et uniquement pour certains types d’œuvres que l’histoire a connu des esthétiques valant pour philosophie de l’art[20]. Ainsi, si l’art contemporain semble à première vue insaisissable par la neuroesthétique, il faut bien admettre que, la plupart du temps, les théories de l’art contemporain ne relèvent plus frontalement de l’esthétique telle qu’elle a été pensée par le XVIIIe siècle. Ceci vient notamment du fait que les pratiques artistiques ont changé. Et cette remarque ouvre la voie à la seconde manière d’aborder l’éloignement entre esthétique et théorie de l’art : s’il est vrai que l’art contemporain est de moins en moins avant tout une question de forme, mais davantage une relation au concept, au politique, au social et à des problèmes civilisationnels en général[21], l’esthétique – en tant que discipline qui étudie la perception et le sensible – ne serait plus épistémiquement pertinente pour étudier l’art[22].
Une des thèses fortes motivant la constitution de ce dossier est que l’éloignement entre l’esthétique philosophique et l’art contemporain serait sans doute moindre si l’esthétique mobilisait davantage les hypothèses formulées par certaines neurosciences cognitives. Elles permettent en effet souvent de penser l’expérience esthétique au-delà de l’expérience de la forme, en radicalisant ainsi ce qui était déjà en germe au XVIIIe siècle.
La dimension esthétique n’est ainsi pas absente des œuvres contemporaines, même celles qui sont en relation frontale aux problèmes sociaux. Elle peut même accompagner et renforcer la portée politique des œuvres. C’est par exemple le cas du film Capitalism: Slavery, réalisé par Ken Jacobs. Ce dernier prélève une stéréophotographie d’esclaves dans un champ de coton et la filme image par image en donnant un effet stroboscopique, qui participe de ce fait au profond malaise de la vision de la scène. En effet, l’effet stroboscopique peut être physiologiquement dérangeant – il est d’ailleurs recommandé de ne pas regarder le film si l’on est épileptique –, il ancre donc le malaise mémoriel dans le corps spectatoriel en redoublant l’engagement de l’œuvre. Suivant les personnes, on peut imaginer que la composante physiologique renforce l’engagement de l’œuvre ou, au contraire, que sa présence dérange, notamment parce que l’effet serait trop redondant. Pourtant, même ce second cas n’annulerait pas la dimension éthique de l’œuvre : l’expérience de ce film permettrait alors de prendre du recul sur la dimension physiologique et sur la facilité d’être manipulé par les ficelles émotionnelles. Dans les deux cas – que l’impact moral se nourrisse du malaise physiologique ou au contraire que leur rencontre dérange d’un point de vue éthique –, l’expérience de l’œuvre a une dimension esthétique et incarnée qui participe de l’expérience artistique. À la suite de ces hypothèses, il serait bien entendu possible de constituer quelques expériences croisées à des témoignages pour voir s’il se dégage ou non les deux cas envisagés précédemment. Peut-être aussi que d’autres modalités de réception non anticipées ici peuvent émerger et être catégorisées. Même si Capitalism: Slavery mobilise frontalement la relation entre l’esthétique et le physiologique, il n’y a pas un évident besoin de recherches en neuroesthétique cognitive pour comprendre sa pertinence. En effet, l’opinion commune a déjà intégré le fait que les images stroboscopiques peuvent altérer le sujet[23]. Il s’agirait en quelque sorte de neuroesthétique cognitive devenue intuitive, peut-être parce que l’introspection apparaît fiable dans ce genre de situation.
L’introspection n’est pas toujours évidente, il n’est pas toujours possible de discerner soi-même les ressorts cognitifs impulsés par une situation. La situation artistique rend cela peut-être encore plus difficile du fait de nombreux distracteurs socio-culturels qui ne facilitent pas l’introspection. C’est notamment pour ces raisons que les approches neuroesthétiques cognitives s’avèrent pertinentes : au-delà de l’effet stroboscopique ici pris en exemple, de nombreuses composantes physiologiques restent encore relativement inconnues du public et sont de ce fait opaques à l’introspection naturelle. Certaines commencent pourtant à être documentées par les recherches en neurosciences cognitives. Ce sont elles qui peuvent être suivies pour baliser la voie d’une rencontre fructueuse entre esthétique philosophique, neuroesthétique cognitive et art contemporain.
II. Contextualisation et confrontation des articles du dossier
L’un des objectifs de l’art des avant-gardes fut de remettre en question les valeurs de l’Académie, dont la primauté de la beauté. De ces nouvelles pratiques émergèrent de nouvelles questions, notamment celles du processus, des institutions de légitimation, du contexte d’exposition, mais également des questions politiques et sociales. Ces questions furent traitées par les artistes eux-mêmes et par les théoriciens de l’art. L’esthétique devint elle-même ancrée dans des problématiques qui différèrent totalement de celles des philosophes traditionnels. Le texte d’Alice Dupas part du constat que ce qui est aussi important que l’œuvre elle-même, c’est ce qu’il se passe autour de l’œuvre. En utilisant des théories d’esthéticiens plus contemporains, tels que Arthur Danto, l’autrice rappelle que l’intention de l’artiste et le contexte sont fondamentaux pour comprendre l’art et l’œuvre, comme dans le cas de l’œuvre de Marcel Duchamp. L’enjeu serait alors de développer une neuroesthétique apte à rendre compte de ces complexités où le contexte serait élargi au contexte de perception. D’une approche internaliste de la cognition, comme celle qui est analysée par les neurosthéticiens avec les recherches sur la beauté, on passe à une approche externaliste, où tout le corps devient impliqué. Les états mentaux ne dépendent pas uniquement du cerveau, mais également du corps dans son ensemble. L’objectif est donc une neuroesthétique étendue, une neuroesthétique qui comprendrait à la fois les neurosciences, mais aussi la biologie et l’histoire, et ce dans le but de comprendre en quoi les nouvelles investigations de l’art moderne puis contemporain, apparemment éloignées du sensible, peuvent avoir des retombées proprement esthétiques[24].
Même s’il est vrai que l’art contemporain a été marqué par son ouverture au concept, au politique et à d’autres questions sociales, il serait faux de dire que l’art contemporain a évacué la question sensible. Les œuvres qui travaillent de près l’expérience esthétique se sont toutefois éloignées de ce que semblaient être les préoccupations classiques. Les problématiques contemporaines s’attardent sur d’autres catégories esthétiques que le beau et sur d’autres effets que produisent les œuvres d’art. Les états modifiés de conscience, l’ivresse, la chute, sont des effets davantage recherchés par l’art d’aujourd’hui que ne peuvent l’être l’harmonie et la grâce. Si Friedrich Nietzsche écrivait déjà à la fin du XIXe siècle sur une relation entre l’expérience du beau et du laid et la constitution naturelle des êtres vivants[25], les expériences d’attraction-répulsion provoquées par l’art contemporain n’engagent pas des réponses naturelles. Si dans la nature, la réponse « combat-ou-fuite » (fight-or-flight response) est un déterminant de survie et sert la fitness, il semblerait qu’il en soit tout autrement dans l’art. C’est ce que développe Pierre-Louis Patoine dans son article centré sur la notion d’état modifié de conscience. L’expérience esthétique devant des œuvres d’art suspend une partie des réactions biologiques et laisse s’exprimer celles qui restent de manière différente. Si devant une proie ou un prédateur, toutes les actions sont « utiles », car elles servent notre fitness, devant une œuvre d’art, elles peuvent s’avérer « inutiles ». Dès lors qu’on ne filtre plus les stimuli inutiles, l’ivresse provoquée par l’œuvre est une ouverture au monde. « Le Oui de l’ivresse » modifie les hiérarchies des stimuli et des actions. Les réactions aux œuvres d’art ne fonctionnent plus tout à fait comme les réactions au monde naturel.
La manière dont l’immersion dans l’œuvre d’art modifie la relation au monde – réel ou immergé – s’éprouve facilement dans l’expérience de la lecture littéraire : lire, et surtout lire de la littérature, permet une modification des relations spatio-temporelles, permet aussi une modification des relations à son propre corps dans les cas d’identification aux personnages d’un roman. Ces points sont à l’origine de l’étude menée par Noëlle Batt dans son article réévaluant les pouvoirs de l’imagination au filtre neuroscientifique et proposant quelques designs expérimentaux. L’expérience de la lecture nécessite en effet de quitter en partie son monde pour se plonger dans celui créé par l’œuvre littéraire et d’en compléter la description. Dans l’œuvre littéraire, il faut à la fois comprendre le langage lu, ainsi que les déformations et les « affects afférents ». L’une des questions possibles à soumettre à l’expérimentation, en partant des recherches en esthétique, est cette capacité d’empathie envers un personnage de fiction littéraire. Sans s’y retreindre, les neurones miroirs peuvent être des outils pour comprendre cette empathie et comprendre la place de cette dernière dans l’expérience esthétique.
Compte tenue de la manière dont l’empathie a des conséquences sociales fortes, la rencontre entre sciences naturelles et sciences humaines et sociales paraît judicieuse. Cette rencontre, dans ce cas pris en exemple comme dans d’autres, a tout intérêt à dépasser les rares moments accordés à une interdisciplinarité souvent non reconduits au-delà des quelques jours de discussions dans des colloques et conférences. La rencontre disciplinaire peut donner lieu à de réelles collaborations. La collaboration permet un solide partage et une mise en danger de chacun des acteurs. Dans leur article, Coline Joufflineau, Matthieu Gaudeau, Alexandre Coutté, Dimitri Bayle, Asaf Bachrach explorent l’expérimentation conjointe entre danseurs et scientifiques. Toutes et tous ont dû sortir de leur zone de confort, les danseurs en verbalisant leur sensation, les scientifiques en ne bénéficiant pas d’une hypothèse claire préalable à l’expérimentation ; mais ces incertitudes n’ont été que provisoires. Dans la même lignée que l’article de Patoine, cet article étudie le déséquilibre – mais il est ici provoqué par la chute en danse. Ici, l’art permet d’explorer le passage de l’attention endogène à l’attention exogène, plus complète, où le sujet doit prendre conscience de lui-même et de sa perception. Les techniques utilisées sont celles de l’EEG, dispositif qui pose des problèmes épistémologiques que les chercheurs prennent en considération.
Si l’EEG permet de sortir du laboratoire, et de favoriser les expériences immersives, contrairement à l’IRMf, il n’en est pas moins que tous ces outils ont leurs limites. La question de la modélisation de la réalité par ces outils est une question épistémologique majeure. C’est ce que développe Jean-Marc Chouvel dans son article. Avec l’IRMf, seuls des instants sont représentés, et non pas la durée. Ce qu’il se passe dans le cerveau est donc représenté par des photographies, et non pas par le film dans sa temporalité. Or l’écoute musicale s’étend par excellence dans la durée, la musique étant un art du temps. La réalité est alors peut-être trop complexe pour être modélisée, pour être symbolisée. Le langage est lui-même limité et peut conduire à des contre-sens.
Une compréhension, même partielle, de la réalité permet de penser le réel social. Les objets du design ou de l’architecture ont des effets mesurables sur les états mentaux des citoyens dans les espaces habités. C’est ainsi que les politiques publiques peuvent transformer l’espace public et avoir une influence sur le comportement des individus. L’article de Jérôme Dokic et Anne Tüscher permet de comprendre que l’architecture et le design sont en attente d’une action et produisent de ce fait une « affordance ». Par exemple, la manière dont les portes et les poignées d’un bâtiment sont pensées détermine grandement une affordance à les pousser ou à les tirer. Avec la notion d’affordance, l’esthétique rompt définitivement sa prétendue relation privilégiée avec la contemplation : ce n’est pas parce qu’il y a affordance qu’il n’y a pas expérience esthétique. L’art peut, a priori, impulser une action, comme dans le cas des ready-made de Duchamp. Dans le cas du sublime, la question est toutefois plus complexe : leur article défend l’idée selon laquelle le sublime engagerait une expérience esthétique totalement dépourvue de toute affordance.
III. Prospective vers une neuroesthétique cognitive à dimension éco-évolutive
Si les articles de ce dossier permettent d’envisager la recherche en neuroesthétique cognitive en croisant plusieurs pratiques artistiques – puisqu’il est question d’arts plastiques, de littérature, de danse, de musique ou encore d’architecture[26] –, une homogénéité conceptuelle se dégage. En effet, quatre pistes, plus ou moins enlacées, sont aujourd’hui particulièrement empruntées par les recherches contemporaines et ressortent nettement des articles du dossier :
— la relation entre la dissonance, le déséquilibre et la catégorie esthétique du sublime[27] :
— la notion d’affordance et la boucle cognitive qui articule la perception et l’action[28] ;
— l’empathie qui permet de repenser la relation d’identification à la fois à ce qui est représenté et à l’artiste à l’œuvre[29] ;
— les états modifiés de conscience et leur proximité aux expériences esthétiques et aux expériences induites par psychotropes[30].
De cette liste synthétique ressort un constat : le déséquilibre, l’affordance, l’empathie ou encore les états modifiés de conscience sont, toutes, des notions qui ont émergé pour décrire à l’origine autre chose qu’une expérience esthétique. Leur pertinence en esthétique ne vient pas de leur formulation par la neuroesthétique, mais par d’autres approches des neurosciences cognitives. Elles décrivent des comportements routiniers, plus ou moins socio-culturels, plus ou moins partagés par d’autres espèces animales, plus ou moins pertinents pour former l’image qu’on peut se faire d’un état ancestral de – ou à – l’être humain. Ainsi, d’une part, la neuroesthétique cognitive devient-elle d’autant plus pertinente en art contemporain qu’elle adopte une démarche soucieuse de comprendre les comportements au regard de l’environnement et au regard de l’histoire évolutive qui a participé à façonner le corps et les processus cognitifs des animaux en général et de l’être humain en particulier. Peut-être alors que le principal rôle que les neurosciences ont à jouer à présent réside dans la compréhension des processus cognitifs au regard d’une routine pour permettre de comprendre comment les expériences artistiques s’y inscrivent – soit en s’en nourrissant, soit en les détournant par inhibition. Aussi, d’autre part, ce constat est en étroite adéquation avec les désormais nombreuses sciences humaines qui sont convoquées en théories de l’art : l’art est de moins en moins pensé comme une activité isolée des autres activités humaines et devant de ce fait bénéficier d’une discipline autonome aux autres[31]. Au contraire, comprendre l’artistique comme comprendre l’esthétique semblent nécessiter le recours certes à la philosophie de l’art et à l’histoire de l’art, mais aussi aux recherches non spécialement appliquées à l’art en sociologie, en ethnologie, comme, pour ce qui est le sujet de ce présent dossier, en physiologie et en neurosciences cognitives.
[1]Voir notamment : Cinzia Di Dio, & Vittorio Gallese, “Neuroaesthetics: A review”, Current Opinion in Neurobiology, no 19(6), 2009, p. 682–687, Anjan Chatterjee, OshinVartanian, “Neuroaesthetics”, Trends in Cognitive Sciences, vol. 18, issue 7, July 2014, p. 370-375 et Marcus T. Pearce et al., “Neuroaesthetics: The Cognitive Neuroscience of Aesthetic Experience”, Perspectives on Psychological Science, vol. 11, no 2, 2016, p. 265–279 ou, en français, Jacques Morizot (dir.), Naturaliser l’esthétique ? Questions et enjeux d’un programme philosophique, Rennes, PUR, 2014 et Alexandre Gefen (dir.), Nouvelle revue d’esthétique, dossier sur la naturalisation de l’esthétique no 15/2015.
[2]Ce titre a été inspiré par le livre de Richard Shusterman intitulé Sous l’interprétation (Paris, Éclat, 1994). S’il est vrai que cet ouvrage vise davantage à présenter la compréhension comme une investigation sous-jacente à l’interprétation, la méthode menée par Richard Shusterman n’était déjà – à l’époque de sa rédaction – pas éloignée des démarches en esthétique cognitive incarnée qu’il développe aujourd’hui.
[3]Semir Zeki, H. Kawabata, “Neural correlates of beauty”, J Neurophysiol, 2004.
[4]C’est notamment ce qui a été reproché à Vilayanur Ramachandran. Voir par exemple Peer F. Bundgaard, “Feeling, meaning, and intentionality—a critique of the neuroaesthetics of beauty”, Phenom Cogn Sci, no 14, 2015, p. 781–801 ou Fernando Vidal, “Neuroaesthetics: Getting rid of art and beauty”, BioSocieties, 2012/2 (7).
[5]On se reportera notamment à l’article critique : Fernando Vidal, « La neuroesthétique, un esthétisme scientiste », Revue d’Histoire des Sciences Humaines, vol. 25, no 2, 2011, p. 239-264
[6]Cette critique peut notamment être formulée à l’égard de certains travaux de Semir Zeki qui cherchaient à naturaliser le libre jeu des facultés décrits par Kant, travaux qui ne prenaient pas en compte la position de ce même philosophe proposant de penser le beau indépendamment notamment de l’agréable ou du sublime. Voir Semir Zeki, H. Kawabata, “Neural correlates of beauty”, op. cit. et Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger, § 2-5.
[7]Si de nombreux travaux étudient la reconnaissance de l’émotion par le prisme de la posture corporelle c’est bien parce que l’émotion se définit comme une mise en mouvement (le fameux ex-movere) : contraindre un individu à l’immobilité pour étudier une émotion court alors le risque de la modifier. Sur la relation entre l’émotion et la mise en mouvement du corps, voir Antonio R. Damasio, Spinoza avait raison. Joie et tristesse, le cerveau des émotions, Paris, Odile Jacob, 2005, p. 60-65, 120-129. L’idée n’est pas de dire que l’immobilité inhiberait les émotions, mais de dire qu’elle en changerait la nature (en développant par exemple davantage la peur).
[8]Zeki Semir, Ishizu Tomohiro, “Toward A Brain-Based Theory of Beauty”, PLoS ONE, 2011.
[9]Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger, op. cit., § 29. Voir notamment le dernier alinéa du paragraphe pour la formulation d’une distinction entre sublime et psychologie empirique.
[10]Kant émet cette position en 1786, donc avant la date généralement considérée comme marquant le début de la psychologie comme discipline. Voir Emmanuel Kant, Premiers principes métaphysiques de la science de la nature, préface.
[11]Pour plus de détails sur la création du premier laboratoire de psychologie expérimentale, voir l’article historique Robert S. Harper, “The First Psychological Laboratory”, Isis, vol. 41, no 2, 1950, p. 158–161. Cet article met en avant le laboratoire étasunien de William James dès 1875. Voir encore Nicolas Serge, « Wundt et la fondation en 1879 de son laboratoire », L’année psychologique, 2005 vol. 105, no 1, p. 133-170.
[12]Pour une présentation des différents paradigmes des sciences de la cognition, voir : Francisco J. Varela, Invitation aux sciences cognitives, Paris, Seuil, 1996. Pour la mise en perspective de cette histoire avec le champ de l’art, voir : Edmond Couchot, La Nature de l’art. Ce que les sciences cognitives nous révèlent sur le plaisir esthétique, Paris, Hermann, 2012 p. 15-32.
[13]Il ne faut toutefois pas oublier des entreprises moins récentes, comme celle, ne cherchant certes pas à rendre compte de l’art de son époque, que l’on peut trouver chez Pierre Francès. Voir son ouvrage : Robert Francès, Psychologie de l’esthétique, Paris, PUF, 1968.
[14]Pour une des dernières publications issues de telles rencontres interdisciplinaires, voir notamment : Zoï Kapoula et Marine Vernet (dir.), Aesthetics and Neurosciences, Springer, 2016.
[15]Pour un article distinguant beauté, art et perception dans un contexte de neuroesthétique, voir : Bevil R. Conway & Alexander Rehding, “Neuroaesthetics and the Trouble with Beauty”, PLoS Biol, 11(3), 2013.
[16]Il faut par ailleurs admettre que l’essor des neurosciences cognitives force à nuancer ce type de distinctions utilisant naïvement l’opposition entre sensible et intelligible. Choisir de définir les disciplines au regard de ces nouvelles hypothèses ne séparant plus qualitativement sensible et intelligible mènerait à une refonte totale de l’esthétique comme discipline. Il reste aussi possible de conserver cette distinction qui, si elle n’est pas juste d’un point de vue scientifique prenant la cognition comme objet, peut rendre compte de la manière dont la cognition est vécue par le sujet.
[17]Sur la relation entre sciences cognitives et création artistique, on pourra notamment consulter la deuxième partie de l’ouvrage : Mario Borillo (dir.), Approches cognitives de la création artistique, Sprimont, Mardaga, 2005. Du fait des applications que ce champ peut avoir au regard de la création contemporaine, certaines formations diplômantes en font leur spécificité. Par exemple, le MSc en psychologie des arts, neuroesthétique et créativité, qui a ouvert à Goldsmiths (University of London) en 2018, https://www.gold.ac.uk/pg/msc-psychology-arts-neuroaesthetics-creativity, consultée le 2 décembre 2019.
[18]Voir notamment : Timothy Binkley, « “Pièce” : contre l’esthétique », Gérard Genette (dir.), Esthétique et poétique, Paris, Seuil, 1992, p. 33-66 ; Richard Shusterman, “The end of aesthetic experience”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, no 55, 1997 p. 29-41 ; Jean-Marie Schaeffer, Adieu à l’esthétique, Paris, PUF, 2000 ; ou encore Yves Michaud, L’Art à l’état gazeux. Essai sur le triomphe de l’esthétique, Paris, Stock, 2003.
[19]Pour l’argumentation de cette position, voir : Jean-Marie Schaeffer, Adieu à l’esthétique, op. cit., p. 43-45.
[20]Une histoire de la constitution de l’esthétique au xviiie siècle menée avec cette hypothèse serait sans doute intéressante à élaborer.
[21]Il est intéressant d’avoir à l’esprit que ce constat est salué d’un côté et davantage déploré d’un autre. Pour le premier côté, on pourra lire les articles et ouvrages inspirés par le texte inaugural de 1995 écrit par Hal Foster au sujet du tournant ethnographique : Hal Foster, “The artist as ethnographer?”, The traffic in culture. Refiguring art and anthropology, G. Marcus & F. Myers (dir.), Berkeley, LA / London, University of California Press, p. 302–309. Pour ce second aspect, voir notamment : Carole Talon-Hugon, L’Art sous contrôle. Nouvel agenda sociétal et censures militantes, Paris, PUF, 2019.
[22]Cette thèse ne prétend pas qu’aucune œuvre ne peut être décrite au regard de l’expérience esthétique. Si l’esthétique n’est p lus pertinente pour toutes les œuvres, elle le reste tout de même pour certaines. Voir par exemple : Marianne Massin, Expérience esthétique et art contemporain, Rennes, PUR, 2013.
[23]Et c’est d’ailleurs précisément ce qui permet de supposer le cas de personnes ayant l’impression que le film les manipule.
[24]Cette voie est notamment celle empruntée dans les publications récentes de Vittorio Gallese. Voir par exemple : Vittorio Gallese, “Embodied Simulation. Its Bearing on Aesthetic Experience and the Dialogue Between Neuroscience and the Humanities”, Gestalt Theory, no41, 2019, p. 113-127.
[25]Friedrich Nietzsche, Crépuscule des idoles, Paris, Flammarion, 2005, p. 186-190, « Incursions d’un inactuel », § 19-23.
[26]Parmi les pratiques absentes figure le cinéma. Pour combler cette lacune, voir par exemple : Laurent Juillier, Cinéma et Cognition, Paris, L’Harmattan, 2002.
[27]On pourra par exemple lire : Richard Shusterman, “Somaesthetics and Burke’s sublime”, British Journal of Aesthetics, vol. 45, no 4, 2005.
[28]Sur l’afforance, voir : James J. Gibson, “The theory of affordance”, dans R. Shaw et J. Bransford (dir.), Perceiving, Acting, and Knowing, Hillsdale/New Jersey/London, Lawrence Erlbaum Associates, 1977, p. 67-82. Dans le champ de l’esthétique, voir : Edmond Couchot, « La boucle action-perception-action dans la réception esthétique interactive », revue Proteus, dossier sur le spectateur face à l’art interactif, no 6, 2013, p. 27-34.
[29]Voir Vittorio Gallese, “The Roots of Empathy: The Shared Manifold Hypothesis and the Neural Basis of Intersubjectivity”, Psychopathology 2003, 36, p. 171-180 et, son écho au regard de l’expérience esthétique, dans Vittorio Gallese & Freedberg, “Motion, emotion and empathy in esthetic experience”, Trends Cogn. Sci, no 11, 2007, p. 197–203.
[30]Voir notamment : Raymond Bellour, Le Corps du cinéma. Hypnoses, émotions, animalités, Paris, P.O.L., 2009. S’il est vrai que l’étude porte essentiellement sur le cinéma, elle dessine toutefois un champ théorique général sur le sujet de l’hypnose.
[31]En parallèle des mouvements en art – et en « non-art » – défendant cette idée, le pragmatisme a grandement participé à sa théorisation. Pour la formulation de la notion d’expérience dans le champ de l’esthétique, voir John Dewey, L’Art comme expérience, Paris, Gallimard, 2010, p. 80-114.