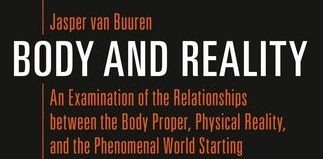Sentir, s’extasier, danser (1)
L’implication chorégraphique selon Erwin Straus.
Si percevoir est impliqué au sens où nous y sommes proprement, danser porte peut-être à son comble, en tant qu’art mais aussi en tant qu’expérience humaine, cette implication. Dansant, je suis impliqué en tant que j’y suis, en tant que danser implique une époché sur l’outil et sur le produit, en tant que je suis à moi-même mon propre instrument. Il n’en ressort ri-en, autrement dit, aucune chose, aucun artefact extérieur. Qui danse ? Non pas « un » corps dansant, mais je, mon corps, indistinctement. Par quoi la danse se déclinerait en première personne. Mais si je danse, à proprement parler, pour ri-en, je ne danse pas pour personne. Je danse pour autrui, présent ou absent. Mais là encore, un je surgit. Regardant l’autre danser, j’y suis impliqué au sens où je suis pris dans sa danse. Non pas simplement par « plaisir kinesthésique – l’expérience musculaire en tant que telle, par procuration »[1], mais par implication de notre être, en tant que « se sentir gagnés par les rythmes et virtuellement dansant nous-mêmes ! »[2]. Regardant danser, je danse, pour ainsi dire, avec et par autrui.

Source : Wikipédia - Creative Commons
Par quoi il y aurait une sorte d’évidence à décrire la danse sous les espèces de la phénoménologie, le ‘je danse’ ou le ‘je danse avec et par’ réclamant en effet une approche descriptive qui se tient dans le milieu de l’expérience. Une telle démarche n’a pourtant rien d’évident. C’est que, si l’on tente d’insérer l’expérience de danse dans le cadre de la phénoménologie husserlienne, celle-ci résiste à toute description. Car si le modèle de la phénoménologie transcendantale est l’objet mathématique comme ce qui est simultanément ce que j’en pense et face à moi, comme totalement indépendant de moi et en même temps totalement pensable par moi[3], il semble que la danse offre un « objet » strictement opposé. Un non ob-jet précisément, puisque rien ne se trouve jeté au-devant de moi. L’ « objet » de la danse est inséparable de moi-même dans la mesure où je danse – on n’osera pas dire, c’est mon corps qui danse, car, disant cela, on scinde déjà ce qui s’éprouve comme un dans l’acte de danser – et où le je danse semble dès lors conceptuellement insécable, non saisissable par la pensée analytique. Bien plus, la danse oblige à quitter le modèle de l’intentionnalité husserlienne parce qu’elle n’offre aucun objet susceptible de remplir une visée à vide. Le vécu coïncide ici strictement avec sa réalisation. Ou même, pourrait-on dire, le mouvement de la visée est cela même qui se réalise. Le milieu phénoménal de la danse serait donc celui de l’ambiguïté. D’où la complexité – l’impossibilité ? – à la ressaisir conceptuellement sans la quitter.
Cette résistance propre à l’expérience de danse, le phénoménologue et neuropsychiatre Erwin Straus, sans véritablement la développer, l’a bien saisi. Pour enquêter au cœur de l’ambiguïté phénoménale et ne pas renoncer à dire quelque chose de ce que d’autres pensées rejetteraient du côté de l’indicible et de l’inconnaissable, il propose une solution. Il s’agit de s’en tenir à un certain milieu, celui de l’Erleben – le vivre au sens transitif – de l’espace, son expérience originaire et pré-objective, en tant qu’il se distingue de l’Erlebnis – le vécu – où se manifeste déjà une intentionnalité vers cela même qui est vécu, à savoir un objet vers lequel se diriger. De fait, il ne faudra pas caresser l’espoir de trouver chez Straus un discours savant sur l’histoire de la danse, sur les processus de composition ou sur les œuvres chorégraphiques – là n’est pas son objet –, mais on assiste, au creux de sa démarche génétique, à une mise en évidence de l’entrée en danse, du passage, flottant et trouble, de l’expérience ordinaire au danser. Rare philosophe à avoir abordé la question de la danse, c’est principalement dans un article, « les Formes du spatial, leur signification pour la motricité et la perception »[4] qu’il thématise cette question. S’il insiste sur le caractère de mélange originaire propre à l’expérience de danse, il semble qu’on puisse ressaisir chez lui trois moments constitutifs – sentir, s’extasier, danser –, moments qui précèdent selon lui le chorégraphique, à savoir l’ordre de la composition, de la mise en forme et en écriture du mouvement, qu’il n’abordera pas. C’est donc dans le passage par ces trois moments que résiderait ce qu’on pourrait nommer l’implication chorégraphique, ce que le chorégraphique implique pour donner à voir et à vivre de nouveaux gestes, de nouvelles configurations spatiales en tant qu’elles sont porteuses aussi de qualités inédites.
On peut lire, au début de l’article de Straus, le paragraphe suivant :
Dans les années d’après guerre, toutes sortes d’essais furent tentés pour trouver de nouvelles formes de danse artistique. L’on forgea le slogan de « danse absolue ». La danse, disait-on, ne pouvait languir plus longtemps sous le joug de l’invention musicale ; elle devait se libérer de la tyrannie de la musique. Seulement, en considérant de telles danses austères et privées de musique, l’on s’aperçut justement que la liaison entre la musique et la danse n’était pas une liaison aléatoire, simplement empirique. De devenir absolu, la danse n’avait bien sûr pas vu le sol se dérober sous ses pieds, mais elle avait perdu l’espace qui lui était approprié. Une connexion d’essence doit donc manifestement lier le mouvement dansant à la musique et à la structure spatiale que cette dernière engendre ; il s’agit là d’une liaison que l’on ne peut supprimer arbitrairement.[5]
Qui connaît, même de loin, l’histoire de la danse au XXième siècle, de la danse dite « savante », ne pourra que s’offusquer devant la grossière erreur de diagnostic dans laquelle tombe ici Straus. La « danse absolue » ou « danse moderne », à savoir essentiellement ici l’Ausdruckstanz, la danse expressionniste allemande[6], a eu une influence considérable sur la danse jusqu’à aujourd’hui, et ce, aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis ou au Japon. De même, le lien supposé essentiel entre danse et musique a été largement remis en cause, à plusieurs reprises et au sein de courants esthétiques très diverses. Pour autant, faut-il renoncer à l’ensemble des thèses de Straus au prétexte qu’elles reposeraient sur une prémisse fausse, à savoir que la « danse absolue » perdrait l’espace propre à la danse et par là même se perdrait comme danse et serait vouée à disparaître ?
L’hypothèse que nous allons défendre ici est que la condamnation des formes de danse sans musique par Straus relève en fait d’un manque de cohérence interne à ses propres thèses et d’un manque de radicalité phénoménologique. Il s’agira pour nous de proposer d’abord une lecture de l’article de Straus depuis les trois moments cités plus haut pour voir ensuite où, d’un point de vue phénoménologique, résident les limites de l’approche straussienne de la danse.
Dans « les Formes du spatial», l’objectif premier de Straus n’est pas de déployer une réflexion sur la danse, ni même sur ses liens à la musique. Celle-ci n’intervient qu’au titre d’un exemple ayant pour fonction spécifique de corroborer ses thèses sur l’espace, et plus précisément sur l’espace tel qu’il se donne originairement dans son vivre. Ainsi s’annonce le programme : «
[…] interroger très généralement la connexion liant qualité d’espace, mouvement et perception[7]
Espace, mouvement et perception – et il faudrait ajouter ‘temps’, inclus certes dans ‘mouvement’ mais qu’il cite juste avant – sont, au creux de l’expérience, non scindés. C’est l’abstraction mathématique et physique qui nous a donné l’habitude de penser l’espace comme une entité séparée. Ainsi, l’interrogation de Straus ne porte ici ni sur la lecture physique de l’espace, ni sur la genèse physiologique de ce dernier, ni enfin sur sa genèse psychologique. Dans une perspective phénoménologique, il cherche bien plus à rendre compte de l’espace tel qu’il se donne dans l’expérience, refusant par là la scission non originaire entre un espace qui serait de l’ordre de la représentation mentale ou perceptive et un autre qui serait de l’ordre de l’être.
Sentir
Si, dans « les Formes du spatial… », Straus n’emploie pas le terme de « sentir », ce dernier – que l’on trouve dans Du Sens des sens – renvoie à ce qu’il nommera successivement ici « ton », « moment pathique », « espace originaire », « comment », « espace acoustique-pathique », « espace de la danse ». De même, ce qu’il nomme « percevoir » renverra dans l’article qui nous occupe successivement à « bruit », « moment gnosique », « espace second », « quoi », « espace optique-gnosique » ou « optico-pragmatique », « espace ordinaire ». Pour éclaircir ces notions, on nous autorisera un crochet par la problématisation du sentir effectuée par Straus au chapitre sept de Du Sens des sens, intitulé « de la différence entre le sentir et le percevoir »[8]. Opérant une analogie non innocente, il défend qu’il en serait du sentir comme du temps, que la réflexion de Saint Augustin sur insaisissabilité du temps vaudrait pour le sentir.
Si nemo a me quaerat scio, si quaerenti explicare velim, nesio[9]
Sentir, c’est l’implication comme telle, c’est ce qu’il y a lorsque personne ne me demande quoi, c’est le « mode de l’existence sensorielle immédiate ». Percevoir au contraire, c’est ce qui m’apparaît lorsque l’autre ou moi-même « arrête le cours de l’existence naïve »[10] et pose la question de ce qu’il y a, invite à réfléchir sur ce qui advient dans cette implication. Autrement dit, soit nous y sommes, soit nous n’y sommes plus et ne pouvons faire retour réflexivement sur ce qui nous échappe en tant que nous l’avons quitté. Pourtant, décrire le sentir est cela même que Straus compte entreprendre, par le biais des arts, en particulier la musique et la danse. C’est dans ce cadre qu’il faut comprendre l’affirmation de Straus selon laquelle la danse aurait pour condition de possibilité la musique. Loin d’un jugement de valeur de sa part, l’affirmation présente une logique phénoménale dans la mesure où, dans « les Formes du spatial », la musique endosse le rôle du sentir. Mais voyons comment il déploie pas à pas sa pensée.
Dans un premier temps, il distingue le « ton » du « son » et du « bruit ». Si le bruit est déterminable en tant qu’il réfère à sa source, à un objet extérieur se manifestant depuis une certaine direction, si le son renvoie également à quelque chose tout en présentant une incertitude relative au quoi qui le distingue nettement du bruit,
[…] le ton lui-même ne s’étire pas dans une direction mais il vient à nous ; il pénètre, emplit et homogénéise l’espace […] le ton se délie du corps résonnant comme l’eau de sa source[11].
Autrement dit, le ton se donne sur le mode d’une passivité par laquelle je me laisse affecter par le dehors, j’accède à une spatialité non locale et qualifiée, par Straus, d’originaire. Les repères et directions, les objets eux-mêmes, sont mis entre parenthèses pour ne laisser apparaître que le sentir comme tel. Straus constate qu’on entend mieux un rythme, une suite de tons ordonnés se donnant temporellement comme détachés de leur source, qu’on ne le voit[12] : attachant la couleur à l’objet, nous ne saisissons pas un rythme détaché de l’objet mais toujours une succession de modifications que nous interprétons comme appartenant à l’objet. Il opère ainsi une distinction entre deux modalités d’apparaître,– modalité dont relève donc aussi le bruit – et celle du ton, c’est-à-dire ce qui se manifeste comme vécu pur de toute source et de toute direction spatiale, ce qui, loin d’être visé dans l’espace, emplit bien plutôt notre espace propre. De fait, la distinction entre ces deux modalités, l’une ressortant de la vue et l’autre de l’ouïe, ne doit en aucun cas être interprétée comme une distinction d’ordre physiologique. En effet, on peut entendre sur le mode de la couleur – lorsque, dans un concert, nous rivons notre attention sur le jeu du musicien sur son instrument – et voir sur le mode du ton – lorsque nous nous laissons pénétrer par le spectacle d’un crépuscule[13]. Pourtant, le choix opéré par Straus ne relève pas non plus, selon nous, d’un pur hasard physiologique dans la mesure où les oreilles n’ont pas de paupières, que nous avons pour ainsi dire moins de recul quant aux phénomènes acoustiques que nous n’en avons dans la vision, où une certaine distance avec l’objet naît dès lors que je peux incérer une frontière, que je peux maîtriser le moment de contact ou d’absence de contact avec lui.
De cette distinction de modalité d’apparaître découle l’ensemble des distinctions que l’on retrouve dans le texte. Ainsi, le « moment pathique »[14] désignera le rapport pré-conceptuel avec les phénomènes par lequel, loin de viser ou de saisir un objet depuis ma position de sujet, je me laisse au contraire saisir par la seule sensation selon sa propre légalité d’apparaître, tandis que le « moment gnosique » désignera la perception active solidaire de l’objet visé, co-naissance à l’objet. En d’autres termes, le « moment pathique » fait apparaître le comment, la manière dont la sensation se donne, tandis que le « moment gnosique » fait apparaître le quoi, l’objet. De fait, on rejoint encore une fois la distinction entre sentir et percevoir, le sentir demeurant « pré-conceptuel », à savoir non saisissable par la connaissance.
(la deuxième partie de cet article sera publiée le 21 juin 2010)
Katharina Van Dyk
[1] Martin, John, La Danse moderne, [1933] trad. fr., Arles, Actes Sud, 1991. p. 32.
[2] Valéry, Paul, Philosophie de la danse, Conférence prononcée à l’Université des Annales le 5 mars 1936, publiée dans Conférencia, 1er novembre 1936, reprise dans Œuvres, tome 1, Paris, Gallimard, Pléiade, 1957, p. 1400.
[3] Voir à ce propos: Dastur, Françoise, Husserl. Des mathématiques à l’histoire, Paris, Presses Universitaires de France, 1995. Voir aussi Barbaras, Renaud, Introduction à la philosophie de Husserl, Chatou, Les Editions de la Transparence, novembre 2004.
[4] Straus, Erwin, „Die Formen des Raümlichen. Ihre Bedeutung für die Motorik und Wahrnemung.“ Nervenarzt, 3, Cahier 11, p.633-656, Berlin, Springen, 1930; trad. Fr « Les formes du spatial. Leur signification pour la motricité et la perception », in Courtine (dir.), Figures de la subjectivité, p.15-49, Paris, CNRS Editions, 1992.
[5] Straus, Erwin, « Les Formes du spatial… », op. cit., p. 15.
[6] Voir notamment : Launay, Isabelle, A la recherche d’une danse moderne, Paris, Chiron, 1997.
[7] Straus, Erwin, « Les Formes du spatial… », op. cit. p. 16.
[8] Straus, Erwin, Du Sens des sens, op. cit., p. 175. (« Si personne ne me le demande, je le sais, si quelqu’un me le demande et que je veuille l’expliquer, je ne le sais plus »)
[9] Saint-Augustin, Les Confessions, XI, 14-17. Traduction personnelle.
[10] Straus, Erwin, Du Sens des sens, op. cit., p. 175.
[11] Straus, Erwin, « Les formes du spatial… », op. cit., p. 19.
[12] Ibid. p. 22.
[13] Exemples développés par Straus dans « Les formes du spatial… », op. cit., p. 21 et 28.
[14] Ibid., p. 23.