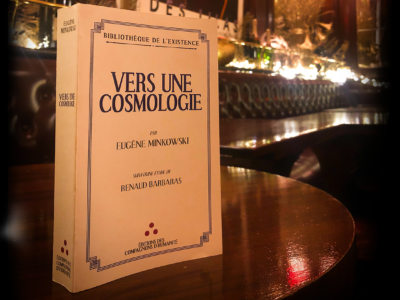Sciences paradigmatiques et sciences sociales
La nature des énoncés sociologiques
Disons seulement, à la suite de Weber, que la validité d’une « régularité historique » n’est jamais énonçable sans référence au contexte construit par une typologie comparative : et cela suffit à distinguer radicalement sons sens descriptif de celui de la « loi universelle ». [1]
Pour Passeron, l’impossibilité d’énoncer des lois universelles sur le cours du monde historique se traduit aussi par la forme du discours sociologique, par le langage utilisé pour produire des énoncés, qui n’admet pas, en principe, de formalisation telle qu’il puisse être à la source d’énoncés universels. Les sciences sociales sont des sciences du raisonnement naturel, horizon indépassable du raisonnement sociologique : « Naturel » se définit ici par opposition au raisonnement formel, qui se réfère au raisonnement axiomatique. La sociologie s’exprime toujours en langage naturel, et non en langage formel, c’est-à-dire que les concepts à l’origine des développements théoriques, généralisés, ne peuvent être « purifiés » de toute référence au contexte singulier par rapport auquel ils ont été formulés, que les énoncés qu’elles produisent ne peuvent être « axiomatisés » dans une « théorie pure », une grammaire et une sémantique formelles figeant le sens de leurs définitions et principes indépendamment de toute contexte d’énonciation.
Le sens référentiel des discours descriptifs et explicatifs, caractéristiques des sciences historiques, est indissociable d’un « ancrage pragmatique » du sens de tous leurs mots et de toutes leurs assertions dans un contexte particulier d’observation et de description. [2]
Jamais les théories des sciences sociales ne s’exprimeront en un langage formalisé, protocolaire, codifié, autrement dit artificiel : C’est le langage des sciences « normales », ou sciences paradigmatiques, qui disposent d’un système unifié et stable de définitions formelles et de lois universelles composant un paradigme, préexistant à toute recherche, à toute définition de l’objet spécifique de recherche. Le langage formel est un instrument atemporel et aspatial qui correspond à l’universalité des lois du monde empirique. « Il n’existe pas et il ne peut exister de langage protocolaire unifié de la description empirique du monde historique »[3] et ceci n’est en rien provisoire ou lié à une hypothétique jeunesse, immaturité des sciences sociales, en attendant l’avènement du paradigme unificateur (comme le prônait par exemple Merton), la Théorie à même de faire des sciences sociales des sciences de plein droit, des sciences « normales » au sens de Kuhn. Bien plutôt, c’est à la nature du monde historique aux variables infinies, auquel une infinité de concepts descriptifs peut s’appliquer, qu’il faut imputer l’impossibilité d’une stabilisation du « chaos conceptuel » auquel les sciences sociales et surtout la sociologie, sont confrontées.
Ainsi, l’évaluation de la scientificité de la preuve dans les sciences de l’ « observation contextualisée »[4] est toujours soumise à la référence à un langage théorique de description du monde, à un ensemble de concepts qui ne sont que des « abstractions incomplètes ». Leur scientificité, ainsi que la scientificité des travaux et résultats auxquels ils ont donné lieu, est même indissociable de leur indexation sur un contexte sans lequel ils perdraient tout sens. On retrouve ici la notion wébérienne de type-idéal, faisant le lien entre singularités historiques et abstractions généralisantes, qui ne prennent tout leur sens qu’en référence aux situations historiques dont ils sont issus : c’est le cas par exemple du concept de « féodalité », dont le sens n’apparaît qu’en rapport au Moyen-Âge occidental, à la Chine des Royaumes Combattants, etc… En somme, dans les concepts sociologiques de Passeron, comme dans les idéaux-types wébériens, « les individualités historiques restent présentes, à titre d’index, dans le concept. »[5]
Ceci a des conséquences directes sur le sens de l’imputation causale en sciences sociales, qui, au contraire des sciences naturelles qui peuvent s’appuyer sur un savoir nomologique stable pour l’explication de phénomènes naturels, eux aussi ontologiquement historiques, mais explicables par des lois universelles, doivent reconstruire en permanence et pour chaque occurrence historique, par exemple dans le cas d’une guerre, le contexte et l’enchaînement singulier des motifs (le sens) et causes qui ne sont jamais des « lois », des relations nécessaires.
Unité conceptuelle et découpage sémantique
Le caractère inépuisable du réel historique a pour corollaire la liberté de découpage sémantique et cette liberté pour effet inévitable (…) l’anarchie de la construction des unités conceptuelles. [6]
Chaque concept ne présente en effet jamais qu’un aspect, qu’une propriété du phénomène à décrire et analyser. L’attitude de mimétisme verbal et stylistique de certains raisonnements sociologiques sur le formalisme et la rigueur conceptuelle des sciences paradigmatiques ne transforme pourtant en rien le statut « naturel », le statut d’idéal-type des concepts utilisés dont le sens est toujours indexé sur des situations singulières et dont les emplois sont, eux-aussi, ceux d’une langue naturelle, pétrie d’histoire. Est-il possible qu’en sciences sociales chaque chercheur prenant pour objet le concept de « culture » soit en mesure de purifier ce terme de toute la charge culturelle et historique particulière dont il est plein selon les pays et, précisément, les cultures ? Existe-t-il un concept de culture qui ne soit pas chargé des présupposés sémantiques du chercheur lui-même, toujours inséré dans une culture particulière à l’acception particulière de la culture ?
Même en cas d’un travail ardu de défrichage de ses propres présupposés, le sens du terme de culture utilisé comme concept, n’est-il pas chargé du sens que donnent à la « culture » les « cultures » que son concept de « culture » permet d’observer et d’interpréter ? Les emprunts conceptuels, la polymorphie qui caractérise certains mots (celui de culture en est le meilleur exemple, dont Kroeber et Kluckhohn recensent plus de 50 définitions différentes) assurent à Passeron l’argument suivant : les mots dont la sociologie se sert dans ses raisonnements sont ceux d’un langage naturel et contextuel et la plus grande récurrence de termes (aux définitions très diverses selon les cas) « à la mode » à un moment donné de l’histoire des sciences sociales (structure, culture, classe sociale, etc…) ne signifie en aucun cas leur formalisation, ni l’unification sémantique de ces termes qui conservent bien un sens conceptuel singulier à chaque occurrence théorique (ou « isolation conceptuelle des emplois » selon Passeron). Au mieux, ces emprunts sémantiquement non-équivalents utilisent la « parenté des sens » comme inducteur d’hypothèse[7]. Au pire, ils entretiennent l’illusion qu’il serait possible d’isoler des concepts du contexte singulier dont ils ont permis l’interprétation.
Irrémédiablement descriptive et non nomologique, la sociologie, pas plus que l’histoire, n’a ni n’aura de langage protocolaire ou (…) de protocole opératoire unifié. Donc, les résultats finaux y seront toujours exprimés en langue naturelle et l’épreuve de la vérité relèvera toujours de l’exemplification, jamais de la falsification au sens donné par Popper [8].
S’il ne peut exister de langage non naturel, il ne peut y avoir de « corroboration provisoire » ou de fausseté déterminée par la réfutation d’une théorie par une autre en sciences sociales, puisque des résultats divergents sont la plupart du temps le résultat de champs sémantiques, d’ensemble conceptuels différents (de théories) auxquels les résultats obtenus se rattachent sémantiquement sans autonomisation possible de leurs conclusions. Le régime de la preuve en sociologie est donc celui de l’exemplification, plus ou moins riche, de théories présomptives irréductiblement contextuelles, et non pas celui de la réfutation. « Il n’y a pas d’autre épreuve empirique pour les résultats des sciences sociales que la multiplication coordonnée des constats empiriques dans une sémantique protocolarisée »[9].
Il existe des théories plus ou moins probantes, plus ou moins adaptées à l’analyse de contextes particuliers. On peut et on doit même multiplier les exemples et les contre-exemples qui sont à la base de la validité des théories, de leur « universalité numérique », mais sans que les contre-exemples puissent permettre jamais de réfuter absolument la théorie qui y a donné lieu, dans la mesure où les propositions générales que les sciences sociales formulent, constamment « rappelées à l’ordre »[10] par l’indexation à un contexte historique, ne sont que de portée présomptive. Un contre-exemple n’est en rien assimilable à une « réfutation » au sens poppérien, réfutation définitive de l’ensemble conceptuel composant une approche théorique. Autant, dans les sciences nomologiques, paradigmatiques, expérimentales, il est possible de trouver dans la réfutation empirique le critère principal de scientificité, permettant d’affirmer : « cette théorie est fausse car tel ou tel fait la contredit », puisque les lois que produit cette théorie a prétention à l’universalité, autant, en sciences sociales, ce critère n’est pas applicable et permet simplement l’affirmation suivante : « cette théorie n’est en l’occurrence pas adaptée à l’analyse de tel ou tel fait », ce qui ne remet pas en cause, a priori, ses qualités heuristiques, ni, d’ailleurs, la scientificité de son utilisation dans d’autres cas.
Si aucune théorie ne peut logiquement être réfutée en sciences sociales, plusieurs approches théoriques concurrentes sont, du fait du statut épistémologique des sciences sociales, possibles, et constituent même le cœur d’une normalité sociologique au pluralisme irréductible. Le jeu scientifique en sciences sociales devrait donc fonctionner de telle façon que plusieurs interprétations soient « légitimement en concurrence », ce qui, précisément en France, selon Passeron, n’est pas de cas, les chercheurs en sciences sociales souffrant de cette « illusion nomologique » directement issue de l’ambition naturaliste des sciences sociales.
Claire Saillour
Cette brève présentation de certains aspects de la pensée de J.-C. Passeron est tirée d’un précédent travail de recherche : « le naturalisme dans les sciences sociales ».
[1] J.C. PASSERON, « De la pluralité théorique en sociologie », Revue européenne des sciences sociales, Tome XXXII, 1994, n°99, pp.71-116, p. 83.
[2] J.C. PASSERON, « La forme des preuves dans les sciences historiques », Revue européenne des Sciences Sociales, Tome XXXIX, 2001, n°120, pp. 31-76, p.35.
[3] J.C. PASSERON, Le raisonnement sociologique. Un espace non poppérien de l’argumentation, Paris, Albin Michel, 2006 [1991], p. 549.
[4] J.C. PASSERON, « La forme des preuves dans les sciences historiques », Op.cit., p. 44.
[5] J.L. FABIANI, « La sociologie et le principe de réalité », Revue européenne des sciences sociales, Tome XXXIV, 1996, n°103, pp. 239-247, p. 245
[6] G. LENCLUD, « Le nomologique et le néant », Revue européenne des sciences sociales, Tome XXXIV, 1996, n°103, pp. 257-265, p. 262.
[7] Cf. J.C. PASSERON, Le raisonnement sociologique, Op.cit., p. 104-105.
[8] J. LAUTMAN, « Un espace non poppérien du raisonnement naturel ? », Revue Européenne des Sciences Sociales, Tome XXXIV, 1996, n° 103, pp. 249-255, p. 251.
[9] J.L. FABIANI, « La sociologie et le principe de réalité », Op.cit., p. 247.
[10] G. LENCLUD, « Le nomologique ou le néant », Op.cit., p.263.