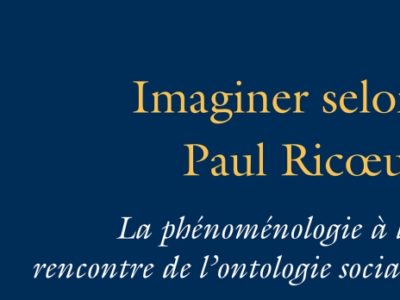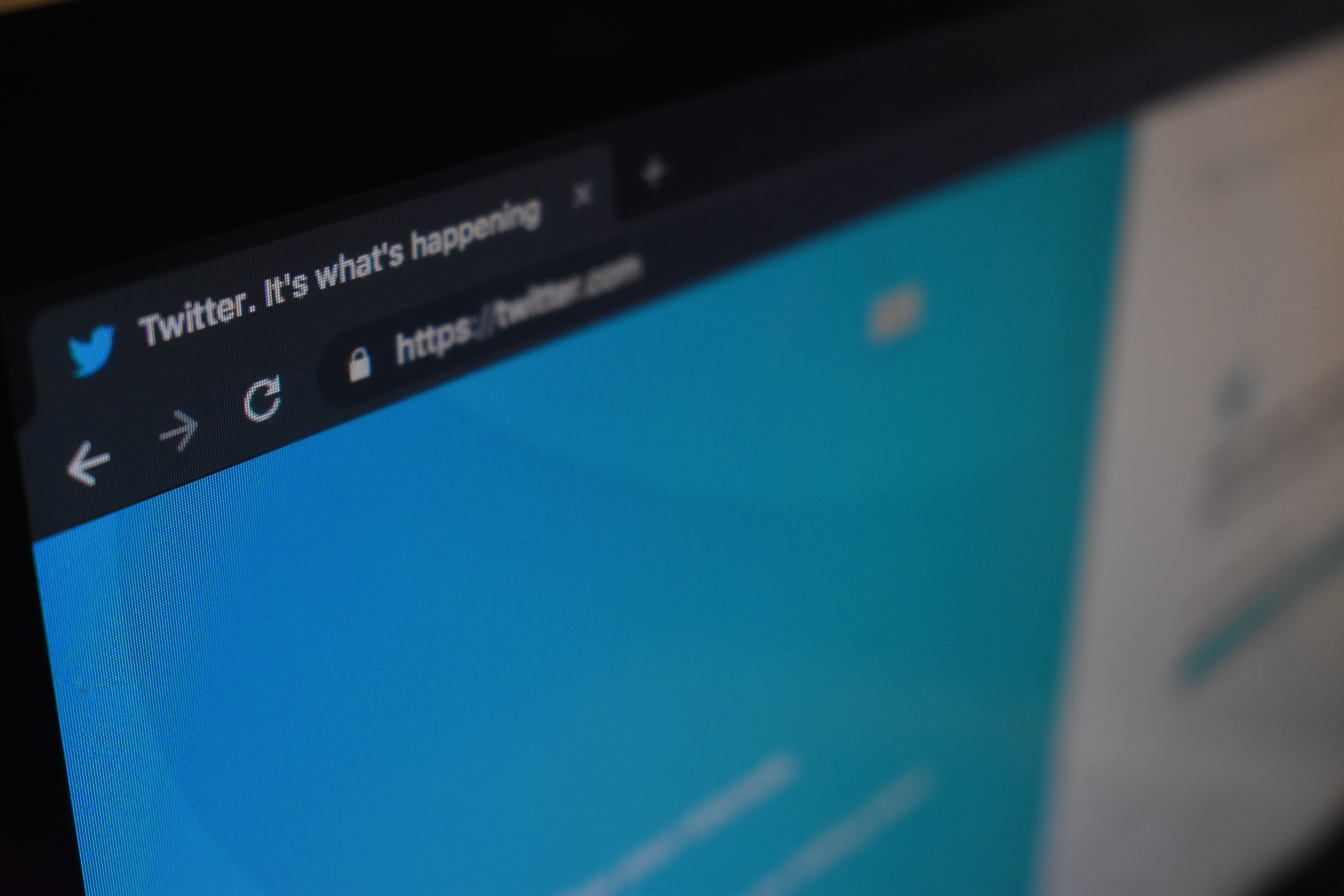Renouveler les débats actuels sur les drogues et les dépendances.
Renouveler les débats actuels sur les drogues et les dépendances en explorant les problématisations littéraires des addictions : l’exemple emblématique de David Foster Wallace et de son roman fleuve Infinite Jest.
Dominique Vuillaume, Cermes 3 (Unité Inserm 988/UMR CNRS 8211/EHESS/Université de Paris Descartes)
Introduction
Cet article a pour point de départ l’identification d’un point aveugle dans la configuration actuelle du champ de la recherche sur les addictions : alors que la narration des conduites addictives est devenue un thème majeur de la littérature contemporaine depuis plus de 50 ans, et singulièrement aux Etats-Unis, les contributions savantes sur les drogues et les dépendances – qu’elles soient de nature biomédicales ou issues des sciences sociales – continuent d’ignorer cette source originale d’information alors qu’elle est fortement reliée à la dimension expérientielle des addictions [1]. Cette inattention a pour conséquence un appauvrissement des débats actuels sur la place des drogues dans nos sociétés et sur la question connexe des dépendances qu’elles peuvent favoriser. En effet, ces débats s’organisent presque exclusivement à partir des problématisations morales, médicales et/ou sociales qui se sont construites progressivement à partir du milieu du XIXème siècle jusqu’à aujourd’hui.
Or la littérature contemporaine élabore également des problématisations de la question des addictions dans le registre narratif qui lui est propre. Prendre en considération ces problématisations est de nature, selon nous, à enrichir les débats actuels en y introduisant des dimensions inédites et peu envisagées jusqu’ici. Nous définissons ici le concept de « problématisation » dans la perspective ouverte par la sociologie constructiviste américaine [2], à savoir comme un processus de construction à la fois intellectuel et institutionnel par lequel un comportement donné dans la société, ou tout autre élément de la vie collective, est constitué en tant que problème social et suscite dès lors des discours et des prises de position multiples s’inscrivant dans divers registres : moral, juridique, médical, littéraire. Des facteurs divers interviennent dans ces processus de construction qui combinent, selon les cas, des mutations culturelles (nouvelle sensibilité collective), des transformations sociales (émergence de nouveaux groupes d’intérêt), de nouveaux agencements institutionnels, des changements de paradigmes scientifiques (par exemple le paradigme de la « perte de contrôle » pour les addictions).
Le présent article a donc pour objet de proposer au lecteur une première exploration des problématisations littéraires des addictions telles qu’elles se sont constituées aux Etats-Unis après-guerre à travers un auteur particulièrement marquant à cet égard : David Foster Wallace [3]. On verra que la problématisation des addictions qu’il élabore au fil de son roman fleuve Infinite Jest est relativement complexe et permet une mise en débat des modèles de l’addiction tels qu’ils sont portés par les problématisations scientifiques actuelles.
Mais avant de conduire cette exploration, il est important d’évoquer dans un premier temps les grandes étapes de la formation des problématisations savantes des addictions, qu’elles soient morales ou médicales, ne serait-ce que pour pouvoir les situer par rapport aux problématisations littéraires qui ont émergé plus tardivement et qui ont développé progressivement leurs spécificités.
1. De la Renaissance à l’avènement démocratique : premières formulations et reformulations des problématisations de la question de l’alcool et des drogues
La question récurrente du bon ou du mauvais usage des boissons alcoolisées est une constante des discours qui se construisent dès le XVIème siècle pour cerner le phénomène social de l’ivresse et caractériser les conduites excessives qui l’accompagnent. Ces discours sont d’emblée multiples et dessinent plusieurs formes possibles de problématisation de la question de l’alcool et de ses usages sociaux tout en trahissant l’émergence d’une inquiétude inédite quant aux effets individuels et collectifs de la diffusion de l’usage des boissons fermentées. Dans sa thèse sur l’ivresse et l’ivrognerie dans la France d’Ancien Régime [4], Matthieu Lecoutre en discerne quatre formes principales qui coexistent en parallèle pendant toute la durée de l’âge classique : religieuse en termes de caractérisation de l’ivresse comme péché, juridico-morale en termes de conduite dangereuse pouvant déboucher sur le crime ; médicale en termes d’affaiblissement physique pouvant favoriser de multiples maladies ; économique enfin en termes de menace de ruine pour les revenus du ménage… Pour autant, cette convergence des mises en garde ne parviendra pas à endiguer une nette progression des conduites d’alcoolisation dans toutes les classes de la société entre le XVIème et le XVIIIème siècle.
Les révolutions démocratiques qui interviennent en France et aux Etats-Unis entre la deuxième moitié du XVIIIème siècle et la première moitié du XIXème provoquent, à distance, un réaménagement très significatif de ces problématisations mais sans mettre fin ni à leur pluralité ni à la tonalité pessimiste qui les caractérisent. Bien au contraire : l’instauration d’un droit pour chacun à la liberté individuelle pose la question inédite de la régularité et de la prévisibilité des comportements individuels désormais « libres » et ce, pour l’ensemble des classes sociales et pas seulement pour les élites dirigeantes [5]. A cet égard, la question des conduites excessives induites par l’alcool prend une tout autre dimension que sous l’Ancien Régime : en-deçà des révolutions industrielles, les épisodes d’alcoolisation intervenaient essentiellement le dimanche, de l’après-midi jusqu’au soir sans déroger fondamentalement aux normes de la société féodale ; avec l’émergence des nouveaux centres industriels, ils peuvent se produire à tout moment, en semaine comme le dimanche, en particulier pour la nouvelle classe ouvrière, détachée de ses anciens liens de dépendance avec le seigneur du lieu mais aussi, du réseau de surveillance mutuelle du village. Ainsi la question de l’alcool, cantonnée jusque-là à la périphérie des jours travaillés, entre-t-elle de plain pied dans la centralité de la vie quotidienne des nouvelles démocraties qui sont également des puissances industrielles en devenir.
Aux Etats-Unis, cette centralité suscite, dès les premières décennies du XIXème siècle, une multiplicité d’écrits visant à nommer et à caractériser les très grands dangers que l’alcool fait courir à la jeune démocratie américaine. Plusieurs concepts successifs sont échafaudés [6] pour servir de lignes directrices à la construction d’un savoir militant sur cette question qui superpose, sans recherche particulière de cohérence, approche morale et approche médicale des usages abusifs d’alcool [7]. Jusqu’à la fin du XIXème siècle, cette superposition perdure et situe la vérité des conduites de dépendance aux divers psychotropes dans l’espace mixte de la maladie et de la faute morale.
En France, la question de l’alcoolisme se trouve durablement enchâssée dans une théorie générale de la dégénérescence et des aliénations mentales popularisée au milieu du XIXème siècle par l’aliéniste Bernard Augustin Morel. Cette subordination de la question de l’alcool à l’espace épistémologique de l’aliénation mentale fait obstacle durant la plus grande partie du XIXème siècle à l’émergence d’un discours médical propre sur l’alcool et ses dangers. C’est pourquoi la reconstruction d’une vision proprement médicale des conduites d’ivresse va venir d’autres horizons : en fait, c’est la multiplication des cas de relations passionnelles à la morphine provoquées par des prescriptions médicales « libérales » de cet opiacé à partir du milieu du XIXème siècle qui oblige des médecins et des aliénistes à proposer, dans l’urgence, une approche médicale de ces phénomènes non anticipés de dépendance aux opiacés [8]. C’est ainsi qu’émerge vers 1875, à l’initiative de médecin berlinois Edouard Levinstein, le concept de morphinomanie (morphiumsucht) qui met l’accent sur la dimension passionnelle de l’appétence des patients pour la morphine. [9] [10] Dans un premier temps, ce concept n’est pas seulement utilisé dans sa dimension médicale mais sert également à formuler des condamnations morales. Ainsi l’aliéniste Pichon distingue-t-il en 1889 les morphinomanes « médicaux », victimes d’une forme d’imprudence de leurs médecins traitants et qu’il convient d’aider à se sevrer, des morphinomanes « par vice » qui utilisent cette nouvelle drogue hors de tout cadre médical pour se procurer des sensations et qui portent l’entière responsabilité de leur état. [11]
Cette façon abrupte de classer les morphinomanes révèle la très grande proximité de cette nouvelle problématisation médicale avec des considérations sous-jacentes qui ont trait aux enjeux moraux de l’action. Dès lors que le morphinomane n’est pas à l’origine de sa morphinomanie, il mérite d’être soigné car on reste sur le terrain de la maladie involontaire stricto sensu ; mais si son état est une conséquence de sa propre action et si cette dernière n’est motivée que par la recherche d’un plaisir égoïste, on est alors, selon Pichon, sur le terrain de la faute morale inexcusable, la société ne pouvant reposer moralement sur la juxtaposition des hédonismes.
Aux Etats-Unis, l’inquiétude face aux risques contenus dans la diffusion à large échelle de la consommation des divers psychotropes, à commencer par l’alcool, s’organise sur de toutes autres bases en ménageant une place centrale aux enjeux politiques de l’action plutôt qu’à ses enjeux moraux. Dans la pensée américaine en effet, le produit alcool est considéré comme le prototype de la substance qui fait perdre au sujet son contrôle de soi (self control) et son libre-arbitre (free will). Or dans l’imaginaire états-unien, ces deux vertus cardinales forment la base anthropologique d’un exercice harmonieux de la liberté individuelle au service de la collectivité et de la démocratie. De ce point de vue, l’alcool est donc l’ennemi de la démocratie et doit être combattu comme tel. Cet ancrage du problème de l’alcool dans les enjeux politique de la démocratie américaine explique à la fois « l’abord tragique » que le problème de l’alcool a suscité aux Etats-Unis jusque dans les années 30 ainsi que les résistances récurrentes à la médicalisation de l’alcoolisme dans la mesure où celle-ci reste perçue par de nombreux secteurs de la société américaine comme une construction intellectuelle visant à exonérer le sujet alcoolique de ses responsabilités politiques et sociales [12] [13].
2. L’émergence de la problématisation littéraire des drogues
Avec l’essor de l’espace romanesque, les dernières années du XIXème siècle ajoutent une nouvelle forme de problématisation de la question de l’alcool et des drogues : celle de la narration littéraire des conduites de dépendance. En France, c’est la passion pour les opiacés, avec sa part d’exotisme et d’étrangeté, qui cristallise les inquiétudes et suscite des romans à thème sur fond de diffusion de l’usage de la morphine dans certaines fractions des classes moyennes et populaires, notamment à la suite du conflit de 1870 contre la Prusse [14]. Cette évolution excite l’imagination de journalistes et de romanciers qui, hors de toute observation contrôlée ou travail sérieux d’enquête, s’interrogent sur les relations possibles entre la morphinomanie et diverses formes de transgression morale. Au milieu de ces spéculations et de ces rêveries, une figure littéraire finit par s’imposer, celle de la « morphinée » c’est-à-dire d’une morphinomanie essentiellement féminine, coextensive à l’émergence des revendications féministes, et qui menace la solidité de la famille bourgeoise quand elle touche les femmes de la bonne société et encourage les désordres et la paresse quand elle contamine les mondaines, demi-mondaines jusqu’à atteindre les ouvrières [15].
Au point de départ, ces récits fantaisistes paraissent très liés aux considérations morales sur le danger des drogues qu’ils relaient dans leur espace narratif propre et qu’ils n’hésitent pas à amplifier à l’occasion. Ainsi, le parcours des « morphinées » est invariablement celui d’une chute morale qui débute avec l’installation de l’esclavage à cet opiacé et se termine dans le déclassement social et l’abjection morale.
Par la suite, la narration littéraire des conduites de dépendance s’autonomise progressivement du récit moral pour s’inscrire pour partie dans l’espace de l’autobiographie et du témoignage et pour une autre, dans celui de la description de mondes sociaux particuliers. Ce faisant, elle se rapproche insensiblement des problématisations savantes, qu’elles soient à vocation juridique ou médicale, sans pour autant se confondre avec elles, dans un jeu de correspondances et de renvois qui mérite d’être analysé pour lui-même.
3. Ouvrir le débat contemporain sur les drogues et les addictions aux problématisations littéraires
A l’heure actuelle, l’espace des débats sur la question des drogues et des conduites addictives est presque entièrement structuré par la confrontation entre les problématisations morales, judiciaires et médicales élaborées entre la fin du XIXème siècle et le milieu du XXème et qui ont pour caractéristique commune de préconiser l’abstinence en tant que but légitime de l’intervention publique (idéal d’une société sans drogues) avec le nouveau paradigme de la réduction des risques qui combine une suspension du jugement moral sur les comportements d’addiction avec une problématisation sanitaire et populationnelle pragmatique qui place au premier plan la limitation des dommages induits par les addictions et la mobilisation des professionnels de santé et des usagers pour prévenir le risque infectieux associé à l’injection de drogues. [16]
Pour intéressante que soit cette façon de construire le débat contemporain sur la question des drogues, elle fait l’impasse, comme nous l’avons dit précédemment, sur une composante essentielle qui est celle de la problématisation littéraire des conduites de dépendance. Or la narration d’épisodes de consommation de drogues est devenue, depuis les années d’après guerre, une composante significative des récits portés par la littérature contemporaine. Cette tendance est perceptible dans la littérature française et européenne mais elle est encore plus marquée dans la littérature américaine à partir des années 50 et 60. Ainsi, entre 1949 – année de parution du roman de Nelson Algren, The Man with the Golden Arm – et 2007, on dénombre pas moins de 16 romanciers anglo-américains de premier plan ayant écrit un ou plusieurs livres dans lesquels le thème des conduites addictives est très présent, voire central : il s’agit de Nelson Algren déjà cité [17], William S. Burroughs [18], Thomas Pynchon [19], Tom Wolfe [20], Donald Goines [21], Hunter S. Thompson [22], Phillipe Dick [23], Hubert S. Selby [24], Jay McInerney [25], Bret Easton Ellis [26], Bruce Benderson [27], Russel Banks [28], Melvin Burgess [29], David Foster Wallace [30], James Frey [31] et Jim Nisbet [32].
Les récits élaborés par ces différents auteurs forment un corpus significatif qu’il est légitime d’interroger en termes de « problématisation ». Nous faisons référence ici aux avancées récentes de l’analyse littéraire et plus précisément, à l’effacement de la séparation traditionnelle entre littérature réaliste et littérature de fiction qu’elles mettent en œuvre. En lieu et place de cette séparation, elles développent une conception unifiée selon laquelle tout récit doit être également regardé comme un acte cognitif qui produit des formes particulières de connaissance et qu’il est dès lors légitime de rapprocher d’autres modes de production du savoir [33].
Partant de ces avancées, le présent article s’inscrit dans l’objectif plus général d’initier une première analyse des jeux de renvois et de correspondance entre les problématisations savantes des conduites addictives, qu’elles soient normatives (théories morales et judiciaires) ou énonciatives (théories scientifiques et médicales) et les problématisations littéraires qui se sont multipliées depuis les soixante dernières années dans l’espace romanesque américain. Nous pensons qu’une telle démarche est de nature à élargir les débats actuels sur la question des drogues et des addictions en y introduisant des dimensions inédites et peu envisagées jusqu’ici.
4. Le choix de David Foster Wallace et de son roman fleuve : « Infinite Jest »
Compte tenu de la situation particulière et emblématique du livre de David Foster Wallace publié en 1996, Infinite Jest, au sein du corpus évoqué, on a fait le choix de limiter, dans un premier temps, l’analyse comparée des problématisations littéraires et savantes de la question des addictions à l’exploration de ce roman hors normes et de ses principaux thèmes anthropologiques [34]. Ce livre présente la particularité de contenir, au fil de ces 1 079 pages de récit (1 487 pages dans la traduction française) [35], la quasi-totalité des registres narratifs que l’on peut retrouver de façon plus dispersée dans les œuvres des autres auteurs cités.
Wallace construit ses différents fils narratifs sur la base de la description, par touches successives, de trois milieux sociaux particuliers dans lesquels le risque addictif est potentiellement élevé : une Académie de formation au tennis de haut niveau (Enfield Tennis Academy), un centre de réhabilitation d’usagers dépendants d’alcool et de drogues (Ennet House) et le milieu transgressif des usagers de drogues de rue.
A ces descriptions et mises en situation de milieux sociaux, Wallace superpose d’autres registres narratifs : tout d’abord celui du « ressenti corporel » de l’addiction par les différents personnages sur le mode du témoignage mais d’un témoignage formulé à la troisième personne comme si l’auteur voulait, en permanence, mettre le lecteur à distance de la narration et décourager toute forme d’identification avec les personnages. Un autre registre narratif est également très présent dans Infinite Jest et constitue sans doute une des grandes originalités de ce roman : celui de la description minutieuse des dispositifs et des techniques de réhabilitation des usagers dépendants de drogues mis en œuvre par le mouvement des Alcooliques et Narcotiques Anonymes qui représente aux Etats-Unis l’institution lourdement dominante pour les sorties d’addiction (hors sorties personnelles sans aide professionnelle). Cette dimension est peu présente chez les autres auteurs américains cités.
Ainsi, par la diversité de ces registres narratifs combinée à l’ubiquité d’un récit qui se déploie simultanément sur trois milieux sociaux particuliers, Infinite Jest représente un roman hors-normes qui justifie une analyse approfondie de ses diverses approches du phénomène addictif.
5. Les grands thèmes anthropologiques de la problématisation wallacienne de l’addiction
5a. L’absolue corporéité de l’addiction
Comme évoqué précédemment, le registre du « ressenti » des conduites addictives chez les divers personnages d’Infinite Jest constitue un élément majeur du livre et l’un de ses principaux fils narratifs. Mais chez Wallace, ce ressenti se localise avant tout au niveau du corps de ses personnages, dans le mélange particulier de sensations physiques et de signes cliniques déclenchés par la prise de substances psychotropes ou par les syndromes de manque et de sevrage, en amont de toute forme de réflexivité ou de rationalisation. A cet égard, l’un des passages les plus caractéristiques d’Infinite Jest est la description sur plus de 10 pages du sevrage forcé de Poor Tony. Poor Tony est un usager de drogues de rue qui vit d’expédients, de vols à la tire, et qui n’hésite pas, si nécessaire, à se prostituer pour payer son héroïne quotidienne. A la suite d’une agression qui ne s’est pas bien déroulée, il est obligé de se cacher pour échapper à la vindicte de ses compagnons habituels de rue. Coupé de ses sources familières d’approvisionnement, il est obligé de vivre un sevrage forcé, ce que Wallace met en scène comme une interminable descente aux enfers. Mais c’est presque exclusivement à travers le corps de Poor Tony et le cortège de sensations physiques désagréables qui en prennent possession tour à tour que Wallace raconte cette descente aux enfers en amont de toute réflexivité à dimension psychologique. Ainsi, tout se passe comme si l’addiction était d’abord celle du corps, d’un corps qui s’autonomise et dont le personnage attend avec terreur la matérialisation de sensations successives de plus en plus létales :
« à chaque pas qu’il faisait dans le couloir noir du Sevrage, Poor Tony Krause tapait du pied et refusait de croire que les choses puissent être pire. Bientôt il fut incapable d’anticiper ses envies d’aller, comme on dit, au petit coin. […] Des fluides de consistances variées commencèrent à couler, sans avertissement par divers orifices. […] Poor Tony avait eu la fatuité de penser que la vie lui avait donné maintes occasions de trembler. Mais jamais il n’avait connu de tremblements semblables avant que les cadences du temps – hachées, froides, empestant le désodorisant – n’entrent dans son corps par divers orifices – froids également mais d’un froid humide, le vrai froid – lui qui croyait savoir déjà ce que signifiait l’expression « être glacé jusqu’à l’os » – des colonnes d’épines gelées bourrant ses os de verre pilé – et, il entendait le craquement vitreux de ses articulations à la moindre variation de position. » (p. 420 – 422)
Dans le fil de cette narration, Wallace introduit, comme il le fait souvent dans d’autres passages du livre, des notations pharmacologiques, redoublant ainsi le registre principal du « ressenti » corporel par celui, plus cognitif, de la pharmaco-chimie :
« vers la fin de son deuxième après-midi sans sirop de codéine, Poor Tony dut commencer à se Sevrer aussi de l’alcool, de la codéine et de la morphine déméthylisée que contenait l’antitussif, en plus de l’héroïne, et éprouva un ensemble de sensations auxquelles même sa récente expérience ne l’avait pas préparé. » (p. 423)
Dans cette hypertrophie de la narration des sensations corporelles, Wallace porte une attention particulière aux déjections corporelles. Mais ce n’est pas toujours pour illustrer l’aggravation du processus addictif comme pour Poor Tony. Ainsi, lorsqu’il décrit minutieusement, dans la partie centrale de son roman, le mode de déroulement des réunions des AA et de leurs rituels, il rapporte le témoignage d’un ex-alcoolique qui voit dans le retour de selles enfin consistantes, le marqueur le plus simple et le plus évident de l’amélioration de son état.
Dans d’autres passages du roman où Wallace évoque les différentes étapes du processus addictif et de ses voies de sortie, c’est toujours par référence à l’évolution des symptômes corporels qu’il situe son propos. Ainsi lorsque l’un des personnages clés du roman, Don Gately, pensionnaire du centre de réhabilitation d’Ennet House, se souvient de l’évolution fatale de l’alcoolisme de sa mère, le récit s’organise entièrement à partir des signes corporels de l’intoxication éthylique auquel Wallace ajoute quelques notations plus médicales sur les complications de la cirrhose.
5b. La réflexivité limitée comme voie de sortie des addictions
Wallace consacre presque un tiers de son roman à la description minutieuse des modes de déroulement des fameuses réunions des Alcooliques Anonymes avec les différents témoignages qui en scandent le déroulement. Dans les quelques lignes d’avertissement en introduction à son livre, il mentionne le fait qu’il a assisté en personne à un certain nombre de réunions « ouvertes » des AA de Boston et qu’il a échangé à ces occasions avec de nombreuses personnes qui ont été « extrêmement patientes, loquaces et généreuses ». S’il a recueilli de cette manière un matériau empirique riche qu’il a largement réinvesti dans son roman, il a aussi voulu percer le mystère de l’efficacité de ces réunions particulières qui demeure énigmatique pour tout observateur extérieur. C’est très certainement dans la logique de cette recherche qu’il explicite, dans son roman, la vision qui est celle des plus « anciens » de ces réunions – il les appelle « les crocodiles » dans son livre – et que nous proposons de caractériser sous le vocable de « réflexivité limitée ».
Cette réflexivité limitée est d’abord celle des participants les plus anciens qui renvoient celui qui veut comprendre l’efficacité de l’approche des AA pour le maintien de l’abstinence au constat purement empirique que, effectivement, « ça marche » :
« ça semblait marcher vraiment, mais comment, bon sang ? Rien qu’en posant son cul sur des chaises pliantes hostiles aux hémorroïdes, chaque soir, pour regarder des pores de nez et écouter des clichés ? Voilà ce que Gately n’arrivait pas à piger. […]. Vous demandez à ces vieux gaillards terrifiants Comment les AA fonctionnent, et ils vous répondent par un sourire glacial en disant Très Bien. Ca Fonctionne, c’est tout ; point barre. Les nouveaux qui abandonnent leur sens commun, décident de s’Accrocher, de continuer à venir et découvrent soudain que leur cage s’est ouverte, mystérieusement, avec le temps, partagent cette sidération et cette crainte d’un piège. » (p. 486)
Mais cette réflexivité limitée s’applique également à la question clé de l’étiologie de l’addiction, ou plus exactement aux faits, sensations, événements, ressentis que celles et ceux qui témoignent de leur descente aux enfers lors des réunions AA pourraient être tentés de placer comme les éléments déclencheurs, voire explicatifs, de leur addiction à l’alcool ou aux narcotiques. Dans le rituel des témoignages qui forment le cœur des réunions des AA, Wallace met au jour une règle non formulée, mais qui n’en régit pas moins l’économie des échanges au sein des réunions : ne pas rechercher les causes de l’addiction quelles qu’elles soient car elles pourraient servir trop facilement d’explication ou d’excuse à d’éventuelles rechutes ou renoncement dans l’épreuve que constitue pour tous les participants le maintien de leur abstinence dans le temps :
« l’attribution causale, comme l’ironie, est mortelle en termes d’Engagement. Les veines temporales des Crocodiles se mettront à saillir et à palpiter d’irritation si vous tentez d’attribuer telle ou telle cause à votre Maladie. […] Le Pourquoi de la Maladie est un labyrinthe que les AA sont fortement incités à boycotter parce qu’il est habité par les minotaures jumeaux du Pourquoi moi ? et du Pourquoi pas ?, c’est-à-dire l’Auto-apitoiement et le Déni, les deux aides de camp les plus redoutés de l’Adjudant à tête de smiley.[…] Alors les pourquoi et les donc sont interdits. » (p. 519 – 520)
Mais la réflexivité limitée s’impose également dans le quotidien des ex-alcooliques, lorsqu’il s’agit de maintenir l’abstinence coûte que coûte, en dépit de la tentation de reprendre du produit, ce que Wallace appelle le « fantôme tentateur » qui, s’il parvient à appâter sa victime, « la prendra au lasso pour la ramener Là-bas », c’est-à-dire dans l’enfer de la spirale de la rechute. La consigne reine est alors d’investir ses pensées dans des activités, des rituels ou des dispositifs qui limitent les pensées circulaires et finalement obsédantes. Car dans l’expérience addictive que Wallace veut nous faire partager, la pensée circulaire et obsédante est celle qui est concentrée sur l’obsession de la rechute et sa difficile conjuration. Elle devient paradoxalement une pensée de type addictif.
Pour échapper à ce mode circulaire de réflexivité, les AA préconisent l’investissement dans deux formes principales d’activité ritualisée : un investissement intellectuel et affectif dans le suivi assidu des réunions AA du groupe auquel on appartient (jusqu’à 4 réunions par jour) ; un investissement corporel dans des rituels tels celui de la prière quotidienne où l’addict invoque une puissance supérieure pour l’aider à s’affranchir de son addiction. Wallace note à ce propos que ces activités ritualisées prennent progressivement la place envahissante qu’occupaient auparavant les substances favorites des sujets addicts à tel point que certains membres des groupes AA se retrouvent avec un emploi du temps aussi chargé que celui d’artistes ou de musiciens professionnels.
Ainsi l’addiction – conçue inséparablement comme un ascendant irrésistible de la substance sur le corps de l’addict (corporéité) et une obsession psychologique torturante qui ne laisse aucun répit à la pensée (pensée addictive) – peut finir par se dissoudre grâce à la monotonie répétitive des rituels AA et à leur capacité à bloquer, sur la longueur, les pensées obsédantes et circulaires. En d’autres termes, il s’agit de prévenir les rechutes en limitant strictement, par un dispositif de rituels, l’activité cérébrale réflexive de l’ex-addict en phase de réhabilitation.
5c. La subjectivité codifiée comme ressource collective pour les sorties d’addiction
A la description des mécanismes de la réflexivité limitée s’ajoute chez Wallace une approche des subjectivités en termes de ressources collectives à la disposition du groupe d’entraide. Ceci est particulièrement net dans la narration qu’il fait, à différents moments du roman, des témoignages personnels qui forment le cœur des réunions des AA. Les récits se conforment en règle générale à un code de présentation de soi qui privilégie les données factuelles de sa biographie d’alcoolique ou de junkie sur les affects et les impressions plus personnelles qui pourraient donner une coloration trop spécifique à chaque témoignage. De cette manière, chaque récit autobiographique fait ressortir les facteurs communs aux divers parcours d’entrée dans la dépendance facilitant une identification collective aux contenus des différents témoignages. Tout se passe comme si les AA avaient trouvé là, et de façon purement empirique, les voies et les moyens de convertir la subjectivité de chaque participant en ressource collective pour l’ensemble du groupe au prix d’une atténuation ritualisée des différences personnelles et d’une canalisation des affects. Et cette mise en commun des subjectivités pourrait être l’un des facteurs clés de la réussite des protocoles AA. [36]
5d. Des entrées dans l’addiction dominées par la contingence
Un dernier trait de la problématisation wallacienne des addictions mérite d’être relevé : le rôle important dévolu à la contingence dans l’initiation du cycle addictif. Si Wallace établit bien une correspondance entre le démarrage des consommations de psychotropes et l’entrée dans l’adolescence, il évoque à ce sujet une pluralité de causes possibles quant au risque de développer une dépendance qui revient à conférer un rôle déterminant au contexte, aux circonstances, c’est-à-dire à diverses incarnations de la contingence. Voici comment il introduit cette thématique en évoquant la consommation de cannabis d’Hal Incandenza :
« les drogues récréatives sont assez communes dans les établissements scolaires secondaires états-uniens, peut-être à cause des tensions nouvelles : post-latence sexuelle, puberté, angoisse, imminence de l’âge adulte, etc. Pour aider à maîtriser les tempêtes intrapsychiques, etc. […] Pour l’essentiel, il s’agit de petits plaisirs provisoires ; mais il existe traditionnellement un noyau dur, réduit, qui s’appuie sur une chimie personnelle pour répondre aux exigences spéciales de l’Académie de tennis.» (p. 77 )
La seule chose précise qu’évoque Wallace dans ce passage relatif à l’amorçage des conduites de dépendance c’est la « chimie personnelle » de certains adolescents, ce qui fait écho au paradigme biologique de l’addiction qui domine très largement la recherche médicale actuelle sur le sujet. Pour le reste, il évoque pêle-mêle des affects, des stades de développement, des symptômes psychiques qu’il relie de façon lâche aux contraintes de l’entraînement au tennis de haut niveau sans établir, ici comme là, de hiérarchie précise ni de rapports de causalité. En cela, Wallace reste très proche de la vision de l’entrée dans les conduites addictives que l’on peut trouver avant lui chez d’autres romanciers américains. Une entrée où le poids des circonstances, du contexte est présenté comme déterminant, au plus loin de tout ce qui pourrait ressembler à un déterminisme ou à un choix de vie précis et assumé comme tel. On pense à William Burroughs qui explique dans Junky qu’il est devenu dépendant à l’héroïne sans raison particulière, par désœuvrement et recherche de sensations nouvelles. On pense aussi à Bret Easton Ellis qui met en scène dans Less Than Zero la vacuité des loisirs de la jeunesse dorée californienne des années 80 au sein de laquelle les personnages du roman s’efforcent de briser la monotonie et l’inanité de leur existence par la consommation répétitive de drogues et d’alcool.
Conclusion
A travers la façon originale dont Wallace mène le récit des conduites addictives de ses différents personnages, trois caractéristiques remarquables émergent : l’importance qu’il accorde à la dimension corporelle de l’addiction au point de résumer l’expérience addictive intime à celle de ses impressions corporelles ; le jeu ambigu de la réflexivité limitée qui est à la fois ce qui accompagne la marche de ses personnages vers la dépendance aux substances et ce qui, paradoxalement, peut les aider à s’en sortir par une limitation délibérée des pensées de type addictif à l’aide d’activités fortement ritualisées telles celles codifiées par le mouvement AA ; la possibilité de modifier la personnalité addictive à travers diverses techniques de mise en récit des expériences subjectives pour en faire une ressource collective au service du groupe en voie de réhabilitation. Au cœur de ces techniques se situe celle du storytelling, initiée par les groupes AA, et qui connaît depuis une vingtaine d’années une diffusion considérable dans de tout autres contextes.
Il faut être attentif au double décentrement qu’opère la problématisation wallacienne des addictions par rapport aux problématisations scientifiques et médicales actuelles. Tout d’abord, en mettant l’accent sur le poids décisif du contexte et des circonstances dans l’initiation du cycle addictif, Wallace prend à revers le modèle déterministe et centré sur la personne qui est sous-jacent aux approches thérapeutiques actuelles. Invoquer, comme le fait aujourd’hui l’écrasante majorité des chercheurs et médecins addictologues, le modèle en vogue dit « bio-psycho-social » de l’addiction, c’est présumer qu’elle est le résultat non pas d’un agencement plus ou moins aléatoire de circonstances et de contextes propre à chaque histoire de vie mais du déploiement de déterminations identifiables, fussent-elles de différents niveaux et, pour certaines d’entre elles, de nature probabiliste plutôt que substantielle. Ainsi c’est bien la possibilité même d’un modèle déterministe de l’addiction, fût-il aménagé, que Wallace met en question à travers les différents récits de son roman-fleuve.
Mais Wallace opère également un deuxième décentrement. En focalisant des parties significatives de son roman sur le déroulement des réunions des AA de Boston avec leur cortège de témoignages, il met en exergue l’importance des phénomènes de dynamique de groupe dans les processus de sortie individuelle des addictions. Ce faisant, il rejoint totalement la perspective ouverte par Grégory Bateson dans son célèbre article de 1968 [37] et que Julien Claparède-Petitpierre analyse de façon détaillée dans son article d’octobre de cette année [38]. Cette perspective est celle de la mise en débat de la pertinence du concept du « soi » entendu comme l’origine unique de notre comportement et donc comme point d’application privilégié de toute démarche de soin en addictologie. De même que l’entrée dans l’addiction échappe selon Wallace à des explications en termes de choix de vie ou en termes de déterminations extérieures (facteurs de risque), la sortie des addictions passe par un décentrement du processus de réhabilitation de l’individu addict vers le groupe de pairs. C’est le groupe de pairs qui constitue le centre de gravité de la démarche thérapeutique chez les AA en permettant aux différents membres qui le constituent de s’affranchir d’un processus addictif qui les dépasse dans tous les sens du terme grâce à la mobilisation collective des expériences subjectives des uns et des autres. En définitive, l’intérêt manifesté par Wallace pour les protocoles d’intervention des AA apparaît comme une conséquence logique de l’attention singulière qu’il porte tout au long de ses récits à la dimension expérientielle de l’addiction et qui fait, de bout en bout, la profonde originalité d’Infinite Jest.
Notes et références bibliographiques
[1] L’expression « dimension expérientielle de la maladie ou d’un état de santé » fait référence à la dimension subjective de la maladie et au savoir profane que le patient construit à partir de ce vécu et qui se différencie clairement du savoir médical. Cette expression est devenue courante en psychologie et en sociologie de la santé depuis une dizaine d’années. Cf. à ce sujet la très complète note de synthèse de Jouet E., Flora L., & Las Vergnas O., « Construction et reconnaissance des savoirs expérientiels des patients », HAL archives ouvertes, 2010, pp. olivier_lv. <hal-00645113>
[2] Freidson E., Profession of Medicine, A Study of the Sociology of Applied Knowledge, 1970, Chicago, University of Chicago Press. Zola I. K., Medicine as an institution of social control. Sociological Review, 1972, 20, 487-505.
[3] David Foster Wallace (1962 – 2008). Ecrivain et universitaire américain. Il met fin à ses jours en 2008. Il était aux prises depuis son adolescence avec des problèmes récurrents de dépression et d’addiction à différentes substances…
[4] Lecoutre M., Ivresse et ivrognerie dans la France moderne, 2011, Rennes/Tours, Presses Universitaires de Rennes, Presses Universitaires François Rabelais, 400 p.
[5] Elias N., La société de cour, Paris, Calmann-Lévy, 1994.
[6] Concepts d’intemperance (au sens de manque de modération) et de drunkenness (ivrognerie) dans la première moitié du 19ème siècle suivis de celui d’inebriety (au sens d’ébriété chronique) dans la deuxième moitié du 19ème et enfin, émergence du concept d’addiction dans les premières décennies du 20ème.
[7] Vuillaume D., La construction des pensées française et américaine sur la question des drogues : du parallélisme des origines au tournant des années trente, Médecine/Sciences, Octobre 2015 ; 31 : pp. 921 – 928
[8] Yvorel J-J., Les poisons de l’esprit. Drogues et drogués au XIXème siècle, Paris, éditions du Quai Voltaire, 1992.
[9] Levinstein E. Ueber Morphiumsucht. 1875, Berlin, Med Gesell. Traduction française : La morphinomanie : monographie basée sur des observations personnelles, 1878, Paris, Masson.
[10] Yvorel J-J., « Les mots pour le dire : naissance du concept de toxicomanie », Psychotropes, 1992, 7, pp. 13 – 19.
[11] Pichon G., Le morphinisme, impulsions délictueuses, troubles physiques et mentaux des morphinomanes, 1889, Paris, Octave Doin.
[12] Valverde M., “Slavery from within: the invention of alcoholism and the question of free will”, Social History, 1997, 22(3), p. 251 – 268.
[13] Vuillaume D., « Interdire l’alcool ou soigner l’alcoolisme ? Flux et reflux de la médicalisation de l’alcoolisme aux Etats-Unis (1860 – 1995) », Sciences sociales et Santé, 2016, 34(4), pp. 5 – 31
[14] L’utilisation de la morphine pour le soin aux blessés de guerre est devenue courante lors du conflit de 1870 ; son usage « post-opératoire » favorise sa diffusion dans certaines fractions des classes moyennes et populaires.
[15] Yvorel J-J., « La morphinée », Communications, 1993, 56(1), pp. 105 – 113.
[16] Jauffret-Roustide M., & Granier J-M., « Repenser la politique des drogues », Esprit, février 2017, pp. 39 – 54.
[17] Nelson Algren, The Man with the Golden Arm, 1949, Doubleday, 343 pp.
[18] William S. Burroughs, Junkie: Confessions of an Unredeemed Drug Addict, 1953, Ace Books, 166 pp. – Version française : Junky, 2008, Gallimard. Catherine Cullaz et Jean-René Major (traducteurs)
[19] Thomas Pynchon, The Crying of Lot 49, 1966, J. B. Lippincott & Co. – Version française : Vente à la criée du lot 49, 2000, Seuil, Michel Doury (traducteur)
Gravity’s Rainbow, 1973, Viking Press, 760 pp. – Version française : L’Arc-en-ciel de la gravité, 1975, Plon, Michel Doury (traducteur)
[20] Tom Wolfe, The Electric Kool-Aid Acid Test, 1968, Farrar Straus Giroux Ed. – Version française : Acid Test, 1996, Seuil, Daniel Mauroc (traducteur)
[21] Donald Goines, Dopefiend: The Story of a Black Junkie, 1971, Holloway House Publishing Company. – Version française : L’Accro, 2004, Gallimard, Alexandre Ferragut (traducteur)
[22] Hunter S. Thompson, Fear and Loathing in Las Vegas: a Savage Journey to the Heart of the American Dream, 1972, Random House, 204 pp. – Version française : Las Vegas parano, 1998, 10/18.
[23] Philip K. Dick, A Scanner Darkly, 1977, Doubleday, 220 pp. – Version française : Substance Mort, 2000, Gallimard, Robert Louis (traducteur)
[24] Hubert Selby, JR., Requiem for a Dream, 1978, Playboy Press, 288 pp. – Version française : Retour à Brooklyn, 2004, 10/18, Daniel Mauroc (traducteur)
[25] Jay McInerney, Bright Lights, Big City, 1984, Vintage Books. – Version française : Journal d’un oiseau de nuit, 1987, Le Livre de Poche, Sylvie Durastanti (traductrice)
[26] Bret Easton Ellis, Less Than Zero, 1985, Simon & Schuster. Version française : Moins que zéro, 1986, Brice Matthieussent (traducteur), Paris, Christian Bourgeois, 234 pp.
[27] Bruce Benderson, User, a Novel, 1994, Plume Ed. 240 pp. – Version française : Toxico, 1998, Payot et Rivages, Thierry Marignac (traducteur)
[28] Russel Banks, Rule of the Bone, 1995, Harper Collins, 320 pp. – Version française : Sous le règne de Bone, 1996, Babel – Livres de poche, Pierre Furlan (traducteur)
[29] Melvin Burgess, Junk, 1996, Andersen Press, 278 pp. – Version française : Junk, 2002, Gallimard, Laetitia Devaux (traductrice)
[30] David Foster Wallace, Infinite Jest, February 1996, Little, Brown, 1 079 pp.
[31] James Frey, A Million Little Pieces, 2003, New York, Anchor Books, 448 pp. – Version française : Mille morceaux, récit, 2004, Belfond, Laurence Viallet (traductrice)
[32] Jim Nisbet, The Octopus on my Head, 2007, Dennis McMillan Publications, 236 pp. – Version française : Comment j’ai trouvé un boulot, 2008, Payot et Rivages, Freddy Michalski (traducteur)
[33] Numéro spécial des Annales : 2010/2, « Savoirs de la littérature » ; deux numéros spéciaux des Cahiers de Narratologie : 18/2010 « Littérature et sciences » et 28/2015 «Le récit comme acte cognitif » ; Numéro spécial de Critique, 2011/4, n° 767 : « La littérature face aux savoirs : frontière ou objet ? ».
[34] Classé par le Time magazine comme l’un des 100 meilleurs romans de langue anglaise écrits entre 1923 et 2005.
[35] Version française : David Foster Wallace, L’Infinie Comédie, août 2015, Editions de l’Olivier, 1 487 pp. Francis Kerline et Charles Recoursé (traducteurs). C’est sur cette version que s’appuie l’analyse conduite dans le présent article.
[36] Quelques années après la parution d’Infinite Jest, plusieurs publications scientifiques portées par des chercheurs américains en psychologie et en anthropologie vont conforter l’approche de Wallace en termes de mise en commun des subjectivités ; c’est le cas notamment de K., Humphrey (« Community Narratives and personal stories in alcoholic anonymous », Journal of Community Psychology, 2000, 28(5) : pp. 495-506) et M.G., Swora (« Narrating Community : the creation of social structure in alcoholics anonymous through the performance of autobiography », Narrative Inquiry, 2001, 2(2) : pp. 363-384).
[37] Bateson G., La cybernétique du « soi » : une théorie de l’alcoolisme, in Vers une écologie de l’esprit, Paris, Seuil, 1972.
[38] Claparède-Petitpierre J., Enjeux théoriques de la cure des Alcooliques Anonymes selon Grégory Bateson, Implications Philosophiques, octobre 2017, p. 1-6.