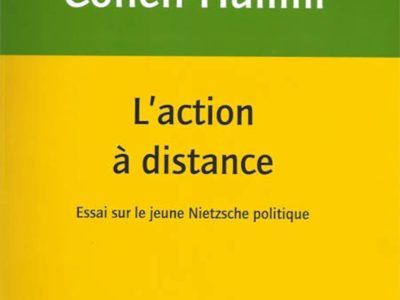Régis Debray et l’idéal égalitaire marxiste
3. Les apories de la critique debrayienne de l’idéal égalitaire marxiste
Debray se montre méfiant vis-à-vis des idéologies dominantes que sont le capitalisme et le communisme. Il y a crise permanente entre appropriation privée et caractère social de la production. Mais loin de se nouer, elle se dénoue pour conforter les inégalités. Un capitalisme sans contradiction serait une contradiction dans les termes. Cependant le marxisme, selon notre auteur, aura contribué à maquiller la profonde diversité des développements inégaux, injustes et désarticulés, axés sur le développement des uns et le sous-développement des autres.
Sa réflexion « médiologique » se concentre plus sur des événements significatifs du passé que sur une prospective proprement politique. Comprendre les raisons de l’échec des tentatives passées de rapprocher les hommes ne lui semble pas nécessairement une propédeutique pour l’avènement d’une nouvelle utopie. A Ziegler qui fait preuve d’une foi marxiste maintenue en dépit de difficultés et d’interrogations désabusées, il oppose un plus grand scepticisme à l’égard et du socialisme, et du libéralisme.
En somme, Marx, tombant contre son gré dans l’utopisme qu’il dénonçait, conçut une société égalitaire où chacun travaillerait et à qui l’on donnerait « à chacun selon ses besoins ». Mais, comme l’a montré Raymond Aron dans Les Étapes de la pensée sociologique, dans tout système économique, une organisation de la production est nécessaire. Les marxistes énumèrent le modèle esclavagiste, servile, capitaliste et asiatique. Ce dernier étant hyper-centralisé, la propriété est dans une seule main. À l’aube de l’URSS, Lénine a craint avec raison que l’on ne se dirige vers celui-ci plutôt que vers le communisme idéalisé par Marx. On ne s’est donc pas dirigé en terre communiste – comme il l’avait prophétisé – vers la mort de l’État, mais vers sa toute puissance : vers une dictature bureaucratique établie au nom des travailleurs. Au contraire, l’ultra-libéralisme tend peu à peu à nier les États. Là est le paradoxe de toute la pensée marxiste. Sa « fin de l’Histoire » n’a pas lieu.
D’après Debray, Marx a mis à jour les « valeurs » qui sont au fondement du mode de production capitaliste : l’accumulation de plus en plus rapide de la plus-value tirée de l’intelligence et du travail des hommes, la maximalisation de profits privés énormes sans égards aux coûts sociaux collectifs. Le marxisme relève une capacité de renouvellement constante du capitalisme, d’une vitalité proprement inégale. Dans la production des marchandises et des services, il fait montre d’inventivité, mais ce même système ravage la nature que Marx appelait « le corps extérieur de l’homme ». Dans l’appropriation privée des matières premières et du travail des hommes, ce système agit avec une immoralité, une cruauté et un cynisme absolus. Il réduit l’homme à sa pure fonctionnalité marchande et le prive de liberté, et, finalement, de destin. Ce système capitaliste atteint son apogée : le capital financier, d’une mobilité extrême, d’une puissance dévastatrice, transforme la planète entière en un unique espace homogène où la maximalisation du profit paralyse les pauvres et accorde à ses détenteurs un pouvoir totalement arbitraire. Ici, le capital financier est à lui-même sa propre référence.
Le livre I du « Capital » est un modèle de déconstruction sobre, sans moralisme, de la nature réelle du capital : son fétichisme. Marx apparait aux yeux de notre auteur comme un grand historien du capitalisme. Or Debray écrit : « marxisme et libéralisme, à mes yeux, c’est presque la même chose »[27]. Ce sont deux versants d’une illusion propre à la première révolution industrielle, mais qui peut aller jusqu’à la deuxième et la troisième. Ce que Debray appelle « l’illusion économique » réside en le fait que ce que Marx situait dans la superstructure appartient en fait à l’infrastructure du développement social.
Pour Marx l’essence de l’histoire se décidait dans l’économie, dans la production des biens matériels. Le développement du capitalisme, c’est celui des inégalités. La pauvreté se situe à des degrés différents. Le prolétaire camerounais vit des réalités non vécues par le prolétaire français. L’inégalité se situe dans la relativité totale. Comment peuvent-ils défendre de la même manière des intérêts non vivables? Marx pensait l’histoire dans le cadre de la mécanique classique, aux termes de laquelle la statique, ou science des forces accélératrices ou retardatrices et des mouvements variés qu’elles doivent produire. Ces forces trouvent un réglage commun, d’après les mêmes principes généraux du levier, de la composition des forces et des vitesses virtuelles. Or l’histoire de l’humanité est plutôt soumise à une dynamique. Cette dynamique engendre des modes d’exploitation de plus en plus sophistiqués et des lignes de fractures non seulement entre riches et pauvres, mais aussi entre cultures dites hégémoniques et cultures dites inférieures. Cela passe par la maîtrise de l’instrument technique et son utilisation implique certaines formes de domination : des centrales nucléaires, des banques, des satellites. « Disons que le Sud se prolétarise, le Nord s’embourgeoise, et que le prolétariat au Nord tend à être remplacé, de plus en plus, par les populations migrantes du Sud »[28]. Autrement dit, l’existence d’inégalités n’a pas changé avec l’avènement du monde moderne. Dans le cadre de la question égalitaire initiée par le marxisme, on a interprété l’évolution comme étant le processus permettant de passer d’une allocation inégale et imparfaite des privilèges et ressources à une version quelconque de l’égalité. L’unification se fait sur le mode de la rationalité marchande, et non par la création d’une identité unifiante. Cette rationalité, présente partout avec ses images aplatissantes et ses schèmes de pensées appauvrissantes, suscite des mouvements de revendications d’origine locale. Notre auteur constate que le monde est de fait dominé par deux logiques. Une logique d’uniformisation technique, dont le vecteur est le marché, qui introduit le libéralisme universel contre les forteresses autoritaires, mais qui écrase la diversité des cultures et des modes de vie, et puis une logique de balkanisation ethnique dont le vecteur est l’Etat, ou parfois la religion. Cette opposition apparaît géographiquement comme une complémentarité entre un centre capitaliste et une périphérie non-démocratique. Marx n’entrevoyait l’inégalité que sur le plan économique. Or elle est de plus en plus symbolique, imaginaire, culturelle, etc.
En particulier, si philosophiquement le projet du marxisme est désuet dans notre société globale, il est à noter que l’inégalité prend de plus en plus le visage de la construction d’une unité globale. C’est pourquoi Debray dénonce le mythe de la construction de l’Europe. Le droit de regard du fort sur le faible ne tient plus compte des frontières et de la souveraineté des Etats. La suppression des normes de souveraineté fait revenir au cynisme du droit du plus fort. Il voit dans le projet européen une « extraordinaire dépossession des peuples »[29]. C’est une implacable machine à broyer les personnalités nationales, la profondeur du temps propre à chaque nation. Si donc les concepts marxistes sont opératoires c’est pour conforter la domination des Etats puissamment influents dans le monde. La souveraineté des Etats était une façon de mettre un trait d’égalité entre les pays. Or le modèle capitaliste tend à supprimer les barrières de souveraineté au profit du capital. Théoriquement le Cameroun a la même souveraineté que la France. Mais un certain droit d’ingérence, plus ou moins colonial, est en train de se remettre en place, avec parfois de très bons prétextes, de bonnes motivations humanitaires et compassionnelles. La France revendique ce droit en République Centrafricaine depuis quelques mois. Il est vrai qu’il y a eu des abus du devoir de non-ingérence et du droit de souveraineté des Etats ; mais cela ne suffit pas pour justifier l’intrusion des Etats hégémoniques dans des pays Africains parfois sous le couvert de l’ONU. L’abolition de la souveraineté de certains Etats n’est qu’un moyen de diffusion de l’idéologie dominante occidentale et, déjà, orientale. L’approche globale des inégalités ne tient pas compte des réalités sociales propres à un Etat. On ne peut comprendre les questions sociales d’un pays qu’à partir d’une étude endogène. Il est donc hasardeux de saisir l’inégalité globale à partir d’un contexte isolé, sous peine de transposer les réalités d’ailleurs dans une situation quelconque. C’est pour cette raison que Régis Debray envisage la souveraineté des Etats comme solution à la mondialisation, qui n’est qu’une forme d’impérialisme moderne. Il qualifie à ce propos l’Europe de « communauté mercantile ».
C’est fort de cet échec de l’organisation égalitaire de la société, que nous voulions dans la logique des critiques susmentionnées envisager l’idée de justice sociale à partir des travaux de John Rawls. En effet, l’important n’est pas de chercher à déconstruire les mécanismes de la société comme l’a fait Marx, mais d’adapter à chaque contexte sa justice sociale. C’est en ce sens que le libéralisme politique de Rawls a toute sa légitimité comme une suite à la critique élaborée par Régis Debray.
On peut réfléchir la pensée de Debray dans celle de Rawls pour mieux en articuler le fond étatiste, même si les deux ne sont pas en tous points semblables. Cependant cette proximité permet aussi d’en apercevoir les limites.
Dans ses derniers travaux, John Rawls propose une conception de la justice globale[30]. Cette théorie se focalise sur les peuples[31], contredisant ainsi le dictum cosmopolitique voulant que les individus, en tant qu’êtres humains, doivent être l’objet premier de nos préoccupations morales. Ce déplacement a pour effet que Rawls refuse d’étendre à la justice globale plusieurs des principes qu’il défendait à l’échelle de la justice domestique, comme le principe de différence, le principe d’égalité des chances, et le principe de la valeur équitable des libertés politiques. À la place de ces principes qui garantissaient des droits et des libertés individuels, on retrouve, dans la théorie de la justice globale rawlsienne, huit principes régissant les relations internationales et les traités. Font partie de la Société des peuples et sont, par conséquent, régies par ces principes, les nations libérales et démocratiques, mais aussi ce que Rawls appelle les sociétés décentes, c’est-à-dire des hiérarchies consultatives de type patriarcal qui ne sont ni agressives ni expansionnistes. Toutes ces nations ont un devoir d’assistance à l’endroit des sociétés « éprouvées », c’est-à-dire des sociétés qui, en raison de circonstances historiques, sociales et économiques, peinent à réaliser leur autonomie politique[32]. Le devoir d’assistance se limite strictement à l’obligation d’aider les sociétés éprouvées à se donner et à maintenir des institutions justes ou décentes. Pour Rawls, il n’y a aucun principe de justice distributive exigeant de combler l’écart entre les sociétés riches et les sociétés pauvres au-delà de ce que demande le principe d’assistance.
Peu ont applaudi à la parution de The Law of People, où Rawls présente cette conception de la justice globale. Ainsi :
« La Société des peuples, telle que la conçoit Rawls, exige d’une part que les peuples soient justes selon les paramètres de leurs propres conceptions de la justice, et ce, dans les limites de la légitimité politique et, d’autre part, qu’ils se comportent entre eux comme de bons voisins. »[33]
Mais en dépit de ceux qui ont pensé reconnaître dans cet ouvrage un virage conservateur ou une parodie de la justice globale, il importe de comprendre, les raisons pour lesquelles Rawls se montre apparemment si peu exigeant à l’endroit des nations qu’il inclut dans la Société des peuples, et pourquoi, en particulier, il se démarque des exigences du cosmopolitisme.
Nous identifions pour notre part deux raisons, qui convergent vers ce qui semble être un impératif de la justice globale rawlsienne, à savoir l’absence de domination entre les peuples. La première tient à la légitimité des principes qui régissent les rapports de justice entre les nations. Dans toute l’œuvre de Rawls, la question de la légitimité apparaît comme une préoccupation centrale. Des principes de justice institutionnalisés, que ce soit à l’échelle globale ou dans le cadre d’un État, ont force de loi et supposent par conséquent l’exercice d’un pouvoir coercitif. Or, pour Rawls et pour toute la tradition du libéralisme politique, le pouvoir coercitif n’est légitime que si les principes qui gouvernent les institutions sont jugés acceptables par ceux qui le subissent. Il est clair que des principes de justice et des institutions « cosmopolitiques » conçues pour régir les relations entre les personnes à l’échelle de la planète contreviendraient de façon flagrante à ce qu’il pourrait sembler raisonnable d’accepter. Et cela, non seulement parce qu’ils iraient à l’encontre du statu quo en matière de système étatique et de relations internationales, comme certains l’ont suggéré, mais aussi pour des raisons purement organisationnelles: les conventions légales ou semi-légales qui régissent la vie publique dans chaque pays, qu’il s’agisse de la famille, de la santé ou de la sécurité, ne peuvent tout simplement pas s’effacer devant des règles régissant les relations d’individu à individu. Or ces conventions soulèvent des questions de justice sociale qui doivent être réglées à l’échelle d’une société, de la façon qui semble acceptable aux membres de cette société.
En limitant les exigences imposées aux peuples par la justice globale, Rawls se soucie de la légitimité du pouvoir coercitif exercé sur les peuples libéraux et décents dans leurs relations entre eux. Les institutions mondiales de la justice ne peuvent pas légitimement exiger de ces peuples qu’ils signent tous les traités, abolissent leurs frontières, congédient leurs armées et partagent entre eux leur richesse tant qu’il ne leur apparaît pas raisonnable de le faire. Et Rawls se soucie également de la légitimité du pouvoir coercitif qui s’exerce au sein des États libéraux et décents lorsqu’il s’agit de se donner et de faire respecter des principes de justice sociale. Les institutions mondiales de la justice ne peuvent pas légitimement forcer un gouvernement à se donner des politiques d’égalité des chances, à remodeler ses institutions ou à adopter certains modes de développement, car ces décisions, chez les peuples libéraux et décents, doivent s’appuyer sur le consentement du peuple, et ils dépendent de l’acquiescement de celui-ci aux valeurs qui sous-tendent ces pratiques.
Cela nous amène à la seconde raison qui a pu conduire Rawls à limiter les exigences de la justice globale. Peu de temps après la parution de Théorie de la justice, Rawls a commencé à émettre des réticences quant au projet de définir des principes de justice à valeur universelle. Dans Libéralisme politique, déjà, il souligne la difficulté de créer un consensus sur le deuxième principe de justice dans une société libérale. Selon lui, le pluralisme qui règne dans ces sociétés, de même que la profonde divergence des intérêts qu’on y rencontre, pourraient faire obstacle à son acceptation générale. Rawls insiste aussi sur les difficultés épistémiques (les difficultés de la raison) qui coupent court aux prétentions à la vérité en matière de justice. Ces préoccupations ne sont bien sûr pas très éloignées de celles qui touchent à la légitimité. Mais elles approfondissent cette question en mettant l’accent sur les conditions du consentement. En particulier, elles attirent l’attention sur le fait que de multiples facteurs peuvent influencer les points de vue sur la justice, et que ces facteurs ne sont pas tous moraux. Nous pensons que, s’agissant de la justice globale, Rawls a pu vouloir inclure parmi ces facteurs la culture, les traditions et les coutumes des peuples libéraux et décents. Tout comme le pluralisme au sein d’une société libérale, le pluralisme à l’échelle internationale nous oblige à réduire la portée des principes de justice. Debray paraît d’accord sur ce point, à savoir qu’il faut penser les inégalités à partir des réalités propres à chaque société, mais ne partage pas du tout l’idée de venir en aide aux « Etats pauvres ». Selon lui c’est un alibi pour les asservir. Rawls propose une alternative à l’idéal égalitaire envisagé par Marx mais sans prétention aucune de lire la situation d’un pays à partir d’une vue générale.
L’inclusion, dans la Société des peuples, de sociétés qui ne sont ni démocratiques (ou si peu), ni égalitaristes, ni libérales, mais seulement « décentes » a soulevé l’indignation de plusieurs spécialistes de la philosophie politique qui ont vu dans la mince justice globale de Rawls une concession faite à ces peuples. Ils ont peut-être raison. Il est clair qu’entre le danger de trop concéder et celui d’imposer à la planète des valeurs et des modes de vie marqués au coin par l’Occident, c’est le second que Rawls craignait le plus. Mais cette crainte, à notre avis, ne se fonde pas uniquement sur une exigence de légitimité; elle prend aussi sa source dans la reconnaissance du fait qu’il y a plusieurs façons pour un peuple de concevoir ses institutions, les rapports entre ses membres, son évolution, ses modes de vie et son développement, bref de se concevoir lui-même, et certaines de ces façons, même si elles diffèrent profondément des nôtres, peuvent néanmoins être « décentes ». Pour le dire autrement, l’imposition à tous des mêmes normes de justice pourrait elle-même constituer une injustice. Reconnaître cela c’est aussi reconnaître que les peuples libéraux et décents ont la capacité de décider par et pour eux-mêmes[34].
Ces deux raisons de limiter les exigences de la justice globale — un souci pour la légitimité et pour l’autodétermination des peuples — devraient intéresser les défenseurs du cosmopolitisme. Ce sont elles, en effet, qui alimentent l’une des critiques les plus tenaces adressées au cosmopolitisme sous toutes ses formes, des plus anciennes aux plus récentes, à savoir la ressemblance de famille qu’il entretient avec l’impérialisme et le colonialisme. Le colonialisme s’est toujours présenté sous les couleurs d’une mission civilisatrice. Prétextant de l’égalité de tous les êtres humains, et par conséquent de l’éligibilité de tous à l’évangile, le colonisateur s’est aussitôt empressé de reléguer le colonisé dans un rôle d’apprenti devant son maître. L’idée que chaque personne a des devoirs moraux à l’endroit de l’humanité tout entière est peut-être une bonne nouvelle pour certains, mais qui définira le contenu de ces devoirs et les droits qui y correspondent? Qui, au nom de l’égalité de tous, s’arrogera la tâche d’enseigner au reste de l’humanité ce qui est bon pour elle? Qui, sans être à la fois juge et partie, aura le mandat de soumettre le genre humain à la Norme? Par-delà ce qui ressemble bien à une aporie de l’égalité cosmopolitique, on retrouve ici deux problèmes proprement moraux que Rawls, croyons-nous, avait bien aperçus: celui de la légitimité des normes et celui de l’autodétermination des personnes et des peuples. Mais ces problèmes ne sont-ils pas, finalement, inhérents à toute tentative d’asseoir les fondements d’une justice globale substantielle?
Mais pour Debray, l’idéal égalitaire passe bien par un idéal étatique préalablement réussi, qui soit garant de l’égalité de tous devant la loi, et non instrument de domination. Les droits de l’homme ne sont pas supra-étatiques, car ils ne sont rien sans les droits du citoyen. C’est pourquoi « l’Etat n’est pas un bien, mais c’est le moindre mal »[35]. Telle est la posture « proétatique » que lui reproche Ziegler[36]. Debray pense à la République comme expression de la souveraineté du peuple, l’intérêt collectif, dont l’Etat n’est qu’un moyen, et un moyen qui destitue ces deux structures inégalitaires que sont les clergés et les mafias. Mais l’Etat peut-il réellement servir les intérêts des peuples ? La raison d’Etat ne s’oblige-t-elle pas à une autonomisation susceptible de justifier toutes les horreurs ? Il lui semble que la république doit aller jusqu’au bout de ses principes, et porter un idéal moral. Mais comment l’opérationnaliser au-delà du discours ? Ziegler oppose aussi à Debray que la nation est source de dissensions entre les peuples[37]. Si Debray y répond que la nation est une réalité élective et non d’abord affective, c’est qu’à ses yeux la nation élective est structurée autour de l’idéal d’égalité :
« n’allons pas confondre la nation élective qui est la nation républicaine et révolutionnaire, la nation des citoyens, avec la nation des morts et du sol, la nation ethnique ou de type germanique, la race et la forêt. Celle-là c’est la tribu. Et le remède à la tribu, pour moi, c’est la nation égalitaire. La nation, c’est l’antitribu »[38].
Pour Régis Debray, s’il est donc question de faire dépendre l’idéal égalitaire de l’idée de la République, ce sera en tâchant de redéfinir la République, pour l’arracher à ses déviations relevant du juridisme. Un idéal égalitaire qui n’est guère fondé sur la République le sera davantage sur le ressentiment. L’idée de justice est recherche d’un certain sens des proportions. La réaction à la pauvreté doit être affaire de fondements (pas toujours logiques), non de fondations (censément rationnels). Il faut repenser le sacré d’un point de vue laïc, pour y lover les valeurs du marxisme : égalité, solidarité, ouverture à l’autre, etc.
L’idée que la République puisse être à elle-même sa propre transcendance est remise en cause par le constat que si la République privilégie la référence à l’Etat, la Démocratie privilégie la référence à la société ; dans la Démocratie, la loi fait place au contrat, où tout ne s’appréhende que sur le plan de la conscience. Ce distinguo permettrait de réentendre, a minima, la voix du sacré. Mais le sacré n’est-il pas une voix, une Voie ? Peut-il s’accommoder d’une réduction politiste opposée à toute fonction sotériologique ? Une politique du religieux (proche des visées finalement réductrices de la religion civile) peut-elle éviter une religion du politique, sol équivoque d’un patriotisme exclusiviste ? La réinvitation du religieux en politique ne se soutient pas d’une réduction de l’anthropologique au religieux, aussi radicalement préjudiciable que la réduction marxiste du politique à l’économique ? En dépit de leur difficulté, ces questions doivent sans doute être regardées comme une invite à la relance post-spinoziste du théologico-politique, dans une perspective qui se veut plutôt symétrique qu’asymétrique. On verrait alors la nécessité d’un troisième personnage qui ne soit pas la philosophie dans une rupture d’avec la morale, mais la morale dans un lien maintenu avec le religieux. Car chez Debray aussi bien que chez Marx, l’allégation de l’idéal humanitaire reste sous-tendue par un optimisme éthique qui pose le problème récurrent de sa mise en concept.
Bibliographie
1. Ouvrages
Althusser (Louis), – Pour Marx, avant-propos et note biographique d’E. Balibar, Editions
La Découverte/Poche, Paris, 1996.
– Écrits philosophiques et politiques, volume II, textes réunis et présentés par F. Matheron, Editions Stock/Imec, coll. Le Livre de Poche, Paris, 1997.
Appiah Kwame (Anthony), The Ethics of Identity, Princeton University Press, 2005.
Beitz (Charles), Political,Theory and International Relations, (seconde édition), Princeton University Press, 1997.
Debray (Régis), – L’Etat séducteur, Paris, Gallimard, 1993.
– Critique de la raison politique ou l’inconscient religieux, Paris, Gallimard, 1981.
– Le pouvoir intellectuel en France, Paris, Gallimard, 1989.
Debray (Régis) et Ziegler (Jean), Il s’agit de ne pas se rendre, Paris, Arléa, 1994.
Ferry (Luc) et Renaut (Alain), La pensée 68. Essai sur l’antihumanisme contemporain, Paris, Gallimard, 1988.
Henry (Michel), Marx, I, une philosophie de la réalité, préface de M. Henry, éditions Gallimard, collection Tel, Paris, 1991.
Kymlicka (Will), Liberalism, Community and Culture, Oxford, Oxford University Press, 1989.
Bernard-Henri (Lévy), La barbarie à visage humain, Paris, Grasset, 1977.
Marx (Karl), – Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, postface de D. Franche, Éditions Mille et une nuits, Paris, 1997 (la traduction est celle des Éditions Sociales, Paris, 1969).
– L’Idéologie allemande, Critique de la philosophie allemande la plus récente dans la personne de ses représentants Feuerbach, B. Bauer et Stirner, et du socialisme allemand dans celle de ses différents prophètes, traduction présentée et annotée par G. Badia, Éditions Sociales, Paris, 1976.
– L’Idéologie allemande, traduction H. Hildenbrand, notes et commentaires de J.-J. Barrère et C. Roche, Nathan, Paris, 1998.
– Le Capital, Livre I, sections I à IV, traduction J. Roy, préface de Louis Althusser, Champs Flammarion, Paris, 1985.
– Le Capital, Livre I, sections V à VIII, traduction J. Roy, Champs Flammarion, Paris, 1985.
– Manifeste du Parti communiste, présentation et commentaire de F. Châtelet, Bordas, Paris, 1986 (traduction réalisée à partir de celles de l’édition bilingue réalisée par E. Bottigelli aux éditions Aubier-Montaigne, Paris, 1971; et de M. Rubel in Karl Marx, Oeuvres, I, Gallimard, Paris, “La Pléiade”, p.161 – 195).
– Manuscrits de 1844, traduction J.-P. Gougeon, introduction et notes de J. Salem, GF-Flammarion, Paris, 1996.
– Thèses sur Feuerbach, présentation par S. Labica, Editions PUF/Collection “Philosophies”, Paris, 1987.
Rawls (John), The Law of People, Harvard University Press, 1999.
– Libéralisme politique(1993), trad. fr. C. Audard, Paris, PUF,1995.
– Théorie de la justice(1971), trad. fr. C. Audard, Paris, Seuil, 1987.
Wallerstein (Immanuel), Les inégalités entre les Etats dans le système international. Origines et perspectives, p.p.7-25, Centre Québécois de relations internationales, Université de Laval, 1975.
2) Articles
Appiah Kwame (Anthony), « Cosmopolitan Patriots » in P. Cheah et Bruce Robbins (dir.), Cosmopolitics, University of Minnesota Press, 91-114, 1998.
Barry (Brian), « Statism and Nationalism: a Cosmopolitan Culture » in I. Shapiro et L. Brilmayer (dir.), Global Justice, New York University Press, 1999.
Beitz (Charles), « Philosophy of International Relations ».In Routledge Encyclopaedia of Philosophy, Routledge, 826-33, 1998.
Cohen (Mitchell), « Rooted Cosmopolitanism ». In Michael Walzer (dir.), Towards a Global Civil Society, Berghahn Books, 223-33, 1995.
Couture (Jocelyne), et Kai (Neilsen), « Cosmopolitisme et particularisme », in Philosophiques, Vol 34, no1,2007, p.3-15.
Couture (Jocelyne), « Nationalisme et démocratie mondiale. Entre le mythe de la communauté et le mirage du village global ». In Michel Seymour (dir.), États-nations, multinations et organisations internationales, Montréal, Liber, 205-226, 2002. Repris sous le titre « Nationalism and Global Democracy: Between the Myth of the Community and the Mirage of the Global Village », dans Michel Seymour (dir), The Fate of the Nation-State, Montréal: McGill / Kingston: Queen’s University Press, 69-89, 2004.
Habib (Irfan), “Problems of marxist historical analysis in India”, Enquiry, 1969.
Pogge (Thomas), « Cosmopolitanism: A Defense », CRISPP, vol. 5, no 3, 86-91, 2002.
[1] Régis Debray, Critique de la raison politique, Paris, Gallimard, 1981, p.65.
[2] Ibid., p.41.
[3] Louis Althusser, Pour Marx, avant-propos et note biographique d’E. Balibar, postface de L. Althusser, Editions La Découverte/Poche, Paris, 1996, p.59.
[4] K. Marx, Manuscrits de 1844, trad. J.-P. Gougeon, introduction et notes de J. Salem, GF- Flammarion, Paris, 1996, p.115.
[5] Ibid., p.113.
[6] Tous ces extraits sur l’opposition Homme-animal sont tirés des Manuscrits de 1844, p.115-116.
[7] Ibid., p.115.
[8] Michel Henry, Marx, volume1, une philosophie de la réalité, préface de M. Henry, Editions Gallimard, collection Tel, Paris, 1991, p.97.
[9] Ibid., p.96 et p.100.
[10] Chez Feuerbach « l’histoire se loge très exactement entre l’individu et l’espèce, pour combler le vide qui les sépare et transformer l’espèce de concept abstrait nominaliste, en réalité, elle n’est donc rien d’autre que le concept de ce vide » (L. Althusser, Ecrits philosophiques et politiques, Volume II, p.253.)
[11]Ibid., p.31.
[12] R. Debray, Critique de la raison politique, Paris, Gallimard, 1981, p.460.
[13] Ibid., p.461.
[14] Ibid., p.461.
[15] Ibid., p. 461.
[16] R. Debray, J. Ziegler, op. cit., p.10.
[17] R. Debray,op.cit., p.462.
[18] Régis Debray, Critique de la raison politique, op. cit., p.20.
[19] R. Debray, J. Ziegler, op. cit., p.21.
[20] I. Habib, “ Problems of marxist historical analysis in India”, Enquiry, 1969.
[21] R. Debray, Critique de la raison politique, op. cit., p.49.
[22] Ibid., p.144-145.
[23] Ibid., p.147.
[24] Ibid., p.73.
[25] Ibid., p.70.
[26] R. Debray, J. Ziegler, Il s’agit de ne pas se rendre, Paris, Arléa, 1994, op. cit., p.31-32.
[27] R. Debray, J. Ziegler, op.cit., p.36.
[28] Ibid., p.17.
[29] Ibid., p.51.
[30] J. Rawls, The law of people, Havard University Press, 1999, p.117.
[31] S’il est vrai que la théorie de Rawls se focalise sur les peuples, il faut néanmoins souligner le fait que, pour lui, ce sont les frontières entre les Etats qui comptent pour un peuple. C’est pour cette raison qu’on peut parler de l’étatisme de Rawls.
[32] J. Rawls, op. cit., p.117.
[33] Ibid., p.117.
[34]Nous ne voudrions pas occulter ici les difficultés pratiques de la position de Rawls. Comme l’ont fait remarquer plusieurs commentateurs, c’est souvent au nom du « peuple » et de son bien que la tyrannie et l’oppression finissent par s’imposer. Mais il faut aussi se rappeler que le respect des peuples prôné par Rawls vaut uniquement pour les peuples « libéraux » et « décents », qui font partie de la Société des peuples et pas pour les régimes expansionnistes et ceux qui violent les droits de la personne. Le pari que fait Rawls est qu’en les incluant dans la société des peuples, les peuples décents se libéraliseront.
[35] R. Debray, J. Ziegler, op. cit., p.45.
[36] Ibid., p.48.
[37] Ibid., p.58.
[38] Ibid., p.60.