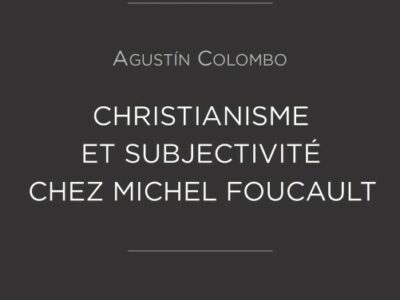Recension – Puissance et impuissance de la réflexion, de Vincent Citot
Recension de l’ouvrage de Vincent Citot, Puissance et impuissance de la réflexion, Argenteuil, Le Cercle Herméneutique, 2017.
Sylvie Taussig – CNRS UMR 8230 – IFEA
L’ouvrage peut être trouvé sur le site des éditions Vrin en cliquant ici.

Quoique le propos de l’auteur soit de bien penser la nature de la réflexion philosophique pour bien la pratiquer, ce travail d’assainissement apparaît principalement comme une entreprise critique à l’égard de la philosophie – d’une certaine conception de celle-ci. Vincent Citot insiste tout particulièrement sur ses « bornes », qu’il trouve tantôt du côté de la science, tantôt du côté de la mystique. Il pointe également certains travers du devenir institutionnel de la philosophie et remet en cause l’historiographie de la philosophie telle qu’elle est couramment pratiquée. Si l’entreprise de l’auteur se veut constructive, la dimension critique est donc très présente.
La première partie, qui est plutôt un propos liminaire, s’interroge sur les enjeux de la réflexion, laquelle n’est pas la somme de tous les actes qui la composent, mais pratique de la réflexivité et, comme activité de penser, le principal outil de la philosophie. L’auteur dégage ses enjeux ontologiques (dans la mesure où il est question de métaphysique et non de biologie), gnoséologiques (puisque la réflexion est nécessaire et non suffisante pour construire le savoir, ayant besoin pour ne pas être prométhéenne de l’expérience) et axiologiques (car réfléchir implique des valeurs). Il annonce les mérites de la réflexion (sa lucidité et ce qui fait qu’elle fait la grandeur de l’homme) et ses limites (son échec à saisir le préréflexif et son incapacité à assurer le « connais-toi toi-même » individuel). Les limites inhérentes à la réflexion – que la réflexion perçoit – l’obligent à se décentrer et à se nourrir des apports d’autres disciplines – sciences sociales, histoire, psychanalyse et psychologie. En réalité la réflexion est ascèse de la liberté en tant que, dans l’esprit critique, elle libère en s’opposant à soi. L’auteur anticipe l’objection qu’on pourrait lui faire que l’individu qui réfléchit semble coupé du monde humain : pour résoudre ce dilemme, qui oppose la réflexion à l’éthique de la vie, Vincent Citot propose de distinguer la morale de l’urgence de la morale de l’intelligence – et c’est là où la réflexion se relie nécessairement à la politique.
La deuxième partie[1] montre comment la réflexion a pénétré la religion, la philosophie et la science, et ce faisant, les a fait progresser. Ce qui est évident dans le cas de la philosophie – tant réflexion et philosophie sont associées – n’est pas moins frappant pour les deux autres formes de savoir, et cela se produit chaque fois qu’elles sont tenues de se préciser – c’est-à-dire de se rationaliser et donc, d’une certaine façon, de se décentrer. Ainsi donc, à la rigueur, ou « du point de vie théorique cognitif », il y a une progression et, disons-le, un progrès de la religion à la philosophie et à la science – rationnelle, dépersonnalisée, universelle et objective. Il est cependant impossible d’affirmer cela sans aussitôt tomber sur l’écueil qui menace la science, à savoir le réductionnisme – forme de présomption. Les qualités de la science (dépersonnalisation, objectivation, etc.) sont exactement ses défauts d’un autre point de vue, car cela la sépare de la morale ainsi que de toute considération de l’existence personnelle. Paradoxe du savant, lui-même doté de valeurs, de dépouiller ses objets de recherche de toute valeur pour les transformer en « faits ». Ainsi la rencontre des limites – que la réflexivité met au jour – oblige-t-elle en quelque sorte à redescendre de la science à la philosophie et de la philosophie à la mystique. Quant à la mystique, à son tour, elle pratique ô combien la réflexivité, puisque faute de pouvoir poser des définitions, elle s’entend comme négation de la négation.
Arrivé à ce point – la troisième partie –, l’auteur semble déplacer son objet et s’emploie à définir la philosophie – ou plus précisément à définir ses critères d’évaluation. Il ne saute pas du coq à l’âne, certes, car les deux activités (réfléchir et philosopher) se ressemblent – la philosophie étant comme l’écriture ou le style de la réflexion. Mais, d’une façon plus essentielle de mon point de vue, la réflexion sur la philosophie suscite une critique des tendances ethnocentriques de la philosophie européenne : l’auteur est attentif à ce que la définition qu’il propose de l’activité philosophique vaille au-delà des usages strictement occidentaux. Il fait valoir en outre une série de critères permettant de juger de la qualité d’un discours philosophique en général, critères regroupés en deux exigences essentielles : « l’exigence théorique » et « l’exigence pratique ». L’ampleur du décentrement critique et l’aptitude à monopoliser à bon escient la culture scientifique contemporaine relèvent plus particulièrement de la première, tandis que la « recentration métacritique », la « réflexivité éthique » et la « cohérence théorico-pratique » relèvent de la seconde. En somme, le philosophe doit universaliser son propos sans s’oublier lui-même comme sujet pensant et même comme personne singulière – de là une certaine réflexivité qui est propre à la philosophie et que la science ne connaît pas sous cette forme.
En quatrième et dernière partie, l’auteur applique sa réflexion sur les limites de la réflexivité à un cas particulier : celui des rapports d’une discipline à sa propre histoire – plus précisément à son historiographie, c’est-à-dire à l’écriture de son histoire. Une discipline quelconque doit-elle écrire elle-même sa propre histoire ? L’auteur pointe les insuffisances d’une telle « réflexivité intradisciplinaire ». Il n’appartient pas aux artistes d’écrire l’histoire de l’art, aux religieux d’écrire l’histoire des religions, aux mathématiciens d’écrire l’histoire des mathématiques, etc. La philosophie n’échapperait pas à la règle, pour des raisons explicitées à l’occasion d’une « réflexion épistémologiques sur l’historiographie de la philosophie ». Il revient aux historiens d’écrire l’histoire, qu’elle soit sociale, culturelle ou intellectuelle – l’histoire de la philosophie étant alors comprise comme une branche de l’histoire intellectuelle. Mais il n’est pas interdit à un philosophe de formation et de profession de se former aussi à l’histoire et à ses exigences épistémologiques propres. Ces réflexions complètent et prolongent celles qu’avaient engagées Vincent Citot sous le titre « L’histoire de la philosophie comme science rigoureuse » – contribution à un collectif qu’il a récemment dirigé[2].
D’une façon générale, Puissance et impuissance de la réflexion est convaincant dans son argumentation. L’ouvrage procède philosophiquement, ce qui pourrait désigner ici à la fois un rythme (le calme d’une pensée qui se construit étape après étape, sans rien laisser dans le flou, avec patience et persévérance et sur le mode de la certitude) et une morale. J’ai envie de dire qu’il est d’autant plus convaincant que précisément il n’a pas d’argumentation. Il procède et intègre, comme dans un art de la mémoire. Les données empiriques, le divers de l’expérience, les différentes branches du savoir et les théorisations humaines (de la religion à la mystique en passant par la science), trouvent abstraitement la place qui est la leur. Le titre, qui parle de puissance et d’impuissance, ne peut pas ne pas renvoyer l’auteur à la métaphysique dont ce couple est le principal ressort et dont la politique est le bras séculier. La réflexion est donc ce qui inlassablement s’emploie à débusquer les enjeux de puissance ; elle devient ici une forme de mystique – le roseau pensant.
Ce niveau d’abstraction, sans compromis avec aucune mondanité, rend assurément l’ouvrage aride, ou du moins pensant sans décoration. Mais il me paraît nécessaire pour répondre à l’accusation du caractère ethnocentrique de la posture philosophique ou réflexive. En effet, il est difficile de ne pas lire cet ouvrage en relation avec les remises en question contemporaines de la philosophie – et notamment de sa critique par les subaltern studies et des invitations à provincialiser l’Europe, c’est-à-dire non seulement à déloger l’histoire européenne de sa position centrale et hégémonique, mais également de relativiser la pensée qu’elle a produite et dont elle est issue, à savoir essentiellement la pensée philosophique, dont est dénoncée la situation de monopole pour conformer les parcours universitaires, par exemple, partout dans le monde, mais également des concepts politiques, des institutions, et plus généralement des catégories de pensée (dans mon domaine je citerais le mot de « religion » auquel il est reproché de ne concerner que la religion telle qu’elle se rencontre au terme de la sortie de la religion).
Vincent Citot, dans son essai, ne traite pas directement de cette question, et l’on pourrait considérer qu’elle détourne son propos, qui est de définir la réflexion et ses limites. Ces limites n’en sont du reste pas puisque le propre de la réflexion est justement de réfléchir, c’est-à-dire l’autoréflexion, si bien qu’elle ne s’exerce jamais dans toute sa force et dignité que quand elle s’autocritique, perçoit ses limites et le risque de présomption qui la menace. Aussi la réflexion est ce qui débusque l’idéologie et identifie, pour les renvoyer à des disciplines moins autoréflexives, donc moins excellentes, les faits de culture ainsi que les données de l’expérience qu’elle transforme ainsi en des sortes de pierres de touche, comme la chance donnée de sortir de sa présomption, et non pas comme de l’eau à son moulin. Elle se pose ainsi avec ses exigences théoriques et pratiques comme une faculté critique qui transcende nécessairement tout particularisme. La pensée décoloniale, par exemple (ou ceux qui assimilent la philosophie à une entreprise coloniale ou néocoloniale), devrait donc, pour réfléchir sur elle-même[3], user des outils que Vincent Citot met en place, comme le font certains penseurs post-coloniaux, et passer au crible tout ce qui dans leur discours pourrait être en deçà de ce niveau d’abstraction insatiable, exigeant et pacificateur. Cette invitation n’est pas si décrochée qu’elle y paraisse (et avec ce terme je veux renvoyer au livre de Jean-Loup Amselle, L’Occident décroché, Paris : Fayard, 2008), dans la mesure où les tenants de cette pensée accuse la « philosophie » d’être un outil parmi les autres, et peut-être le plus puissant, du système-monde occidentalocentrique/christianocentrique moderne/colonial capitaliste/patriarcal, dominant les « autres » au titre de ce qu’ils appellent la colonialité du pouvoir ou la colonisation des esprits ; et le doute s’étend à Descartes voire commence par lui[4]. Le livre de Vincent Citot montre jusqu’à quel point au contraire la réflexivité dépouille de toute présomption et interroge le moindre présupposé. La philosophie, définie par cet outil qui soumet à son critère y compris les philosophes et caractérisée par ce dessillement ne peut manquer le caractère universel. Un projet pluriversel ou transmoderne ne peut pas faire l’économie de la réflexivité, pour échapper aux écueils de l’idéologie.
[1] En fin de première partie surgit une bibliographie. On regrette que l’unité du livre soit ainsi affectée.
[2] V. Citot, « L’histoire de la philosophie comme science rigoureuse », in V. Citot (dir.), Problèmes épistémologiques en histoire de la philosophie, Montréal, Liber, 2017.
[3] Ainsi Dipesh Chakrabarty, dans la dernière partie de Provincialiser l’Europe. La pensée postcoloniale et la différence historique (2000), Paris, Éditions Amsterdam, 2009. Je me permets de renvoyer à mon compte-rendu www.cndp.fr/magphilo/index.php?id=174.
[4] Voir Enrique Dussel, « Meditaciones anti-cartesianas : sobre el origen del anti-discurso filosófico de la modernidad », Tabula Rasa, no 9, juillet-décembre, 2008, p. 153-197.