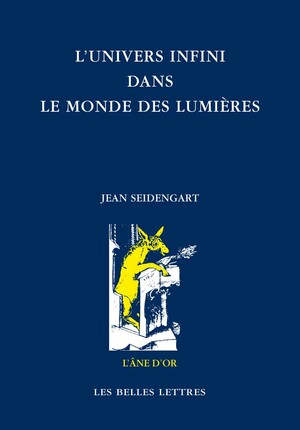Recension – Sociologie des controverses scientifiques de D. Raynaud
Recension de Sociologie des controverses scientifiques de Dominique Raynaud,
Raphaël Kunslter, PRAG, Université Toulouse II Jean Jaurès, département de philosophie. Responsable du pôle recensions pour Implications Philosophiques.
Il s’agit d’une recension du livre Sociologie des controverses scientifiques, de Dominique Raynaud, Éditions Matériologiques, 2018, 426 p. Vous pouvez vous procurer l’ouvrage sur le site des Éditions Matériologiques en suivant ce lien.
 Selon Dominique Raynaud, les « Sciences Wars », qui opposaient rationalisme — c’est-à-dire « une approche se refusant à considérer les contenus scientifiques comme l’émanation d’un état, toujours variable et fluctuant, de la société »[1] — et relativisme — c’est-à-dire « toute approche de la science qui soutient que les connaissances scientifiques sont largement (thèse faible) ou totalement (thèse forte) indépendantes des structures du monde réel qu’étudient les chercheurs »[2] — paraissent s’être progressivement épuisées à partir de 2006. Corrélativement, l’étude des controverses, qui fut le terrain privilégié de ces affrontements, a été déclarée morte2. Pourtant, Dominique Raynaud fait paraître cette année une nouvelle version de son ouvrage Sociologie des controverses scientifiques, déjà paru en 2003 aux PUF, dans un contexte polémique.
Selon Dominique Raynaud, les « Sciences Wars », qui opposaient rationalisme — c’est-à-dire « une approche se refusant à considérer les contenus scientifiques comme l’émanation d’un état, toujours variable et fluctuant, de la société »[1] — et relativisme — c’est-à-dire « toute approche de la science qui soutient que les connaissances scientifiques sont largement (thèse faible) ou totalement (thèse forte) indépendantes des structures du monde réel qu’étudient les chercheurs »[2] — paraissent s’être progressivement épuisées à partir de 2006. Corrélativement, l’étude des controverses, qui fut le terrain privilégié de ces affrontements, a été déclarée morte2. Pourtant, Dominique Raynaud fait paraître cette année une nouvelle version de son ouvrage Sociologie des controverses scientifiques, déjà paru en 2003 aux PUF, dans un contexte polémique.
On pourrait donc avoir initialement l’impression que l’ouvrage vient littéralement après la bataille. Ce serait une erreur. Par-delà le fait que le livre a été enrichi de nouveaux chapitres,Raynaud part du constat que le relativisme est la position dominante de notre temps, et les thèses des Social Studies of Knowledge (SSK) sont devenues le préjugé d’aujourd’hui, — une position à la fois idéologiquement confortable et cognitivement évidente. Cette réédition indique donc que Raynaud refuse la défaite des rationalistes à l’issue de la « guerre des sciences », et reprend le combat : l’ouvrage met en œuvre un programme de recherche rationaliste de sociologie des sciences, et rouvre les hostilités. Pour Raynaud, la bataille de la science s’est achevée, mais pas la guerre.
Comme le souligne justement Dominique Raynaud, l’étude des controverses joue un rôle stratégique dans le débat entre sociologues rationalistes et relativistes : chacune de ces théories produit des prédictions spécifiques concernant les causes, le déroulement et l’achèvement des controverses. Les rationalistes affirment que les débats théoriques sont tranchés par l’application à une méthodologie mobilisant l’expérience, c’est-à-dire une réalité indépendante des humains, et le raisonnement, dont les règles de validité sont indépendantes de la subjectivé des agents. Les relativistes soutiennent que la raison et l’expérience sont incapables de justifier une décision théorique. Que les adhésions théoriques reposent un acte de volonté collectif — une convention —, qui est précédé par une négociation, c’est-à-dire une tentative de mettre en accord les volontés individuelles. Les relativistes peuvent estimer que les contenus ou les méthodes sont conventionnels. L’étude des controverses permettrait d’établir empiriquement la vérité du relativisme. Dans une pure veine poppérienne, ces cas servent à tester des hypothèses. Pour y parvenir, il s’attèle d’abord, dans un premier chapitre, tout en y revenant fréquemment dans le reste de l’ouvrage, à dégager des thèses des Social Studies of Knowledge des prédictions empiriques, c’est-à-dire des conséquences. Cela paraît à première vue désespéré, puisqu’il n’existe pas de doctrine claire, qu’il s’agit d’un patchwork d’éléments contraires, et que, du contradictoire, on peut déduire n’importe quoi. Dominique Raynaud identifie néanmoins les thèses et les arguments en présence, soit en identifiant les positions communes les plus générales, soit en identifiant des propositions propres à un auteur en particulier. Voici quelques unes des positions discutées :
— Des individus ayant le même arrière-plan idéologique et la même situation sociale doivent défendre les mêmes thèses.
— Qu’une théorie soit considérée comme vraie ou fausse, rationnelle ou irrationnelle, son acceptation a toujours le même type de cause.
— Les controverses ont des causes extrascientientifiques.
— Les controverses ne peuvent pas être réglées sur la base de la méthode expérimentale.
— Les controverses sont réglées par des facteurs extrascientifiques : par la mobilisation de réseaux.
— Les résultats scientifiques font l’objet d’une négociation.
— L’opposition entre les gagnants et les perdants doit correspondre à des dissymétries extrascientifiques.
— La thèse du « grand partage » : la rationalité serait une invention « occidentale ».
— Le monde naturel ne joue aucun rôle dans la construction des énoncés scientifiques.
Ce sont ces différentes thèses que discute empiriquement l’ouvrage, c’est-à-dire sur la base d’études de cas de controverses.
Encore faut-il savoir ce qu’est une controverse. Raynaud consacre opportunément l’introduction de son ouvrage à l’élaboration d’une définition claire et argumentée des controverses scientifiques : « une controverse scientifique se caractérise par la division publique et persistante de plusieurs membres d’une communauté scientifique, coalisée ou non, qui soutiennent des arguments contradictoires dans l’interprétation d’un phénomène donné » (p. 40). Chacun des éléments de cette définition est clair, si bien qu’elle est parfaitement opérationnelle, au sens où, pour n’importe quel phénomène, elle permet de décider s’il s’agit ou non d’une controverse. Mais l’opérationnalité d’une définition est facile à obtenir par simple stipulation. Rien de tel ici : la définition proposée n’est pas nominale, mais réelle, étant élaborée au cours d’une discussion argumentée et empiriquement étayée.
Le travail sur un domaine délimité par définition rigoureuse et restrictive devrait conduire à la production d’un ouvrage homogène, voire monotone. C’est tout l’inverse qui se produit ici. Chacun des chapitres est consacré à une étude de cas, et ces études de cas couvrent une grande ampleur thématique : disciplinaire (biologie, architecture, mathématiques, sociologie, métaphysique, etc.), historique (du XIIIe, au XIXe siècle), géographique (d’Oxford à la Perse, en passant par Bédoin).
Cette diversité participe au plaisir de lecture que procure l’ouvrage. On peut néanmoins se demander si cette diversité de cas n’est pas abordée au prix d’un relâchement de la définition de départ. Ainsi, la contribution du chapitre sur « l’affaire de la voûte de l’église de Bédoin » à la question du relativisme sociologique ne saute pas vraiment aux yeux. Raynaud paraît y reprendre le travail de définition pourtant achevé en introduction alors qu’il est d’emblée évident qu’il s’agit d’un différend technologique plutôt que d’une controverse scientifique. De même, on se demande si la « guerre des perspectives », abordée dans le cinquième chapitre, constitue véritablement une controverse scientifique. Et le chapitre sur la mathématisation de la perspective au XVIe siècle n’est rattaché qu’in extremis à la question de l’ouvrage. De ce point de vue, la première version de l’ouvrage était plus cohérente. Ce sont sur les chapitres immédiatement pertinents du point de vue de la discussion entre relativistes et rationalistes que nous nous concentrerons à présent.
Le second chapitre est principalement une discussion de la manière dont Bruno Latour, dans « Pasteur et Pouchet : hétérogénèse de l’histoire des sciences »3, analyse le débat concernant la génération spontanée qui opposa les deux savants. Latour s’appuie sur l’identification factuelle d’un ensemble d’asymétries entre Pasteur et Pouchet, de manière à justifier l’affirmation selon laquelle, si la thèse de la génération spontanée a été rejetée, ce n’est pas parce qu’elle était la plus mal justifiée d’un point de vue expérimental, mais parce que les positions (géographiques, institutionnelles, politiques, idéologiques) de Pasteur et de Pouchet étaient asymétriques. Ce serait donc parce que Pasteur était plus puissant que Pouchet que nous n’accepterions plus de nous jour la thèse de la génération spontanée telle que la concevait Pouchet. On aurait ainsi une démonstration empirique et sociologique de la vérité du relativisme — puisque ce que nous tenons pour vrai dépendrait simplement de circonstances sociales — et du constructivisme — ce que nous considérons comme réel serait en réalité le produit de processus sociaux. Cette étude de cas est donc une pièce centrale dans le relativisme sociologique et l’ontologie qui en découle.
Dominique Raynaud, de manière méticuleuse, en dépouillant de nouveau les archives, démontre pas à pas que tout, dans le texte de Latour, est faux. Les asymétries qu’il identifie s’appuient sur des anachronismes ou des erreurs factuelles. Latour ignore d’autres asymétries qui montrent que Pouchet était bien plus puissant que Pasteur dans les années 1860-62, que prétendre l’inverse relève d’un anachronisme projetant la situation ultérieure de Pasteur sur sa situation à cette époque, et il ignore tous les faits qui prouvent que Pouchet n’était rien de plus qu’un mauvais perdant manipulateur, et même faussaire. Enfin, Raynaud montre à juste titre que prétendre inférer de la coïncidence entre la foi religieuse et l’adhésion à une théorie sur la base d’un unique cas est méthodologiquement inepte.
Il est rare d’assister à un démontage en règle d’un texte devenu canonique, écrit par un auteur aussi célébré, et cela de manière sobre, rigoureuse, factuelle et argumentée. Si bien qu’on sort de cette lecture un peu éberlué. Comment expliquer que le texte de Latour puisse être (un) faux à ce point ? Le lecteur qui ignorerait le la puissance institutionnelle et la réputation internationale de cet auteur ne pourrait pas ne pas s’interroger de manière frontale, voire brutale. Est-ce un manque de discernement ? De la pure et simple manipulation ? La paresse d’aller consulter soi-même les sources ? Un peu des trois ? N’oublions pas qu’à l’époque où Latour publiait son texte, les archives savantes n’étaient pas encore numérisées et mises en ligne, si bien qu’il y avait peu de chance qu’on puisse aussi facilement qu’aujourd’hui accéder aux sources, et découvrir le pot au rose.
Au troisième chapitre, la controverse biologique et médicale entre les organicistes de l’école de Paris et les vitalistes de l’école de Montpellier, durant la première moitié du XIXe siècle, permet à l’auteur de prouver que le principe de causalité de Bloor est faux : il est impossible de prédire, à partir des conditions sociales des protagonistes, leurs positions théoriques. Le désaccord s’explique en réalité par les raisons internalistes : la position de Barthez était spéculative, et sortait du champ de la science, tandis que celle des Parisiens était empirique. La clôture de la controverse s’explique par la dérive spéculative de Montpellier et, corrélativement, la plus grande productivité scientifique de celle de Paris.
Dans l’évaluation factuelle de la justesse du relativisme, le septième chapitre, abordant la controverse entre intromissionnistes et extramissionnistes qui prit place à Oxford, entre franciscains, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, remplit une double fonction : il présente un cas qui « constitue un cas exemplaire pour tester l’hypothèse d’une relativité des normes de la rationalité par rapport au contexte de production scientifique » (pp. 273-274) ; il établit une fois de plus la fausseté du « principe de causalité ». En effet, selon ce principe, Robert Grosseteste, Roger Bacon et John Pecham, tous trois franciscains et oxfordiens, auraient dû prendre une même position dans le débat sur le mécanisme de la vision. Leurs positions sont pourtant différentes. Raynaud établit de manière convaincante que cette dissymétrie est entièrement explicable par une dissymétrie argumentative : ces trois auteurs n’ayant pas eu le même accès à l’argumentation développée par Ibn Al-Haytham dans l’Opticae Thesaurus, ils n’avaient pas les mêmes raisons d’adopter leurs positions respectives. Raynaud peut conclure : « les opticiens ont préféré la logique et l’expérience aux arguments d’autorités » (p. 297).
La théorie des discussions théoriques de l’astronome, mathématicien et philosophe perse du XIIIe siècle Sham al-Dīn al-Samarqandī est exposée dans le septième chapitre de l’ouvrage. Le dispositif argumentatif qui y est mis en place par DR est pour le moins complexe. Le cas d’al-Samarqandī est initialement présenté comme la réfutation thèse du « grand partage », que défendent les constructivistes — d’accord sur ce point avec les théoriciens du colonialisme — qui ferait de la rationalité une propriété de l’ « Occident » : puisque la Perse du XIIIe siècle a connu des débats sur la manière de clore rationnellement un débat, il est complètement absurde de prétendre que la rationalité serait une invention « moderne » et « occidentale » (à moins d’opposer la parade malhonnête qui consiste à redéfinir comme « occidentale » toute conduite soumise aux normes rationnelles). Ce cas est également utilisé pour remettre en question la théorie selon laquelle les controverses seraient réglées par une négociation (si on peut parler de « théorie » pour des affirmations tonitruantes qui ne définissent jamais clairement ce qu’est une « négociation »). Al-Samarqandī est ici considéré comme un théoricien des controverses qui réfuterait le relativisme de la négociation. Il n’est plus pris comme un contre-exemple, mais comme un sujet à part entière du débat actuel.
Dominique Raynaud ayant prouvé que les thèses du SSK ne sont pas empiriquement bien justifiées, qu’elles sont fausses, il reste aux relativistes sociologues une position de repli : leur position ne serait pas fondée sur l’expérience sociologique, mais sur la philosophie. Car l’un des arguments les plus mobilisés en faveur d’un programme de sociologie des sciences externaliste et constructiviste est épistémologique : certains philosophes soutiendraient que les données empiriques dont disposent les scientifiques ne suffisent pas à expliquer leurs choix théoriques. Si les chercheurs étaient fidèles à la méthodologie scientifique, aucun choix théorique ne devrait être observé au cours de l’histoire de l’enquête scientifique. Il existe donc un reste explicatif, lequel doit être expliqué par des facteurs extérieurs à la pratique scientifique elle-même. Le dernier chapitre, « Duhem, Quine, Wittgenstein. Penser à l’abri des philosophes » s’attèle à tordre le cou aux interprétations toutes faites et consensuelles de ces philosophes. Dans une synthèse argumentée et utile, Raynaud montre que les interprétations que proposent les SSK de ces philosophes sont en réalité des contresens ou des contrefaçons.
Dans une ambitieuse conclusion, ces études de cas sont interprétées du point de vue de deux controverses, sociologique et philosophique. Raynaud tranche dans le vif dans la controverse sociologique des rationalistes et des relativistes : l’étude empirique des controverses prouverait que les relativistes ont tort. Dans le débat concernant la méthodologie scientifique entre le falsificationnisme et le vérificationnisme, l’auteur cherche au contraire une voie de conciliation. Il défend enfin une théorie « incrémentaliste » de l’histoire des sciences, laquelle synthétise les leçons sociologiques et épistémologiques des études de cas de l’ouvrage, théorie selon laquelle l’activité scientifique est « une forme d’action collective dans laquelle la transformation d’une organisation ou de ses produits résulte d’une série de petits changements qui ne sont pas nécessairement planifiés » (pp. 367-368).
D’un point de vue général, Dominique Raynaud déploie ici une érudition et une capacité à travailler des contenus techniques qui forcent l’admiration. Son ouvrage est une rare réussite, associant sociologie soucieuse du détail et philosophie capable de traiter des questions les plus spéculatives. Il est à la fois facile à lire, car les études de cas sont passionnantes, et exigeant, dès lorsqu’on s’efforce de saisir les enjeux théoriques mobilisés. Trois questions se posent néanmoins à propos de l’ouvrage. D’abord, l’épistémologie qui s’y trouve proposée ne paraît pas achevée. Ensuite, la structure démonstrative de l’ensemble semble manquer de clarté. Enfin, la démonstration de Raynaud en faveur du rationalisme étant rationaliste, elle risque de ne pas pouvoir convaincre un relativiste en recourant à des normes que celui-ci rejette, et donc de tomber sous le concept relativiste d’incommensurabilité normative. Reprenons ces trois points.
La synthèse entre le vérificationnisme et le falsificationnisme n’est pas convaincante. D’abord, les deux théories ne répondent pas à la même question. Le vérificationnisme du Cercle de Vienne est une théorie sémantique, c’est-à-dire une manière de déterminer quels sont les énoncés dotés de sens et ceux qui en sont dénués, tandis que le falsificationnisme de Popper est une théorie de la science, visant à déterminer quand une théorie est scientifique et quand elle ne l’est pas. Ainsi, pour Popper, une théorie peut très bien être non scientifique et être douée de sens. Or, Dominique Raynaud prend l’une et l’autre de ces théories pour des théories épistémologiques, c’est-à-dire permettant de déterminer à quelles conditions une croyance est une connaissance. Pour qu’une telle synthèse soit envisageable, les référents théoriques doivent être réaménagés.
Imaginons cependant que ce que veut soutenir l’auteur soit en gros la théorie épistémologique suivante : « nous savons qu’une théorie est fausse quand nous avons identifié une prédiction testable, mais non réalisée de cette théorie. Si les débats théoriques prennent la forme d’alternative, savoir qu’une théorie est fausse équivaut à savoir qu’une autre est vraie ». Il s’agit ici d’une reprise de la théorie baconienne de l’expérience cruciale, laquelle permet de concevoir les controverses comme une étape dans un accroissement de connaissance. Mais pour que la théorie de l’expérience cruciale puisse être reprise, il faut préalablement répondre à trois arguments : (1) une proposition théorique n’affronte jamais seule l’expérience, si bien que la réfutation d’une hypothèse par une expérience peut conduire non pas à l’acceptation de la proposition contraire, mais à la formulation d’une nouvelle version de l’ensemble des propositions accompagnant cette hypothèse4. (2) Comme l’a montré Kyle Stanford, il arrive souvent dans l’histoire des sciences qu’on rencontre des « alternatives non conçues », si bien que ce qu’on prenait, à un moment donné pour une dichotomie, n’en était pas une en réalité5. (3) Il existe dans l’histoire des sciences des effondrements théoriques où une génération de scientifiques affirme que ce que croyait une génération précédente était faux. Ce fait donne lieu à une « méta-induction pessimiste », laquelle conclut que les théories actuellement tenues pour vraies seront dans le futur tenues pour fausses6. Par conséquent, l’incrémentalisme, qui s’appuie sur une épistémologie de l’expérience cruciale, doit être sinon abandonné, du moins retravaillé pour être convaincant.
Un second défaut apparent de l’ouvrage vient de la multiplicité de ses ambitions et de ses strates de lecture. On s’y perd un peu. Du point de vue de la démonstration, certains chapitres pourraient être retirés : leur ajout nuit à sa cohérence. Il serait souhaitable que les chapitres soient plus explicitement mis en relation avec la discussion des thèses, par exemple en récapitulant à la fin du second chapitre comment les différentes thèses des SSK seront discutées. Si les titres des chapitres comportent bien une telle indication, on découvre ensuite dans le corps du texte que les thèses discutées sont en réalité beaucoup plus diverses que ce qui était annoncé. On imagine cependant que ce défaut est la conséquence nécessaire d’une qualité : comme l’auteur part d’études de cas, c’est en réfléchissant après coup sur les leçons épistémologiques de ces cas qu’il est amené à identifier quelle thèse des SSK est réfutée par ce cas. Il est effectivement impossible, sauf à donner une présentation artificiellement cohérente des études empiriques, de concilier approche inductive (ou réflexive) et approche déductive. Le défaut de lisibilité pourrait donc être atténué, par des clarifications, mais ne peut être éliminé : il est une propriété du réel empirico-logique, et ne saurait être imputé à l’auteur.
Une troisième fragilité apparente de l’ouvrage peut être exprimée par la question : comment trancher par l’argumentation et l’expérience une controverse qui porte sur la capacité de l’argumentation et de l’expérience à trancher des controverses ? En effet, la manière dont Raynaud tranche la controverse à propos des controverses est fidèle à sa position dans cette controverse : il procède de manière argumentative et empirique. Mais cela ne l’empêche pas de trouver un idiome commun avec les relativistes : comme ceux-ci prétendent pratiquer la sociologie, il suffit de les prendre au mot, et de les affronter sur ce terrain. L’auteur montre ainsi que SSK bâclent certaines de leurs études de cas : dans le cas de Pateur/Pouchet les auteurs se recopient les uns les autres sans se confronter réellement aux sources. C’est pourquoi Dominique Raynaud prend soin de rouvrir lui-même les dossiers — et insiste. Ce souci se traduit par la forme même de l’ouvrage : l’auteur associe souvent à ses études de cas des annexes où il livre aux lectrices des documents sur lesquels il s’est appuyé ; de nombreuses illustrations, fac-similés permettent de se replonger dans les sources et dans les époques. Un autre argument est que les SSK manquent d’ampleur historique. « La thèse selon laquelle les énoncés scientifiques sont modelés par la négociation n’est convaincante que si la controverse est étudiée dans le temps court. Ce n’est donc pas un hasard si cette thèse est généralement portée par une ethnométhodologie des laboratoires qui opère dans la très courte durée. Dès que l’activité scientifique est étudiée dans le temps long, le diagnostic se retourne » (p. 318). Par ailleurs, Dominique Raynaud pousse l’enquête entamée par les relativistes jusqu’au bout. La recherche latourienne des asymétries en Pasteur et Pouchet, si elle est menée de manière rigoureuse, conduit à la réfutation des thèses latouriennes. C’est donc du point de vue même de Latour que Latour a tort. Enfin, il utilise la méthode quasi-expérimentale que Durkheim préconise dans les Règles de la méthode sociologique pour réfuter les affirmations causales de Bloor ou de Latour.
Que reste-t-il donc des thèses de SSK à l’issue de l’ouvrage de Raynaud ? Si les analyses de Raynaud sont justes, ces thèses ne seraient pas sociologiques, puisque l’expérience les réfuterait. Elles ne seraient pas philosophiques, puisque les arguments qui les soutiennent ne tiendraient pas, et qu’elles s’appuieraient sur des contresens. Elles ne seraient même pas nouvelles. Elles se révèleraient alors n’être que des produits de marketing universitaire. Dont l’impact et la prégnance s’expliqueraient par leurs résonances idéologiques, — et par le grand souci qu’ont eu ces « sociologues » de prendre soin, conformément à leurs propres analyses, de leurs longueurs de réseaux. Ainsi, leurs carrières illustreraient leurs thèses, et leurs thèses révéleraient comment ils ont conçu leurs carrières.
1. Callon M. & Latour B., 1991 La science telle qu’elle se fait, Paris, La Découverte, p. 26.
2. Lamy, J. 2017, « Frictions », in Zilsel, Vulaines sur Seine, Éditions du Croquant , pp. 124-184.
3. Latour, 1989, « Pasteur et Pouchet : hétéogenèse de l’histoire des sciences », in Serres M. (dir.) Éléments d’histoire des sciences, Paris, Bordas, pp. 423-445.
4. Il ne s’agit pas ici de la version forte de la thèse de Duhem, que Raynaud réfute au dixième chapitre de son ouvrage, mais d’une version plus modeste. Le cas Pasteur/Pouchet décrit par Raynaud illustre ce point : la discussion de la thèse de la génération spontanée était adossée à des hypothèses d’arrière-plan, comme, par exemple, le rôle de l’air dans le mécanisme de la génération spontanée (cf. Raynaud, ibid. p. 90).
5. Stanford, K. Exceeding Our Grasp, OUPS, USA, 2010.
6. Sur ce point, je me permets de renvoyer à R. Künstler, Faut-il croire les scientifiques, Paris, Hermann, 2019 (à paraître).
[1]. Raynaud, op. cit., p. 61.
[2]. Ibid.p. 60.