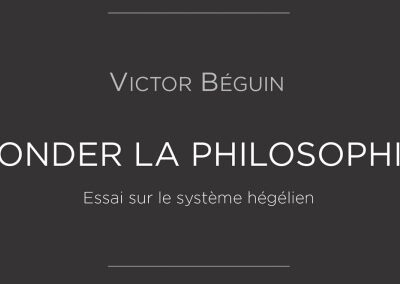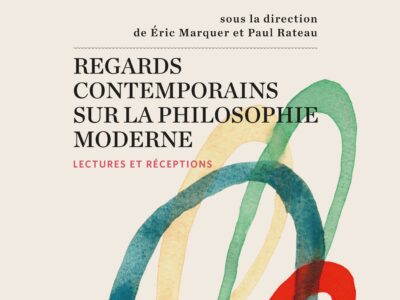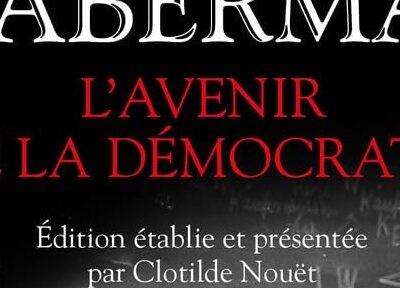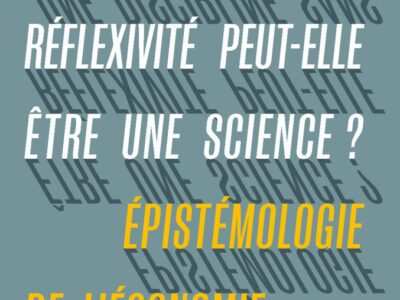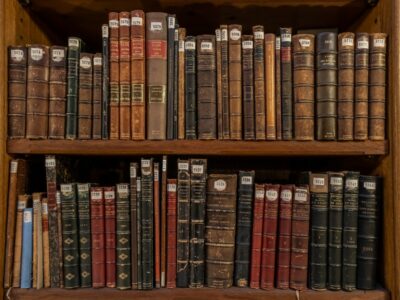Recension – Qui a vu le zèbre ? L’invention de la perspective animale
Arnauld Rochereau est docteur en philosophie de l’Université de Nantes, collaborateur scientifique au FNRS rattaché au Centre de Recherche de Philosophie de l’Université Libre de Bruxelles. Il dirige le site Espace de recherches perspectivistes sur la plateforme Hypothèses.org. Après une thèse consacrée au sens pratique du perspectivisme dans laquelle il fait notamment dialoguer la philosophie de Nietzsche et les sciences contemporaines, il poursuit ses recherches sur le perspectivisme, l’interprétation au cœur du vivant (relations organismes-environnement) et travaille au développement d’une éthique plastique des habitudes.
Thibault de Meyer, Qui a vu le zèbre ? L’invention de la perspective animale, Les Liens Qui Libèrent, Paris, 2024.
L’ouvrage est disponible ici.
Ce livre est à la fois une enquête et un pari. Une enquête sur les points de vue, sur ce qui nous est donné de voir, et donc sur les processus perceptifs également, inhérents à toute perspective humaine ou non-humaine. Le point de départ de cette enquête est une planche scientifique issue d’un article de l’éthologue Tim Caro, composée de quatre visions différentes d’un même zèbre. A travers ces perceptions distinctes, on s’aperçoit que la perspective des zébrures d’un zèbre se module selon les yeux qui regardent celui-ci, qu’ils soient ceux d’un humain, d’un zèbre, d’un lion ou d’une hyène. Voici donc ce zèbre « multiplié perspectivement » [1]. Mais, nous le disions, ce livre est aussi un pari : comment rendre compte de ces perspectives, de la diversité qui les anime et comment en célébrer la puissance, propre à chacune, propre à chaque mise en rapport des mondes en eux ? Pour ce faire, l’auteur va déplier différentes versions du perspectivisme et chercher, comme nous allons le voir, à les faire communiquer entre elles. En ce sens, cette enquête et ce pari servent tous deux un perspectivisme laudatif, (comme le souligne Vinciane Despret en préface), qui tend en conséquence à célébrer la diversité des perspectives et la richesse potentielle de leurs entremêlements. En cela, Thibault De Meyer prend la recommandation nietzschéenne très au sérieux et la met ici en pratique :
« Il n’y a de vision qu’en perspective, de « connaissance » que perspectiviste et plus nous laissons parler les affects sur une chose, plus nous savons faire varier les regards chaque fois différents sur la même chose, plus notre « concept » de cette chose, notre « objectivité » seront complets » [2].

Comment différents animaux voient un zèbre dans la savane, d’après les recherches de Tim Caro en 2016. PLOS ONE
1. Trois perspectivismes
De Meyer distingue trois perspectivismes aux aspects pratiques et aux particularités épistémiques différentes. Tout d’abord ce qu’il appelle un perspectivisme pictural et architectural. La question des perspectives est en effet primordiale pour la peinture depuis la Renaissance. L’auteur présente en ce sens la singulière et décisive expérience de Filippo Brunelleschi consistant en la création d’un dispositif optique qui tend à reproduire la perspective de l’observateur en peinture. Le dispositif, une « tavoletta », cache en réalité plus le sujet qu’il ne le dévoile pour finalement laisser à l’objet étudié une place prépondérante. Tout part néanmoins de la perspective du sujet qui seule offre à l’objet représenté sa réalité ou son objectivation. Pour De Meyer cette technique picturale est irrémédiablement perspectiviste car elle met le corps au centre du processus perceptif qui permet de rendre compte du réel, même si tout de même ce perspectivisme « tend à focaliser toute l’attention sur l’objet de la perception aux dépens du sujet de la perspective » (p. 149).
Ensuite vient le perspectivisme éthologique qui est, quant à lui, introduit à partir de cette planche scientifique que nous évoquions précédemment, issu d’un article de Tim Caro représentant un zèbre vu par quatre perspectives différentes. A cette multiplication des manières de voir dont cette planche fournit un exemple paradigmatique, correspond une analyse pointue des données éthologiques où l’on sent bien « à quel point le comment (comment prendre en compte une perspective ?) répond au pourquoi (pourquoi prendre en compte cette perspective ?) » (p. 93). Ici émerge cette question pratique [3] d’une attention particulière aux conditions mêmes des perspectives et ce, quel que soit le vivant. Ce que la perspective, pour telle ou telle espèce, capte du réel est-elle bénéfique ou préjudiciable à son devenir ? Est-elle celle d’une proie, d’un prédateur, ou les deux à la fois ? De sorte que « le perspectivisme éthologique adjoint à la variété des positions, la multiplicité oculaire : la variété des yeux » (p. 116).
Vient enfin un troisième perspectivisme que De Meyer qualifie tantôt de pédagogique, tantôt de laudatif, l’un étant plus tourné vers un projet éducatif et l’autre vers la célébration de la diversité des points de vue. Son analyse de cette autre forme de perspectivisme repose d’un côté sur les travaux bien connus de Jakob von Uexküll dans Milieu animal et milieu humain et de l’autre sur un imagier perspectiviste issu d’albums de jeunesse de Guillaume Duprat tels que Zooptique. Dans les deux cas, le but n’est pas, pour De Meyer, de connaître ou de reconnaître des objets mais de « faire découvrir les multiples manières dont ces choses sont vues par des espèces différentes », et par là de nous apprendre « à prêter attention à ce qui est absent de l’image, mais qui la structure pourtant : celui qui voit, le sujet du point de vue » (p. 146).
2. Des passages entre les plis
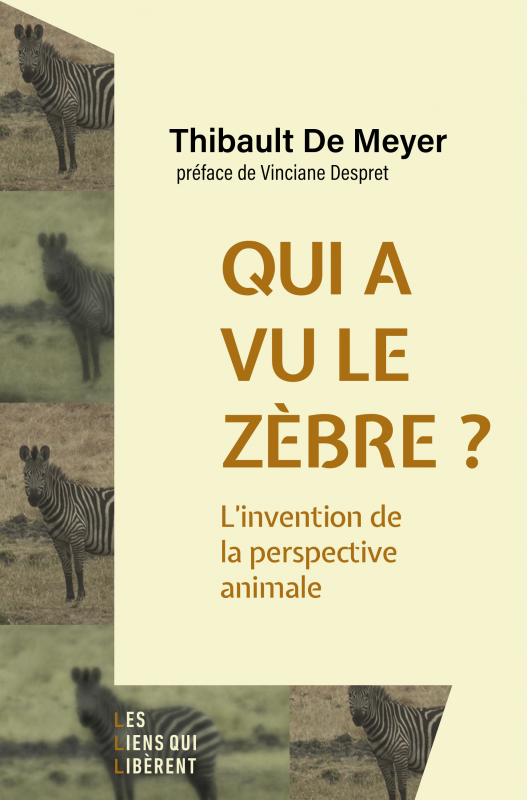 La multiplication des perspectives sur le perspectivisme est de fait particulièrement fructueuse pour repenser à nouveaux frais les complexités de cette notion. En effet, pour notre philosophe ces « trois démarches de Brunelleschi, de Caro et d’Uexküll correspondent à trois versions ou trois plis du perspectivisme : le premier pli est marqué par l’objet, le second par le sujet tandis que le troisième se moule dans le creux des deux premiers » (p. 152). L’auteur distingue également des mouvements et des vitesses spécifiques à chacun. Ainsi le perspectivisme pictural (« objectivant ») additionne les points de vue à grande vitesse, le perspectivisme laudatif d’Uexküll (« subjectivant ») demande pour sa part du temps pour approcher et rendre compte des perspectives animales et le perspectivisme éthologique de Caro (« relationnel ») est quant à lui le plus lent car il tente de déterminer à la fois la vision réelle des animaux mais également ce qui conditionne telle ou telle perspective dans telle ou telle situation (p. 153).
La multiplication des perspectives sur le perspectivisme est de fait particulièrement fructueuse pour repenser à nouveaux frais les complexités de cette notion. En effet, pour notre philosophe ces « trois démarches de Brunelleschi, de Caro et d’Uexküll correspondent à trois versions ou trois plis du perspectivisme : le premier pli est marqué par l’objet, le second par le sujet tandis que le troisième se moule dans le creux des deux premiers » (p. 152). L’auteur distingue également des mouvements et des vitesses spécifiques à chacun. Ainsi le perspectivisme pictural (« objectivant ») additionne les points de vue à grande vitesse, le perspectivisme laudatif d’Uexküll (« subjectivant ») demande pour sa part du temps pour approcher et rendre compte des perspectives animales et le perspectivisme éthologique de Caro (« relationnel ») est quant à lui le plus lent car il tente de déterminer à la fois la vision réelle des animaux mais également ce qui conditionne telle ou telle perspective dans telle ou telle situation (p. 153).
En somme, les vitesses varient selon ce que requiert le voyage entre les perspectives car si le perspectivisme pictural est avant tout géométrique, le perspectivisme subjectivant réclame de la patience, de l’expérience, de la prudence pour se mettre dans le point de vue de l’autre, tandis que le perspectivisme relationnel implique de saisir le comment et le pourquoi des relations des perspectives animales entre elles et donc ce qui est engagé dans tel ou tel rapport ou circonstance. A travers ces vitesses et ces mouvements propres à chacun, De Meyer cherche avant tout à explorer des passages entre les plis objectivants, subjectivants et relationnels du perspectivisme qui finalement peuvent se retrouver en proportions variables dans l’une ou l’autre de ces versions perspectivistes qu’il propose.
C’est pourquoi, selon lui : « considérer le perspectivisme dans ses multiples versions, dans ses plis variés, permet […] de penser les transformations d’une version en une autre ou l’insinuation d’un pli dans un autre » (p.153). C’est donc une nouvelle fois un pari que fait ici De Meyer, « le pari des versions » (p. 167). De sorte que dans ce passage de pli en pli, un enrichissement de la notion de perspective pousse par le milieu, et dès lors par l’agencement des versions et leurs connexions s’opèrent des transformations et même une croissance des dimensions conceptuelles et des multiplicités pratiques du perspectivisme. Comme le dit Deleuze, « toujours des choses qui se croisent, jamais des choses qui se réduisent » [4].
3. Perspectivisme embarqué et philosophie des rencontres
Néanmoins peut-on réellement faire l’expérience de l’altérité ? Est-il possible par exemple d’accéder à des vérités optiques qui ne nous appartiennent pas, par le biais de ces caméras embarquées sur les animaux que nous proposent certains documentaires télévisuels ? C’est la question que se pose De Meyer à la suite de Donna Haraway. En effet, ce système de crittercam se veut l’instrument par excellence d’une traduction fidèle de la perspective animale. Pourtant, comme l’écrit par ailleurs Haraway, « une traduction est toujours interprétative, critique et partiale » [5]. Et comme le remarque également De Meyer (avec Emmanuel Grimaud) « la caméra n’élimine pas les médiations ; au contraire, elle en rajoute une » (p.187). Ainsi, il ne s’agit plus ici de parvenir à l’objectivation d’une perspective mais de spécifier ce qui co-existe dans son voisinage.
Si ce « perspectivisme embarqué » offre donc de nouvelles perspectives, produit-il pour autant de nouvelles connaissances, se demande l’auteur. En réalité, ce dispositif perspectiviste nous apprend surtout à porter le regard sur ce qui intéresse le regard de l’animal, sur ce qui lui importe. Il permet de porter attention à l’attention des autres, mais également à la combinaison des rencontres, à l’ajustement des agencements territoriaux dont nous faisons aussi partie. Selon De Meyer, c’est ici tout l’objet d’une éthologie correctement pratiquée, où l’anthropocentrisme laisse sa place à une philosophie des rencontres et des interdépendances, où les éthologues « enchevêtrent leur perspective à celle des êtres qu’ils étudient » (p. 192). Ce perspectivisme devient un perspectivisme créatif dont le moteur est avant tout une rencontre « où rien n’est donné, rien n’est reproduit [et où] tout reste à créer » (p. 193). Loin du relativisme, ces rencontres interperspectivistes et interspécifiques deviennent des blocs de devenirs ou plutôt de co-devenirs. Comme l’écrit De Meyer :
« C’est en s’intéressant au processus plutôt qu’au résultat qu’on modifie une forme de relativisme (« à chacun son monde ») en une philosophie différente, une philosophie des rencontres, des relations, des interstices » (p. 204).
4. Un au-delà des images
La fin de l’enquête sur l’origine et la raison des zébrures des zèbres nous est offerte à travers différentes expériences de Tim Caro que Thibault De Meyer relate avec précision. Nous comprenons alors que les zébrures servent avant tout à se protéger des mouches tsé-tsé par alternance du clair et des lignes verticales. Caro, même s’il ne reproduit pas le point de vue des mouches, s’est vraiment donné les moyens de prendre en compte celui-ci par le biais de ces diverses expériences que nous évoquions précédemment. Le voyage perspectiviste entre les points de vue s’est ainsi opéré au-delà des images et de leur reproduction.
Il en va de même pour l’araignée qui « prend en compte la mouche et son Umwelt lorsqu’elle construit sa toile » afin de s’adapter aux caractéristiques de leur mode d’existence. Ces pièges mis en place par les zèbres et les araignées ne sont néanmoins pas issus d’une reproduction du point de vue des mouches mais le résultat de leur cohabitation et de leur coévolution. Les transformations, les adaptations poussent ainsi entre les points de vue, dans leur entremêlement [6]. Le perspectivisme éthologique de Caro, explicité ici, nous donne donc à penser ou plutôt à complexifier les relations entre les êtres, à les insérer au sein « d’une théorie de l’action » (p. 240), mais également à interroger les modes d’attention qu’il s’agit de faire émerger entre les points de vue. Dès lors, c’est tout l’intérêt de la démarche de De Meyer qui en abordant les images en perspectiviste nous questionne : « à quoi celles-ci nous font prêter attention : à l’objet, au sujet ou à leur relation ? » (p. 245).
Conclusion
C’est un voyage entre les perspectives que Thibault De Meyer entreprend à travers cet ouvrage où l’on apprend à changer de regard, à basculer d’une perception et d’une attention à l’autre.
L’un des points forts de ce livre est incontestablement la variété de ces points de vue qu’il nous fait adopter pour nous mettre en situation de comprendre ce qui caractérise les conditions d’existence de ces perspectives humaines et non humaines mais également picturales, éthologiques, architecturales, objectivantes, subjectivantes, relationnelles, laudatives ou pédagogiques. Autant de termes et autant de pratiques et d’effets que de penseurs convoqués (de T. Caro, R. Giere, D. Haraway, G. Deleuze, A. Gell, E. Grimaud, P. Descola, G. Duprat, etc.) dont il nous offre une lecture perspectiviste rafraichissante. C’est une profonde diversité qui anime ce livre mais c’est aussi une exigence qui répond au mieux à la recommandation d’Haraway « du grand soin dont on doit s’armer pour apprendre à voir fidèlement à partir du point de vue d’un autre » [7]. De surcroît, ces perspectivismes différentiels et nuancés sont replacés dans un système d’action qui permet d’épaissir le perspectivisme [8] et de renforcer ses multiplicités pratiques afin comme il l’espère « de rendre le perspectivisme plus fort ou plus exigeant […] en prêtant attention aux mondes que ce concept participe à construire, aux relations qu’il permet ou non d’instaurer » (p. 248).
Toutefois, il nous semble que les trois perspectivismes qu’il essaye de dégager demeurent des concepts fragiles pris isolément puisque voués à se retrouver dans des proportions diverses au sein de plis communs. L’intérêt de cette réflexion perspectiviste opérée par De Meyer nous apparaît surtout liée à cet hyper-perspectivisme qu’il déploie où, à l’image de Deleuze, les perspectives ne cessent de se croiser, de basculer les unes dans les autres, ne cessent de se transformer sous les agencements en mouvement impliqués par l’expérience de la relation. Et si ce livre est un livre qui compte pour les études perspectivistes [9], c’est aussi pour cela, c’est-à-dire pour ces modes d’attention pluriels qu’il produit et qui laissent entrevoir ces potentielles « fissures ontologiques par où peuvent émerger de nouveaux mondes, des mondes où l’on peut imaginer d’autres liens entre les êtres, où l’on peut commencer à penser d’autres modes de cohabitation » (p. 250).
En cela le perspectivisme de De Meyer est fondamentalement pratique ; il permet de penser autrement nos rapports aux perspectives qui ne sont pas nôtres, à la fois en tant qu’instrument d’observation (Giere [10]) et en tant que processus de construction (Haraway [11]). En créant des zones de contact entre les usages de ces différentes modalités perspectivistes, il nous livre ici une étude réussie qui offre de nouvelles manières de voir les mondes, permettant ainsi d’enrichir les résonances de la notion elle-même.
[1] Leibniz, Monadologie, § 57. Cité par l’auteur p. 27.
[2] Nietzsche, Généalogie de la morale, trad. Éric Blondel et al., Paris, GF-Flammarion, 2002, III, § 12, p. 136.
[3] Le rapport à l’éthologie est ici symptomatique de ce perspectivisme pratique qui, (à la différence d’un perspectivisme théorique ou même métaphysique traitant par exemple du rapport entre l’infini et le fini des perspectives – et de la présence de l’infini dans le fini), se doit de trouver le moyen de prendre concrètement la perspective de l’animal afin d’apprendre à connaître et à reconnaître son point de vue, d’apprendre à lui poser les bonnes questions tel que le professe Vinciane Despret. Ainsi, comme elle l’écrit en préface, il s’agit ici de se demander : « par quelles procédures inventives nous est-il possible de changer de point de vue, d’en explorer d’autres, de « sortir », de « voir » depuis « ailleurs », bref de modifier nos « modes d’attention » et de pensée ? » (p. 19-20)
[4] Gilles Deleuze et Claire Parnet, Dialogues, Paris, Flammarion, 1977, rééd. 1996, p. 133.
[5] Donna Haraway, Manifeste cyborg et autres essais, Anthologie établie par Laurence Allard, Delphine Gardey et Nathalie Magnan, Exils Éditeur, Paris, 2007, p. 126.
[6] Notons que l’auteur s’intéresse davantage à la rencontre, à l’agencement des perspectives les unes avec les autres qu’à leurs incompatibilités potentielles. Reste à savoir comment intégrer l’incommensurabilité des perspectives au sein d’un perspectivisme pratique contemporain tel que le défend De Meyer, si ce n’est peut-être au travers de la question des modes d’attention développée en conclusion.
[7] Donna Haraway, Manifeste cyborg et autres essais, op. cit., p. 118.
[8] Voir en ce sens l’article de Thibault De Meyer, « Épaissir le perspectivisme scientifique de Ronald Giere à Donna Haraway », in Camille Chamois et Didier Debaise (dir.), Perspectivismes métaphysiques, Paris, Vrin, 2023, pp. 147-158.
[9] Evoquons notamment : Quentin Landenne (dir.), Philosopher en point de vue, Histoire des perspectivismes philosophiques, Presses de l’Université Saint-Louis, 2020 ; Camille Chamois et Didier Debaise (dir.), Perspectivismes métaphysiques, Vrin, 2023, Emmanuel Alloa, Partages de la perspective, Fayard, 2020, Camille Chamois, Un autre monde possible : Gilles Deleuze face aux perspectivismes contemporains, PUR, 2022.
[10] Cf. Ronald Giere, Scientific Perspectivism, Chicago, University of Chicago Press, 2006.
[11] Cf. Donna Haraway, « savoirs situés : question de la science dans le féminisme et privilège de la perspective partielle », in Manifeste cyborg et autres essais, op. cit., p. 107-142.