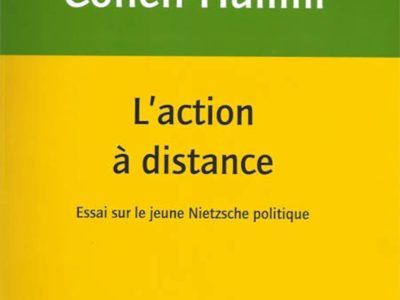Recension – Processus sociaux et types d’interactions
Recension de Processus sociaux et types d’interactions, de Pierre Livet et Bernard Conein
Ilias Voiron, professeur agrégé de philosophie.
Cet article est une recension de l’ouvrage de Pierre Livet et Bernard Conein, « Processus sociaux et types d’interactions ». Il vous est possible de trouver le livre sur le site de son éditeur en cliquant ici.
Pierre Livet, professeur émérite de philosophie à l’Université d’Aix-Marseille, et Bernard Conein, professeur émérite de sociologie à l’Université Côte d’Azur de Nice, ont fait paraître en 2020, dans la collection « Philosophie » des éditions Hermann, Processus sociaux et types d’interactions[1]. Ils y développent un cadre conceptuel fondé sur la notion d’interaction, censé permettre une description de la société plus adéquate qu’une description par les seules relations, tendance qu’ils imputent à la majorité des sciences sociales. Le problème d’une simple description des relations, et donc de la structure, d’une société, est qu’elle serait trop « statique », alors qu’une société est avant tout constituée d’un ensemble de « processus » par lesquels les liens sociaux se tissent et évoluent – et qui ne sont autres que les interactions. En fin de compte, seul ce cadre interactionniste[2] permettrait de rendre raison à la fois de la stabilité et du changement de la société, et de ses niveaux microscopique (celui de l’individu) et macroscopique (celui des institutions et des organisations), qui ne seraient que le « produit des interactions »[3].
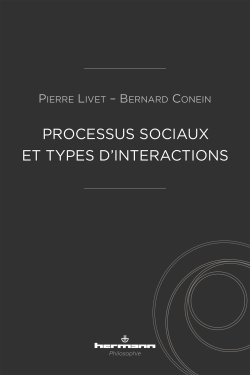 Dans une partie introductive (une « Ouverture »), les auteurs exposent leur typologie des interactions, qui constitue le cadre conceptuel avec lequel ils interpréteront dans les trois grandes parties de l’ouvrage les différents phénomènes sociaux, du niveau sociologique le plus local au plus global. Une telle typologie des interactions s’impose, dans la mesure où celles-ci ne se réduisent pas aux interactions directes – et c’est en cela que les auteurs prennent explicitement leurs distances avec l’interactionnisme de Goffman. Il faut en effet ajouter aux interactions directes, les interactions indirectes, les interactions « hors de portée » et les interactions « mises hors de portée »[4], qui, exposées dans cet ordre, coïncident de moins en moins avec la notion intuitive d’interaction. Les interactions directes, qui constituent le premier type, sont les interactions en face-à-face – ou en « co-présence » –, dont l’exemple paradigmatique est la conversation. En exposant ce type d’interactions, les auteurs introduisent également deux concepts importants dans leur charpente théorique, qui indiquent que toute interaction est un processus : celui de reprise, et celui de virtualité. Pour que le lien social se tisse, une interaction ponctuelle est insuffisante : celle-ci doit être reprise après une discontinuité interactive. Cette reprise n’est pas nécessairement une répétition du même : c’est ce qu’indique la notion de virtualité, qui rend possible une variation entre deux connexions d’interaction. Le deuxième type, celui des interactions indirectes, se caractérise par une référence, au cours d’une interaction directe, à des personnes temporairement absentes – par exemple, un trio d’amis qui se rencontrent deux à deux. En se développant et en formant une chaîne de plus en plus longue, elles donnent lieu au troisième type d’interactions, celui des interactions dites hors de portée, qui rendent impossibles les interactions directes ou indirectes entre ceux qui interagissent. Par exemple, les échanges marchands donnent lieu à des interactions hors de portée. Enfin, le quatrième type est celui des interactions « mises hors de portée »[5], qui renvoient essentiellement aux institutions, par lesquelles des règles explicites sont partiellement « mises hors de portée » des autres types d’interactions, c’est-à-dire qu’elles ont une stabilité telle qu’elles sont partiellement hors de portée de variations et manipulations impulsées par les agents individuels. À la lumière de ce cadre conceptuel, les auteurs vont ensuite, dans les parties suivantes de l’ouvrage, analyser différents types de phénomènes sociaux, des plus locaux aux plus globaux.
Dans une partie introductive (une « Ouverture »), les auteurs exposent leur typologie des interactions, qui constitue le cadre conceptuel avec lequel ils interpréteront dans les trois grandes parties de l’ouvrage les différents phénomènes sociaux, du niveau sociologique le plus local au plus global. Une telle typologie des interactions s’impose, dans la mesure où celles-ci ne se réduisent pas aux interactions directes – et c’est en cela que les auteurs prennent explicitement leurs distances avec l’interactionnisme de Goffman. Il faut en effet ajouter aux interactions directes, les interactions indirectes, les interactions « hors de portée » et les interactions « mises hors de portée »[4], qui, exposées dans cet ordre, coïncident de moins en moins avec la notion intuitive d’interaction. Les interactions directes, qui constituent le premier type, sont les interactions en face-à-face – ou en « co-présence » –, dont l’exemple paradigmatique est la conversation. En exposant ce type d’interactions, les auteurs introduisent également deux concepts importants dans leur charpente théorique, qui indiquent que toute interaction est un processus : celui de reprise, et celui de virtualité. Pour que le lien social se tisse, une interaction ponctuelle est insuffisante : celle-ci doit être reprise après une discontinuité interactive. Cette reprise n’est pas nécessairement une répétition du même : c’est ce qu’indique la notion de virtualité, qui rend possible une variation entre deux connexions d’interaction. Le deuxième type, celui des interactions indirectes, se caractérise par une référence, au cours d’une interaction directe, à des personnes temporairement absentes – par exemple, un trio d’amis qui se rencontrent deux à deux. En se développant et en formant une chaîne de plus en plus longue, elles donnent lieu au troisième type d’interactions, celui des interactions dites hors de portée, qui rendent impossibles les interactions directes ou indirectes entre ceux qui interagissent. Par exemple, les échanges marchands donnent lieu à des interactions hors de portée. Enfin, le quatrième type est celui des interactions « mises hors de portée »[5], qui renvoient essentiellement aux institutions, par lesquelles des règles explicites sont partiellement « mises hors de portée » des autres types d’interactions, c’est-à-dire qu’elles ont une stabilité telle qu’elles sont partiellement hors de portée de variations et manipulations impulsées par les agents individuels. À la lumière de ce cadre conceptuel, les auteurs vont ensuite, dans les parties suivantes de l’ouvrage, analyser différents types de phénomènes sociaux, des plus locaux aux plus globaux.
La première partie, intitulée « Dynamiques d’interactions locales, directes et indirectes », part d’une analyse des conversations pour, progressivement, aboutir à une analyse des groupes. La conversation constitue le point de départ naturel, car, comme nous l’avons vu, c’est le « mode paradigmatique [des interactions directes] »[6]. Les auteurs schématisent les régularités conversationnelles au moyen de leurs concepts de reprise et de virtualité, en s’appuyant sur une logique de l’interaction développée par le logicien Jean-Yves Girard. Toute conversation est une succession d’ouvertures de virtualités par l’un des locuteurs et de reprises sélectives de l’ouverture précédente par l’autre locuteur – les deux rôles pouvant sans cesse s’intervertir. Le caractère (socialement) interactif de la conversation point dans ces reprises, par l’un, des « virtualités esquissées » par l’autre, et dans la réciprocité dont elles sont le signe[7]. Si c’est certes le langage qui rend les interactions conversationnelles possibles, celui-là permet surtout de rendre raison de l’apparition, dans les interactions directes, d’interactions indirectes, qui se caractérisent par une référence, dans la conversation, à une ou plusieurs personnes absentes, et surtout, corollairement, aux liens sociaux qui relient lesdites personnes – ce que les auteurs appellent les « commérages », traduction de l’anglais gossip. Les commérages – loin d’être réservés aux seules « commères » – participent, selon les auteurs, de la formation du groupe, dans la mesure où ils projettent, maintiennent et renforcent les liens sociaux virtuels (pas nécessairement irréels, mais du moins non-actuels), inclusifs ou au contraire excluants, et sous-tendent ainsi un réseau social qui s’étend au-delà des liens actualisés par les interactions directes. Les interactions indirectes seraient donc à l’origine du groupe, dans la mesure où ce dernier n’est jamais un simple ensemble de connexions données (c’est-à-dire actualisées), mais toujours d’abord un ensemble virtuel de connexions – un « nœud virtuel »[8] –, dont la conscience chez ses membres est au fondement du sentiment d’appartenance.
Alors que l’unité thématique et la progression de la première partie étaient manifestes, celles de la deuxième, intitulée « Des interactions locales aux interactions hors de portée », le sont moins : il y est question, dans les chapitres successifs, des artefacts, de la connaissance sociale et des réseaux sociaux. L’objectif général de cette partie semble être d’exposer ce qui rend possibles les interactions dites hors de portée, et d’appliquer cette catégorie à l’analyse de certains des objets les plus récents des sciences sociales. En effet, les auteurs soutiennent tout d’abord que « les artefacts sont […] indispensables à tous nos types d’interactions »[9], et plus précisément qu’ils « facilitent des interactions en co-absence [donc indirectes] »[10], en favorisant la coordination des différentes interactions. Leur conception extensive des artefacts comprend également les symboles (ou « artefacts symboliques »), qui permettront notamment à une société d’édicter des règles explicites. Les artefacts symboliques rendent également en partie possible la « connaissance sociale » – c’est-à-dire la connaissance acquise socialement –, ce qui semble motiver les auteurs à la prendre ensuite pour objet d’analyse, bien que le lien entre les deux ne soit pas explicitement établi[11]. Néanmoins, c’est davantage sur l’aspect interactif, et donc « processuel », de la connaissance sociale qu’ils mettent l’accent, que l’épistémologie sociale et ses concepts trop « statiques » auraient en partie négligé. S’il « ne peut exister de connaissance qui n’implique pas d’interactions sociales »[12], alors le cadre interactionniste est nécessaire pour étudier son émergence ; aussi est-ce ce à quoi vont s’attacher les auteurs, par exemple en réinterprétant les sources d’évaluation des connaissances dégagées par Alvin Goldman, ou en s’intéressant aux chaînes de croyances caractérisant les connaissances « de longue portée », toujours à la lumière de leur typologie des interactions. Enfin, cette deuxième partie se clôt sur une analyse des réseaux sociaux. Là encore, les auteurs critiquent les formalisations habituelles des réseaux – sous forme de structure graphique – comme étant trop statiques, ce qui interdirait de les penser en mouvement, alors même que ces derniers sont le résultat « processuel » d’interactions. Un réseau social, en réalité, – comme un groupe –, n’existe jamais comme ensemble de relations constamment actualisées, mais est produit – et potentiellement modifié – par des interactions connectées entre elles sous forme de reprises. La notion de virtualité permettrait de penser cette plasticité du réseau.
La troisième et dernière partie, intitulée « La gestion des interactions hors de portée », s’intéresse essentiellement aux interactions hors de portée et « mises hors de portée », qui permettraient de décrire les niveaux macroscopiques de la société que sont, principalement, les institutions et les organisations. C’est ici que l’on s’éloigne le plus de la notion intuitive d’interaction, et qu’on a le plus de mal à saisir la pertinence descriptive du cadre interactionniste. Les institutions seraient fondées sur des « mises hors de portée » des interactions directes et indirectes au moyen d’artefacts symboliques. Le paradigme de l’institution est la règle juridique, qui a pour but de réguler les interactions interindividuelles, tout en étant « hors de portée » des individus eux-mêmes – dans le sens où elle ne peut (presque[13]) pas être reprise et modifiée par ces derniers. Les auteurs appliquent ensuite leur cadre conceptuel à des organisations institutionnelles spécifiques, comme le marché ou l’État. Enfin, les deux derniers chapitres de cette dernière partie traitent respectivement des émotions collectives et des rituels. Les émotions seraient des « dynamiques interactives »[14], et permettraient de rendre raison de certaines reprises sociales du passé, qu’elles se fassent sur le mode de la tradition ou, au contraire, de la révolution. Les rituels, quant à eux, seraient des facteurs de socialisation impliquant à la fois des reprises individuelles et une mise hors de portée les faisant échapper aux manipulations individuelles.
Au total, l’ouvrage est, dans son intention, ambitieux, dans la mesure où il couvre, en moins de trois cents pages, une grande multiplicité de types de phénomènes sociaux – des plus traditionnels dans les sciences sociales, aux plus récents –, et novateur, par son extension du concept d’interaction au-delà des seules interactions directes et par la mise au point d’une typologie censée fournir des outils descriptifs et explicatifs théoriquement performants. Mais il nous semble, comme nous l’avons déjà laissé entendre, qu’à mesure que l’on progresse du niveau micro-sociologique vers le niveau macro-sociologique, la notion d’interaction soit de moins en moins opératoire. Ainsi, si les analyses des interactions directes et indirectes éclairent le lecteur par les schématisations conceptuelles et les exemples qu’elles déploient, celles des interactions hors de portée et mises hors de portée sont un peu trop souvent obscures. Le cadre conceptuel interactionniste développé gagnerait donc, à notre sens, à être précisé, afin de donner davantage de force démonstrative à son extension et son application à une si grande diversité d’objets. Cela étant dit, l’ouvrage fournit un panorama appréciable des objets et débats qui occupent et animent la philosophie et les sciences sociales contemporaines.
[1]Livet Pierre et Bernard Conein, Processus sociaux et types d’interactions, Paris, Hermann, coll. « Philosophie », 2020, 285 p.
[2]Précisons que les auteurs ne qualifient jamais leur théorie d’« interactionniste », et ne s’inscrivent pas explicitement dans la tradition sociologique américaine du même nom. Si la référence à Erving Goffman est récurrente, elle a souvent pour but de s’en distancer. Lorsque nous parlerons donc du cadre conceptuel « interactionniste », ce sera exclusivement pour désigner celui développé par Pierre Livet et Bernard Conein dans leur ouvrage, par commodité de langage.
[3]Ibid., p. 11.
[4]Nous soulignons.
[5]Les auteurs mettent eux-mêmes l’expression entre guillemets, sans doute pour distinguer entre le troisième et le quatrième type d’interactions.
[6]Ibid., p. 39.
[7]Ibid., p. 56.
[8]Ibid., p. 104.
[9]Ibid., p. 116.
[10]Ibid., p. 121.
[11]Selon les auteurs, il est « naturel » de « passer des symboles, des artefacts, aux manières de les utiliser et aux apprentissages qu’ils exigent et permettent, donc aux connaissances et à leur aspect social » (Ibid., p. 137). Le lecteur aurait souhaité davantage d’éclaircissements.
[12]Ibid., p. 141.
[13]« Presque », car l’individu en tant que citoyen peut essayer indirectement de modifier les règles juridiques par l’intermédiaire de ses représentants politiques.
[14]Ibid., p. 227.