Recension – Philosophie des sciences humaines, T.2.
Recension de Philosophie des sciences humaines, T.2.
Ilias Voiron. Professeur certifié de philosophie [learn_more caption= » » state= »open »] Il s’agit d’une recension du recueil Philosophie des sciences humaines tome 2, sous la direction de Florence Hulak et Charles Girard. Vous pouvez vous procurer l’ouvrage sur le site de la Librairie Vrin, en cliquant ici
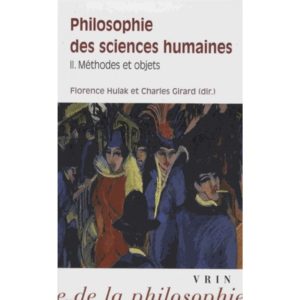 Sept ans après la parution du premier tome[1], Florence Hulak et Charles Girard font paraître, en cette année 2018, le second tome de l’ouvrage collectif Philosophie des sciences humaines[2], dans la collection « Bibliothèque d’histoire de la philosophie » des éditions Vrin. Comme le premier tome, ce second réunit neuf études, de dix auteurs différents, prenant chacune pour objet une notion particulière du domaine des sciences humaines, qu’elle soit un objet (« La population », « Le psychisme », « La pratique », « Les classes », « Le genre »), une méthode (« Le quantitatif », « La comparaison »), ou un certain rapport à la normativité (« Le public », « La critique ») desdites sciences. La plupart des études proposent un parcours historico-conceptuel sur la notion en question, en mettant en évidence les débats épistémologiques et/ou politiques ayant animé l’histoire philosophique et scientifique de la notion, et ses évolutions conceptuelles consécutives. Certaines défendent, en outre ̶ ce qui était moins le cas dans le premier tome, qui nous semblait plus didactique ̶ , une thèse, explicite ou non, qui sert de fil directeur à l’étude. L’esprit de l’ouvrage demeure toutefois introductif, s’adressant en priorité, à notre sens, à des étudiants et professeurs de philosophie non spécialistes de la philosophie des sciences humaines, ainsi qu’à des étudiants et chercheurs en sciences humaines désireux d’accéder à un point de vue réflexif sur leurs objets et pratiques scientifiques.
Sept ans après la parution du premier tome[1], Florence Hulak et Charles Girard font paraître, en cette année 2018, le second tome de l’ouvrage collectif Philosophie des sciences humaines[2], dans la collection « Bibliothèque d’histoire de la philosophie » des éditions Vrin. Comme le premier tome, ce second réunit neuf études, de dix auteurs différents, prenant chacune pour objet une notion particulière du domaine des sciences humaines, qu’elle soit un objet (« La population », « Le psychisme », « La pratique », « Les classes », « Le genre »), une méthode (« Le quantitatif », « La comparaison »), ou un certain rapport à la normativité (« Le public », « La critique ») desdites sciences. La plupart des études proposent un parcours historico-conceptuel sur la notion en question, en mettant en évidence les débats épistémologiques et/ou politiques ayant animé l’histoire philosophique et scientifique de la notion, et ses évolutions conceptuelles consécutives. Certaines défendent, en outre ̶ ce qui était moins le cas dans le premier tome, qui nous semblait plus didactique ̶ , une thèse, explicite ou non, qui sert de fil directeur à l’étude. L’esprit de l’ouvrage demeure toutefois introductif, s’adressant en priorité, à notre sens, à des étudiants et professeurs de philosophie non spécialistes de la philosophie des sciences humaines, ainsi qu’à des étudiants et chercheurs en sciences humaines désireux d’accéder à un point de vue réflexif sur leurs objets et pratiques scientifiques.
L’unité de l’ouvrage n’étant pas, de l’aveu même de ses éditeurs, thématique, et l’ouvrage ne se voulant pas former une totalité organique dont les parties seraient solidaires entre elles, nous nous proposons de présenter une à une et indépendamment les unes des autres les études dans l’ordre arbitraire dans lequel elles se donnent dans l’ouvrage.
La première étude, rédigée par Luca Paltrinieri, prend pour objet le concept de population. Son intérêt majeur est de faire voir la genèse historico-politique moderne d’un tel concept, qui conditionne l’apparition d’une science de la population : la démographie. L’étude glisse tout d’abord de l’aspect épistémologique à l’aspect politique d’un tel concept, qui en appelle ensuite une histoire de la genèse de sa version moderne. Dans un premier temps, proprement conceptuel, Luca Paltrinieri montre la façon dont la démographie s’empare du concept de population pour l’extraire de déterminants strictement naturels. La démographie étudie les variations d’une population humaine donnée, en cherchant à les expliquer par la combinaison des taux de mortalité, de natalité et de migration. Or, lorsqu’elle cherche à expliquer, à leur tour, ces derniers facteurs, la démographie ne peut se contenter des seules causes biologiques et écologiques : elle doit chercher les « causes humaines des phénomènes étudiés »[3] ̶ juridiques ou religieuses, par exemple. La population qu’étudie la démographie, si elle peut faire en elle-même l’objet d’une mesure strictement quantitative, doit ainsi être expliquée dans ses variations par des facteurs sociaux ̶ l’organisation et les normes sociales. La question épistémologique, en découvrant de tels facteurs dans la détermination des variations de population, mène à la question politique de la population ̶ c’est-à-dire non plus à la simple question de sa mesure, mais à celle de sa gestion. L’auteur fait alors apparaître que la population est un objet politique, sa régulation étant une préoccupation majeure de l’État moderne, lequel agit sur la mortalité, la natalité et la migration par le moyen de politiques sanitaires, matrimoniales et migratoires. La science démographique apparaît ainsi dans sa dimension originaire : celle d’orientation de l’action politique. Dans un second temps, historiographique, Luca Paltrinieri présente une brève généalogie de la conception moderne de la population, et donc aussi des conditions de possibilité d’une science de la population. A la conception prémoderne font défaut deux idées majeures : celle d’une égalité, et par conséquent d’une commensurabilité, entre tous les individus humains ; et celle d’une possible connaissance empirique de la reproduction, de la fertilité et de la mortalité, et par conséquent d’une action possible sur celles-ci. La prise de conscience progressive de la possibilité d’une connaissance démographique est historiquement la conséquence d’une prise de conscience de son utilité pour l’exercice du pouvoir politique, notamment en vue d’agrandir la population nationale. S’inspirant de Foucault, l’auteur avance que la conceptualisation moderne de la population comme ensemble d’unités additionnables s’opère, à partir du XVIIIe siècle, à partir du paradigme économique de la société comme ensemble d’individus intéressés interagissant sur un marché.
Dans la seconde étude, consacrée à la notion de psychisme, Étienne Bimbenet expose les trois grands paradigmes ontologiques et épistémologiques successifs dans le développement de la psychologie scientifique depuis le XIXe siècle : l’introspection, le comportement et la cognition. Cette exposition a ceci de caractéristique qu’elle ressemble fort à une histoire de l’échec de la psychologie à conserver la singularité de son objet propre : le caractère subjectif ̶ de sorte qu’on a le sentiment qu’il ne s’agit pas d’une simple histoire des idées psychologiques, mais d’une tentative de démonstration de l’impossibilité essentielle d’une objectivation totale de son objet par la psychologie, en même temps que du nécessaire objectivisme spontané de celle-ci. Tout d’abord, l’auteur expose le paradigme introspectif commun aux psychologies scientifiques anglaise et allemande naissantes du milieu du XIXe siècle, qui n’a en réalité d’« introspectif » que la reconnaissance du fait psychique comme fait intérieur. Ce fait, s’il est reconnu dans son existence spécifique, est néanmoins conçu comme étant causé par des stimulations physiques : la connaissance scientifique du psychisme signifie donc la connaissance objective, si possible mathématisée, des déterminants corporels des états psychiques. Le paradigme suivant, en vigueur tout au long de la première moitié du XXe siècle, opère une véritable extériorisation du psychisme, puisque ce dernier est alors conçu comme comportement, c’est-à-dire comme « ensemble des réactions observables d’un organisme à une situation observable »[4]. Connaître scientifiquement le psychisme, c’est alors connaître les relations régulières entre conditions objectives du milieu et réactions de l’organisme. Enfin, le paradigme apparu dans les années 1960 est celui de la psychologie cognitive : s’il signe certes une réhabilitation du concept de fait mental, c’est en faisant jouer à ce dernier un rôle simplement causal et calculatoire : la conscience, et donc la subjectivité, n’entrent pas dans la définition de la « cognition », pensée « mécanisée »[5]. L’auteur avance donc que, malgré des inflexions marginales, l’histoire de la psychologie scientifique est l’histoire d’une mise entre parenthèses méthodique de ce qui semble relever de la nature même de son objet : le caractère conscient, subjectif, vécu, du psychisme. Il tente de rendre raison de la prévalence de l’objectivisme dans cette histoire : ce dernier serait un caractère de la « psychologie spontanée », par laquelle on a tendance à expliquer causalement les actions d’autrui, alors que le témoignage de l’expérience vécue est dénué de toute preuve objective.
L’étude suivante, de Laurent Perreau, et consacrée à la notion de pratique, prend pour fil directeur la nécessité d’une théorie générale de la pratique prenant appui sur l’apport que constitue l’étude des pratiques réelles et particulières par les sciences humaines et sociales. Son parti pris est de se structurer exclusivement autour de la théorie de la pratique de Pierre Bourdieu, ce qui est à notre sens quelque peu regrettable pour une étude intitulée « La pratique ». Les autres inconvénients d’un tel parti pris sont : quelques longueurs inopportunes dans l’exégèse de l’œuvre de Bourdieu, qui n’est pourtant pas l’objet annoncé de l’étude, ainsi qu’un manque de distance critique vis-à-vis de la théorie bourdieusienne qui a pour conséquence un certain défaut de rigueur conceptuelle et démonstrative (le concept de pratique étant chez Bourdieu, comme le précise l’auteur, un « concept opératoire »). Cela étant dit, l’intérêt de l’étude est de présenter une théorie de la pratique à prétention générale conçue, non pas par un philosophe de métier, mais par un chercheur en sciences sociales (philosophe de formation, rappelons-le tout de même), c’est-à-dire dans ces sciences dont l’objet est précisément l’ensemble des pratiques, entendues comme toutes activités humaines. Or l’effet d’une telle perspective est de dévoiler que, la théorisation en général, et celle de la pratique en particulier, étant elles-mêmes des pratiques, penser la pratique est une activité partiellement réflexive cherchant à mettre au jour les conditions réelles, par conséquent sociales, de toute pratique. La conséquence heureuse, à notre sens, de cette perspective, n’est ainsi pas tant une conceptualisation originale de la pratique qu’une remise en cause du partage entre théorie et pratique, la pratique n’étant plus alors considérée comme un objet extérieur à la pensée, et l’homme lui-même devant alors être conçu comme « être de connaissance socialisé ». Dans cette perspective empirico-réflexive, c’est alors à la mise au jour des « conditions sociales de possibilité de la théorie » qu’il faut s’attacher : c’est ce qui donne lieu, chez Bourdieu, à la théorie de l’habitus comme principe générant des styles de pratiques. L’étude se clôt assez naturellement sur une dépréciation de la philosophie ̶ dont la perception du monde, et en particulier du monde social, serait déformée, du fait de son aveuglement à l’égard de ses propres conditions sociales de possibilité ̶ , au profit de la sociologie, qui aurait l’aptitude épistémologique avantageuse de relier réflexions théoriques et considérations empiriques. Une telle dépréciation n’en demeure pas moins étonnante, insérée dans un ouvrage de philosophie des sciences humaines.
Dans l’étude intitulée « Les classes », Alice Le Goff s’attache à faire voir la dualité intrinsèque au concept de classe sociale et défend la thèse que « l’unité du concept reste introuvable »[6]. La sociologie oscille en effet entre une conception strictement fondée sur des critères socio-économiques objectifs et une conception « compréhensive », c’est-à-dire fondée sur l’expérience subjective des individus de la division sociale ̶ sans parvenir à unifier complètement ces deux perspectives. Cette dualité structure l’étude, qui propose le parcours historico-doctrinal suivant : Marx et Weber d’une part ; Bourdieu d’autre part. L’auteure expose ainsi tout d’abord deux concepts économiques de la classe. Celui de Marx est strictement économique, puisque selon lui la division de la société en classes n’est que le résultat d’un mode de production économique et des rapports de production en découlant. En société capitaliste, les rapports entre classes ne sont autres que des rapports d’exploitation économique. Weber, quant à lui, développe également un concept économique de la classe, mais le fonde sur le pouvoir d’acquisition sur un marché, et le nuance en mettant au jour une stratification sociale plus complexe que celle proposée par Marx, du fait d’une relative autonomie des facteurs économiques, politiques et culturels ̶ bien qu’en société capitaliste les premiers tendent à prédominer. En outre, à l’intérieur même du spectre des conceptions socio-économiques de la classe se joue un débat ontologique, sur la nature de son existence : est-elle réelle, ou seulement fictive, simple outil d’analyse du sociologue ? L’auteure expose ensuite la tradition bourdieusienne de la conception des classes, prédécesseurs et successeurs de Bourdieu compris, dont l’unité repose sur la tentative de « réarticule[r] ses facettes objectives et subjectives »[7], et remettre ainsi en cause, notamment, l’économisme marxien. Selon Bourdieu, la division sociale est indéniablement sous-tendue par une distribution inégalitaire objective des pouvoirs ou « capitaux » de tous ordres (économique, culturel, social, etc.) ; précisément pour cette raison, la constitution de la classe est relationnelle : elle se détermine par une différence de dotation par rapport aux autres classes. Ces capitaux n’ont néanmoins pas d’existence simplement objective ̶ surtout s’agissant de ce capital structurant pour Bourdieu qu’est le capital culturel ̶ : ils sont toujours mis en œuvre par les individus eux-mêmes de façon « semi-consciente », mise en œuvre cristallisée dans l’habitus. L’étude se termine sur les débats post-bourdieusiens portant notamment sur la notion de capital culturel et sur la relativisation d’une définition strictement relationnelle de la classe au profit d’une définition par les valeurs.
Dans l’étude intitulée « Le genre », Riccardo Fanciullacci et Stefania Ferrando se proposent de montrer la façon dont les sciences sociales ont progressivement fait de la distinction et des rapports sexués un objet d’étude pour elles, ainsi que la portée critique impliquée par une telle appropriation. Le « genre » est dès l’abord un objet problématique, parce que situé à la frontière entre déterminations biologiques et sociales ̶ et c’est cette porosité qui semble pousser les auteurs à mettre tout au long de l’étude le terme entre guillemets. Après avoir inscrit l’émergence d’une problématique philosophique et scientifique du « genre » dans le sillage historique, mais aussi épistémologique, des mouvements sociaux et féministes en faveur de la liberté et de l’égalité depuis le XVIIIe siècle, les auteurs exposent la matrice théorique d’une telle problématique, à partir de Simone de Beauvoir : la distinction entre le « sexe » comme réalité biologique et le « genre » (bien que le terme apparaisse plus tardivement) comme production historico-sociale ̶ le genre étant défini au début de l’étude comme l’« ensemble des principes, pratiques et représentations qui organisent les formes de relation et de subjectivation qualifiées par des distinctions de sexe »[8]. Le « genre » devient ainsi objet de pensée pour les sciences sociales dès lors qu’il apparaît, au moins en partie, comme une réalité sociale. Une fois une telle distinction opérée, les sciences sociales commencent alors à remettre en question la pertinence même d’une catégorie biologique du sexe, montrant par des études empiriques que la « bicatégorisation » (le fait de ne reconnaître que deux catégories sexuelles : homme et femme) est l’institution sociale (non consciente) d’une pratique biologique, scientifique et médicale, surdéterminée par les représentations de genre dominantes. Le « genre » est ainsi conçu aujourd’hui par les sciences sociales comme une élaboration sociale qui tout à la fois organise les rapports sociaux et oriente les représentations biologiques de la distinction sexuée. Les auteurs posent alors le problème, pour ces sciences, de l’articulation des niveaux descriptif et normatif dans l’analyse du « genre », c’est-à-dire de l’élaboration d’un jugement critique, qui ne saurait découler purement et simplement de l’historicisation du « genre ». Plus précisément, si le rapport social du « genre » mis au jour par ces sciences est un rapport dit de domination, comment élaborer scientifiquement un critère permettant d’établir l’existence d’une domination, si ce dernier concept a une portée normative autant que descriptive ? L’étude se termine ainsi sur l’exposition de tentatives, au sein des sciences sociales, d’élaborer un tel critère en essayant de conjurer le danger, souligné par les auteurs, d’une superposition pure et simple entre distinctions sociales genrées et rapports de pouvoir, et en propose une illustration avec le problème de l’élaboration d’un jugement critique sur la division sexuée du travail.
Dans l’étude suivante, intitulée « Le quantitatif », Isabelle Drouet propose de fournir des éléments d’évaluation des apports et des dangers épistémologiques de ce qu’elle nomme l’« approche quantitative » en sciences humaines, soit « le fait de prendre en compte plusieurs individus [, personnes physiques ou collectifs,] […] et de s’intéresser à la façon dont ils se caractérisent sous différents aspects »[9] ̶ autant de « variables » (par exemple, la catégorie socio-professionnelle) pouvant avoir plusieurs « valeurs » différentes (par exemple, « ouvrier », « cadre », etc.). L’auteure détermine tout d’abord plus avant la nature de l’approche quantitative, en précise ensuite les visées et présupposés épistémiques, et enfin en montre les usages scientifiques possibles. L’opération principale de l’approche quantitative est la « mise en variables » des données empiriques que l’on veut étudier, qui consiste à isoler certains aspects de la réalité que l’on veut prendre en compte (qui deviennent par là des « variables ») et à déterminer les valeurs possibles pour chaque variable. Il s’agit ensuite de délimiter l’ensemble d’individus que l’on veut étudier (qu’il soit échantillon ou population exhaustive), et d’attribuer à chacun une valeur dans chaque variable que l’on aura retenue. L’ambition d’une telle approche est la production de connaissances à portée générale, assurées par l’objectivité à laquelle elle prétend et les régularités qu’elle est en mesure de mettre en évidence. La méthode qu’elle met en œuvre cependant, et c’est là où elle prête le flanc à la critique, présuppose une homogénéité des individus agrégés et comparés du point de vue des aspects mis en variables, ainsi qu’une abstraction consistant à ne considérer les individus qu’au travers de ces variables. La puissance épistémique de l’approche quantitative demeure cependant, une fois la mise en variables effectuée, par le croisement des différents aspects des individus de constituer des typologies, c’est-à-dire des associations typiques de propriétés chez ces derniers, ainsi que d’identifier des relations causales, bien que seulement probables, entre les différentes variables, rendant ainsi possible un raisonnement expérimental dans les sciences ne pouvant pas avoir recours à l’expérimentation. L’étude se termine sur une appréciation nuancée de l’influence du progrès technique sur les analyses statistiques : si les ordinateurs rendent celles-ci de plus en plus aisées à mener, leur automatisation risque d’en masquer la compréhension à son utilisateur, ce qui peut être dommageable pour la recherche scientifique.
Dans l’étude consacrée à la notion de comparaison, Florence Hulak, récusant l’opposition entre connaissance du singulier et comparaison généralisante, défend la thèse du caractère « de part en part comparati[f] »[10] de la connaissance mise en œuvre par les sciences humaines et sociales. Elle s’efforce ainsi de montrer la comparaison à l’œuvre dans la description ethnologique, dans l’activité historienne et dans l’explication et l’interprétation sociologiques, en s’appuyant à chaque fois sur les méthodes théorisées et mises en œuvre par de grandes figures de ces disciplines ̶ sans toutefois que la distinction entre l’exemple méthodologique constitué par tel auteur et le concept général d’une méthode disciplinaire soit toujours très claire. S’agissant de l’ethnologie, l’opposition entre description ethnographique du singulier et comparaison ethnologique visant le général est récusée : la connaissance même des sociétés singulières passe nécessairement par des moments comparatifs, que le cadre théorique soit celui de l’évolutionnisme, du fonctionnalisme de Malinowski ou du structuralisme de Lévi-Strauss. En histoire, discipline qui cherche à établir spatio-temporellement des événements, la comparaison est aussi outil de connaissance du singulier, que ce soit dans l’activité pratique de critique des sources ou dans l’activité théorique d’identification des singularités des sociétés passées. Plus évidemment, la méthode comparative, telle que l’a théorisée Durkheim, est l’outil de la sociologie qui cherche à expliquer causalement les faits sociaux : ne disposant pas de la possibilité de l’expérimentation, elle peut néanmoins mettre en œuvre un raisonnement expérimental scrutant les « variations concomitantes ». Enfin, lorsqu’elle cherche, à l’instigation de Weber, à interpréter les actions humaines sociales, la sociologie établit des « types idéaux », la typologisation passant nécessairement par une activité comparative et oppositionnelle déterminant les types singuliers les uns par rapport aux autres. Il semble que la thèse de l’auteure, au-delà de tous ces exemples disciplinaires et méthodologiques, s’appuie sur une autre thèse, qui aurait peut-être mérité une exposition plus explicite et détaillée : celle de la comparaison comme mode de fonctionnement essentiel de l’esprit humain.
Dans l’étude intitulée « Le public », Charles Girard s’empare d’un objet original de la réflexion scientifique, puisqu’il constitue, historiquement, un concept philosophique normatif et conditionnel des théories démocratiques (pour que la démocratie soit possible, il faut que quelque chose comme un « public » existe), avant de faire l’objet d’études scientifiques empiriques (quelque chose comme le « public » existe-t-il?). L’étude part donc de la conceptualisation initiale du public par la philosophie politique, et montre les diverses manières dont les sciences humaines et sociales se sont mises à la recherche empirique de cet objet, tantôt pour en nier l’existence, voire la possibilité même, tantôt pour la conceptualiser à nouveaux frais, tantôt pour mettre en évidence les conditions sociales de son émergence. L’idée normative du public qui émerge à partir du XVIIIe siècle se distingue de celles de peuple et de population, en ce qu’elle le situe essentiellement au plan de l’opinion des représentés (dans le cadre d’une démocratie représentative), dont le rôle majeur garantissant le fonctionnement démocratique est d’orienter le choix des représentants politiques et les actions de ceux-ci. Les deux critères à l’aune desquels les sciences humaines et sociales ultérieures vont interroger la réalité du public sont son efficacité (le public n’existe que s’il peut avoir des effets politiques réels) et, surtout, sa rationalité (le public n’existe que s’il constitue une opinion construite rationnellement). Ainsi la psychologie du tournant des XIXe et XXe siècles et la sociologie politique du début du XXe ont-elles émis de sérieux doutes sur l’existence, voire sur la possibilité même, du public, sur la base d’une tendance irrationnelle des « foules » ou d’une complexité des sociétés modernes insaisissable au plus grand nombre. La philosophie pragmatiste ne se satisfait néanmoins pas du constat d’inexistence et s’interroge sur les conditions sociales de constitution effective d’un public démocratique, au premier rang desquelles figure le développement de la connaissance de la société par ses membres, devant aboutir à la prise de conscience d’expérience partagées et d’intérêts communs. Le questionnement glisse alors vers les conditions sociales de communication dans les sociétés contemporaines, le développement des médias de masse devenant le point d’interrogation central : ceux-ci sont-ils vecteur ou obstacle à la constitution d’un public ? Sont-ils simple instrument de domination ou espace de discussion rationnelle de sujets d’intérêt public ? L’étude se clôt ainsi sur les débats qui animent la sociologie des médias et sur leur influence sur la conceptualisation philosophique du public.
Dans la dernière étude, consacrée à la notion de critique, Julia Christ part de la thèse d’un lien essentiel entre les sciences sociales et la critique ̶ l’objet des premières étant historiquement la société postrévolutionnaire, essentiellement « critique » puisque ses membres interrogent sans cesse la légitimité de l’autorité établie ̶ , et prend pour fil directeur de son étude la question de la nature de la critique dont ces sciences sont elles-mêmes capables, en présentant dans un premier temps le legs philosophique du concept de critique, et dans un second les différentes appropriations et inflexions du concept, dans une perspective pratique et empirique, par les théories sociologiques et les sciences sociales ultérieures. Le premier temps propose ainsi une genèse théologico-philosophique du concept, essentiellement moderne, de critique, allant de la critique biblique et religieuse promue par la Réforme, en passant par la conceptualisation kantienne de la critique comme réflexion « sur la capacité objective de la raison à produire des vérités »[11], jusqu’à l’inflexion du concept kantien opérée par Hegel et Saint-Simon, qui déplacent le sujet de la critique de l’individu vers la société. Le second temps propose un parcours, résolument axé sur la critique sociale, de Marx aux héritiers de Bourdieu en passant par Nietzsche, Weber, Durkheim et l’École de Francfort ; il s’intéresse aux divers dépassements d’une critique philosophique qui se plaçait du seul point de vue de l’idéalité et tourne constamment autour du problème de la possibilité d’une critique immanente à la société elle-même et aux acteurs sociaux.
A l’issue de la lecture du second tome de cet ouvrage, on ne peut que se réjouir que ce dernier ait été enrichi de neuf notions supplémentaires, traitées par des spécialistes du domaine de la philosophie des sciences humaines, comme c’était déjà le cas pour le premier tome. Ce type de publications est très bienvenu dans le paysage éditorial philosophique, constituant un outil maniable pour les non spécialistes, déjà familiarisés ou non avec les textes philosophiques, à mi-chemin entre le dictionnaire et l’ouvrage spécialisé. Il permet une entrée, à la fois accessible et rigoureuse, dans un champ disciplinaire, et, grâce aux riches références bibliographiques, oriente vers les textes fondamentaux le lecteur désireux d’approfondir son savoir.
[1]Florence Hulak et Charles Girard (dir.), Philosophie des sciences humaines, t.1 « Concepts et problèmes », Paris, Vrin, 2011, 280 p.
[2]Florence Hulak et Charles Girard (dir.), Philosophie des sciences humaines, t. 2 « Méthodes et objets », Paris, Vrin, 2018, 312 p.
[3]Ibid., p. 17.
[4]Ibid., p. 55.
[5]Ibid., p. 65.
[6]Ibid., p. 104.
[7]Ibid., p. 117.
[8]Ibid., p. 135.
[9]Ibid., p. 163.
[10]Ibid., p. 195.
[11]Ibid., p. 266.














