Recension – Philosophie de l’odorat
Raphaël Pierrès est docteur de l’Université Paris 1. Il y enseigne actuellement la philosophie générale et la lecture de textes philosophiques en langues étrangères. Dans le cadre de son doctorat, effectué sous la direction d’André Charrak, il a travaillé sur le problème de l’intériorité à l’âge classique (en particulier chez Descartes et Locke). Il en déploie désormais les implications contemporaines dans un double rapport à Husserl et Wittgenstein, pour un ouvrage à paraître chez Vrin. Il est membre associé du laboratoire d’Histoire de la Philosophie Moderne de l’Université Paris 1 (HiPhiMo) et participe au réseau européen de philosophie japonaise (ENOJP).
Faut-il perdre l’odorat pour y prêter enfin attention ? Chantal Jaquet introduit sa Philosophie de l’odorat par la mention d’une affection dont on ignorait « jusqu’au nom », mais que la pandémie nous a depuis appris à connaître : « l’anosmie ». Or, les philosophes seraient singulièrement exposés à ce trouble : de manière générale, l’auteure indique en effet, quoique ce constat soit tempéré dans la dernière partie de l’ouvrage, qu’ils se sont peu préoccupés de l’odorat. S’il est possible de chercher des ressources du côté de la littérature, de l’histoire, de l’anthropologie, ou de la médecine, ces textes laissent ouverte la question de la valeur esthétique et épistémique de l’odorat. Dès lors, comment construire une philosophie de ce sens mal-aimé ? L’auteure esquisse les contours de son propre travail qui s’intéressera d’abord à la sensibilité olfactive (première partie) avant de construire une esthétique olfactive (deuxième partie) ouvrant la voie à des philosophies olfactives (troisième partie).
Le premier chapitre s’efforce de lever un certain nombre d’obstacles épistémologiques, mais aussi culturels, à la construction d’une philosophie de l’odorat. L’odorat est en effet dévalué ou peu considéré en tant qu’il serait un sens faible, ou affaibli par l’évolution biologique et le développement de la civilisation, « par comparaison avec le flair puissant de l’animal » (p. 24). Cette objection peut toutefois être affrontée en faisant valoir d’une part que la faiblesse de l’appareil acoustique humain vis-à-vis de celui des chiens ou des dauphins « n’a nullement entraîné la disqualification de l’ouïe » ni fermé la possibilité d’une philosophie du son et de la musique (p. 29). D’autre part l’idée d’une dégénérescence de l’odorat humain est fondée sur des conceptions scientifiques aujourd’hui dépassées, associant l’odorat à une seule zone, restreinte, du cerveau (p. 32). À condition de l’exercer, le nez humain est capable de distinguer des milliers d’odeurs, comme en témoigne la formation des sommeliers, des parfumeurs, des cuisiniers, etc.
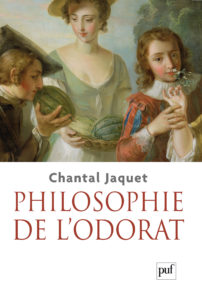 Si ce sens est peu cultivé, c’est sans doute aussi parce que le discrédit jeté sur l’odeur tient à un ensemble de valeurs et de représentations qui l’associent à la bestialité, à la saleté, à l’immoralité. À ceux qui réduisent l’odorat à un sens sauvage, portant encore la marque de l’animalité (p. 38), l’auteure répond, avec Aristote, en faisant valoir une gamme de perceptions olfactives proprement humaines[1]. De même, si l’odeur est parfois gênante en société, elle prend aussi une fonction sociale dans de nombreuses cultures : l’auteure oppose ainsi diverses coutumes d’accueil, de salutations, de mariages, à la répression « occidentale » (p. 60) associée à une forme de « puritanisme », de « rejet du corps et de sa sensualité » (p. 64).
Si ce sens est peu cultivé, c’est sans doute aussi parce que le discrédit jeté sur l’odeur tient à un ensemble de valeurs et de représentations qui l’associent à la bestialité, à la saleté, à l’immoralité. À ceux qui réduisent l’odorat à un sens sauvage, portant encore la marque de l’animalité (p. 38), l’auteure répond, avec Aristote, en faisant valoir une gamme de perceptions olfactives proprement humaines[1]. De même, si l’odeur est parfois gênante en société, elle prend aussi une fonction sociale dans de nombreuses cultures : l’auteure oppose ainsi diverses coutumes d’accueil, de salutations, de mariages, à la répression « occidentale » (p. 60) associée à une forme de « puritanisme », de « rejet du corps et de sa sensualité » (p. 64).
Enfin, un dernier obstacle, proprement épistémologique engage la catégorisation de l’odeur comme qualité seconde. L’auteure mobilise ici l’analyse du morceau de cire de Descartes, dont les odeurs s’évanouissent lorsqu’on l’approche du feu[2]. Il est en effet tout à fait remarquable que l’odeur disparaisse lorsque le morceau de cire est chauffé, mais peut-être faudrait-il introduire cette réserve que la figure aussi est changée. Il n’en reste pas moins que Hobbes s’appuie bien sur le constat de la diversité des appréciations des odeurs pour faire valoir leur subjectivité : elle n’est pas une propriété inhérente aux objets sentis mais au sujet sentant[3]. Ou en d’autres termes, l’odeur n’a pas « lieu d’être » (97) : elle n’est ni tout à fait dans l’objet, ni tout à fait dans le sujet. En outre, elle est particulièrement trompeuse, car Hobbes montre que la même odeur est tolérée si nous croyons qu’elle vient de nous, ou perçue comme désagréable, si nous l’associons à autrui. L’auteure cherche à retourner ce reproche en suggérant que l’odeur serait justement une manière d’accéder au « monde intérieur », à l’ « intimité du sujet » (p. 101), mais aussi à son histoire intersubjective, en particulier dans les liens affectifs que nous nouons en société. Elle propose ainsi de se livrer à une « phénoménologie du nez », et sans doute, est-ce bien la voie de sortie de l’objection tenant au caractère de qualité seconde de l’odeur.
Toutefois, qu’on le regrette ou qu’on s’en félicite, ce projet est essentiellement réalisé au deuxième chapitre sur le mode d’une analyse sociale des relations impliquées par l’odeur, et de son rôle dans la construction de l’identité. L’auteure joue à nouveau d’un vocabulaire ambivalent selon lequel sentir l’autre, c’est « pénétrer dans son intériorité » (p. 103). Cela ne va pas de soi, tant le personnel n’est pas réductible à l’intérieur, et que la phénoménologie de l’odorat invite au contraire à être sensible à une perception « de grand air », où ce qui a pu être désigné comme « atmosphère » nous sollicite. De fait, c’est plutôt dans cette dimension interpersonnelle que l’auteure s’engage, analysant les divers usages du vocabulaire olfactif dans l’expression de la haine et de l’amour (p. 105). Elle montre notamment comment des formes de discrimination olfactive sont à l’œuvre dans le racisme (p. 106), l’homophobie (p. 109), le sexisme (p. 111) ou divers types de mépris de classe (p. 115). Mais en retour, l’odeur de l’être aimé a une charge érotique toute particulière (p. 122). Au croisement de ces dynamiques, l’odeur joue un rôle décisif dans la constitution d’une identité (p. 133), en particulier de genre (p. 134). Le parfum contribue à la séduction et à la beauté d’un être, au sein de dynamiques sociales différenciées.
Dans ce fil, la deuxième partie de l’ouvrage s’efforce de dégager, en deux temps, la possibilité d’une esthétique olfactive. Avant de se pencher sur l’art olfactif proprement dit, l’auteure s’intéresse aux expressions indirectes de l’odeur, en particulier dans la littérature (Proust), mais aussi par la musique (Debussy), la peinture (Gauguin), voire la sculpture (Rodin). En premier lieu, la possibilité d’une esthétique olfactive est en effet liée à la constitution d’un vocabulaire des odeurs (p. 151). Or, les odeurs sont souvent difficiles à exprimer, les mots nous manquent (p. 152). A cela, l’auteure répond en rappelant une typologie, dont le lecteur aurait pu souhaiter qu’elle la discute plus : des parfums fleuris et fruités, sont distingués les parfums boisés, fauves et épicés. Elle évoque le fait que la langue française est relativement riche en la matière (p. 154) tout en rappelant l’obstacle que constitue la diversité linguistique, qui va de pair avec une diversité perceptive (p. 155). Elle nous invite à nous tourner alors vers la poésie et la littérature pour développer nos possibilités d’expression. Elle évoque brièvement Flaubert et Zola, un peu plus Balzac, afin d’approfondir le rapport entre odeur et amour. Mais c’est surtout Proust qui fournit ici matière à réflexion. C’est peut-être en ce point qu’il faut chercher les prémisses d’une phénoménologie de l’odorat. Plus qu’au retour du motif de l’intériorité (p. 178) ou de l’affectivité (p. 186), c’est l’analyse de la temporalité qui nous semble apporter des éléments véritablement nouveaux. Proust confère un effet à l’odeur un rôle bien spécifique dans la réminiscence du passé[4]. Si l’odeur déploie un monde, c’est un monde temporel. L’odeur se charge des sensations passées, qui s’ordonnent autour d’elle, et dont elle fournit la clé (p. 177). En effet, ce n’est pas seulement la saveur qui jour ce rôle chez Proust. A son tour, l’odeur est susceptible de déclencher une forme de mémoire involontaire qui surgit soudain, s’impose et mêle au présent le passé (p. 208). Par là, s’ouvre encore un imaginaire qui, pour être sans image, n’en est pas moins riche et profond.
Chantal Jaquet explore alors la parenté entre odeurs et sonorités, au travers de la manière dont Debussy évoque l’odeur suffocante de la mort dans Pélléas et Mélisande, par le basson, les timbales, le choix de rythmes lents, de tonalités mineures (p. 229). Sons et odeurs sont portés par l’air et se déploient dans le temps. Debussy rêve ainsi plus directement d’une musique « de plein air » où la mélodie se mêlerait au vent qui agite les feuilles et porte le parfum des fleurs (p. 232). Ces explorations synesthésiques ne sont pas limitées à la musique. Au-delà des représentations de l’odorat dans des séries de tableaux classiques consacrés aux cinq sens, Chantal Jaquet prend à témoin Gauguin, qui fait entrer la couleur en résonance avec l’odeur dans Noa Noa (p. 240).
Mais la question reste ouverte, par-delà les évocations littéraires, musicales et picturales de l’odeur, de savoir si un art olfactif autonome peut exister (p. 255). Ce qui se présente en premier lieu est le statut incertain de la parfumerie qui semble plutôt se rattacher aux arts d’agrément qu’aux beaux-arts (p. 256). Le parfum apparaît d’abord comme un produit de luxe et de consommation (p. 257). L’auteure discute alors de la possibilité d’un art olfactif, en mobilisant essentiellement, les catégories, très classiques, de la Critique de la faculté de juger. Pourtant, la distinction entre art et artisanat, et plus encore entre l’agréable et le beau, mériterait d’être remise à plat tant l’exemple kantien central (le vin des Canaries) a trait non seulement à la saveur mais encore à l’odeur : ne pourrait-on appliquer à Kant le type d’interprétation que l’auteure a livré de la madeleine de Proust pour questionner le processus d’esthétisation à l’œuvre dans l’œnologie ? A l’objection qui voudrait que l’odeur soit trop éphémère pour constituer une œuvre d’art pérenne (p. 265), l’auteure répond en faisant valoir non seulement le statut éphémère des performances, mais aussi l’analogie entre la partition musicale et la formule d’un parfum (p. 266). De même, à une exigence de type hégélien selon laquelle l’art doit avoir pour fonction d’exprimer l’intelligible (p. 268), l’auteure répond d’une part qu’il peut y avoir un art du sensible qui n’a pas vocation à exprimer l’esprit, d’autre part qu’il y a dans le parfum aussi une puissance d’évocation (p. 269). En dernière analyse, la principale limite à l’émancipation d’une esthétique des parfums semble tenir selon l’auteure à leur vocation commerciale (p. 279) et à la finalité « de parure et de séduction » (p. 281).
Pour dégager la possibilité d’une authentique esthétique olfactive, elle doit donc faire un triple pas de côté, vers la philosophie antique, vers l’imaginaire littéraire, vers les « arts » traditionnels japonais. Elle prend d’abord un point d’appui philosophique inattendu, en cherchant dans le Philèbe de Platon un pur plaisir des odeurs (p. 282), l’associant au statut ondoyant (hugros) d’eros dans le Banquet (p. 292). Chantal Jaquet mentionne alors la figure littéraire de l’esthète décadent Des Essseintes dans A rebours de Huysmans qui compose de véritable poèmes olfactifs (p. 307, 309). Mais c’est surtout le modèle japonais du kôdô qui fournit à l’auteure ses principaux arguments en faveur d’une esthétique olfactive. Il est notable qu’il soit présenté par opposition au statut d’ « art d’agrément » des parfums « dans la civilisation occidentale » (p. 313). Il est possible de présenter le kôdô comme une « cérémonie » de l’encens : dans sa modalité la plus courante, un auditoire restreint est invité à respirer une série de fragrances, s’efforçant alors dans une forme de jeu fortement ritualisé, de les distinguer et d’en identifier la signification (p. 326). Toutefois, cette tradition présentée comme relevant de la « civilisation japonaise » est liée dès ses origines à l’idéalisation du monde chinois, et la société japonaise de kôdô nourrit à son tour une forme d’amitié fascinée pour l’exotisme de la parfumerie française. Bien plus, le statut des voies (dô) japonaises fait problème vis-à-vis de l’enjeu principal, à savoir l’identification d’un art qui ne soit pas « d’agrément », « décoratif » ou lié à ce que Kant désigne comme « artisanat ». Cette catégorie de la langue japonaise qui renvoie à la fois aux arts martiaux, à la « cérémonie » du thé, aux arrangements floraux ou à la calligraphie, semble effectivement faire bouger les lignes de partage kantienne, et c’est sans doute son principal bénéfice. Le chapitre s’ouvre ainsi sur l’horizon d’un art contemporain olfactif, qui paraît décidément bien éloigné du cadre d’analyse kantien, en particulier dans les diverses installations qui font intervenir l’odeur sur un mode qui n’est pas nécessairement lié à une esthétique de la beauté ou de la pureté (p. 341). L’auteure choisit cependant de clore cette analyse sur la réinterprétation contemporaine de la tradition de l’encens proposé par Hiroshi Koyama, qu’elle présente comme un sculpteur olfactif (p. 346).
Si l’odeur peut revêtir une dimension esthétique, Chantal Jaquet nous invite, dans la troisième partie de l’ouvrage, consacrée aux philosophies olfactives, à réfléchir à sa portée spéculative, et à sa valeur de vérité (p. 357). S’appuyant sur le double sens des termes latins de sapere et de sagax, elle suggère que l’odeur fournit un modèle d’évidence (p. 358). Après un détour par les présocratiques (p. 363), l’auteure se penche enfin sur trois modèles de philosophies olfactives : Lucrèce, Condillac et Nietzsche. L’enjeu principal est de se demander ce qu’apporte de spécifique le paradigme olfactif, ou, en d’autres termes, ce que peut le nez que la vue ne peut pas. Il est ainsi tout particulièrement remarquable que l’odorat fournisse un argument décisif à l’atomisme de Lucrèce, afin de lever l’objection consistant à refuser l’existence à des corps que nous ne pouvons voir : en effet, nous admettons bien l’existence du vent et de l’odeur[5]. Bien plus, l’odorat lui permet de penser, par analogie, la nature de la matière invisible de l’esprit (p. 413) et son lien au corps, comme l’encens à son parfum (p. 415). Un autre modèle important peut être trouvé dans la fiction condillacienne de la statue, d’abord réduite à l’odorat, dans le Traité des sensations (p. 417). Il permet en effet de manifester la productivité de ce sens, fût-il isolé, dans une genèse de l’attention, de la mémoire, du jugement, du besoin et de l’imagination. Ici, la compréhension matérialiste de l’odorat entre en tension avec une autre thèse qui affirme que si nous étions réduits à l’odorat, nous ne pourrions affirmer l’existence de la matière, ou des choses extérieures (p. 423) car l’odeur ne met pas en jeu la distinction entre sujet et objet (p. 421). Reste donc à rendre compte de l’émergence de l’idée d’un moi distinct du monde qui l’entoure, ce qui n’est possible que par l’intervention du toucher, ou, si l’on y tient, par la combinaison de l’odorat et du toucher (p. 453). Pris au pied de la lettre, le texte de Condillac fournit ainsi le modèle d’une philosophie construite à partir de l’odorat. Mais peut-être fournit-il en outre des ressources pour une phénoménologie qui ne pose pas le primat du sujet, et comprenne la perception sur un autre mode que la représentation. Le livre s’ouvre sur l’évocation de la figure de Nietzsche qui a fréquemment recours à des métaphores olfactives[6]. Nietzsche valorise ainsi la fulgurance du flair contre la démonstration besogneuse (p. 469). Il y a en outre une dimension (anti-)morale, qui dénonce la puanteur des contempteurs de la chair (p. 472) et qui annonce la de création d’une philosophie aux « parfums tout autres » (p. 475).
L’ouvrage est vivement évocateur, et remplit son objectif d’ouvrir un champ de recherche. Il convainc pleinement de la valeur de son objet d’étude, et de l’intérêt qu’il y a à explorer ce domaine. Il faut donc saluer la nouvelle édition, dans la collection Quadrige, de l’ouvrage paru en 2010, qui aura initié de belles dynamiques d’investigation, en particulier au plan d’une interrogation historique du statut du kôdô[7], mais aussi d’une esthétique des formes contemporaines d’art olfactif.
[1]Chantal Jaquet renvoie, en page 54 de son ouvrage, au Traité des sensations d’Aristote 444a-445a.
[2]Voir Descartes, Méditations Métaphysiques II, en AT IX-24 (op. cit. p. 93).
[3]Chantal Jaquet se réfère à De la nature humaine chapitre 8, §2.
[4]Chantal Jaquet donne de nombreuses références à Proust, en particulier à Du côté de chez Swann, p. 8, p. 12, p. 20, p. 49, p. 72, p. 84, p. 121, p. 124, etc.
[5]Chantal Jaquet renvoie p. 409 à Lucrèce, De la nature, I, 298-300.
[6]Voir en particulier Nietzsche, Généalogie de la morale, III, §7 ; Par-delà bien et mal, V, 190, 198.
[7] Voir notamment Chantal Jacquet, Philosophie du kôdô. L’esthétique japonaise des fragrances, Paris, Vrin, 2018.














