Recension – Noesis : Les Limites de la Bioéthique.
Frédéric Ducarme – docteur spécialisé en philosophie des sciences et chercheur attaché au Muséum National d’Histoire Naturelle (UMR 7204). Recension du numéro 28 de la revue Noesis, du Centre de Recherches en Histoire des Idées de l’Université de Nice Sophia Antipolis (CRHI), dirigé par B. Morizot & P-Y. Quiviger.
[learn_more caption= »Vous procurer l’ouvrage : » state= »open »] Le numéro 28 de la revue Noesis sur Les Limites de la Bioéthique peut être acheté chez Vrin. Suivez le lien en cliquant ici.
La bioéthique est une discipline relativement jeune, mais qui jouit d’un succès spectaculaire autant dans le champ académique que médiatique. Du haut de ses 47 ans, elle atteint progressivement une certaine maturité, qui s’accompagne inévitablement d’une crise d’adolescence, caractérisée à la fois par une croissance brusque et désordonnée, une remise en question de ses propres principes fondateurs, et enfin par une conscience accrue de ses propres limites, que ce numéro de la revue Noesis, dirigé par Baptiste Morizot et Pierre-Yves Quiviger, s’est proposé d’explorer.
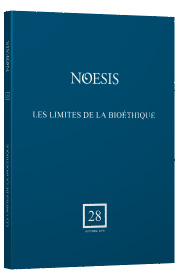 La bioéthique s’est en effet imposée comme une instance incontournable du paysage intellectuel dès lors qu’il est question de la manipulation du vivant et en particulier des biotechnologies – thème ô combien d’actualité –, et est notamment illustrée en France par le très solennel Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) depuis 1980. Il s’agit également d’un champ philosophique remarquablement structuré, ce qui est suffisamment rare pour être noté (même si comme nous le verrons c’est autant une qualité pratique qu’un défaut théorique), et ce en particulier grâce à un ouvrage de référence qui a réussi à demeurer incontournable au fil de ses rééditions, Principles of Biomedical Ethics, de T. L. Beauchamp et J. F. Childress (paru en 1979, et en bonne partie inspiré du rapport Belmont de 1978), dans lequel les auteurs développent quatre « principes » qui doivent guider l’action : l’autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice. Cet ouvrage constitue ainsi à la fois le point d’appui et la cible privilégiée de l’ensemble des textes du recueil, qui conservent toutefois le mérite de ne jamais vraiment verser dans un bipartisme stérile, la démarche étant plutôt celle d’un rayonnement à partir de ce point de départ, que ce soit pour le prolonger, le désavouer, proposer de le dépasser ou le mettre en perspective.
La bioéthique s’est en effet imposée comme une instance incontournable du paysage intellectuel dès lors qu’il est question de la manipulation du vivant et en particulier des biotechnologies – thème ô combien d’actualité –, et est notamment illustrée en France par le très solennel Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) depuis 1980. Il s’agit également d’un champ philosophique remarquablement structuré, ce qui est suffisamment rare pour être noté (même si comme nous le verrons c’est autant une qualité pratique qu’un défaut théorique), et ce en particulier grâce à un ouvrage de référence qui a réussi à demeurer incontournable au fil de ses rééditions, Principles of Biomedical Ethics, de T. L. Beauchamp et J. F. Childress (paru en 1979, et en bonne partie inspiré du rapport Belmont de 1978), dans lequel les auteurs développent quatre « principes » qui doivent guider l’action : l’autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice. Cet ouvrage constitue ainsi à la fois le point d’appui et la cible privilégiée de l’ensemble des textes du recueil, qui conservent toutefois le mérite de ne jamais vraiment verser dans un bipartisme stérile, la démarche étant plutôt celle d’un rayonnement à partir de ce point de départ, que ce soit pour le prolonger, le désavouer, proposer de le dépasser ou le mettre en perspective.
Baptiste Morizot et Pierre-Yves Quiviger annoncent ainsi dans leur article liminaire leur ambition de « mettre en place les conditions théoriques d’une réflexion méta-bioéthique », c’est-à-dire de tendre un miroir à la bioéthique pour l’envisager autant dans son contenu que dans ses contours, dans ce qu’il y aurait en-dehors ou au-delà d’elle, mais aussi envisager cet autre qu’elle pourrait être. La démarche se veut à la fois historique, sociologique, épistémologique et critique, servie par quatorze auteurs très variés à tous points de vue. Trois « problèmes paradigmatiques » sont levés par les deux coordinateurs, et traversent tout l’ouvrage : à commencer par celui du nom, du mot « bioéthique ». En effet, rien ne suggérait au départ que ce terme, forgé dans une perspective très large par l’oncologue américain Van Rensselaer Potter, serait destiné à devenir synonyme d’« éthique biomédicale », alors que le champ du vivant offre bien d’autres domaines d’application possibles à une éthique biologique. Second problème, le primat presque écrasant en bioéthique de l’approche par des « principes », empruntée à Beauchamp & Childress mais qui s’inspire ouvertement des Lumières et surtout de Kant, avec une ambition universaliste qui peut passer pour anachronique au siècle de la post-modernité. Si les problèmes posés par cette démarche ne semblent plus niés par personne, encore reste-t-il à trouver une alternative convaincante, et cette absence d’alternative a sans doute contribué à la si longue prédominance de l’approche proposée par Beauchamp & Childress, qui avait au moins le mérite du consensus et de la simplicité. Le troisième problème touche à la fonction même de la bioéthique : doit-elle être un kit de résolution automatique de problèmes éthiques pour les soignants ? Ou une formation intellectuelle de haut niveau délivrant des outils de réflexion permettant d’apporter une réponse ad hoc à chaque cas particulier ?
Pour traiter ces questions, le recueil est découpé en trois parties : « Une crise des fondements : la controverse du principisme », « La bioéthique : une pratique ou une discipline ? Enjeux épistémologiques » et « Lumière sur quelques points aveugles de la bioéthique ». Le premier article, signé Olivier Rabary, fournit une excellente entrée en matière : il s’agit d’une synthèse claire, riche et documentée de l’éthique des principes héritée de Beauchamp & Childress, contenant l’essentiel des définitions et mises au point indispensables, ainsi qu’un aperçu des principales critiques qui y sont faites, notamment par H.T. Engelhardt ou S. Holms, qui récusent la prétention à l’universalisme. Dès ce premier article sont avancées deux alternatives possibles au principisme : d’une part une nouvelle casuistique, débarrassée de la référence chrétienne et revisitée au prisme d’un pragmatisme qui emprunterait à Dewey, et de l’autre une « éthique relationnelle », éthique de la sollicitude intersubjective nourrie entre autres de Lévinas.
Le second article, signé Bernard Baertschi, aborde plus spécifiquement l’approche néo-casuistique, à la lumière de L’abus de la casuistique d’A. Jonsen et S. Toulmin, présenté comme une réponse à l’ouvrage de Beauchamp & Childress. Il y voit une casuistique moderne assez convaincante, plus réaliste que le principisme dans son application, débarrassée de l’encombrante référence médiévale à une loi naturelle divine et confortée par certaines expériences de neurosciences. Cette perspective « neuroéthique » pourrait en effet bien s’avérer plus proche de la réalité de la pratique médicale que l’impératif catégorique kantien, chaque « cas » médical représentant aussi le carrefour d’une trajectoire de vie par nature unique et difficilement soluble dans une loi aveugle et rigide.
Dans le troisième article, Emmanuel Picavet s’attaque à ce qui fait la force du principisme bioéthique : son pouvoir d’unification des pratiques, sous la bannière de l’universalisme des principes, gage de sécurité pour les soignants et de moindre surprise pour les patients. C’est évidemment cette prétention à l’universalisme qui est facilement critiquable, les fameux principes de Beauchamp et Childress passant facilement pour très américains vu d’Europe continentale, et sans doute pour très occidentaux dans le reste du monde. De plus, ces principes sont donnés comme équivalents, sans priorité en cas de conflit, alors que leur nombre (4) amène facilement des équilibres insolubles… C’est donc le mode d’emploi de ces principes plutôt que leur légitimité qui est ici questionné, d’autant plus que l’indécision à laquelle ils invitent régulièrement cède souvent la place à une analyse en termes de bénéfices-risques, qui sous couvert d’une objectivité de façade dissimule bien souvent un réel désinvestissement éthique dans le soin, permettant d’écarter le choix au profit d’une combinatoire mécanique pas toujours très humaine.
Par-delà cas et principes, Jérôme Ravat propose une approche novatrice par ce qu’il appelle le « pragmatisme interactionnel ». Il commence par un exposé détaillé et critique du principisme et de la casuistique, mettant en évidence le manque d’utilité pratique du principisme et la dimension arbitraire de la casuistique, ainsi que son complexe de tour d’ivoire, puisque la casuistique suggère plus que jamais une bioéthique qui serait affaire d’« experts ». Pour résoudre cette double déception, l’auteur propose une démocratisation de la discipline, dans une démarche ouvertement inspirée de Dewey et qui passe avant tout par l’éducation, dans le but de former un « public bioéthique » en vue de décloisonner les débats.
La seconde partie du volume s’ouvre sur un article de Catherine Larrère, spécialiste d’éthique environnementale. Revenant sur la généalogie du terme « bioéthique » elle propose un retour à la définition originelle de Potter, qui prévoyait d’instaurer une éthique qui aurait pour champ d’application toutes les sciences du vivant, comprenant donc aussi nos interactions avec les animaux et l’ensemble des écosystèmes. L’article vise donc à démontrer que cette limitation de la bioéthique à l’éthique médicale, sorte de nosoéthique, est infondée, et même contradictoire, puisqu’elle sert essentiellement à protéger l’humanité de ce qu’elle fait subir au reste du règne vivant. Rappelant que Potter était un collègue et ami d’Aldo Leopold, fondateur de l’éthique environnementale, l’auteure propose d’articuler autour de la notion de « santé » une approche plus inclusive de la bioéthique, qui considère le malade non comme une monade abstraite mais comme un être vivant pris dans un tissu d’interactions biologiques avec un environnement complexe et lui aussi soumis à des pressions diverses.
Le biologiste Vincent Menuz propose dans l’article suivant un témoignage à la première personne, orienté vers les défis épistémologiques que pose l’exercice de sa discipline. Spécialiste de l’« amélioration » biologique d’êtres microscopiques, il pose notamment la question de l’éventuel transfert (encore scientifiquement hypothétique) de certaines découvertes à l’humain, pour non plus seulement guérir les maladies et handicaps mais améliorer l’Homme en bonne santé, et déployer de nouveaux pouvoirs dans une perspective transhumaniste. Se pose alors la question du « progrès » des connaissances biologiques et donc des possibilités biotechnologiques et la problématisation de ces innovations en termes éthiques. On regrettera presque l’absence de rapprochement avec les grandes philosophies de la technique, d’Arendt à Ellul et Séris, qui aurait pu nourrir ce témoignage par une réflexion plus intense sur ce thème complexe du transhumanisme.
Pierre Le Coz, membre du Comité Consultatif National d’Ethique, propose une sorte de courte monographie sur cette désormais vénérable institution, riche de 37 années d’expertise, et 120 avis rendus. Son statut demeure cependant incertain, son rôle étant uniquement consultatif mais presque jamais désavoué dans les faits par le politique, peut-être trop content de pouvoir se défausser à si peu de frais d’une dangereuse prise de parti dans des débats complexes, au risque d’instrumentaliser le Comité. L’auteur décortique le processus de prise de décision de l’institution, fondée sur une « éthique de discussion » inspirée d’Habermas, avec comme objectif le consensus nuancé, au risque de prendre, justement, peu de risques. L’auteur pointe aussi l’absence toujours criante des questions animales et environnementales à l’ordre du jour, en écho à l’article de Catherine Larrère. Notons cependant que depuis l’écriture de cet essai, le Comité a publié son avis n°125, intitulé Biodiversité et santé : nouvelles relations entre l’humanité et le vivant, preuve d’un début de prise en compte de cette dimension du vivant.
C’est Anna Zielinska qui clôt cette seconde section, avec un article brillant, original et volontairement provocateur, qui remet en doute la pertinence même de l’idée de bioéthique. Cet article est de loin le plus radical du recueil, et peut-être aussi le plus conforme au titre, puisqu’il propose ni plus ni moins que de renverser la statue du Commandeur, que les précédents articles n’osaient que poliment critiquer. Non sans humour, l’auteure part d’une métaphore : s’il est entendu que la bioéthique est indispensable à tout exercice responsable de la médecine, il relève donc d’un scandale criant que les études puis l’exercice du droit pénal ne soient pas assujettis à des comités de socioéthique, constitués d’experts en éthique sociale et juridique – fiction que l’on peut ensuite étendre à tous les autres domaines du savoir et de l’action. Cette utopie burlesque sert de base à une analogie critique : si cette socioéthique nous paraît bien absurde, voire insultante pour les juristes, comment se fait-il qu’on accorde tant de crédit à son jumeau biologique ? Anna Zielinska propose ainsi une critique en règle de la légitimité de ces « sages » qui sauraient mieux que les praticiens comment faire leur travail de manière responsable, et seraient même habilités à produire des jugements sur leur travail en dehors de tout contexte, sans forcément en maîtriser eux-mêmes les rouages et le contexte épistémique. Ce qui est visé ici est en fait autant la dérive potentiellement tyrannique de ces conseils de sages non élus que la croyance en un possible détachement des questions éthiques de la pratique concrète de la médecine, c’est-à-dire l’idée qu’on puisse être « spécialiste de bioéthique », comme si l’éthique appliquée aux biotechnologies pouvait être pensée à part de son objet, et par une minorité de vénérables plutôt que par un collège représentatif d’un corps disciplinaire. Elle attribue l’origine de cette croyance à une ontologie dualiste héritée du christianisme et de Platon, tandis qu’on trouverait dans une filiation plus aristotélicienne (mais qui va jusqu’à Wittgenstein, et on pourrait y rapprocher Dewey) une alternative légitime à ces postulats, passée sous silence par le dogme bioéthique. Non contente d’avoir ainsi sapé les fondements de la bioéthique, l’auteure instruit ensuite elle aussi une critique du principisme, plus proche du reste du corpus. Dénuée de légitimité et biaisée dans son fonctionnement, la bioéthique ne serait alors plus qu’une instance idéologique, voire un aéropage moderne fournissant des oracles sans autre validité que le crédit que leur confère le decorum républicain, dont ils seraient un simple instrument de pouvoir. Nul n’est bien sûr forcé de prendre cette destruction en règle au pied de la lettre, mais son principal mérite demeure d’ouvrir des perspectives théoriques passionnantes sur la réflexion quant aux fondements de ce que pourrait et devrait être une éthique biomédicale – ou biologique dans un sens plus large, éthique du vivant.
La troisième et dernière section du volume propose de jeter la lumière sur « quelques points aveugles de la bioéthique ». Souad Touzri Takari nous propose pour commencer l’exemple d’une expérience pédagogique menée sur 42 étudiants tunisiens en biotechnologie, sur le thème de la xénogreffe de cœur de porc sur des humains – technologie non encore applicable, mais déjà envisageable médicalement. Elle décrypte ainsi le raisonnement des étudiants et les justifications invoquées (qui pourraient évoquer le travail de Boltansky et Thévenoud), montrant que leur démarche est spontanément déductive et relève d’une rationalité rarement rigoureuse.
Comme Michel Serres avait croisé la tradition philosophique du contrat social avec la philosophie environnementale, Alexandre Foucher propose une relecture de la bioéthique à la lumière de Hobbes, celle-ci constituant selon lui une charnière capitale à l’articulation entre liberté individuelle et nécessités de la société. Il propose une distinction assez fine entre deux bioéthiques : tout d’abord un champ philosophique (l’« interrogation sur les conséquences des progrès scientifiques sur les valeurs humaines »), et d’autre part un champ légal, exécutif (« la bioéthique en tant qu’application légale à la vie quotidienne des recommandations scientifiques »). C’est donc le passage de l’un à l’autre qui pose problème : la bioéthique n’est à aucun moment une science, mais semble pourtant se poser socialement comme telle quand elle émet des avis normatifs non soumis à la délibération démocratique. La bioéthique est donc ici vue comme l’un des lieux où s’exprimerait un droit moral du Léviathan sur les citoyens, puisque des principes généraux édictés par la société président aux destinées médicales des individus. Cet article assez iconoclaste est en assez bonne complémentarité avec celui d’A. Zielinska, en tant qu’il instruit une critique radicale de la légitimité sociale de la bioéthique, quoique avec une méthodologie très différente.
L’anesthésiste-réanimateur Serge Duperret propose ensuite un nouveau témoignage de professionnel médical, mettant en lumière le décalage fréquent entre la bioéthique théorique, universitaire, et les problèmes concrets qui se posent face à des patients, tout comme les méthodes expérimentées par les soignants, en l’occurrence dans un service d’hospitalisation suivant des greffes d’organes. A la lumière de Gilbert Simondon (mais aussi de Paul Ricœur et Emmanuel Lévinas), il développe une théorie de l’« agir narratif », dans laquelle le patient reprend l’initiative sur sa vie après l’épreuve par le biais de la narration de celle-ci, manière de recoller, de « greffer », un moi présent neuf et déconcertant à un moi passé révolu dont il est difficile de faire le demi-deuil. La narration devient donc le medium d’un lien qui n’est plus pensé comme le passage d’un état à un autre (homme sain à homme traité) mais une étape dans un processus plus général d’individuation, aucun stade de cette dynamique n’étant plus légitime qu’un autre, puisque chacun ne peut se penser que par rapport à la totalité. Cet accompagnement particulier participerait ainsi d’un renouveau de l’idée d’hospitalité en milieu hospitalier, peut-être trop souvent oubliée sous la froideur de la médecine mécaniciste.
Dans l’article qui clôt le recueil, Jean-Philippe Pierron invite à considérer une certaine dérive de la bioéthique depuis 1980, allant d’une attention à l’action vers une science de l’action qui mécaniserait l’éthique, une sorte de combinatoire méta-médicale qui se voudrait une science exacte de l’action, et donc simple déduction rationnelle dans laquelle l’humain, soignant comme soigné, n’a pas vraiment son mot à dire. De plus, cette bioéthique se substitue souvent à d’autres domaines normatifs (juridiques, syndicaux, organisationnels), sans disposer de leur légitimité démocratique : elle se poserait ainsi comme un ensemble de dogmes de nature quasi-religieuse, et il n’est donc pas étonnant qu’elle puise tant dans les philosophies de la transcendance (de Kant à Lévinas), et attire tant de théologiens, comme James Childress. Face à un principisme d’experts à prétention faussement objective, l’auteur invite à considérer une bioéthique qui apporterait non pas des solutions clefs en main à des problèmes éthiques mais des éléments de réflexion aux acteurs engagés, sur le modèle non plus d’un idéal platonicien mais d’une prudence aristotélicienne. En somme, passer d’une ritournelle psalmodiée à une inventivité pratique, là où l’universel a bien peu de légitimité puisque ce qui est en jeu, c’est une trajectoire de vie éminemment singulière.
Ce numéro de Noesis fournit donc un bon aperçu des grandes questions d’actualité dans le domaine de la bioéthique, et notamment des problèmes que l’ouvrage de Beauchamp et Childress avait laissés en suspens. De la remise en cause radicale de la discipline même aux propositions d’évolution de la bioéthique principiste, il balaie également une large gamme de postures épistémologiques, dans laquelle le lecteur pourra nourrir sa propre position. On saluera la démarche qui s’attache plus aux fondements et méthodes de la bioéthique qu’à un fastidieux catalogue de problèmes, ainsi que la diversité des intervenants, entre praticiens, universitaires et jeunes chercheurs. Les différents articles sont tout à fait indépendants, ce qui est utile au lecteur qui voudrait n’en consulter qu’un en particulier, mais rend une lecture cursive souvent redondante, puisqu’on se voit réexpliquer à chaque article l’histoire et les fondements de la bioéthique principiste, alors que ces éléments factuels sont déjà résumés dans l’article liminaire. L’absence de réel dialogue entre les auteurs (comme on peut en lire dans des actes de colloque, ce que ce numéro n’est pas) est donc parfois regrettable, d’autant qu’elle aurait sans doute permis des mises en perspective du plus grand intérêt, mais le lecteur dispose cependant d’assez d’éléments pour confronter lui-même ces textes les uns aux autres, et en tirer la matière d’une réflexion éclairée sur l’un des plus brûlants débats de la philosophie contemporaine.














