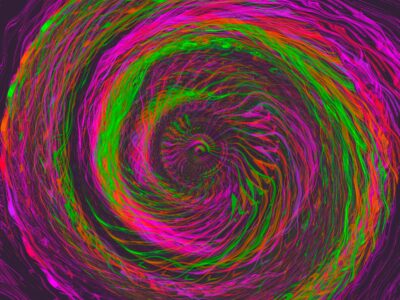Recension – Les hommes lents
Marco Dal Pozzolo est doctorant et ATER à l’Université de Bourgogne. Il prépare une thèse intitulée Le pathologique et son milieu : perspectives philosophiques sur le stress chronique à partir de Georges Canguilhem. Il est auteur de divers articles dont « Repenser le milieu par l’Umwelt. Les lectures croisées de Canguilhem et Merleau-Ponty » (in A. Charpentier, M. Dal Pozzolo, M. Pagan, Repenser la nature. Dewey, Canguilhem, Plessner, Paris, Éditions de la Rue d’Ulm, 2023) et « Governare il comportamento : le radici comportamentiste del capitalismo digitale », (Lo Sguardo, N.34, 2022).
Laurent Vidal, Les Hommes lents. Résister à la modernité XVe-XXe siècle, Flammarion, 2020.
L’ouvrage est disponible ici.
Le livre de Laurent Vidal est le texte d’un historien qui parle de pouvoir et donc, forcément de philosophie. Le volume trace une histoire diachronique et transnationale de la vitesse en tant que mythe et dispositif de pouvoir de l’Occident. Dans ces pages, la lenteur se révèle comme son opposé maudit, déprécié et anormal, selon différentes déclinaisons à chaque époque. L’histoire des hommes lents est une histoire de discrimination politique et morale ; l’auteur insiste sur le rôle joué par le concept de lenteur dans le cadre de la domination ethnique (les peuples colonisés) et également dans la domination de classe (des ouvriers et des travailleurs). Tout au long du livre la polarisation de valeur vitesse-lenteur agit en tant que clé pour relire les relations sociales de pouvoir depuis le Moyen Âge, en traçant une histoire des rythmes au cœur de notre civilisation. La sémantique de l’adaptation imprègne les pages du livre (p. 11, p. 67, p. 115, p. 205) et il ne pourrait pas en être autrement, car la vitesse s’impose en tant que commandement irréfutable, autrement dit comme la forme même de la civilisation à laquelle il faut se conformer. Il est question d’« injonctions à l’adaptation, à rattraper nos retards, à accélérer nos rythmes, à sortir de l’immobilisme et à nous prémunir de tout ralentissement »[1] dans cette histoire, discipline et d’impératifs moraux qu’innervent même la pensée néolibérale au XX siècle, comme l’a bien montré Barbara Stiegler. Il s’agit donc d’une histoire de domination, mais pas uniquement, et c’est peut-être là que réside la contribution la plus originale du livre : la lenteur, dévalorisée, est aussi un facteur de résistance, un pivot à partir duquel il est possible de désarticuler le pouvoir sur les corps par la réappropriation des corps eux-mêmes. Qu’il s’agisse de grèves, de sabotages ou créations artistiques, ralentir signifie se réapproprier son propre corps et ses rythmes, dépossédés par la vitesse imposée. Et c’est en ralentissant qu’une politique affirmative des corps peut émerger.
La première partie du volume reconstruit l’histoire du couple conceptuel vitesse-lenteur au Moyen Âge et dans la première modernité. Dépassant le cadrage temporel explicité dans le sous-titre (« Résister à la modernité XVème-XXème »), c’est au Moyen Âge que Laurent Vidal retrace les racines de la discrimination de la lenteur ; en effet à cette époque la lenteur s’apparente aux péchés capitaux tant elle est corrélée à l’acédie. À partir du traité des vertus et des vices du dominicain Guillaume Peyraud, l’acédie devient une véritable plaie sociale et morale à combattre : il s’agit d’une forme d’apathie et de paresse qui décourage les croyants et les éloigne de Dieu, en les enchaînant dans un cercle vicieux d’ennui et de gaspillage du temps. Elle est d’autant plus effrayante que les moines en étaient aussi victimes. Pascal Chabot dans sa reconstruction généalogique du burn-out en fait un ancêtre de l’épuisement : non pas une paresse parmi d’autres, mais un désordre moral grave, un refroidissement de l’âme qui peut conduire à la perte de la foi[2]. Bien évidemment, la lenteur ne s’identifie pas à l’acédie en tant que telle, mais elle en est une composante essentielle ; la dilatation des rythmes, la lenteur, l’apathie se font signe d’une dilapidation coupable du temps qui, dans l’iconographie, est souvent identifiée à des animaux paresseux, tels l’âne ou l’escargot (p. 37). Si la théologie du Moyen âge déprécie la paresse en tant qu’insulte à Dieu, au XVe siècle elle devient un péché envers la société également. Laurent Vidal nous montre la transformation d’une faute qui était essentiellement d’ordre moral et religieux et qui s’enrichit d’une dimension sociale dans la première modernité : il faut désormais faire vite, être efficient, suivre les rythmes des échanges économiques (p. 45). La dépréciation de la paresse s’entrelace inextricablement avec la valorisation de la vivacité d’âme, de la rapidité, de la promptitudo qui caractérise l’humain véritablement épanoui, à savoir l’humain authentique. La vitesse devient ainsi une vraie idole de l’Europe en train de conquérir le monde économiquement et militairement, certainement non sans justifications religieuses ; « il n’est pas inutile de souligner ici que l’homme n’a pas été créé pour être oisif, mais pour travailler »[3] comme l’écrit Luther (p. 44). La modernité fait de « l’homme lent » son double grotesque : indolent, et donc lent d’esprit, il est essentiellement inutile, comme l’ont dit les auteurs de la ballade intitulée Slow Men of London diffusée en Angleterre dès le XVIIe siècle (p. 63). Dès le XVIe siècle, les ombres inquiétantes de la lenteur et de la paresse (du latin pigritia, mot qui a un sens péjoratif) hantent l’imaginaire du travail. La lenteur est associée à la paresse et la paresse au non-travail. Le siècle des Lumières n’échappe pas à cette appréciation politique et morale de la paresse : si pour Mandeville[4] elle touche spécialement les pauvres qu’on doit contraindre à travailler par la bride de l’argent, l’Encyclopédie[5] souligne que l’homme indolent entrave le fonctionnement de la société et en fait un parent proche de l’homme sauvage. La forme de vie oisive des châteaux aristocratiques légitimait encore, dans une certaine mesure, la paresse et l’indolence, signes du privilège ; la ville moderne en revanche s’organise autour du complexe « accélération/labeur/richesse » et elle est intolérante à toute forme de perte de temps (pp. 74-75).
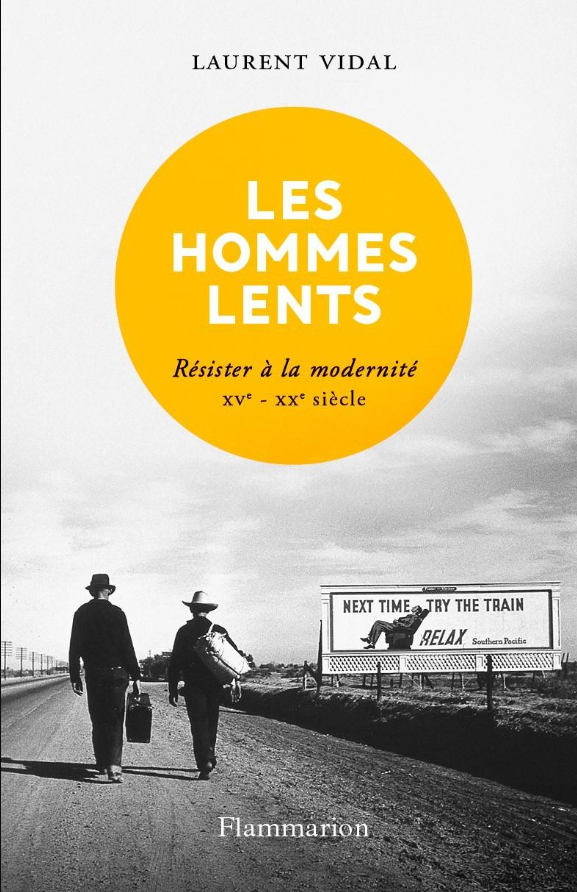 Dans la deuxième partie du livre, Laurent Vidal reconstruit les étapes de l’accélération imprimée par la révolution industrielle, qui vise avant tout à dresser les corps au travail. C’est une révolution à la fois anthropologique et épistémologique qui coïncide avec l’aboutissement de la marginalisation des Hommes lents. Mutation anthropologique parce que, depuis que James Watt transforme la vapeur en force motrice, les machines imposent le rythme du travail, en inversant le rapport de force avec l’homme (p. 84). Le segment d’humanité soumis au temps des machines commence à être appelé prolétariat, une partie du peuple qui, pour survivre, est contrainte à tenir le rythme infernal du progrès techno-économique. Il s’agit d’une transformation épistémologique aussi : le rythme devient un élément central de l’épistémé moderne et les populations humaines sont classées en fonction des multiples rythmes qui les caractérisent (p. 97). Mais c’est surtout l’époque où le temps s’inscrit dans les corps. Les horloges disciplinent le geste au travail, le travail se mécanise et devient essentiellement répétitif. La disciplinarisation des corps passe par la synchronisation de ceux-ci (p. 107). On croise ici le thème foucaldien de la constitution d’un « schéma anatomo-chronologie du comportement », ce qui implique que « le temps pénètre les corps, et avec lui tous les contrôles minutieux du pouvoir »[6]. Un aspect qui fait l’intérêt du livre est la lecture de la normalisation des corps à travers le prisme du temps, souvent secondarisé dans les études foucaldiennes par rapport à l’organisation de l’espace disciplinaire. Une autre dimension du système disciplinaire est pour Laurent Vidal le gouvernement de l’attention : en faisant référence à la littérature médicale et pédagogique au XIXe siècle (sans oublier les analyses de Marx), l’auteur souligne la constitution du discours sur l’attention en tant que condition de l’adaptation physique aux rythmes de travail ; a contrario, l’inattention rejoint la lenteur parmi les cibles de la surveillance des corps (p. 111)[7]. Encore une fois, l’horloge est un dispositif stratégique : elle impose la vitesse et, implicitement, contraint le travailleur à une attention supérieure. Il s’agit du modèle qui structure le travail industriel jusqu’à la chaîne de travail au XXe siècle et aux tentatives de Taylor d’y apporter de la rigueur scientifique. Dans un contexte où l’automobile impose un considérable choc de vitesse dans la perception des espaces et des temps, le travail mécanisé occupe encore une fois une place centrale dans les transformations sociales et dans leurs imaginaires – pensons aux films de Charlie Chaplin et René Clair (p. 138).
Dans la deuxième partie du livre, Laurent Vidal reconstruit les étapes de l’accélération imprimée par la révolution industrielle, qui vise avant tout à dresser les corps au travail. C’est une révolution à la fois anthropologique et épistémologique qui coïncide avec l’aboutissement de la marginalisation des Hommes lents. Mutation anthropologique parce que, depuis que James Watt transforme la vapeur en force motrice, les machines imposent le rythme du travail, en inversant le rapport de force avec l’homme (p. 84). Le segment d’humanité soumis au temps des machines commence à être appelé prolétariat, une partie du peuple qui, pour survivre, est contrainte à tenir le rythme infernal du progrès techno-économique. Il s’agit d’une transformation épistémologique aussi : le rythme devient un élément central de l’épistémé moderne et les populations humaines sont classées en fonction des multiples rythmes qui les caractérisent (p. 97). Mais c’est surtout l’époque où le temps s’inscrit dans les corps. Les horloges disciplinent le geste au travail, le travail se mécanise et devient essentiellement répétitif. La disciplinarisation des corps passe par la synchronisation de ceux-ci (p. 107). On croise ici le thème foucaldien de la constitution d’un « schéma anatomo-chronologie du comportement », ce qui implique que « le temps pénètre les corps, et avec lui tous les contrôles minutieux du pouvoir »[6]. Un aspect qui fait l’intérêt du livre est la lecture de la normalisation des corps à travers le prisme du temps, souvent secondarisé dans les études foucaldiennes par rapport à l’organisation de l’espace disciplinaire. Une autre dimension du système disciplinaire est pour Laurent Vidal le gouvernement de l’attention : en faisant référence à la littérature médicale et pédagogique au XIXe siècle (sans oublier les analyses de Marx), l’auteur souligne la constitution du discours sur l’attention en tant que condition de l’adaptation physique aux rythmes de travail ; a contrario, l’inattention rejoint la lenteur parmi les cibles de la surveillance des corps (p. 111)[7]. Encore une fois, l’horloge est un dispositif stratégique : elle impose la vitesse et, implicitement, contraint le travailleur à une attention supérieure. Il s’agit du modèle qui structure le travail industriel jusqu’à la chaîne de travail au XXe siècle et aux tentatives de Taylor d’y apporter de la rigueur scientifique. Dans un contexte où l’automobile impose un considérable choc de vitesse dans la perception des espaces et des temps, le travail mécanisé occupe encore une fois une place centrale dans les transformations sociales et dans leurs imaginaires – pensons aux films de Charlie Chaplin et René Clair (p. 138).
L’articulation entre vitesse et travail dans la modernité industrielle permet de faire une analyse originale de la division de classe, mais ce n’est pas la seule intersection significative entre rythmes et pouvoir. Le livre est traversé aussi par la question de la colonisation et de la racialisation des non-européens en fonction de leur rapport au temps. Depuis le début de la colonisation (déjà dans le journal de Christophe Colomb), les indigènes d’Amérique sont pris dans le récit des conquérants qui les présentent comme « Indiens paresseux » (p. 50). Ce sont des peuples mélancoliques et fainéants, favorisés par un pays fertile qui leur permet de ne pas trop travailler ; dans l’iconographie du XVI-XVIIe siècle le hamac devient le symbole de la paresse naturelle qui caractérise les peuples américains. Le nouvel impérialisme colonial du XIXe siècle, chargé d’une mission de civilisation, approfondit cette image stéréotypée des Amérindiens : ils sont inadaptés au modèle civilisationnel occidental par leur indolence naturelle et même les esclaves noirs, qui constituent désormais une grande partie de la main d’œuvre aux Amériques, profitent « de la paresse, de l’ignorance et de la liberté » s’ils ne sont pas contraints par l’esclavage, comme l’écrit l’écrivain George Fitzugh[8] (p. 121). Le XIXe est aussi le siècle de la diffusion de la pseudoscience des races. Sous la plume de Gobineau et d’autres théoriciens de l’infériorité raciale, les Africains sont condamnés par leur propre nature et avant tout par leur attitude psychologique : ils sont peints comme émotifs et inconstants, soumis au régime des sentiments et incapables d’accomplir les tâches nécessaires à l’homme moderne. Sans surprise, pour eux, l’oisiveté est un trait typique des peuples africains réticents à adopter la discipline du travail ; expressions telles que « travail avec lenteur » ou « inattention au travail » figurent parmi les plaintes contre les travailleurs d’Afrique du Sud dans les années 1930 (p. 122). La reconstruction historique de Laurent Vidal semble suggérer que la domination de classe et la domination raciale ne sont pas si dissociées : elles sont les côtés sombres, mais tout à fait conséquents, d’une éthique du travail qui idolâtre la vitesse et la productivité.
La dernière partie du livre traite essentiellement des révoltes et des résistances des corps aux travaux. La tentative de structurer de plus en plus scientifiquement le travail est en premier lieu motivée par la lutte contre les échappements, les ruses et les ralentissements que les travailleurs mettent en pratique (p.156). Encore une fois dans le sillage de Foucault : « Ils [les rapports de pouvoir] ne peuvent exister qu’en fonction d’une multiplicité de points de résistance : ceux-ci jouent, dans la relation de pouvoir, le rôle d’adversaire, de cible, d’appui, de saillie pour une prise. Ces points de résistance sont présents partout dans le réseau de pouvoir »[9]. Ces résistances, ajoute Vidal, sont aussi des « enjeux rythmiques » qui nourrissent les différentes formes de lutte (p. 153). Des ralentissements délibérés du rythme de travail sont attestés chez les esclaves au Brésil et aux États-Unis depuis le XVIIIe siècle. L’histoire des sabotages et des grèves est apparentée à l’idée de casser les rythmes du travail, de rompre la cadence de la production. L’inversion sémantique imposée par les ouvriers français au terme « fainéants » au XIX siècle est emblématique : appellation attribuée aux Hommes lents de la modernité industrielle, elle devient la qualification propre aux travailleurs qui ne luttent pas, à ceux qui ne font pas de grèves. Le travailleur qui ne résiste pas n’est pas reconnu actif par ses pairs. Il s’agit d’une résistance qui ouvre « une nouvelle allure de vie », c’est la possibilité « d’expérimenter d’autres formes rythmiques de vie » (pp. 166-167). Ces aspects pointés par Laurent Vidal rappellent un texte où Georges Canguilhem (cité dans l’ouvrage pour ces travaux sur le concept de normalisation), critiquant les fondements épistémologiques du taylorisme, il écrit que « les ouvriers ne tiendraient pour authentiquement normales que des conditions de travail qu’ils auraient eux-mêmes instituées en référence à des valeurs propres et pas empruntées »[10]. Ce passage condense l’échec de l’utopie moderne à maitriser parfaitement les corps au travail, en les dominant par le rythme. On ne pourra jamais combler l’écart entre travail prescrit et travail réel[11], entre temps de la production et temps propre des travailleurs ; c’est justement pour cela que Laurent Vidal peut parler « d’un rôle subversif de la paresse » en s’appuyant sur Lafargue et Rimbaud, entre autres. Le travailleur interprète toujours à sa manière le rythme de travail et il ouvre en son sein son propre rythme, selon ses exigences. La musique, le jeu et la danse en sont des exemples fascinants, comme le montre l’historien. Prenons les dockers au début du XXe siècle qui à Rio, dans l’attente d’un appel à travailler, mettent en place des loteries et des jeux de hasard, pour passer le temps. Ils jouent et ils chantent aussi sur les rythmes de la Samba et à New Orléans, à la même époque, des chansons blues et des mélodies jazz remplissent les entre-temps, « ces temps d’attente, qui se confondent parfois avec l’ennui, se traduisent également par des créations poétiques et musicales » (p. 183). Cette musique, appelée par la petite bourgeoisie stink music ou dirt music, c’est aussi l’occasion de rapprocher les corps, contre la dévalorisation de la proximité et du toucher de la morale des classes dominantes. Le tempo musical des dockers est traversé par la syncope, accusée par la revue musicale The Etude en 1900 de nuire à la santé mentale (p. 191). Elle est un autre rapport au temps : « le temps syncopé s’oppose au temps rythmé de la modernité », il configure un autre rapport possible à la modernité (p. 194).
Le noyau théorique du livre s’achève sur ces hommes qui ouvrent des brèches dans le rythme de la production moderne, qui habitent des lieux aux marges, comme les ports. Leurs corps sont protagonistes de cette histoire, mais leurs espaces marginaux aussi deviennent des ressources pour exprimer une temporalité alternative, caractérisée par l’attente et le ralentissement. Si le temps de travail est contraint, les corps investissent les espaces différemment et, inversement, ils remanient les rythmes si les espaces sont inhabitables (p. 202). Sur ce point, une divergence s’ouvre avec le travail du philosophe et sociologue Hartmut Rosa qui dans son analyse de l’accélération en tant que trait fondamental de modernité procède, en apparence, dans le même sens ; en fait, si pour le penseur allemand « dans ce processus l’espace, à bien des égards, perd son importance pour l’orientation dans le monde de la modernité tardive »[12], ce n’est pas le cas pour l’historien qui essaie constamment d’articuler les temps aux corps et aux espaces. Plus en général, son histoire politique de la vitesse et de la lenteur est essentiellement une grille de lecture pour relire l’histoire des dominés, plutôt qu’une thèse interprétative sur la modernité en tant que telle. Comme l’admet l’auteur lui-même, cette grille mériterait d’être élargie à une histoire contemporaine des femmes lentes, porteuses potentiellement d’autres rapports à temporalité (p. 211). En tout cas, les pages de Laurent Vidal ne perdent jamais de vue l’articulation entre temps, conditions matérielles, pratiques locales, et formes de vie contextuelles : c’est ce que constitue l’apport spécifique de ce texte, historique et théorique en même temps.
[1] Barbara STIEGLER, Il faut s’adapter. Sur un nouvel impératif politique, Paris, Gallimard, 2019, p. 17.
[2] Pascal CHABOT, Global Burnout, Paris, PUF, 2017, pp. 29-35.
[3] Cité in Carla CASAGRANDE et Silvana VECCHIO, histoire des péchés capitaux au Moyen Âge, Paris, Aubier, 2003, p. 44 (cité dans le livre).
[4] Bernard MANDELVILLE, The Fable of the Bees; or Private Vices, Public Benefits, Londres, 1795, pp. 113-114 (cite dans le texte).
[5] Denis DIDEROT et Jean Baptiste Le Rond D’ALAMBERT, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, vol. VIII, 1765, p. 686 (cité dans le livre).
[6] Michel FOUCAULT, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, pp. 153-154.
[7] Pour approfondir la centralité de l’attention dans l’économie et plus en généralement dans notre forme de vie contemporaine voir Yves CITTON, Pour une écologie de l’attention, Paris, Points, 2021, surtout pp. 110-112 et 122.
[8] GEORGE FITZHUGH, Cannibals All!, or Slaves without masters, Richmond Va, A. Morris Publisher, 1875, p. 276 (cité dans le livre).
[9] Michel FOUCAULT, Histoire de la sexualité I. La Volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, p. 126.
[10] Georges CANGUILHEM, « Milieu et normes de l’homme au travail », in G. Canguilhem, Œuvres complètes tome IV, Paris, Vrin, 2015, p. 306.
[11] Yves SCHWARTZ, Expérience et connaissance du travail, Paris, Éditions sociales, 1988, p. 25.
[12] Hartmut ROSA, Aliénation et accélération, Paris, La Découverte, 2014, p. 19.