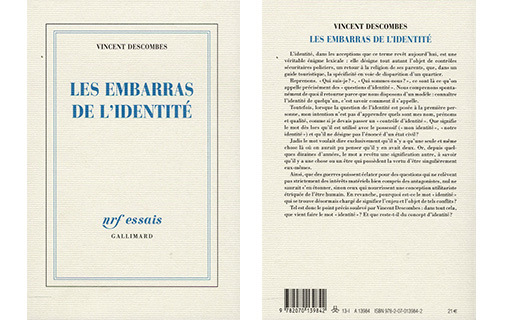Recension – Les embarras de l’identité
Pierre Fasula – Paris I – Phico
Recension : Vincent Descombes, Les embarras de l’identité, Paris, Gallimard, 2013.
Dans Les embarras de l’identité, Vincent Descombes continue d’interroger l’individu moderne, après avoir cherché à rendre compte du mental et du sens[1], des concepts de sujet et d’agent[2], ou encore du moi[3]. Avec cette nouvelle parution, c’est encore un autre aspect relatif à l’individu qu’il interroge, à savoir son identité.
L’intérêt de cette enquête conceptuelle réside selon nous avant tout dans la manière dont le problème est posé. D’une part, il est essentiel selon l’auteur que cette question de l’identité se pose à la première personne ; d’autre part, il est nécessaire de contextualiser historiquement et culturellement cette question de l’identité.
Commençons par ce dernier point. Ce n’est pas le moindre intérêt de ce livre que de contextualiser adéquatement les embarras liés au concept d’identité en évitant à la fois d’en faire un problème éternel mais aussi d’en rester aux seules polémiques récentes à propos de l’identité nationale. Cette juste mesure dans la contextualisation se fait par le rappel des circonstances dans lesquelles le mot « identité », au sens problématique de l’identitaire, a été introduit. Une bonne partie du premier chapitre prend en effet la forme d’une enquête historique sur l’origine de ce sens particulier et notamment de l’expression « crise d’identité ». Ce serait Erik Erikson, psychanalyste viennois émigré aux USA, qui aurait introduit cette expression à la fin de la première guerre mondiale et donné un nouveau sens à la notion d’identité en rapport avec l’anthropologie culturelle américaine[4]. Dans le chapitre II, cette enquête est rapportée à une analyse plus large de la modernité dans le sillage de Louis Dumont et surtout de Charles Taylor. Cette dernière référence permet notamment de comprendre comment l’individu en vient à se penser de manière moderne, c’est-à-dire comment « l’être humain se définit lui-même comme un individu lorsqu’il se pose comme indépendant des liens sociaux qu’il peut avoir par ailleurs »[5], et ce, au moyen d’exercices de définition de soi, par l’imagination d’autres possibilités (« quelles auraient été ma vie et mon idée de moi-même dans d’autres circonstances ? »[6]).
La conséquence tout à fait heureuse de cette contextualisation tient à ce qu’elle permet à la fois de relire autrement la philosophie moderne, notamment Pascal et Rousseau, de leur rendre justice, et de ne pas s’engager trop facilement dans la voie des critiques sociologiques et historiennes de l’identité au nom de « l’identité plurielle »[7] ou du nominalisme à l’égard des entités collectives[8]. Sur ce dernier point, il est intéressant de voir Vincent Descombes discuter les thèses de sociologues et d’historiens contemporains, par-delà ses références habituelles dans ses travaux à Mauss et Dumont. En même temps, l’usage de ces références est renouvelé par leur articulation avec Aristote dont le rôle est central pour la compréhension aussi bien de l’identité individuelle que de l’identité collective. La référence à Aristote permet en effet de penser dans le premier cas un concept d’ « identité expressive »[9], dans le deuxième cas la dimension historique de l’identité collective[10] – nous y reviendrons.
Abordons maintenant le premier point, l’idée selon laquelle il est essentiel que ces embarras se disent à la première personne : « qui suis-je ? », « qui sommes-nous ? ». Il n’empêche qu’il est nécessaire de passer par l’examen du « concept élémentaire de l’identité, celui qui nous permet de juger de ce qui est identique »[11], puisque la présentation de soi qui répond aux questions posées à la première personne fait appel à ce concept élémentaire. C’est le chapitre II qui se charge de cet examen en s’attaquant d’abord à l’objection d’ordre physique selon laquelle il est impossible « d’appliquer le concept d’identité à des réalités de ce monde […] toute chose est perpétuellement dans un état de flux »[12], puis à l’objection d’ordre logique selon laquelle le concept d’identité, compris comme relation, est inintelligible. C’est ainsi que l’on pourrait comprendre la critique par Wittgenstein de cette compréhension du concept d’identité : « Soit dit en passant : Dire de deux choses qu’elles sont identiques est un non-sens, et dire d’une seule chose qu’elle est identique à elle-même, c’est ne rien dire du tout »[13].
On retiendra notamment de ces analyses, en effet nécessaires, cette distinction de Geach rappelée par Vincent Descombes entre deux usages du concept d’identité, « côté prédicat ou côté sujet »[14]. Bien trop souvent, c’est seulement l’usage prédicatif de l’identité (« … est le même que… », « … est identique à… ») qui est envisagé. Or, ce prédicat ayant besoin d’être complété par deux noms propres pour pouvoir dire quelque chose de vrai ou de faux, il est alors tentant de penser que l’identité est une relation. Mais on se heurte alors au paradoxe de Wittgenstein et on s’expose à la réfutation suivante :
Avec quoi la chose est-elle mise en relation lorsqu’elle est déclarée identique ? Si l’on persiste à chercher une relation réelle, on s’expose à une réfutation dialectique : si la chose doit avoir une relation d’identité avec une autre chose, il faut pourtant que cette chose soit finalement à nouveau la même que le sujet de cette relation ; et si la chose doit avoir une relation d’identité avec elle-même, il faut que d’une façon ou d’une autre elle se sépare d’elle-même, sinon quel serait l’intérêt de la mettre en relation d’identité avec elle-même ?[15]
Or il y a un usage de l’identité qui est non seulement différent mais aussi prioritaire, à savoir son usage « côté sujet » qu’on trouve dans « c’est le même homme, Smith, qui a fait ceci, cela, etc. » : il ne s’agit plus de compléter un prédicat au moyen de deux noms propres, mais de répéter le nom propre d’un individu humain. C’est là user autrement du concept d’identité :
Nommer “Smith”, c’est poser que tout usage ultérieur du nom propre, “Smith” dans la suite du récit aura pour fonction de faire référence au même homme que celui dont nous avons communiqué le nom en commençant le récit.[16]
Pour comprendre le sens élémentaire du concept d’identité, il faut simplement remonter « jusqu’à notre pratique langagière des noms propres que nous donnons à ce que nous reconnaissons comme des individus »[17] Avec le concept élémentaire d’identité, il en va moins d’une relation que d’une identification au moyen de la pratique ordinaire des noms propres.
Reste que la question de l’identité au sens de l’identitaire se pose à la première personne et que ce sont les embarras qui en découlent qui intéressent Vincent Descombes. Répondre à la question « qui est-ce ? », puis aux questions « qui suis-je ? » et « qui sommes-nous ? », ce n’est pas répondre à la même question en changeant simplement de sujet : c’est répondre à deux types de questions différentes. Mais, une fois démarqués ces deux types de question, jusqu’où peut-on pousser l’analogie entre « qui suis-je ? » et « qui sommes-nous ? ». Il nous semble qu’à l’horizon des deux dernières parties de ce livre, une analogie apparaît grâce au concept d’expression.
Le chapitre III met en évidence les impasses de la psychologie réflexive classique (qui cherche la réponse à la question de l’identité dans un savoir privé, le savoir qu’un individu aurait de lui-même grâce à sa conscience ou sa mémoire) et celles d’une psychologie morale (qui voit dans l’identité ce qui s’exprime au travers de la décision radicale, du choix existentiel). Pourtant, ces deux impasses ne semblent pas traitées à égalité puisque c’est bien la discussion de la deuxième qui fournit à Vincent Descombes le point de départ de sa propre perspective. Les philosophies existentielles au sens large reposent sur un choix radical de soi dont Hamlet pourrait être l’exemple et qui place l’individu, selon l’auteur, dans une situation inextricable :
Pour se représenter les deux options qui s’offrent à lui, Hamlet doit se représenter lui-même comme n’étant encore ni l’un ni l’autre. Mais, justement, ce pas en arrière qui devrait le porter jusqu’à la racine de tous les choix, vers un primordial « choix de soi-même », est un pas de trop. En se dépouillant de toute identité pratique, Hamlet se prive des raisons qu’il pourrait avoir de préférer une possibilité à l’autre. Il a fait un pas de trop en arrière de lui-même.[18]
Pour sortir de cette situation, il lui faut donc à nouveau se définir, ce qui passe par la reconnaissance de son individuation, du « fait ontologique de l’individuation »[19], qui lui permettra de poser de véritables questions pratiques (« être ou ne pas être ? » n’en est pas une) et surtout d’agir. Et c’est dans ses œuvres que le sujet a à chercher son identité, selon ce concept d’ « identité expressive » que Vincent Descombes élabore au moyen d’Aristote. Pour ce dernier, il y a une identité entre l’artiste et l’œuvre, de sorte que, conformément à ce que développait par ailleurs Proust dans son Contre Sainte-Beuve, « on ne doit pas chercher l’artiste dans sa biographie, dans ses conversations souvent banales, dans ses stratégies de réussite mondaine, mais on doit le chercher dans son œuvre […] dans ce qui en est l’être en acte, son expression sous la forme d’un ergon »[20].
Malheureusement pour nous, Vincent Descombes ne développe que peu cette dimension de l’expressivité, d’où un certain nombre de questions. Quelle conclusion tirer de ces quelques pages pour celui qui n’est pas un artiste ? De quels actes dira-t-on qu’ils expriment son identité ? Ce qui est intéressant dans la référence à Proust et à son Contre Sainte-Beuve, c’est cette différence entre les œuvres de l’artiste, dans lesquelles nous trouvons son individualité, et sa biographie. Mais qu’est-ce qui tient lieu des œuvres des artistes pour ceux qui n’en sont pas ? S’il n’y a rien pour en tenir lieu, que faire de leur biographie ? Plus radicalement, la distinction proustienne est-elle encore opératoire ? Où l’individu ira-t-il chercher son identité ?
Si l’on se penche maintenant sur la dernière partie du livre, celle qui porte sur l’identité collective, il est intéressant de constater qu’elle se termine elle aussi sur cette idée d’expression. Une bonne partie du chapitre IV est consacrée à la remise en cause de l’idée selon laquelle l’identité collective ne serait qu’une construction, une représentation, ou encore une fiction. Cela ne signifie pas que, pour Vincent Descombes, une critique historique de ce qui se fait passer pour l’identité collective n’est pas légitime : au contraire, une telle critique « de premier degré » invite à faire la part entre ce qui relève réellement de l’identité collective et ce qui n’en relève pas. L’auteur s’oppose bien plutôt à une critique historique et sociologique « de deuxième degré » qui voit dans la notion même d’identité quelque chose de nécessairement fictif voire néfaste, et son but est de rendre compte de la réalité des groupes réels par démarcation avec les groupes seulement nominaux.
Il ne s’agit pourtant pas d’objecter frontalement à la critique de second degré la supposée évidence de la réalité des identités culturelles, mais de montrer que c’est au « nous » de fixer des limites, des contours, à l’entité collective. Cela implique à la fois une acceptation de cette délimitation par les autres entités collectives, une individuation de ce « nous » dans la succession des générations et enfin une articulation, une composition interne de ce « nous ».
Toute la question est alors de savoir comment s’articulent identité individuelle et identité collective, comment un « je » peut se dilater en un « nous » :
La notion d’identité, prise au sens moral, permet en effet à cet individu de se trouver lui-même hors de lui-même. Elle l’autorise à dire « moi » pour autre chose que lui-même. Aristote l’avait déjà noté quand il expliquait, à l’aide de sa distinction entre la puissance et l’acte, pourquoi les artistes se comportent envers leurs œuvres comme les parents envers leurs enfants. Le fait de pouvoir se tenir pour l’auteur d’une chose permet d’entretenir avec cette chose une relation expressive.[21]
Mais, dans le cas de l’identité collective, il ne s’agit plus de se demander « quelles sont mes œuvres ? », mais « de quelle histoire suis-je l’œuvre ? ». De même qu’il y a un « fait ontologique de l’individuation » que l’individu doit reconnaître quand il pose le problème de son identité personnelle, de même, quand se pose à lui le problème de l’identité collective, il a à reconnaître son histoire comme une condition de son identité. Il ne s’agit pas pour lui d’accepter nécessairement cette histoire, mais de se définir en déclarant, dans ce dont il fait partie, ce qui fait partie de son identité, ce qui exprime ce qu’il est.
[1] Vincent Descombes, La denrée mentale, Paris, Minuit, 1995 ; Les institutions du sens, Paris, Minuit, 1996.
[2] Vincent Descombes, Le complément de sujet, Paris, Gallimard, 2004.
[3] Vincent Descombes, Les dernières nouvelles du moi, Paris, PUF, 2009.
[4] Vincent Descombes, Les embarras de l’identité, op. cit., p. 27 sq.
[5] Id., p. 138.
[6] Id., p. 142.
[7] Id., p. 45 sq.
[8] Id., p. 174 sq.
[9] Id., p. 169 sq.
[10] Id., p. 203 sq.
[11] Id., p. 56.
[12] Id., p. 57.
[13] Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 5.5303, cité par l’auteur p. 60.
[14] Id., p 76.
[15] Ibid.
[16] Id., p. 77.
[17] Id., p. 86.
[18] Id., p. 130.
[19] Id., p. 168.
[20] Id., p. 170-171.
[21] Id., p. 252.