Recension – Le consumérisme à travers ses objets. Gobelets, vitrines, mouchoirs, smartphones et déodorants
Jérémy Ollivier est doctorant en philosophie à l’université de Poitiers et enseigne au lycée Pierre de Coubertin de Calais.
Jeanne Guien, Le consumérisme à travers ses objets. Gobelets, vitrines, mouchoirs, smartphones et déodorants, éd. Divergences, Paris, 2021.
L’ouvrage est disponible ici.
Introduction
Le livre de Jeanne Guien, philosophe française, paru aux éditions Divergences nous propose un exercice d’attention face à des réalités ordinaires que souvent nous ne regardons plus, permettant de saisir les dimensions fondamentales de la culture du consumérisme. Cette culture est matérielle, au sens où elle fait interagir des comportements, des représentations sociales et des artefacts. Cette démarche redonne une épaisseur sociale, historique et politique à un ensemble d’objets quotidiens emblématiques, des objets le plus souvent invisibilisés à travers nos usages et le foisonnement des discours publicitaires (« gobelets jetables », « vitrines », « mouchoirs jetables », « smartphones » et « déodorants »). Chaque objet se voit ainsi dédié un chapitre au sein duquel il est analysé. Cette progression par objet rend les singularités du consumérisme manifestes, mais elle acquiert aussi une portée générale en traçant les traits d’une histoire sociale et matérielle de notre modernité consumériste. Elle approfondit des considérations philosophiques autour du devenir incertain de ces objets, de leur conception et marchandisation à leur mise au rebut. L’autrice avait fait porter son travail de thèse de doctorat en philosophie en 2019 sur la notion d’« obsolescence » ( Obsolescences : Philosophie des techniques et histoire économique à l’épreuve de la réduction de la durée de vie des objets). Cette publication approfondit son travail précédent autour de la considération philosophique du déchet, s’inscrivant dans l’héritage d’un philosophe comme Günther Anders, auteur de L’obsolescence de l’homme (1956)[1].
La réalité du consumérisme ne peut se saisir qu’à travers une attention portée à ses différents produits. Le projet de l’ouvrage est de lutter contre les puissances du fétichisme, lequel provoque une méconnaissance des objets[2]. Celui-ci tend en effet à « les faire passer pour des choses sans passé, sans histoire, sans effets sociaux » (p.10). Cette invisibilisation de la dimension sociale de l’objet sous l’effet du consumérisme est pourtant, selon l’autrice, inséparable d’un travail de qualification qui engendre un ensemble de discours et de présentations matérielles du produit capable de le « faire exister d’une certaine manière » (p.222). L’objet d’hygiène par exemple prend un caractère jetable via une présentation rendant nécessaire et justifié l’usage unique.
L’introduction éclaire le choix philosophique et méthodologique de l’autrice, son refus de s’en tenir à une simple critique du sujet-consommateur dans le cadre de la société consumériste. Ce dernier terme désigne une société fondamentalement focalisée sur l’achat, « dans laquelle acheter est une norme comportementale (une habitude du quotidien) mais aussi morale (quelque chose de valorisant) » (p.8).
L’étude historicisée des objets rend compte de « la construction » et « la mise en valeur de certaines qualités changeantes » (p.11). La focalisation sur ces qualités socialement construites permet de mieux appréhender la relation entre les contextes des produits et leur valorisation en évitant de s’enfermer dans une typologie anhistorique. L’ouvrage saisit les cheminements complexes et buissonnants des qualifications et requalifications des objets, en interaction avec les évènements historiques et les changements du marché. Il éclaire ainsi le refus de certaines approches théoriques. L’autrice s’oppose entre autres aux approches sémiotiques, à l’instar de celles de François Dagognet ou de Roland Barthes, qui ont la « tentation de réduire toute réalité à un message » (p.12)[3]. En ce sens, la matérialité des objets ne doit pas être réduite à un ensemble de signes. Le passage de la matière aux mots n’a aucune forme d’évidence et rend l’approche contextualisée des situations nécessaire. Plus précisément, la signification des objets renvoie aux luttes concernant leurs qualifications. L’autrice fait ainsi référence à des histoires récentes des techniques qui redonnent une place importance aux controverses[4]. L’apparition de nouveaux objets techniques provoquent un ensemble de tensions, de résistances et de débats au cœur d’une société.
Jeanne Guien récuse aussi les critiques simplificatrices du consumérisme centrées sur la responsabilité de la figure individualisée du consommateur. A l’inverse, la perspective qu’elle choisit d’adopter a l’intérêt de penser les sociétés consuméristes comme « des milieux, qui exercent des contraintes sur le mode de vie de chacun » (p.15). La consommation s’inscrit dans un entremêlement de dispositifs marchands et de prescriptions touchant à nos besoins et à nos attentes. Elle n’est plus le simple rapport d’une marchandise à la conscience individuelle d’un sujet. En complexifiant le propos, il s’agit alors d’envisager pleinement les possibilités de politisation de la consommation au-delà de sa réduction au choix individuel.
Nous suivrons dans cette recension certains des enjeux philosophiques qui apparaissent à travers la présentation de ces cinq objets révélateurs du consumérisme. « Sur la piste des objets » (p. 9), l’autrice fait émerger des réflexions qui dépassent la seule perspective historique et interrogent plus largement notre considération pour la matérialité des produits qui accompagnent notre existence.
Sur la piste des objets
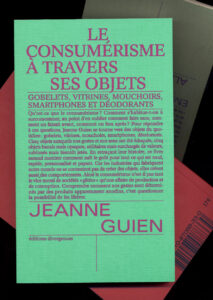 Dans le premier chapitre, l’autrice s’intéresse à l’histoire du gobelet jetable, l’occasion alors d’initier une histoire plus générale du jetable, cette propriété objectale qui est le résultat d’un ensemble de circonstances croisées à un dispositif marchand. L’histoire du gobelet est ainsi inséparable d’innovations techniques telles que l’émergence du plastique, mais aussi de ces requalifications qui accompagnent les stratégies d’ouverture vers de nouveaux marchés. Le gobelet est tantôt un produit d’hygiène, tantôt un produit festif, tantôt enfin un produit du quotidien. La philosophe met en lumière l’interaction entre l’ustensile jetable et la restauration rapide et nous fait saisir la nécessité d’envisager les relations conjointes de la sphère de la production et de celle de la consommation. On remarque alors que le capitalisme se construit à la fois via cette immense accumulation d’objets produits et dans le même temps par une mise au rebut de ces objets. Faisant le lien de l’une à l’autre, le marketing a pour but « la célébration du geste “jeter” » (p.33). La présentation de l’objet par le discours de la publicité produit enfin un oubli des conditions de sa production tout comme de son devenir-déchet. Le discours publicitaire doit justifier la mise au rebut. Le caractère jetable de l’objet devient alors le support de différentes valeurs sociales comme le propre. Ainsi « le propre, c’est qui sort tout juste de l’emballage, comme si l’emballage était le lieu d’émergence première des choses, comme si l’objet n’avait pas eu d’histoire avant d’arriver dans la main du consommateur qui l’a acheté » (p.41). Le jetable se voit valorisé et il nous fait oublier la présence sensible de l’objet. Cette valorisation doit permettre au consommateur de faire plusieurs activités à la fois et ne pas être arrêté par la pesanteur d’un objet dont il faudrait prendre soin. D’un autre côté, la rhétorique de la mobilité permet d’oublier que cet objet existe après son usage comme un véritable déchet. En somme, il n’existe qu’à travers sa consommation : « Ainsi ce petit objet omniprésent, parce qu’il est toujours en mouvement, semble toujours être une exception, une solution qu’on s’accorde « pour une fois », dans l’urgence, et qu’on oublie aussitôt. » (p.53)
Dans le premier chapitre, l’autrice s’intéresse à l’histoire du gobelet jetable, l’occasion alors d’initier une histoire plus générale du jetable, cette propriété objectale qui est le résultat d’un ensemble de circonstances croisées à un dispositif marchand. L’histoire du gobelet est ainsi inséparable d’innovations techniques telles que l’émergence du plastique, mais aussi de ces requalifications qui accompagnent les stratégies d’ouverture vers de nouveaux marchés. Le gobelet est tantôt un produit d’hygiène, tantôt un produit festif, tantôt enfin un produit du quotidien. La philosophe met en lumière l’interaction entre l’ustensile jetable et la restauration rapide et nous fait saisir la nécessité d’envisager les relations conjointes de la sphère de la production et de celle de la consommation. On remarque alors que le capitalisme se construit à la fois via cette immense accumulation d’objets produits et dans le même temps par une mise au rebut de ces objets. Faisant le lien de l’une à l’autre, le marketing a pour but « la célébration du geste “jeter” » (p.33). La présentation de l’objet par le discours de la publicité produit enfin un oubli des conditions de sa production tout comme de son devenir-déchet. Le discours publicitaire doit justifier la mise au rebut. Le caractère jetable de l’objet devient alors le support de différentes valeurs sociales comme le propre. Ainsi « le propre, c’est qui sort tout juste de l’emballage, comme si l’emballage était le lieu d’émergence première des choses, comme si l’objet n’avait pas eu d’histoire avant d’arriver dans la main du consommateur qui l’a acheté » (p.41). Le jetable se voit valorisé et il nous fait oublier la présence sensible de l’objet. Cette valorisation doit permettre au consommateur de faire plusieurs activités à la fois et ne pas être arrêté par la pesanteur d’un objet dont il faudrait prendre soin. D’un autre côté, la rhétorique de la mobilité permet d’oublier que cet objet existe après son usage comme un véritable déchet. En somme, il n’existe qu’à travers sa consommation : « Ainsi ce petit objet omniprésent, parce qu’il est toujours en mouvement, semble toujours être une exception, une solution qu’on s’accorde « pour une fois », dans l’urgence, et qu’on oublie aussitôt. » (p.53)
Le chapitre 2 s’interroge sur l’histoire de la vitrine en tant que dispositif marchand. Ce choix a pour vertu de nous montrer en quoi la vitrine est un médium qui par sa transparence peut se faire oublier. En visibilisant la vitrine, l’autrice nous présente aussi la manière dont cet objet s’inscrit en réalité dans des formes de luttes de classes. L’objet-vitrine porte cette promesse de « prétention à la dilapidation générale de la lumière », mais « on assiste en fait à une répartition classiste de l’éclairage » (p.68). L’éclairage marchand ne s’adresse pas à tous de la même manière, il permet la mise en valeur de la marchandise pour une clientèle choisie et s’absente des coulisses besogneuses des grands magasins. L’historicisation de la vitrine permet donc de l’inscrire dans des rapports de pouvoir où chaque sujet n’occupe pas la même place face à l’usage et à la jouissance de l’objet. La considération esthétique des effets de l’objet ne peut alors pas être séparée d’une prise en compte des effets sociaux de la présence matérielle de cet objet dans un espace public. L’ouvrage prend ici une dimension plus activiste et donne une place aux phénomènes de destruction (comme la vitre brisée) des dispositifs marchands, dépassant les visions simplificatrices de la violence matérielle. Les vitrines font ainsi « l’objet d’une appropriation par les mouvements sociaux, qui les placent au cœur de “techniques de lutte” variées » (p.85). Le sujet qui vit dans le milieu consumériste n’est plus seulement qualifié par une forme de passivité. Il est un sujet qui peut à la fois disqualifier et requalifier des objets. L’objet apparaît lui-même comme ambivalent car il est à la fois un dispositif marchand et un support potentiel de politisation : « la vitrine génère des rapports de forces, et peut devenir l’outil de leur remise en question. » (p.98).
Au chapitre 3, l’autrice nous guide à travers l’histoire de longue durée du mouchoir jetable. A rebours du peu de considération que nous avons pour lui, il est ici considéré comme « un objet total » (p.99), en relation avec les différentes dimensions de notre existence. En effet, cet élément du quotidien qui entre en interaction avec le corps produit une forme de discipline et un certain nombre de gestes et d’attitudes. Jeanne Guien évoque entre autres les diverses « régulations de pratique du mouchage » (p. 107) et les différences d’usage suivant les classes sociales. Le mouchoir est l’occasion de découvrir une histoire longue des qualifications et requalifications d’un objet. La fin de ce chapitre s’attarde alors sur deux problèmes. D’une part, l’objet jetable est porteur d’une certaine idéologie que Guien nomme « utopisme du déchet », soit « le fait de croire (ou de faire croire) que mettre dans une poubelle quelque chose la fait disparaître ou la neutralise, pour toujours » (p.139). Cette croyance fait s’évanouir l’existence sensible de l’objet jeté et provoque de ce fait l’invisibilisation sociale de ceux qui travaillent avec les déchets. Les qualifications sociales de l’objet consumériste ont encore une fois partie liée avec diverses formes d’exploitation des travailleur.ses. D’autre part, l’autrice soulève un problème quant à l’histoire sociale et matérielle du consumérisme : l’histoire des objets, comme le mouchoir, est « obscurcie par une réécriture permanente ». Par exemple, « les fabricants de papiers sanitaires jetables se révèlent champions dans la réécriture de leur propre histoire, dans la récupération et la distorsion de certaine notions (innovation, zéro déchet, calcul d’impact…) » (p.141). L’ouvrage montre l’intérêt d’un contre-récit critique à même de disqualifier les présentations du marketing et de s’inscrire dans un mouvement plus large de mise en lumière des effets du consumérisme.
Le chapitre 4 s’attache à décrire l’émergence du smartphone et son essor extrêmement rapide. La difficulté de ce chapitre est celle de se mesurer à « un temps très court, et particulièrement dense en discours » (p.142). A cette occasion, Guien montre comment l’action sur notre perception du temps est une dimension fondamentale du consumérisme. L’autrice saisit cette difficulté de produire une typologie figée des formes d’obsolescences. Dès lors, il s’agit de cerner l’obsolescence comme le produit dynamique d’une histoire sociale, un phénomène qui traverse l’ensemble de la production, plutôt que comme une propriété concernant seulement des produits spécifiques. Le milieu consumériste s’appuie donc sur un véritable « marketing du temps » (p.170). Le caractère obsolescent du produit dépend d’industries qui « parviennent à produire une esthétique du renouvellement : à rendre sensible et désirable le renouvellement des modèles à travers le temps » (p.164). Le produit n’est pas dépassé par une usure matérielle, mais il est présenté comme dépassé par rapport aux innovations d’un produit concurrent. Après l’étude des obsolescences techniques et psychologiques, l’autrice prend le temps d’étudier « l’obsolescence humaine », au cœur du monde de la production, dans la lignée des travaux d’Anders et de Bauman mais aussi à partir des témoignages de travailleur.ses du secteur de la technologie[5]. La souffrance de la production révèle crûment la distinction entre les discours marketings de qualification des objets et les situations disqualifiantes et insupportables du travail humain. Ainsi « tandis que les marques célèbrent la vitesse et l’innovation, les travailleuses se voient voler leur temps, enfermées dans un cercle de répétition littéralement infernal » (p.178).
Dans le dernier chapitre de son ouvrage, Jeanne Guien cherche à saisir, à travers l’exemple du déodorant, la relation entre un produit et le genre. Le déodorant, par son contact avec la peau, s’adresse tout autant à l’intime qu’à nos rapports publics aux autres et au monde. En s’intéressant au « rôle de la différence des genres dans la qualification des produits de beauté » (p.184), l’autrice montre que le marketing produit un certain rapport du sujet à lui-même. Elle évoque ainsi l’usage de « campagnes de la honte » destinées au marché féminin, créant « une gêne psychique là où il n’y avait pas de gêne physique » (p.191). L’ensemble des qualifications attachées à un objet débouche sur une « définition publicitaire du corps socialement acceptable » (p.206). Ce chapitre a le mérite de montrer à partir d’un objet quotidien la puissance d’incorporation des normes à travers le jeu des qualifications consuméristes. Les images publicitaires travaillent en profondeur notre subjectivité. Et l’autrice fait surgir la densité historique et politique de nos ustensiles les plus quotidiens.
Perspectives politiques
La conclusion de l’ouvrage réfléchit rétrospectivement à la portée des stratégies anticonsuméristes en considérant les impasses et les ressources d’un « vaste appel au boycott » (p.212). Alors que le boycott, acte individuel désigné comme « abstentionnisme économique », semble avoir une portée limitée, il peut aussi se « socialiser pour devenir politiquement significatif » (p.217). L’objectif du livre est alors bien de nous montrer que la réorganisation de la production et de la consommation est une affaire collective qui doit s’attacher à repenser nos manières de faire communauté contre, par et avec les objets. A ce titre, les histoires conçues au fil des objets nous laissent entrevoir d’autres avenirs en nous permettant de comprendre la contingence de nos relations aux produits quotidiens. Ce désir d’alternatives se renforce encore par l’enquête que propose l’ouvrage, laquelle a pour but, selon les mots de l’autrice, « d’attirer l’attention sur ce que certains fabricants, distributeurs et communicants font au monde au moyen de discours mais aussi par l’interaction silencieuse des choses matérielles » (p.222).
Cet ouvrage propose avec une grande pertinence de reconsidérer des objets techniques au cœur de nos actes ordinaires de consommation. C’est là une perspective originale dans la mesure où ces objets échappent le plus souvent au discours philosophique. En outre, la généalogie des objets jetables permet de modérer le désir de généralisation philosophique par la prise en compte des contextes sociaux, matériels et techniques. L’autrice nous donne in fine à penser des articulations heuristiques entre une histoire sociale des objets et une philosophie de la production et de la consommation. Ici, la consommation a le mérite d’être pensée comme un acte éminemment politique et collectif.
Bibliographie indicative
ANDERS Günther, L’obsolescence de l’homme : Sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution industrielle, éd. Encyclopédie des nuisances, Paris, 2002
BARTHES Roland, Mythologies, éd. Seuil, Paris, 1957
BAUMAN Zygmunt, Vies perdues : la modernité et ses exclus, éd. Payot, Paris, 2012
DAGOGNET François, Eloge de l’objet, éd.Vrin, Paris, 1989
JARRIGUE François, Technocritiques ; Du refus des machines à la contestation des technosciences, Paris, La découverte, 2016
MARX Karl, Le capital. Critique de l’économie politique, I, éd. PUF, Paris, 2006
YANG, CHAN Jenny, LIZHI Xu, La machine est ton seigneur et ton maitre, éd. Agone, Marseille, 2015
[1] Günther Anders, L’obsolescence de l’homme : Sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution industrielle, éd. Encyclopédie des nuisances, Paris, 2002
[2] L’autrice fonde son propos sur la référence à Marx et son analyse du fétichisme de la marchandise. Voir Karl Marx, Le capital. Critique de l’économie politique, I, éd. PUF, Paris, 2006, p94-95.
[3] Elle fait plus précisément référence à François Dagognet, Éloge de l’objet, éd.Vrin, Paris, 1989 ; et à Roland Barthes, Mythologies, éd. Seuil, Paris, 1957
[4] On peut citer entre autres ouvrages celui de François Jarrige : Technocritiques ; Du refus des machines à la contestation des technosciences, Paris, La découverte, 2016
[5] On peut ici se référer à Zygmunt Bauman, Vies perdues : la modernité et ses exclus, éd. Payot, Paris, 2012 et Yang, Jenny Chan, Xu Lizhi, La machine est ton seigneur et ton maître, éd. Agone, Marseille, 2015














