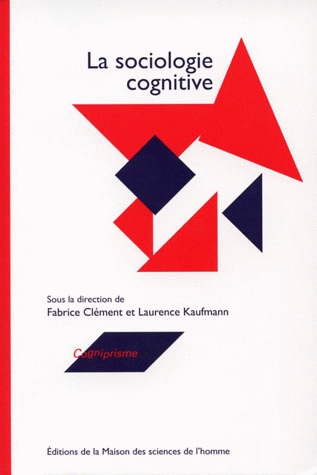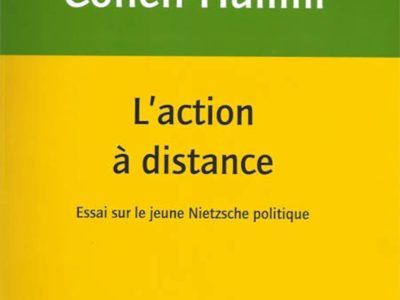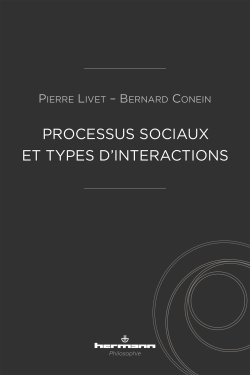Recension – la sociologie cognitive
Compte-rendu de F. Clément et L. Kaufmann (dir.), La sociologie cognitive, Paris, éd. de la MSH, 2011.
Sébastien Urbanski, ATER à l’ISPEF de l’Université Lyon 2 et Chercheur associé au laboratoire Education, Cultures, Politiques (Lyon 2/IFE/ENS/Univ. St-Etienne)
L’ouvrage est composé de trois parties et rassemble douze contributions. Les approches cognitives du social (1° partie) insistent sur la délimitation naturelle et matérielle de l’esprit, par exemple sur les frontières physiques du cerveau. Le social viendrait alors « remplir » ces éléments naturels. Dans cette perspective, « l’esprit ne peut être social qu’a posteriori » (p. 16), d’où la méfiance de nombreux sociologues envers ce type d’approche qui pourrait sembler reléguer la sociologie au second plan, en donnant à la psychologie voire à la biologie un rôle de premier plan. Selon les approches sociales de l’esprit au contraire (2° partie), l’esprit n’est pas localisé dans « les mécanismes cognitifs du sujet individuel » mais dans « l’ensemble des significations communes qui forme un principe d’ordre supérieur à partir duquel les actions et les pensées apparemment personnelles sont élaborées et différenciées » (p. 17). Enfin, les approches de la cognition sociale (3° partie) montrent que la cognition n’est pas confinée dans le cerveau, ne serait-ce que parce que certaines tâches compliquées nécessitent une division cognitive du travail forcément basée sur une organisation sociale.
Trois contributions illustrent l’approche cognitive du social. Celle de Raymond Boudon décline différents idéaux-types de rationalité et évalue leur pertinence. Le postulat de rationalité utilitariste permet de fournir des explications claires, dans les cas où le postulat de l’égoïsme est réaliste. Par exemple, il est réaliste de dire qu’un gouvernement est égoïste, dans la mesure où tout gouvernement considère « en priorité les intérêts de la nation dont il a la charge » (p. 51). Dès lors, le postulat de rationalité utilitariste permet d’expliquer un phénomène tel que la course aux armements entre les USA et l’URSS, et par suite l’effondrement brutal de l’URSS. Cependant, le postulat de l’égoïsme n’est pas réaliste quand on a affaire à des comportements dictés par des croyances non-triviales. Certes, l’adhésion à une théorie scientifique pourrait s’expliquer, par exemple, par la « facilité » de la défendre. Mais dès que l’on cherche à comprendre pourquoi telle théorie est plus « facile » (ou moins « coûteuse ») à défendre qu’une autre, il est nécessaire d’abandonner le cadre étroit de l’utilitarisme : si la théorie du baromètre de Toricelli-Pascal est plus facile à défendre, c’est notamment parce qu’« elle n’introduit pas l’idée anthropomorphique douteuse selon laquelle la nature aurait horreur du vide » (p. 53). La fin de la contribution suggère que les neurosciences, en confirmant la conception « non-utilitariste » du sujet social, ne sont pas forcément les ennemies de la sociologie : « dans certaines situations, le sujet ne se comporte selon les axiomes de la théorie utilitariste de la rationalité que si l’activité normale de son cerveau est partiellement neutralisée » (p. 72). Ainsi, les neurosciences montrent que l’individu est naturellement non-utilitariste – ce qui va dans le sens de ce que disent la plupart des sociologues, récusant le postulat utilitariste.
La contribution de Gérald Bronner a pour ambition de définir un espace de travail sociologique qui, d’une part, ne se diluerait pas dans les sciences cognitives, et d’autre part ne resterait pas aveugle aux avancées de ces dernières. Le cas de la paréidolie est exemplaire. La paréidolie – « une illusion fondée sur la mauvaise interprétation d’un stimulus vague ou imprécis conçu comme un signe clair et distinct » – se manifeste par la reconnaissance de visages dans des nuages, des tâches, etc. Il arrive que ce réflexe mental donne lieu à des croyances collectives : « c’est ainsi qu’à Houston, aux Etats-Unis, des gens se sont prosternés devant les restes d’une crème glacée, prétendant voir une apparition de la Vierge » (p. 80). Or la paréidolie est très probablement une capacité héritée phylogénétiquement : « cette capacité à imaginer le pire [notamment des visages de prédateurs] était une garantie de survie dans un environnement très hostile » (p. 80). Bronner propose alors d’identifier les variables sociales qui s’hybrident avec cet invariant naturel. En effet, on ne saurait en rester à l’explication strictement naturaliste, car comment comprendre que les hispanophones (majoritairement catholiques) aient été plus nombreux que les anglophones (majoritairement protestants) à se prosterner devant la crème glacée? De façon similaire, un individu peut avoir des raisons de croire que l’apparition d’une sorte de visage (celui de Satan, diront certains) dans les fumées du World Trade Center n’est pas due au hasard. En effet, n’y a-t-il pas forcément une intention au principe d’un évènement aussi surprenant ? Pourtant, cette « apparition » est bien due au hasard, combiné à l’invariant naturel qu’est la tendance à la paréidolie: « l’effondrement des Twin Towers a produit des milliers d’images (…) ; il était donc probable que parmi certaines de ces images, les volutes de fumée (…) dessinent des formes furtives prêtes à être interprétées » (p. 84).
La contribution de Fabrice Clément a pour but de d’expliciter la conception des « liens entre les phénomènes psychiques et les phénomènes sociaux » (p. 109) chez les sociologues classiques et contemporains. Certaines travaux sociologiques contribueraient en effet à mettre en évidence une « strate représentationnelle de l’esprit ». Pour Weber et Pareto, la causalité sociologique va de l’intérieur vers l’extérieur, c’est-à-dire de ce qui est « psychique » vers ce qui est proprement « social ». Mais Pareto conçoit la sociologie comme dépendante de la psychologie, alors que Weber envisage au contraire la sociologie comme étant indépendante de la psychologie. Pour Durkheim et Tarde, la causalité sociologique va de l’extérieur vers l’intérieur, c’est-à-dire de « l’environnement socioculturel » vers « les états mentaux ». Mais Tarde conçoit la sociologie comme dépendante de la psychologie, dans la mesure où les phénomènes sociaux se « résol[veraient] en croyances et désirs » (p. 107) ; tandis que chez Durkheim, l’existence sui generis des représentations collectives tend à faire de la sociologie une discipline indépendante de la psychologie. L’auteur discute alors les conceptions du fonctionnement de l’esprit humain chez Boudon et Bourdieu. Malgré des différences énormes entre ces deux auteurs, Clément note qu’ils se rejoignent quand ils suggèrent l’ancrage biologique des mécanismes sociologiques. L’esprit socialisé (à la Bourdieu) reposerait sur l’acquisition d’ « abrégés décisionnels » généralement inconscients et fonctionnant « comme des structures de connaissance qui permettent à partir de la détection d’éléments du contexte jugés similaires à des situations rencontrées dans le passé, d’inférer (…) la suite des évènements » (p. 123). Quant à l’esprit réflexif (à la Boudon), il aurait également été sélectionné au cours de l’évolution de l’espèce, car avoir à disposition un « ‘espace de travail’ où il est possible de manipuler mentalement des contenus mentaux » (p. 124) procurerait des avantages adaptatifs.
Cinq contributions illustrent l’approche sociale de l’esprit. Celle de Bernard Lahire s’appuie d’abord sur une expérience de pensée de Hume, selon laquelle un homme placé face à deux boules de billard sur le point de s’entrechoquer ne peut être « capable d’inférer le mouvement de la seconde boule du mouvement et de l’impulsion de la première » (p. 139) que s’il a déjà fait l’expérience passée de deux boules de billard s’entrechoquant. Ce type de situation est transposé aux situations sociales : « Il suffit de remplacer l’exemple des boules de billard en interaction (…) par des situations proprement sociales » pour comprendre que les propriétés de la situation sociale ne peuvent que se croiser avec les propriétés incorporées de l’acteur. Le but est alors de se tenir à distance d’un trop grand contextualisme accordant trop de poids à la situation (les boules de billard s’entrechoquant) et pas assez au passé (l’expérience antérieure de boules de billard s’entrechoquant). Les sociologies de Boltanski ou Boudon, jugées trop contextualistes, sont ici critiquées. L’usage répété du langage donne forme à ce que l’auteur appelle des « schèmes cognitifs », confortés par des dispositifs institutionnels : par exemple, divers colloques organisés sur le thème de « l’illettrisme » conduisent leurs participants à « contracte[r] (…) des habitudes discursives » (p. 154) consistant notamment à associer « illettrisme » et « dangerosité » (p. 155). C’est ainsi que l’auteur développe une sociologie à la fois dispositionnaliste et contextualiste de la cognition.
La contribution d’Asia Friedman commence par une remise en question de la « théorie naïve » de la perception selon laquelle « ce que nous percevons est un exact reflet de la réalité empirique » (p. 163). Malinowski avait déjà observé que « les Trobriandais percevaient que les enfants ressemblaient à leur père, là où il leur trouvait une ressemblance plus marquée à leur mère » (p. 161). Dans un second temps, Friedman propose une voie permettant d’échapper au fondationnalisme, qui tend à nier l’idée de construction sociale, aussi bien qu’à l’anti-fondationnalisme qui tend à nier l’idée de réalité biologique. Cette voie consiste à utiliser les concepts d’ « attention sélective » et de « filtre », plus acceptables que les concepts d’ « habitus » ou « paradigme ». Un avantage du premier groupe de concepts est de maintenir clairement l’idée d’une « importante quantité de données potentiellement perceptibles qui, parce qu’elle est bloquée par le filtre, n’accède généralement pas à notre conscience » (p. 175). Ainsi, il existe une réalité hors de ce qui est perçu, même s’il n’existe pas de perception sans filtre puisqu’il faut bien être inattentif à certains stimuli pour être pouvoir être attentif à d’autres. Ces principes théoriques sont mis à l’épreuve via l’exemple de l’attribution ordinaire des catégories de genre : les membres de telle culture attribuent une catégorie de genre sur la base des poils du visage, tandis que les membres d’une autre culture n’y prêtent pas attention. Mais il existe aussi des normes perceptuelles « hégémoniques » : les enfants, dès qu’ils apprennent à parler, ne peuvent « faire référence ou s’adresser à une personne sans déterminer en premier lieu son genre » (p. 182) – cf. le système des pronoms.
La contribution de Bernard Conein pose la question de savoir si la classification des objets naturels est du même type que la classification des personnes. Pour Durkheim et Lévi-Strauss, les classifications sont un « mode de pensée » ou un « mode de connaissance ». Or, pour la psychologie cognitive, la classification est une tâche de reconnaissance – appelée catégorisation – qui est moins liée à la connaissance qu’à la perception. Classifier, c’est par exemple mobiliser, au premier coup d’œil, la catégorie perceptuelle chien en présence d’un chien (alors que d’autres catégories, par exemple animal, sont disponibles). Sacks tente de transposer ce type d’analyse, valable pour les objets visuels, au cas des « objets sociaux » tels les personnes. Le problème est qu’il est souvent impossible « de relier directement un concept social à une personne » (p. 200), notamment parce que dire de quelqu’un qu’il est, par exemple, « alpiniste », c’est décrire cette personne « en fonction des buts ou des actions qu’elle accomplit » (p. 200). Pour résoudre cette difficulté, Conein mobilise les travaux de Schegloff, qui montre que l’usage d’un terme catégoriel n’implique pas forcément une catégorisation. Par exemple, dans la phrase « there is a woman in my class who is a nurse », le mot nurse sert « à faire référence à quelqu’un de singulier en attirant l’attention sur lui en tant qu’individu » (p. 204). Ainsi, « désigner quelqu’un au moyen d’une description qui contient un nom de groupe comme nurse ne veut (…) pas dire automatiquement le classifier » (p. 206). Plus généralement, dans les conversations, les références identifiantes sont plus fréquentes que les descriptions classifiantes. C’est que l’acquisition d’informations singularisantes est le moyen privilégié de la construction des relations sociales, comme on le voit bien dans le cas des anecdotes et du commérage, qui permettent « d’accroitre la connectivité interpersonnelle au sein des réseaux » (p. 211).
La contribution de Louis Quéré a pour but de différencier deux types d’erreurs dans la cognition sociale. Nous pouvons nous tromper suite à la non-application d’un principe, d’une règle, ou d’un procédé que nous sommes supposés connaitre et être en mesure d’appliquer. Mais on peut également se tromper « faute de (…) pouvoir connaitre, au moment d’agir, la conduite correcte » (p. 220). D’où une distinction entre erreur-error et erreur-mistake : il y a error quand l’ignorance était difficilement évitable, et mistake quand la règle ou la procédure – donc la manière correcte de faire – était supposée connue. L’action sociale a éminemment partie liée avec l’erreur-error : en effet, il arrive quotidiennement que nous engagions « un cours d’action dont on ne peut pas savoir, à l’avance, s’il convient ou non à la situation » (p. 223). De plus, l’action sociale est souvent moins affaire de conformation à des règles que de savoir-faire et de perspicacité. Par exemple, la transsexuelle Agnès décrite par Garfinkel était « en permanence exposée à commettre des erreurs de comportement qui risquaient de révéler ce qu’elle était, et ce qu’elle avait été, et, par là, de provoquer une dégradation de son identité » (p. 240). Une personne « normale » ne manifestant pas assez les signes de son identité sexuelle pourrait être blâmée ; mais si l’on prend en compte la situation d’apprentissage dans laquelle se trouve Agnès, on ne peut parler que d’erreur-error. L’auteur soutient qu’il n’est pas possible de définir un « élément de réalité » à l’aune duquel des erreurs-mistakes sociales puissent se produire : les personnes sont toujours susceptibles d’être, dans une certaine mesure, en situation de « transit socio-culturel » (p. 238) et ne peuvent donc commettre, quand ils se trompent, que des erreurs sociales de type error.
La contribution de Cyril Lemieux propose une voie permettant de renouveler la sociologie des épreuves de Callon/Latour et Boltanski/Thévenot. D’abord, une définition des notions d’épreuve et d’objet est donnée. Il y a épreuve dans « toute situation au cours de laquelle les acteurs font l’expérience de la vulnérabilité de l’ordre social » (p. 251). Par exemple, un « plat qui se révèle avoir un léger goût de brûlé » (p. 252) pourra amener des acteurs à remettre en question la réputation du restaurant, qui sera « mise à l’épreuve ». Quant aux objets, ils servent à orienter l’action sociale : la présence de certains objets rend « plus probable la survenue d’actions et de jugements d’un certain type » (p. 257). La cognition est donc envisagée comme ayant une forte dimension matérielle. L’auteur s’applique alors à infléchir ce cadre théorique de façon à ce qu’il 1/. rende mieux compte des dispositions ; 2/. permette la prévision ; 3/. puisse être compatible avec une approche critique. En fait, selon Lemieux, toutes ces tâches ont été occultées par Callon/Latour et Boltanski/Thévenot pour des raisons conjoncturelles, en réaction à la sociologie hyper-critique de Bourdieu. Toutefois, en ce qui concerne l’idée de disposition, Lemieux ne plaide pas pour un retour à l’idée bourdieusienne d’habitus. La notion de « tendances à agir » est préférée en ce qu’elle permet de reconnaître « des élans et des attentes » qui sont « à chaque fois différents » (p. 267), ne serait-ce que parce que les objets sur lesquels s’appuie l’action changent constamment. A propos de la prévision, c’est encore les « objets » qui sont convoqués : par exemple « pouvons-nous prévoir que les membres d’une commission d’attribution du RMI qui formulent (…) des jugements péremptoires sur la faiblesse de volonté (…) du candidat, auraient de grandes chances de faire effort pour se censurer s’ils étaient en leur présence ou s’ils s’exprimaient devant des tiers ou des caméras de télévision » (p. 266). Enfin, en ce qui concerne la critique, elle demeure possible notamment 1/. si elle se reconnaît comme telle ; 2/. si elle renonce à l’idéalisme « en admettant l’importance de la matérialité des appuis que les personnes trouvent, ou ne trouvent pas, pour former leurs jugements » (p. 271) ; 3/. si elle porte sur des dispositifs matériels et non sur des individus.
Trois contributions développent une approche de la cognition sociale. Celle de Christophe Heintz montre que les processus cognitifs, généralement définis comme étant « dans la tête », peuvent être analysés comme s’appuyant sur « des produits culturels, des artefacts techniques ou des rapports sociaux » (p. 277). La cognition serait alors « distribuée » au sein d’organisations sociales marquées par une division du travail cognitif. Un exemple-type est emprunté à Hutchins. Les membres d’un équipage veulent déterminer où se situe leur navire. Deux matelots « situés de chaque côté du bateau doivent chacun mesurer l’angle que fait par rapport au nord la ligne passant par le bateau et un point de repère sur la côte. Cette mesure se fait en manipulant un outil – l’alidade – (…) [qui] produit une représentation – un nombre » (p. 282). Ce nombre est ensuite communiqué au navigateur qui manipule une règle permettant de tracer une droite qui elle-même permet de localiser le bateau. Le traitement de l’information est bien ici social. Pour autant, l’analyse de « ce qui se passe dans la tête des agents » (p. 285) ne saurait être évacuée. En effet, les processus cognitifs opérés par les humains forment « des maillons dans les chaînes cognitives qui produisent le résultat final » (p. 286). La psychologie permet de comprendre pourquoi tel outil et telle organisation sociale permettent de maximiser les capacités du cerveau. Ainsi, le jugement de Latour, selon lequel Hutchins mettrait tous les processus cognitifs « hors de la tête des agents », n’est pas partagé par Heintz. Quant à la sociologie, elle permet de comprendre l’avènement et la persistance des systèmes de cognition distribuée. Par exemple, l’invention d’un outil tel l’ordinateur n’est pas suffisante pour expliquer son utilisation fréquente en mathématiques. Il a fallu que s’opère « un rapprochement (…) entre l’opération logique en mathématiques et les évènements matériaux internes à l’ordinateur » (p. 293), qui ne peut être compris que dans le cadre d’une histoire de la révolution cognitive ayant diffusé l’idée selon laquelle le cerveau est une machine manipulant des symboles.
La contribution de Patrick Pharo vise à intégrer les éléments les moins contestables des théories constructionnistes et naturalistes. Le constructionnisme culturel n’est pas valable, car l’esprit humain n’est pas une « page blanche sur la quelle n’importe quelle histoire culturelle pourrait être arbitrairement écrite » (p. 302). Par ailleurs, certaines régularités sociales sont durablement inscrites dans « des ‘plis’ mentaux, articulés sur des adaptations neurophysiologiques (…), comme par exemple la vision tactique du footballeur » (p. 303). Cela dit, la conception naturaliste a ses limites, notamment parce que l’existence de modules sophistiqués n’éclaire pas bien les comportements sociaux réflexifs, intégrés dans un récit à la première personne permettant de contrôler l’action et d’échapper à certaines contraintes biologiques. L’exemple de l’utilisation de substances psychoactives permet d’éclairer ces points. Le constructionnisme de Becker, selon lequel « le désir [et le plaisir] de fumer [de la marijuana] est engendré par la définition des impressions en termes favorables qui est transmise par les autres » (cité par Pharo, p. 309), est rejeté. On sait en effet que les plaisirs « sont étroitement associés au fonctionnement d’une certaine zone du cerveau » (p. 310), et que le risque de dépendance peut avoir des causes génétiques. Mais le problème du plaisir et des substances psychoactives ne doit pas être « organicisé ». L’interdiction ou l’encouragement à consommer des psychotropes est bien un phénomène socialement construit : dans les sociétés occidentales, l’usage d’alcool est presque encouragé alors que dans le même temps, « une peur grandissante des substances psychoactives (…) conduit à criminaliser toute une série d’usages » (p. 318). Toutefois, ce genre d’interdiction ne saurait être expliqué par des causes exclusivement culturelles, comme par exemple « les tendances conservatrices ou répressives immanentes aux sociétés occidentales » (p. 319), puisque ces dernières tolèrent de toute façon une multitude de pratiques hédoniques.
La contribution d’Aaron Cicourel vise à montrer la continuité des re-descriptions représentationnelles dans l’évolution naturelle et culturelle de l’espèce. Il y aurait notamment des points communs fondamentaux entre la capacité des enfants à produire des récits qui condensent des expériences dépassant leurs capacités sensorielles, et la capacité des adultes à se représenter la réalité sous la forme abstraite de « modèles », par exemple les « modèles démographiques » (p. 329). Ces capacités, dont les primates non-humains seraient également en partie dotés, auraient pour origine les « pressions évolutives liées à l’acquisition et à la transmission des connaissances anciennes et nouvelles pour survivre dans des habitats très diversifiés » (p. 327). S’appuyant sur Tomasello, Cicourel affirme que la culture dérive d’un triple processus. D’abord – phylogénétiquement – les humains ont appris à concevoir leurs congénères comme des êtres intentionnels munis d’états mentaux ; puis – historiquement – l’attribution d’états mentaux « amène la constitution d’artefacts culturels » (p. 328) ; enfin – ontogénétiquement –, « les enfants grandissent en étant environnés de ces artefacts (p. 328). L’auteur pose alors la question des re-descriptions représentationnelles produites par les activités de recherche en sciences sociales. Selon lui, les chercheurs ont tendance à produire des récits qui « ignorent la nature située des processus sociaux observables » (p. 333) et négligent les récits quotidiens que les acteurs sociaux eux-mêmes produisent. L’objectif est dès lors de préciser les conditions d’émergence de ces récits en général. Les récits « savants » deviennent donc eux-mêmes objets d’analyse, notamment quand ils « autovalident l’existence de structures sociales » (p. 343), comme c’est le cas pour les « catégories démographiques utiles pour la gestion de l’État » (p. 343). En somme, il s’agit de placer sur un même continuum les méthodes de traitement propres aux primates (dimension phylogénétique), celles propres aux enfants (dimension ontogénétique) et celles acquises à l’âge adulte à partir d’artefacts culturels.
La contribution « conclusive » de Fabrice Clément et Laurence Kaufmann montre que si la sociologie peut faire appel aux sciences cognitives, l’inverse est également vrai : « les autres disciplines qui tentent actuellement de rendre compte des comportements humains ressentent de plus en plus clairement le besoin de faire appel à la sociologie » (p. 355). Par exemple, selon l’hypothèse biologique du « cerveau social », les contraintes sociales ont été plus sélectives que les contraintes posées par l’environnement physique. Un indice allant dans ce sens est que « la taille relative du néocortex des primates [est] corrélée à la taille de leur groupe social » (p. 356). Cette pression sélective aurait donné émergence à des modules destinés à traiter les informations socialement pertinentes (identification de la hiérarchie, etc.). De façon similaire, sur le plan ontogénétique, il y aurait un lien entre l’origine sociale des enfants et le degré de spécialisation de la région cérébrale incluant « l’aire de Broca, essentielle dans la production des mots » (p. 357). Les auteurs proposent de nommer neurosociologie la discipline – ou plutôt l’hybride disciplinaire – qui pourrait saisir les implications de ce genre d’études. Mais il est important de préciser que la sociologie aurait, dans ce cadre, une place de premier plan, car loin de vouloir réduire le savoir sociologique à un savoir « naturalisé » (biologique), les auteurs suggèrent que les sciences naturelles pourraient se « sociologiser » . En effet, s’il existe « des propriétés de l’environnement social suffisamment stables pour avoir donné prise à la sélection naturelle » (p. 358), alors il faut bien que les sciences cognitives, notamment, empruntent à la sociologie certaines idées sur ces propriétés. Mais de toute façon, une part de la sociologie ne peut a priori pas entrer en dialogue avec les sciences cognitives. En effet, il existe des phénomènes sociaux irréductibles à des faits biologiques ou cognitifs : par exemple, les fictions institutionnelles créées par les humains (la France, Dieu…), bien qu’elles aient un pouvoir causal, sont inexistantes au sens matériel. Ainsi, le dialogue interdisciplinaire proposé par Clément et Kaufmann n’implique « ni un réductionnisme épistémologique, (…) ni un réductionnisme ontologique » (p. 363).
Dans son ensemble, l’ouvrage est très bien organisé, alors que la tâche n’était pas facile, vu l’extrême diversité théorique et disciplinaire des contributeurs : quoi de commun, par exemple, entre d’un côté l’approche théorique et empirique de Lahire, et de l’autre la réflexion épistémologique et spéculative de Heintz ? Réunir dans un même ouvrage douze auteurs aux points de vue parfois très contradictoires n’était sûrement pas évident ; pourtant, à la fin de la lecture, on ressent une cohérence d’ensemble. Sans doute la tripartition, très bien explicitée, entre approches cognitives du social, approches sociales de l’esprit et approches de la cognition sociale y est-elle pour quelque-chose. Certes, certains lecteurs jugeront que le propos général aurait pu être plus ciblé. Mais ce serait au prix de la visée « œcuménique » de l’ouvrage. Néanmoins, on reste un peu surpris par l’absence d’un thème central pour la sociologie cognitive, celui de la cognition de groupe : des groupes peuvent-ils avoir des croyances ? Si oui, alors peuvent-ils raisonner à la manière d’un « moi », etc. ? Cette absence est d’autant plus surprenante que Clément et Kaufmann se sont intéressés à ces questions, notamment via les travaux de Margaret Gilbert.
Enfin, voici quelques questionnements qui se sont posés au fil de la lecture. Le titre de la contribution de Clément, « L’esprit de la sociologie », semble opaque – alors que le sous-titre est explicite (« Les sociologues et le fonctionnement de l’esprit humain »). Plus généralement, dans les titres de sections, l’auteur fait des utilisations très diverses du mot « esprit », ce qui désoriente un peu le lecteur (« Durkheim et l’esprit des représentations collectives » ; « L’esprit des pères fondateurs de la sociologie » ; « Bourdieu et l’esprit aveuglé »…). Dans la contribution de Lahire, la transposition de l’exemple des boules de billard à l’analyse du social est surprenante de la part d’un auteur qui a beaucoup critiqué l’usage sociologique d’exemples décontextualisés. Par ailleurs, Lahire semble prendre pour acquis que le passé des acteurs n’est que dispositionnel ; pourtant, l’acquisition passée d’informations non-dispositionnelles et non sédimentées en dispositions fait aussi, par définition, partie du passé. Dans la contribution de Friedman, de nombreux exemples de « sous-cultures perceptuelles » ne sont pas très convaincants : le dermatologue ou l’orthodontiste voient-ils ce qu’ils voient en fonction de leur « sous-culture » ou plus prosaïquement en raison de leur formation professionnelle ? La contribution de Lemieux est très programmatique et offre peu d’exemples ; par ailleurs, l’utilisation du vocabulaire de Boltanski/Thévenot semble parfois forcée : par exemple, pourquoi écrire que la sociologie critique doit se « déployer dans le régime d’engagement le plus ajusté à l’activité critique – à savoir celui de la critique et de la justification publique » (p. 271) ? Ne suffirait-il pas de dire que les résultats de la sociologie critique doivent être justifiés ? Enfin, la contribution de Cicourel semble suggérer, d’une part que les modèles théoriques issus des sciences sociales sont quasiment toujours trompeurs, et d’autre part que seule l’analyse des récits de la vie quotidienne (qui seraient « le cœur de la vie sociale ») est valable. Mais on peut très bien expliquer des évènements, éventuellement à l’aide de modèles, sans s’appuyer sur le quotidien des acteurs. Pour cette raison, la méfiance de Cicourel à l’égard de toute analyse ne prenant pas en compte la « vie quotidienne » est sans doute trop grande.