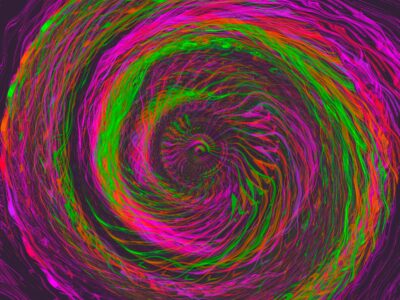Recension – La philosophie comme attitude
Quentin Revol est agrégé de philosophie et doctorant contractuel rattaché au laboratoire SOPHIA-POL (Université Paris Nanterre) depuis septembre 2023. Il mène sous la direction d’Emmanuel Renault une recherche en histoire de la philosophie politique qui entend développer un modèle de critique sociale pragmatiste à partir des figures de Jane Addams et de John Dewey.
Stéphane Madelrieux, La philosophie comme attitude, PUF, 2023
L’ouvrage est disponible ici.
Le livre de Stéphane Madelrieux n’est pas seulement un assemblage rétrospectif d’articles qui permettent à l’auteur de produire un bilan provisoire de ses travaux sur le pragmatisme américain dont il est l’un des meilleurs spécialistes en France [1]. Comme son titre l’indique, le livre est en effet porteur d’un questionnement radical sur le sens de l’activité philosophique que l’académisme est souvent réticent à aborder frontalement.
C’est dans l’introduction et la fin du dernier chapitre (382-409) que l’auteur cherche le plus directement à justifier sa conception de la philosophie comme attitude. Quel sens y a-t-il donc, comme le fait Madelrieux à la suite de Pierre Hadot, à poser le « primat de l’attitude » en philosophie (15) ? Que gagne-t-on à s’intéresser non seulement aux doctrines et aux méthodes des philosophes mais aussi à la manière personnelle dont ils « s’engagent » à travers elles ?
Formellement, le concept d’« attitude » permet de décrire une action autrement qu’en la rapportant aux changements qu’elle effectue dans le monde ou à la « méthode » qu’elle emploie. « L’attitude » renvoie plutôt à l’état d’esprit général de l’agent qui effectue l’action. On peut par exemple distinguer deux joueurs par l’attitude de sérieux ou d’enjouement qui transparaît dans leurs comportements respectifs (9). S’intéresser à l’attitude des philosophes implique donc de les concevoir comme accomplissant des actions spécifiques, leurs doctrines étant autant de « coups effectués dans l’espace philosophique » (10). L’auteur envisage alors une manière qui ne soit pas « doxographique » (18) d’étudier l’histoire de la philosophie qu’il qualifie de « méthode de ‘l’ascension éthique’ » (19). Cette dernière consiste à s’appuyer sur les thèses et méthodes d’un philosophe pour en inférer une certaine attitude ou « manière de penser » caractéristique. Par exemple, réduire le rationalisme à quelques thèses éparses sur le caractère apodictique des principes ou sur la raison comme faculté des idées innées serait passer à côté de ce qu’il y a de réellement important dans le rationalisme, son attitude, qui consiste dans une « foi dans la puissance de l’esprit à pouvoir pénétrer dans l’ordre véritable des choses » (23). Une lecture un peu rapide de l’introduction pourrait trouver quelque cause d’irritation devant ce que l’on peut prendre pour la défense d’une conception esthétisante de la philosophie qui rechercherait dans le « style » (18) propre d’un auteur la trace d’une intuition géniale qu’il chercherait toute sa vie à formuler. La lecture du reste de l’ouvrage tend à démontrer que là n’est pas l’objet du concept d’attitude auquel Madelrieux cherche à donner une extension inédite.
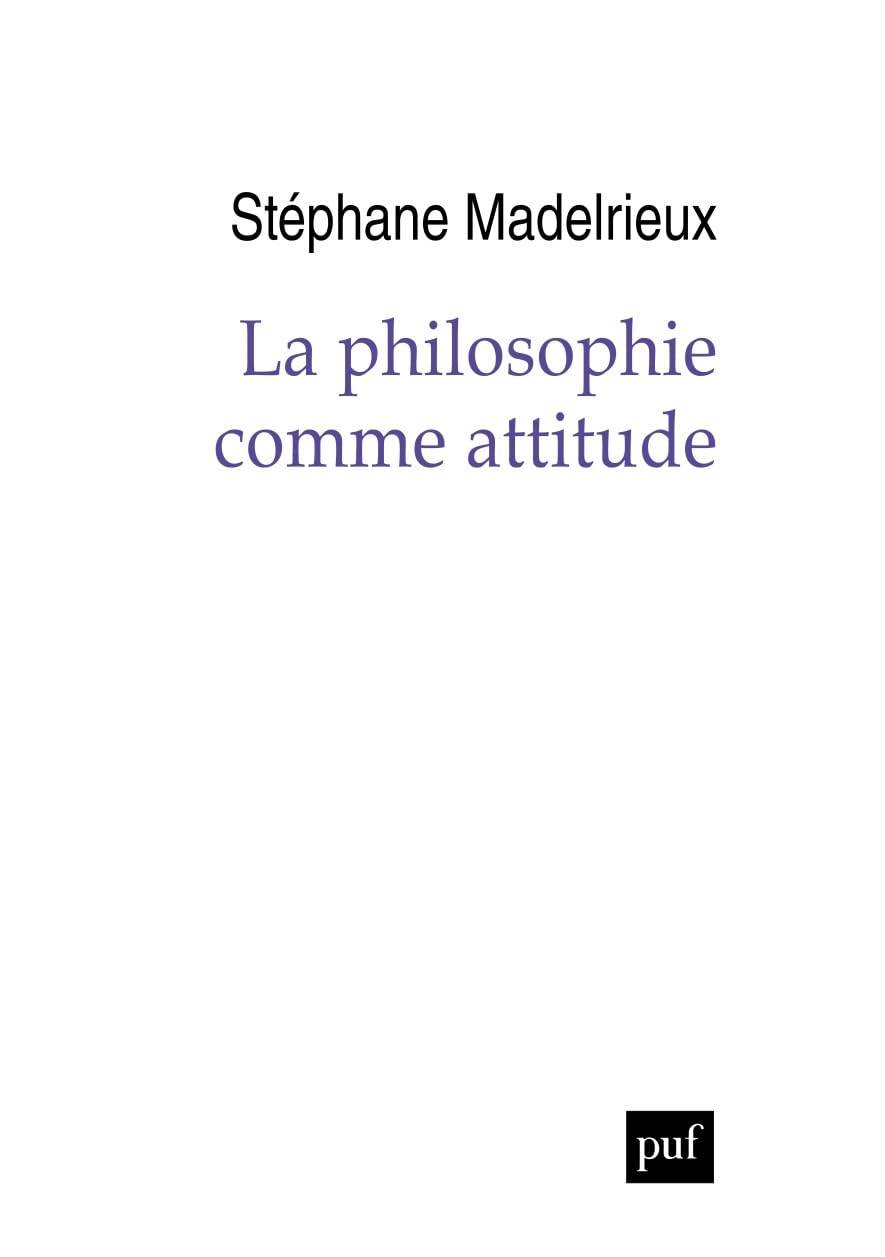 La fin du dernier chapitre fournit une clé permettant de clarifier ce qu’il faut entendre par « attitude ». Madelrieux y explicite la référence à Dewey qui demeure plus implicite dans l’introduction et sur laquelle s’étaye la construction de son propre concept « d’attitude » [2]. L’auteur se réfère notamment à un passage de Démocratie et éducation [3] dans lequel Dewey cherche à expliciter sa propre conception de la philosophie en s’appuyant sur une ré-interprétation des « attributs traditionnels du discours philosophique, dans sa distinction avec le discours scientifique » (391). Dewey, et Madelrieux à sa suite, ne nient pas que la philosophie ait à voir avec la « totalité », « la généralité », le caractère « ultime de la réalité » ainsi qu’avec la « sagesse » consistant à « mettre le savoir au service de la conduite » (391). Mais plutôt que d’être « un savoir de ce tout » qui entrerait en concurrence avec l’activité scientifique et ses résultats, la philosophie serait davantage à concevoir comme une totalisation imaginaire « des différents faits et théories provenant des sciences naturelles et sociales » qui « projette, en passant à la limite dans l’espace comme dans le temps, une image du tout de l’univers comme du tout de l’humanité » (392). Madelrieux peut alors montrer que l’attitude philosophique n’a rien de mystérieux : elle n’est pas une qualité occulte de la conduite ou un je-ne-sais-quoi qui permettrait de qualifier le génie de tel ou tel philosophe consacré de la tradition. Elle relève plutôt d’une disposition qui est à la fois plus « inclusive » et plus « profonde » que nos dispositions ordinaires et qui affecte ces dernières de manière « durable » en nous amenant à aborder d’une certaine façon les problèmes intellectuels qui se posent à nous.
La fin du dernier chapitre fournit une clé permettant de clarifier ce qu’il faut entendre par « attitude ». Madelrieux y explicite la référence à Dewey qui demeure plus implicite dans l’introduction et sur laquelle s’étaye la construction de son propre concept « d’attitude » [2]. L’auteur se réfère notamment à un passage de Démocratie et éducation [3] dans lequel Dewey cherche à expliciter sa propre conception de la philosophie en s’appuyant sur une ré-interprétation des « attributs traditionnels du discours philosophique, dans sa distinction avec le discours scientifique » (391). Dewey, et Madelrieux à sa suite, ne nient pas que la philosophie ait à voir avec la « totalité », « la généralité », le caractère « ultime de la réalité » ainsi qu’avec la « sagesse » consistant à « mettre le savoir au service de la conduite » (391). Mais plutôt que d’être « un savoir de ce tout » qui entrerait en concurrence avec l’activité scientifique et ses résultats, la philosophie serait davantage à concevoir comme une totalisation imaginaire « des différents faits et théories provenant des sciences naturelles et sociales » qui « projette, en passant à la limite dans l’espace comme dans le temps, une image du tout de l’univers comme du tout de l’humanité » (392). Madelrieux peut alors montrer que l’attitude philosophique n’a rien de mystérieux : elle n’est pas une qualité occulte de la conduite ou un je-ne-sais-quoi qui permettrait de qualifier le génie de tel ou tel philosophe consacré de la tradition. Elle relève plutôt d’une disposition qui est à la fois plus « inclusive » et plus « profonde » que nos dispositions ordinaires et qui affecte ces dernières de manière « durable » en nous amenant à aborder d’une certaine façon les problèmes intellectuels qui se posent à nous.
C’est donc à partir du concept pragmatiste d’attitude tel qu’il est élaboré par Dewey à la suite de James que Madelrieux va tenter de produire une analyse du pragmatisme. La circularité entre la méthode employée dans l’ouvrage et son objet est revendiquée par l’auteur. Madelrieux souscrit en effet au « pragmatisme métaphilosophique » (234) de Rorty [4]. Comme le sceptique, le pragmatiste ne croit pas dans l’existence d’un critère « objectif » extérieur à une philosophie et qui permettrait d’en critiquer les prémisses une fois pour toutes. La circularité entre méthode et objet qui caractérise l’ouvrage n’est donc pas un cercle vicieux ; elle est plutôt le résultat d’un légitime travail d’auto-compréhension. En pragmatiste, Madelrieux cherche à extraire du corpus pragmatiste une conception de la philosophie pragmatiste. Toutefois, le pragmatiste, à la différence du sceptique, refuse de se désengager de la conversation philosophique car il voit dans « l’absence de critère neutre et extérieur la possibilité pour la communication de progresser » (237). Le livre doit donc être appréhendé à la fois comme une contribution interne au champ des études pragmatistes sur la bonne manière de concevoir en pragmatiste l’activité philosophique mais bien aussi comme une proposition adressée au reste de la communauté philosophique qui espère sans doute contribuer à la discussion sur les objets et fonctions de la philosophie.
Partant, il est possible de lire la première partie (« L’attitude pragmatiste ») comme un travail généalogique destiné à la fois à montrer comment émerge le concept d’attitude dans la tradition pragmatiste et quel type d’attitude correspond aux pragmatistes. La deuxième partie (« L’esprit critique ») cherche à mettre au travail cette attitude sur des problèmes traditionnels de la philosophie tels que la critique, le concept d’expérience, le pluralisme et, enfin, la religion.
L’un des intérêts de l’ouvrage est d’aborder les principales figures historiques du pragmatisme comme « des figures de transition, qui s’efforcent de dire des choses nouvelles dans un vocabulaire encore ancien, et qui, de ce fait, sont encore pour partie tributaires des manières de penser dont ils s’efforcent de se déprendre » (268) et dont les doctrines ont par conséquent vocation à être critiquées par rapport à l’attitude qu’elles promeuvent par ailleurs. En outre, en proposant d’approcher les auteurs pragmatistes par l’attitude générale qu’ils exhibent plutôt que par un trait de doctrine, comme celui de l’ontologie pluraliste qui a constitué le principal axe de réception du pragmatisme en France au XXè siècle [5], Madelrieux entend renouveler la réception française du pragmatisme états-unien dans une direction qu’il juge plus conforme à l’esprit du pragmatisme lui-même. Madelrieux affirme ainsi clairement dans l’ouvrage une interprétation du pragmatisme fortement inspirée de celle de Richard Rorty qui fait de l’anti-fondationnalisme le cœur de cette philosophie.
Le premier chapitre entend clarifier l’interprétation qu’il convient de donner à l’analyse jamesienne des différences de « tempéraments » philosophiques. Dans Le pragmatisme, il distingue par exemple entre les esprits « coriaces » (tough-minded) qui ont le goût des « faits » et les esprits « délicats » (tender-minded) en quête d’absolu [6]. Contre les interprétations « expressivistes » et « éthologiques » qui tombent respectivement sous le coup de procès en subjectivisme d’une part et en réductionnisme de l’autre, Madelrieux défend l’idée que ces tempéraments doivent être interprétés sous l’aspect d’un « dispositionnalisme logico-éthique » (71-87). James soutiendrait qu’il est possible d’évaluer d’un point de vue logique les différences de tempérament intellectuels en prenant pour pierre de touche leur capacité à rendre possible la croissance de l’expérience. Ainsi ressaisi, le tempérament apparait comme un facteur décisif dans le « processus moral de construction de soi » (87). Ce dernier peut être cultivé ou inhibé réflexivement et ne désigne donc pas une nature rigide à laquelle serait soumise la personnalité de chacun.
Le deuxième chapitre, quant à lui, vise à clarifier le sens qu’il convient de donner à la méthode de « la volonté de croire » présentée par James dans une conférence de 1896, que d’aucuns, comme Bertrand Russell, tiennent pour un sommet d’irrationalisme [7]. Madelrieux rappelle utilement qu’on ne peut pas « vouloir croire », selon James, à n’importe quel sujet mais seulement lorsque nous sommes confrontés à ce que James appelle « des hypothèses vivantes » qui désignent, pour l’agent qui les envisage, une « possibilité réelle » sur la base de laquelle il serait enclin à agir dès lors qu’il consent à la tenir pour vraie (117). James entend soumettre à l’attitude de l’enquête les questions métaphysiques qui se signalent notamment par le fait qu’elles ne sauraient être réglées par le recours à des « preuves empiriques » ou à des « justifications logiques » (103). Pour James, ces dernières demeurent indécidables indépendamment d’un « engagement actif de la part de l’enquêteur » (118). La « foi préalable » dans le libre-arbitre contribue ainsi à « produire les preuves de la validité » de l’hypothèse : « croyez que la vie vaut la peine d’être vécue, et cette croyance même fera une différence dans la conduite de votre vie qui pourra contribuer à la valoriser » (118). Loin de constituer une entorse à l’esprit de l’enquête, « la volonté de croire » de James doit donc être considérée comme une tentative d’extension de la méthode de l’enquête au champ de la métaphysique qui prétendait pouvoir s’y soustraire « en produisant de nouveaux faits » (118) d’une façon qui se veut fidèle à l’attitude de l’expérimentateur.
Le chapitre 3 n’est pas tendre avec Peirce à qui Madelrieux reproche de vouloir donner une « preuve anti-pragmatiste du pragmatisme » (158) en cherchant à fonder la méthode qu’il invente sur une « théorie transcendantale des catégories comme formes a priori de la pensée et de l’expérience » là où, pour Madelrieux, la justification de la « méthode pragmatiste n’a pas d’autre ‘base’ que le progrès possible dans le cours futur de nos pratiques que l’attitude expérimentale qu’elle incarne fait espérer » (158). Le rabougrissement métaphysique que Peirce ferait subir au pragmatisme viendrait in fine de son refus d’étendre l’attitude scientifique au champ de la morale qu’il tient pour un champ hétérogène aux questions scientifiques (139-140).
Au fond, c’est le kantisme de Peirce et le kantisme en général qui est la principale cible de Madelrieux dans la mesure où il tend à instaurer une « métaphysique de l’expérience » qui cherche à en régenter a priori la structure en substituant à l’ancien fondationnalisme « de type substantiel » un fondationnalisme « de type formel » à la faveur d’une « réorientation immanentiste de la métaphysique » qui doit désormais faire l’objet d’une nouvelle critique empiriste (170). L’argument de Madelrieux peut être schématisé de la manière suivante. Si l’on peut observer dans l’expérience des régularités et non un simple chaos ; alors cela devrait être à l’expérience elle-même d’en rendre compte. Or l’empirisme classique serait incapable de le faire car il dispose d’un concept trop pauvre de l’expérience. En effet, ce dernier repose sur une psychologie qui fait concevoir les idées comme ayant leur origine dans des sensations isolées. Aussi, si l’expérience apparait ordonnée, cela ne serait pas de son propre fait. Il est alors nécessaire aux yeux de James et Dewey de modifier le concept d’expérience pour corriger cette anomalie. Contre une psychologie focalisée sur les sensations, ces derniers font donc valoir le point de vue des « tendances impulsives à agir » (304), et plus généralement celui du circuit sensori-moteur de l’organisme, qui contribue à organiser l’expérience sans qu’il soit besoin d’en sortir. Le pragmatisme est donc bien un empirisme radical, au sens où il exprime une foi sans réserve dans l’expérience
Soulignons que, pour Madelrieux, le sens du recours à l’expérience a avant tout une dimension méthodologique et pas fondationnelle. Ce n’est pas parce que l’expérience est ce sur quoi réfléchit la pensée dès lors que la continuité des activités de l’organisme se trouve durablement empêchée, qu’elle doit pour autant être instituée comme un principe ontologique fondamental, un fond originel duquel émergerait toutes choses. C’est une telle erreur que décèle Madelrieux chez James lorsqu’il traite de « l’expérience pure » comme d’une expérience « préconceptuelle et non subjective » (270), qui formerait « l’étoffe » de la réalité, en-deçà de la distinction sujet/objet. Aussi, « revenir à l’expérience » ne signifie pas rechercher une réalité qui serait plus « pure » que celle de nos expériences ordinaires [8]. Le mot d’ordre délimiterait, plus modestement, une exigence de description de l’activité de la pensée à partir des problèmes d’où elle émerge.
Nous touchons là à un passage stratégique de l’ouvrage dans la mesure où Madelrieux entend dénoncer la réception française du pragmatisme au XXè siècle qui s’est accomplie en sur-investissant les thèmes ontologiques – le pluralisme – que l’on trouve chez James au détriment du pragmatisme comme attitude. L’auteur montre que cette interprétation s’est faite au prix, chez Bergson, Wahl puis plus notoirement encore chez Deleuze, de l’affirmation de la thèse absolutiste selon laquelle les relations seraient extérieures à leurs termes. En s’appuyant sur un projet de thèse non publié de Deleuze daté de la fin des années 1950, Madelrieux montre qu’une des ambitions initiales de Deleuze était de faire converger James et Nietzsche pour construire une « philosophie de la différence » (324) qui célèbrerait le « goût et le jeu du divers par opposition au travail de l’identification » (324). Ambition qui ne se démentira pas puisque Deleuze déploiera beaucoup plus tard dans « Bartleby ou la formule » la vision d’un monde fait de « pierres libres, non cimentées, où chaque élément vaut pour lui-même, et non par rapport aux autres », thème qui aurait fourni « les plus belles pages de William James » selon Deleuze [9] (326). Or Madelrieux démontre que cette interprétation du pragmatisme comme un pluralisme intégral qui s’exprime de façon paroxystique chez Deleuze relève en réalité du contre-sens par rapport à ce que James lui-même entendait par pluralisme. Son intention était, plus humblement, de montrer qu’il y a, dans l’expérience, plusieurs types de relations, des plus externes, par exemple la position d’une tasse de café sur une table, aux plus internes comme la relation de modèle à copie (342-343). Deleuze absolutise l’idée des relations externes alors qu’elle fonctionne, chez James, de façon beaucoup plus critique et heuristique.
Le dernier chapitre consacré à la religion nous permet de ressaisir de façon synthétique l’intérêt qu’il y a à endosser l’attitude expérimentale des pragmatistes. D’un côté, elle nous enjoint à garder l’esprit ouvert en ne traitant pas par le mépris les expériences de conversion, qui sont souvent interprétées dans un vocabulaire religieux particulier, en tâchant de les soumettre à une investigation empirique aussi précise et systématique que possible comme s’y attellent James et Dewey [10]. De l’autre, elle recommande de faire preuve d’esprit critique en refusant d’instituer arbitrairement une entité surnaturelle comme étant la cause ultime de cette expérience « et devant faire autorité sur elle » (357). La philosophie comme attitude nous demande donc de jeter la philosophie dans le grand bain de l’expérience mais en s’en tenant à l’expérience et rien qu’à l’expérience, c’est-à-dire sans chercher à la rationaliser excessivement au point de risquer de faire obstacle à la poursuite de recherches ultérieures.
[1] Madelrieux Stéphane, William James. L’attitude empiriste, Paris, Presses universitaires de France, 2008 ; Madelrieux Stéphane, La philosophie de John Dewey, Paris, Vrin, 2016.
[2] « généralité, totalité, caractère ultime, sont d’abord des traits de l’attitude elle-même, et non pas de ce à quoi elle se rapporte. » (16).
[3] Dewey John, Démocratie et éducation, trad. fr. par G. Deledalle, Paris Armand Collin, 2018, p. 417-425.
[4] Rorty Richard, « Recent Metaphilosophy », Review of Metaphysics, 15, décembre, p. 299-318.
[5] Henri Bergson, Sur le pragmatisme de William James, Paris, Puf, 2011 [1911] ; Jean Wahl, Les philosophies pluralistes d’Angleterre et d’Amérique, Les empêcheurs de penser en rond, 2005 [1920].
[6] James William, Le pragmatisme, trad. fr. par N. Ferron, Flammarion, 2007, p. 89-90 [traduction modifiée].
[7] James William, La volonté de croire, trad. fr par L. Moulin, Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 2005. Sur Russell critique de James, voir Jean-Mathias Fleury, « Souveraineté de la raison », in Claudine Tiercelin, La reconstruction de la raison. Dialogues avec Jacques Bouveresse, Collège de France, 2014.
[8] La critique des métaphysiques de l’expérience « pure » ou « radicale » correspond à un autre projet de Madelrieux. Voir Stéphane Madelrieux, Philosophie des expériences radicales, Paris, Seuil, 2022.
[9] Gilles Deleuze, Critique et clinique, Paris, Éditions de Minuit, 1993, p. 110-111.
[10] William James, Les formes multiples de l’expérience religieuse : essai de psychologie descriptive, trad. fr. par F. Abauzit, Chambéry, Exergue, 2001 ; John Dewey, Une foi commune, trad. fr. par P. di Mascio, Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 2011.