Recension – La Fabrique des émotions
Benjamin Tremblay est docteur en sociologie, membre du Centre Max Weber (UMR 5283) et de l’association Pragmata. Il enseigne actuellement à l’Université Lumière Lyon 2.
Louis Quéré, La fabrique des émotions, Paris, PUF, 2022.
L’ouvrage est disponible ici.
En plaçant d’emblée son investigation sous le double patronage de Wittgenstein et de Dewey plutôt que dans une tradition strictement sociologique, Quéré annonce la coloration particulière de La fabrique des émotions. En effet, et contrairement à ce que pourrait laisser penser l’intitulé de l’ouvrage, l’auteur ne s’intéresse pas à la construction des émotions (ou des « normes » qui les régissent) sous une perspective sociohistorique[1], mais à la façon qu’elles ont d’être thématisées par les sciences sociales (première partie) et à leur émergence dans des activités conjointes (seconde partie). Les neufs chapitres du livre composent alors un cheminement exclusivement théorique qui vise à « exercer le doute pour relancer l’enquête » (p.21), via un examen approfondi de travaux en provenance de l’anthropologie, de la psychologie, de la philosophie et de la sociologie. L’enjeu est double : d’abord, identifier les problèmes que posent les théories usuelles des émotions (et notamment le « paradigme du partage des émotions », p.20) ; ensuite, proposer de nouvelles voies d’analyse qui puissent permettre, d’une part, d’articuler la dimension biologique des émotions avec leur caractère « social », et d’autre part, de nous aider à repenser intégralement la question des « émotions collectives ».
L’investigation de Quéré porte donc, prioritairement, sur les façons que nous avons de conceptualiser les émotions en sciences sociales : et de fait, on comprend dès l’entame du premier chapitre que l’ambition de « déjouer les pièges que nous tendent nos manières habituelles de parler des émotions » (p.24) ne se réduit bel et bien pas, ici, à une déconstruction sociohistorique du vocabulaire ordinaire des émotions (ou du « sens commun », selon l’expression consacrée). Le véritable problème, pour Quéré, vient de ce que les enquêtes scientifiques elles-mêmes puisent dans le langage naturel pour traiter des émotions, au lieu de le prendre pour objet (c’est la « confusion du thème et des ressources »[2]). Les émotions tendent à être décrites à l’aide du vocabulaire courant (verbes psychologiques, lexique des « ressentis »), conçues comme des états privés antérieurs à « l’expression et au comportement » (p.34), et localisées « dans le sujet et pas ailleurs » (p.33). Cette conception des choses, historiquement forgée, présente désormais un degré d’évidence tel qu’il semble difficile (sinon impensable) d’imaginer des alternatives. Tel est pourtant le défi que souhaite relever l’auteur, au travers d’un programme qui doit permettre de saisir « le flux de l’expérience sensible » (p.26), de délocaliser les émotions hors des sujets pour les redistribuer sur l’environnement[3], et de décrire leur « opérativité dans des interactivités sérielles » (p.52). Les lecteurs familiers de Quéré évolueront donc en terrain connu ; les autres devront peut-être s’armer de patience puisque La fabrique des émotions reprend des réflexions développées dans des dizaines de textes antérieurs, mais dont les références explicites se comptent sur les doigts de la main. C’est pourquoi j’intègrerai à cette recension des renvois bibliographiques vers quelques-uns des textes en question, qui aideront à élucider ou à compléter certains points délicats de l’ouvrage.
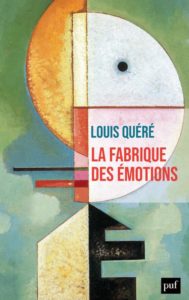 Dans le second chapitre, Quéré expose ses assises théoriques en partant de l’optique « transactionnaliste »[4] de Dewey : « l’organisme vit par le moyen d’un environnement, de son activité et de ses énergies, et pas simplement dans un environnement » (p.78). L’avantage de cette perspective « écologique »[5], caractéristique du pragmatisme[6], est qu’elle permet de tenir ensemble l’ancrage biologique-organique des émotions et leur caractère social/institué. À revers des schémas linéaires proposés en outre par Darwin[7] (qui considère les émotions comme « des états internes suscités par des stimuli », p.86) et par James[8] (pour qui « l’émotion [n’est] rien d’autre que la résonance dans la conscience de […] modifications organiques », p.90), Quéré raisonne avec Dewey[9] en termes de flux, de co-constitution des émotions et de leurs objets dans le cours d’action. Car « ce qui est […] premier, selon Dewey, ce n’est pas le déclenchement, via une excitation nerveuse, de sensations corporelles d’ordre réflexe par un stimulus […] mais une perturbation dans la coordination d’un ensemble d’activités organiques » (p.94). Cette perturbation, ce désajustement ou, selon l’expression de Dewey, cette « situation indéterminée »[10] appelle un traitement pragmatique (dont les émotions peuvent être un des ressorts). Bref c’est dans l’action, dans le mouvement, que se spécifient les émotions en tant que « force[s] organisatrice[s] » (p.117), c’est-à-dire comme ressources qui participent de la reconfiguration de l’expérience et de sa conduite vers une fin.
Dans le second chapitre, Quéré expose ses assises théoriques en partant de l’optique « transactionnaliste »[4] de Dewey : « l’organisme vit par le moyen d’un environnement, de son activité et de ses énergies, et pas simplement dans un environnement » (p.78). L’avantage de cette perspective « écologique »[5], caractéristique du pragmatisme[6], est qu’elle permet de tenir ensemble l’ancrage biologique-organique des émotions et leur caractère social/institué. À revers des schémas linéaires proposés en outre par Darwin[7] (qui considère les émotions comme « des états internes suscités par des stimuli », p.86) et par James[8] (pour qui « l’émotion [n’est] rien d’autre que la résonance dans la conscience de […] modifications organiques », p.90), Quéré raisonne avec Dewey[9] en termes de flux, de co-constitution des émotions et de leurs objets dans le cours d’action. Car « ce qui est […] premier, selon Dewey, ce n’est pas le déclenchement, via une excitation nerveuse, de sensations corporelles d’ordre réflexe par un stimulus […] mais une perturbation dans la coordination d’un ensemble d’activités organiques » (p.94). Cette perturbation, ce désajustement ou, selon l’expression de Dewey, cette « situation indéterminée »[10] appelle un traitement pragmatique (dont les émotions peuvent être un des ressorts). Bref c’est dans l’action, dans le mouvement, que se spécifient les émotions en tant que « force[s] organisatrice[s] » (p.117), c’est-à-dire comme ressources qui participent de la reconfiguration de l’expérience et de sa conduite vers une fin.
Le troisième chapitre (« Les émotions comme institutions ») semble annoncer un retour à des interrogations sociologiques plus conventionnelles. Seulement, Quéré ne s’arrête ni à l’idée selon laquelle « les émotions sont historiquement et socialement « construites », […] lieu commun[11] aussi bien de l’anthropologie que de la sociologie des émotions d’inspiration durkheimienne » (p.125), ni à une perspective normativiste qui, traitant de la soumission des émotions à des conventions et à des règles, ne permet pas de comprendre leur genèse. Il s’agit plutôt de réintégrer la « dimension biologique des émotions » (p.131) dans la réflexion sociologique, sans céder aux explications neurobiologiques ou computationnelles : pour ce faire, Quéré établit un dialogue entre les théories des habitudes de Mauss[12] et de Dewey[13] afin d’envisager les émotions comme techniques – socialement informées – du corps. Pour Dewey en effet, les habitudes consistent en des « montages sensori-moteurs » (p.148), en des « arts de faire » (p.149) standardisés – institués – mais flexibles, par lesquels l’organisme s’ajuste aux modifications de l’environnement. L’important est que cet environnement n’est pas extérieur à l’organisme (qui aurait à simplement s’y « adapter ») : il contribue à l’accomplissement de l’action[14]. Quéré parle alors d’« intériorité mutuelle d’organisme et de l’environnement » (p.153), dans le sens où l’environnement est incorporé aux habitudes qui s’y forment et qui, toujours dans l’optique de la trans-action, le reconfigurent à leur tour. Ainsi en va-t-il des habitudes émotionnelles, i.e. des émotions comme institutions : elles sont « constituées par des modifications conjointes de structures organiques et de l’environnement sous des conditions socioculturelles déterminées » (p.158).
Le chapitre 4 revient sur la composante cognitive des émotions : dans quelle mesure permettent-elles « d’apprécier, d’interpréter, voire de juger immédiatement un événement ou une situation » (p.165) ? La question, on l’aura compris, se pose d’autant plus que Quéré s’inscrit dans une veine pragmatiste qui tâche de dé-mentaliser l’esprit[15] et de distribuer l’activité cognitive[16]. Une perspective cependant loin d’être partagée puisque les théories en vigueur (Arnold[17], Lazarus[18], Fridja[19]) tendent à mettre en scène un individu traitant les informations qu’il reçoit de l’environnement (extérieur) au prisme de ses « motifs » ou « valeurs ». Pour Quéré, ces propositions « surintellectualis[ent] la dimension cognitive de l’émotion […], reconduisent les dualismes classiques : sujet/objet, organisme/environnement, interne/externe, etc. […] [et] introduisent prématurément les notions de Self, de personne ou d’individu dans l’explication » (p.178). Autrement dit, elles reprennent à leur compte les évidences de sens commun en attribuant l’expérience émotionnelle « à une personne à laquelle elle serait attachée en tant que propriété privée » (p.180), et en réduisant cette expérience à une affaire de traitement subjectif d’informations[20] objectives. Le recours à la théorie de la valuation[21] de Dewey permet d’aborder autrement le problème, en distinguant notamment « la valuation immédiate (de facto valuing), qui est irréfléchie parce qu’elle est principalement affective-motrice, et l’évaluation proprement dite, qui est un jugement établi par une réflexion, une exploration ou une enquête » (p.182). La valuation immédiate n’est pas assimilable à un jugement imputable à un Self : elle est une activité accomplie conjointement avec un environnement qui présente « d’emblée des qualités affectives/émotionnelles entremêlées à leurs qualités sensorielles » (p.184). Elle a ensuite une « composante intellectuelle de nature intentionnelle » (p.187) qui lui confère une orientation téléologique par la « médiation d’idées » (p.187), l’important étant est que ces idées ne sont pas logées dans l’esprit ou dans la conscience – elles sont immanentes à la pratique, « incarnée[s] dans un comportement tacitement orienté » (p.193). Certaines de ces valuations, pour peu qu’elles atteignent un certain degré de structuration, peuvent alors donner lieu à des émotions et contribuer à « l’unité de l’expérience »[22].
Après cette passionnante « clarification conceptuelle » (p.23), la seconde partie de l’ouvrage propose une extension des réflexions ouvertes dans le volume de Raisons Pratiques codirigé par Quéré et L. Kaufmann en 2020 (« Les émotions collectives »[23]). « Comment caractériser ces émotions éprouvées ensemble et exprimées en chœur ? » (p.217) Y a-t-il des « techniques d’accordage des réactions instinctives et des valuations immédiates des événements et des situations ? » (p.218) Considérant que la « prolifération [des recherches] ne se traduit pas nécessairement par un gain de clarté » (p.219), Quéré nous invite à examiner les théories consacrées à la collectivisation des émotions.
Le chapitre 5 revient sur la figure de la foule, généralement conçue – en opposition au public – comme un « type dégradé de collectif »[24]. À en croire Taine[25], Tarde[26] ou Le Bon[27], la foule serait pour ainsi dire « atteinte d’une pathologie mentale » (p.226) qui se propagerait par contagion ou imitation. Contre ces « explications » psychologiques teintées de moralisme, Quéré convoque Durkheim chez qui le sentiment collectif est, en tant que fait social de nature sui generis, « autre chose qu’une convergence de sentiments particuliers semblables ; il est un […] un « état collectif » » (p.231). Ainsi, l’exaltation induite par sa participation à l’activité collective non seulement donne à l’individu « l’impression de n’être plus lui-même »[28], mais génère aussi des idéaux qui « lui permettent de s’élever au-dessus de l’expérience ordinaire » (p.235). Le sentiment collectif naît de l’activité réalisée en commun : argument que Quéré considèrera plus loin (chap.7) comme praxéologique[29] et qui, à ce titre, formera le cœur de sa propre démonstration. D’ici là, force est de constater que cette voie tracée par Durkheim n’a guère été suivie, la plupart des recherches contemporaines se contentant de peaufiner « le paradigme du partage des émotions » (p.248), et donc de proposer des versions sophistiquées de la « sémantique naturelle de l’action »[30] et des émotions.
Le panorama des recherches en ontologie sociale proposé dans le chapitre 6 doit aider à clarifier les conditions sous lesquelles un phénomène peut être dit « collectif ». Dans une conception nominaliste, « on considèrera comme pures fictions intellectuelles les émotions attribuées collectivement à des groupes, ceux-ci n’étant eux-mêmes que des collections d’individus unifiées par la représentation » (p.250) ; dans une conception intersubjectiviste, on insistera davantage sur « l’interdépendance et la co-régulation » (p.261) des émotions entre individus, ou sur ce qu’elles doivent à une sorte d’identification à un groupe. D’un côté, le collectif comme fiction ; de l’autre, le collectif comme construction intersubjective : pour éviter ces écueils, Quéré s’oriente vers les approches collectivistes. La première, normativiste, impute à des agents ou sujets pluriels des émotions fondées sur une « reconnaissance commune de ce qui importe au groupe » (p.266). Par exemple, c’est parce que tel aïeul comptait pour « nous » en tant que famille que sa mort « nous » attriste : en tant que membre de cette famille je suis, d’une part, astreint à adopter une « attitude émotionnelle » (p.267) adéquate, et d’autre part en droit d’attendre la même attitude des autres membres. Mais l’explication est circulaire : l’existence de groupes partageant des perspectives communes y apparait comme « condition préalable »[31] à l’émotion collective, alors même que le flou demeure sur le type de « groupes » dont on parle, sur l’origine de leurs « perspectives communes », et sur les modalités d’exercice de leur normativité. Quéré propose alors une « conception adverbiale du « nous » » (p.270) qui permet de penser que « ce qui est collectif, c’est l’action, pas le sujet »[32]. Une émotion collective n’est ni un agrégat d’émotions d’abord privées, ni l’émotion d’un « sujet pluriel » ou d’un « individu collectif » : elle est quelque chose que l’on fait ensemble (comme « s’indigner » ensemble), et c’est autour de ce faire (le verbe) que s’organise le « nous » (adverbe).
Le septième chapitre revient sur les théories qui expliquent les émotions par l’« appartenance » ou l’ « identification » à un « groupe » : après avoir distingué différentes modalités d’appartenance à différents types de groupes (réels et nominaux, physiques et virtuels, etc.), Quéré se focalise sur le cas de la « collectivité dotée d’une conscience de soi et d’une histoire propre [, qui] est un groupe qui se représente lui-même, cette représentation de soi étant constitutive de ce qu’il est » (p.307). « Les Français », par exemple : un tel groupe est organisé – via des institutions –, sans être pour autant un « organisme ». Mais comment peut-il être traversé par des émotions, si celles-ci reposent sur une « capacité de sélectivité, de discrimination et d’orientation en vue de son maintien en vie ? » (p.313). Quéré revient alors à la proposition praxéologique de Durkheim selon laquelle c’est « l’accomplissement concerté de gestes et de mouvements communs et homogènes » (p.319) qui donne naissance aux sentiments collectifs. Cette « préséance de l’activité, du mouvement et de la motricité sur les sensations et donc sur les émotions » (p.326) vient rejoindre la conception adverbiale du « nous » et nous (re)conduit aux termes que Quéré empruntait dès les premières pages du livre, après Wittgenstein, à Goethe : « au commencement était l’action » (p.13). Le huitième chapitre synthétise l’investigation et affine une conception pragmatiste d’émotions dont la forme collective est corrélative d’« accomplissements concertés médiatisés par des usages, des méthodes, des objets et des dispositifs » (p.328). Au bout du compte, les émotions individuelles doivent être saisies non pas comme préalables aux émotions collectives, mais comme conséquences d’un faire ensemble : elles sont, selon l’expression de Mauss[33] qui vaut son titre au chapitre, « moulées dans une forme collective ».
Le dernier chapitre apparaît comme une tentative de l’auteur pour raccorder ses réflexions à une thématique perpétuellement actuelle : « les émotions publiques en politique » (p.359), et en particulier les « passions publiques hostiles » (p.377). Pour Quéré, de telles passions s’exercent contre des catégories nominales (« les privilégiés », « les médias », etc.) auxquelles sont associées des qualités (négatives) stéréotypiques. Les groupes nominaux passant pour être des groupes réels, chaque membre présumé d’un tel groupe est dès lors susceptible de devenir la cible de « réactions de destruction » (p.381), en particulier à l’heure où l’on assiste à un « élargissement de [la] « conversation sociale » » (p.386), à la « désinhibition de la haine » (p.386) et à la « production culturelle de contre-vérités » (p.387). À défaut d’être aussi stimulantes que les précédentes, ces considérations permettent au moins à Quéré de rappeler une dernière fois Dewey à notre mémoire en proposant d’« éduquer les émotions pour faire en sorte qu’elles soient éclairées par l’intelligence, [ce qui] requiert que se crée un attachement affectif à la méthode de celle-ci, qui est celle du questionnement, de l’enquête et du jugement réfléchi » (p.394).
La fabrique des émotions est un ouvrage particulièrement dense et exigeant, qui requiert pour être apprécié une certaine familiarité vis-à-vis des approches pragmatistes (et, dans une certaine mesure, ethnométhodologiques) qui le sous-tendent : en dépit des efforts de structuration du propos, l’ouvrage manque peut-être d’une forme de « liant narratif » qui le rendrait accessible à un lectorat plus large, et faciliterait certaines des (très) nombreuses transitions conceptuelles qui s’effectuent de page en page. Ce texte de Quéré ne manquera cependant pas de faire date, non seulement parce qu’il marque un décalage assez radical dans les façons de concevoir les émotions, mais aussi parce qu’il constitue une première synthèse remarquable de l’œuvre, aussi singulière que prolifique, de l’auteur.
[1] Cette démarche n’est cependant guère surprenante au regard des positions théoriques de Quéré, qui reposent en outre sur une critique des investigations sociohistoriques (lesquelles sont, d’ordinaire, au départ de la plupart des recherches en sciences sociales, via des contextualisations, généralisations, etc.) : sur ce point, voir Louis Quéré, « Pour une sociologie qui « sauve les phénomènes » », Revue du MAUSS, vol. 24, n°2, 2004, pp. 127-145.
[2] Louis Quéré & Jacques Hoarau, « Le sociologue et le touriste », Espaces Temps, 1992, n°49-50, p.41-60, p.42.
[3] Louis Quéré, « L’émotion comme facteur de complétude et d’unité dans l’expérience. La théorie des émotions de John Dewey », Pragmata, 2018, n°1, p.10-59.
[4] Louis Quéré, « Valeurs : « machins quasi-gazeux » ou choses « en dur » ? De Durkheim à Dewey… aller-retour », SociologieS [En ligne], 2019. DOI : https://doi.org/10.4000/sociologies.10574.
[5] Louis Quéré, « Le naturalisme social de Dewey et Mead », Intellectica, 2013/2, n°60, p. 91-114, p.112.
[6] « Le pragmatisme propose une vision radicalement relationnelle, écologique (aucun élément n’existe indépendamment du réseau de relations dans lequel il est engagé) et émergente (le tout dépend des parties qui dépendent du tout) des processus organisants, ce que Dewey et Bentley (1949/2008) nomment des «trans-actions. » Philippe Lorino, Damien Mourey, Fabian Muniesa, Aura Parmentier Cajaiba & Alvin Panjeta, « Pragmatisme et enquête sur les organisations », Pragmata, 2019, n°2, p.243-293, p.253.
[7] Charles Darwin, The Expression of the Emotions in Man and Animals, John Murray, 1872.
[8] William James, The Principles of Psychology, Henry Holt and Company, 1890.
[9] L’auteur reprend ici à son compte la lecture critique que Dewey avait faite de James et de Darwin (et notamment des deux ouvrages mentionnés en notes 7 et 8) dans un double article : « The theory of emotions. (I.) Emotional attitudes », Psychological Review, n°I(6), 1894, p. 553-569 ; et « The theory of emotion. (II.) The significance of emotions », Psychological Review, n°II(1), 1895, p.13-32.
[10] John Dewey, Logique, la théorie de l’enquête, Paris, PUF, 1993 [1938], p.172.
[11] Pour prendre la mesure de ce « lieu commun », voir par exemple Ian Hacking, Entre science et réalité. La construction sociale de quoi ?, Paris, La Découverte, 2008 [2000]. Pour Hacking, l’expression de « construction sociale » est usée d’avoir trop servi, au point d’apparaître comme une « métaphore morte » (ibid., p.75) qui ne nous dit plus rien sur ce que l’on appelle, au juste, « construction » et « sociale ». Cet argument se retrouve également dans : Bruno Latour, Changer de société, refaire de la sociologie, Paris, La Découverte, 2006 [2005].
[12] Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie, PUF, 1968 [1936].
[13] Voir par exemple John Dewey, Human Nature and Conduct, Henry Holt and Company, 1922.
[14] Louis Quéré, « L’environnement comme partenaire », in Jean-Marie Barbier & Marc Durand (dir.), Sujets, activités, environnements, Paris, PUF, « Éducation et formation », 2006, p.7-29.
[15] Guillaume Garreta, « Lieu et temps de l’esprit. Dewey et l’analyse adverbiale de la conduite humaine », Intellectica, 2012/1, n°57, p. 115-138.
[16] Louis Quéré, « La situation toujours négligée ? », Réseaux, 1997, vol. 15, n°85, p. 163-192. « Distribuer » la cognition, c’est refuser d’adhérer à une perspective strictement mentaliste selon laquelle seul « l’esprit humain », éventuellement réductible à un substrat neurologique, serait capable de « connaitre ». A l’inverse, il s’agit de dire que cet élément humain et mental n’est « qu’une composante » (ibid., p.178) de l’activité cognitive, laquelle implique également les « objets de l’environnement » (p.185), les institutions (incluant « nos idées et […] nos pensées », ibid., p. 187), les « affordances » (ibid., p.184) des situations, etc.
[17] Magda B. Arnold, Emotion and Personality, Columbia University Press, 1960.
[18] Richard S. Lazarus, Emotion and Adaptation, Oxford University Press, 1991.
[19] Nico H. Fridja, The Emotions, Cambridge University Press, 1986.
[20] Louis Quéré, « Au juste, qu’est-ce que l’information ? », Réseaux, 2000, vol.18, n°100, 2000, p.331-357.
[21] Pour Dewey, la valuation « n’a lieu que lorsque quelque chose fait question : quand il y a des difficultés à écarter, un besoin, un manque ou une privation à combler, un conflit entre tendances à résoudre en changeant les conditions existantes. Ce fait prouve à son tour qu’un élément intellectuel – un élément d’enquête – est présent chaque fois qu’il y a valuation. » (John Dewey, « La théorie de la valuation », Tracés. Revue de Sciences humaines [En ligne], n°15, 2008, DOI : https://doi.org/10.4000/traces.833). Pour le dire vite, la « valuation » se situe en quelque sorte à mi-chemin entre le comportement réactionnel ou l’« habitude routinière » (ibid.) et l’évaluation au sens strict, qui relève du jugement réfléchi.
[22] John Dewey, L’art comme expérience, Paris, Gallimard, « Folio Essais », 2010 [1934], p.89. Les émotions sont à fois corrélatives et constitutives de l’activité pratique : elles émergent et se spécifient dans l’activité, et participent à sa reconfiguration. Imaginons un dialogue entre deux amis : c’est au fil de leurs échanges que peut naître, par exemple, un « enthousiasme » commun, lequel va avoir des implications directes sur la conduite de l’interaction (si « nous » sommes enthousiastes, nous n’allons ni faire ni dire les mêmes choses que si nous étions « tristes »). L’enthousiasme est donc à la fois une conséquence et un constituant du dialogue amical. Par conséquent, dire que les émotions peuvent contribuer à « l’unité de l’expérience », c’est dire qu’elles peuvent participer à l’organisation et à la mise en cohérence de l’expérience – elles lui confèrent une « tonalité » et une certaine direction. Mais cette vertu des émotions n’est, selon Quéré, que potentielle : en effet, comme le soulignait Dewey lui-même, toutes nos expériences ne sont pas unifiées et, bien souvent, « nous voguons à la dérive. […] Il y a expérience, mais si informe et décousue qu’elle ne constitue pas une expérience » (ibid., p.88). Ces expériences décousues reposeraient alors sur – et donneraient lieu à – des émotions elles-mêmes décousues, donc peu structurées et peu descriptibles.
[23] Laurence Kaufmann & Louis Quéré (dir.), Les émotions collectives, Paris, EHESS, « Raisons Pratiques », 2020, vol. 29.
[24] Ibid., p.11.
[25] Hippolyte Taine, Les origines de la France contemporaine II, Laffont, 1986 [1875-1883].
[26] Gabriel Tarde, L’opinion et la foule, PUF, 1989 [1901].
[27] Gustave Le Bon, Psychologie des foules, Alcan, 1985.
[28] Emile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, PUF, « Quadrige », 2013 [1912], p.312.
[29] Une perspective praxéologique revient à prendre l’action pratique (praxis) pour objet de l’enquête et de la description sociologiques : il s’agit d’étudier « la logique endogène de la pratique » (Michel Peroni, « Déliaison, quand tu nous tiens… », in André Micoud & Michel Peroni (dir.), Ce qui nous relie, Editions de l’Aube, 2000, p.5-30, p.8). Ici, l’argument « praxéologique » que Quéré identifie chez Durkheim consiste plus précisément à dire que les émotions collectives sont des corrélats d’activités pratiques : elles ne préexistent donc pas à ces activités (comme le suppose le schéma du « partage »), mais sont au contraire instanciées dans et par elles. Saisir sociologiquement les émotions collectives revient alors à décrire ces activités « réalisées ensemble », au lieu de reprendre – dans le texte scientifique – la conception « naturelle » des émotions (voir note 30), qui consiste à en faire des états privés, internes, etc.
[30] « J’entends par sémantique naturelle de l’action, au sens large, cet ensemble de ressources contenues dans le langage ordinaire, qui permet de déterminer ce qui compte comme action, de faire des attributions d’actions, d’imputer des responsabilités, et d’assurer la lisibilité et la communicabilité du champ pratique. » (Louis Quéré, « Agir dans l’espace public. L’intentionalité des actions comme phénomène social », in Patrick Pharo & Louis Quéré (dir.), Les formes de l’action. Sociologie et sémantique, Paris, EHESS, « Raisons Pratiques », 1990, vol. 1, p.85-112, p.90). La langue française nous offre par exemple une structure typique de description des évènements (privés ou publics), via la forme sujet/verbe/complément : c’est elle que nous utilisons pour dire ce qui (nous) arrive et, entre autres, pour dire ce que nous « ressentons ». Lorsque je prononce une phrase comme « Je suis triste », je mobilise non seulement le lexique commun des émotions (colère, tristesse, etc.), mais aussi et surtout une conception de l’action qui revient à imputer ces émotions à un sujet privé (en l’occurrence, à « je », à « moi » : c’est ma tristesse) doué d’« intentions » ou de « raisons » elles-mêmes descriptibles dans le langage « naturel » (du type : « je suis triste parce qu’elle m’a déçu », et ainsi de suite). Le problème, pour Quéré, ne vient pas de cette sémantique naturelle en tant que telle (elle est inévitable dans la mesure où elle est constitutive de nos façons de parler, de penser, d’agir etc.), mais de sa reprise directe dans les analyses scientifiques : « l’analyse sociologique doit se garder d’emprunter ses ressources analytiques à la sémantique naturelle de l’action », ibid., p.109), notamment parce qu’elle ne permet pas de décrire rigoureusement les émotions comme corrélats d’activités pratiques (voir note 29), comme émergences.
[31] Mikko Salmela, « Les émotions peuvent-elles être collectives ? », in Laurence Kaufmann & Louis Quéré (dir.), Les émotions collectives, Paris, EHESS, « Raisons Pratiques », 2020, vol.29, p.35-67, p.42.
[32] Louis Quéré, « Le public comme forme et comme modalité d’expérience », in Daniel Cefaï & Dominique Pasquier (dir.), Les Sens du public. Publics politiques, publics médiatiques, Paris, PUF, 2003, p.113-134, p.126.
[33] Marcel Mauss, « L’expression obligatoire des sentiments (rituels oraux funéraires australiens) », in Œuvres, vol.3 : Cohésion sociale et division de la sociologie, Minuit, 1969 [1921], p.269-282.














