Recension – La dette comme rapport social
Recension de l’ouvrage La dette comme rapport social : liberté ou servitude ? de Jean-François Bissonnette et Pierre Crétois (et alii) par Antoine Dumont, ancien élève de l’ENS Ulm et agrégé de philosophie.
La dette : cadeau empoisonné ?
 La crise financière des subprimes en 2008 a permis de lever le voile sur la rationalité paradoxale du capitalisme contemporain, et plus particulièrement de sa conception de la dette. Outil permettant d’accéder immédiatement au capital, et donc de satisfaire ses désirs en abolissant la durée de l’épargne, levier de l’investissement qui dynamise l’économie en pariant sur l’avenir, la dette est aussi apparue, à cette occasion, comme une contrainte implacable étouffant les particuliers qui y sont soumis. Relation de domination ou lien de réciprocité, émancipatrice ou tyrannique, c’est la nature ambivalente de la dette et ses implications philosophiques qui font l’objet de cet ouvrage collectif. À rebours d’une approche comptable faisant de l’endettement un problème technique de mathématiques financières, les différentes contributions issues d’un colloque tenu en décembre 2015 à l’Université de Paris-Nanterre et recueillies dans le présent ouvrage entendent dégager les enjeux anthropologiques, moraux et politiques de la dette.
La crise financière des subprimes en 2008 a permis de lever le voile sur la rationalité paradoxale du capitalisme contemporain, et plus particulièrement de sa conception de la dette. Outil permettant d’accéder immédiatement au capital, et donc de satisfaire ses désirs en abolissant la durée de l’épargne, levier de l’investissement qui dynamise l’économie en pariant sur l’avenir, la dette est aussi apparue, à cette occasion, comme une contrainte implacable étouffant les particuliers qui y sont soumis. Relation de domination ou lien de réciprocité, émancipatrice ou tyrannique, c’est la nature ambivalente de la dette et ses implications philosophiques qui font l’objet de cet ouvrage collectif. À rebours d’une approche comptable faisant de l’endettement un problème technique de mathématiques financières, les différentes contributions issues d’un colloque tenu en décembre 2015 à l’Université de Paris-Nanterre et recueillies dans le présent ouvrage entendent dégager les enjeux anthropologiques, moraux et politiques de la dette.
En effet, il en va du lien complexe et, peut-être, inextricable, entre deux sens de « devoir » : si l’on ne doit que de l’argent à son créancier, la relation d’endettement impose sur le débiteur le sceau de la faute morale, voire du péché – faute qui ne pourra jamais être lavée. La question est alors de savoir si l’on peut penser les relations sociales selon d’autres modalités que celles du crédit et de la dette, par exemple sous le paradigme du don ou d’échanges qui ne s’accommodent pas des prix du marché mais se soumettent à des critères éthiques. Ces considérations obligent à repenser le caractère obligatoire du remboursement de la dette et la relation de solidarité qui nous lie, non seulement à nos contemporains mais à longue chaîne des générations, ce que peine à saisir la théorie libérale du contrat social.
L’être humain en dette
Si la question de la dette occupe une place prépondérante dans les enjeux économiques contemporains, peut-être masque-t-elle une préoccupation plus fondamentale, l’idée d’une « dette de vie » qui oblige chaque individu dans la mesure où elle constitue l’étoffe même de son existence. Antérieure à toute forme économique de réciprocité, la notion de dette permettrait de décrire le mode d’être propre des humains, voire d’en prendre conscience. C’est ce qu’examine Samuel Le Quitte dans un chapitre[i] qui se signale par sa grande clarté, consacré à « l’être-en-dette » dans Être et Temps. Le phénomène de l’être-en-dette émerge chez Heidegger sur fond de la reconnaissance de ce qui constitue l’existence de l’être humain pris par l’angoisse. Celle-ci désigne, chez le philosophe allemand, non pas une phobie à l’encontre d’un objet précis, mais une tonalité générale de l’existence, un mouvement par lequel l’existence fuit devant elle-même, soudain étrangère au monde du quotidien. Symptôme de l’inanité d’une existence rivée aux choses, l’angoisse ouvre aussi la possibilité de la liberté, du choix fondamental de sa propre existence. C’est ici que le sens usuel de la dette paraît insuffisant.
En effet, la dette renvoie habituellement à deux imputations distinctes : elle signifie le devoir de restituer à autrui quelque chose qu’il m’a prêté ; elle renvoie en outre à la responsabilité morale du débiteur, dans la mesure où il est cause de la dette. Or, comme le remarque Samuel Le Quitte, l’être-en-dette échappe à cette double détermination : « je suis responsable d’une chose (en l’occurrence, mon être) dont je ne suis pas la cause »[ii]. Telle est la condition de la liberté humaine et, en même temps, de sa responsabilité : nous ne sommes pas le fondement de notre existence, et pourtant nous devons exister comme si nous l’étions, puisque nous nous en sentons responsables. Heidegger parvient donc à une conception originaire de la dette, antérieure à sa dimension de réciprocité vis-à-vis d’autrui : si je dois quelque chose à autrui, c’est sur fond de l’endettement de chaque existence vis-à-vis d’elle-même. Or, comme le souligne Samuel Le Quitte, le raisonnement de Heidegger trouve une issue insuffisante : si je suis responsable de ma propre existence face à moi-même, puis aux autres, encore faut-il que je reconnaisse une instance tierce face à laquelle je me sente moralement responsable, et qui dépasse ce que je suis.
C’est ce qui retient l’attention d’Elettra Stimilli dans un chapitre[iii] consacré au rôle de la religion dans le développement d’économies fondées sur l’investissement par la dette. Après une restitution brève et limpide du mécanisme de la crise économique mondiale de 2008 à 2012, l’auteur s’interroge sur la tonalité morale de la dette. Imputée tout particulièrement aux pays du sud de l’Europe, la faute liée à la dette serait celle d’une gestion dissolue du budget et de la transgression de règles communes mettant en péril l’équilibre général de la zone Euro, catastrophe qui ne pourra être évitée qu’au terme de nombreux sacrifices. Ce qui frappe d’emblée, c’est que cet usage d’un vocabulaire religieux émane souvent d’instances (banques et agences de notation) qui prétendent décrire la situation dans une langue rigoureusement technique et axiologiquement neutre.
Or cela n’a rien d’accidentel : comme le souligne Elettra Stimilli, dans le prolongement des travaux de Christian Marazzi et Paolo Virno[iv], l’usage de la monnaie, et par suite, du crédit, est fondateur du fait social dans la mesure où elle accompagne le processus d’évaluation morale et de distinction sociale. En cela, il est intrinsèquement lié à l’institution d’un langage prédiquant des valeurs. Monnaie, dette, morale, ces trois opérateurs de l’intégration sociale ne se développent pas dans n’importe quelle condition. Comme le soulignent Michel Aglietta et André Orléan[v], ils apparaissent dans les groupes humains dans lesquels le culte des dieux domine et cimente l’ordre social. Le sacrifice est alors conçu comme le moyen permettant de rembourser aux divinités le don de vie. Or, bien que censés se prolonger de génération en génération, le rituel du sacrifice et la pratique de l’augure ont le sens d’une reconnaissance et de l’acquittement d’une dette, ce qui ne semble pas correspondre à la dynamique propre de l’endettement public sur les marchés financiers aujourd’hui.
C’est qu’un changement de paradigme s’est effectué dans la matrice du christianisme. La thèse (féconde, mais hélas trop brièvement développée) d’Elettra Stimilli est que « le christianisme a radicalisé la condition d’endettement »[vi], en subvertissant la traduction des mots araméen « hôbâ » et grec « opheilema », dont le sens courant est celui de « dette », mais qui devient ici « péché. » Celui-ci n’est pas simplement un état qu’il faudrait amender, mais une condition rachetée gratuitement par le sacrifice du Christ et dans laquelle chaque individu a l’opportunité d’investir en tendant par ses œuvres à la sainteté. La Passion et la résurrection du Christ ne contraignent en rien le pécheur, elles lui offrent plutôt la possibilité d’investir en soi. Ce nouveau paradigme permettrait d’éclairer la situation actuelle de la dette, qui n’est plus principalement un capital à rembourser, ni même un devoir qui oblige pour l’éternité, mais un état dans lequel il faut investir et qu’il faut prolonger indéfiniment, une vie coupable qu’il s’agit de mettre à profit.
Néanmoins, cette conclusion peine à convaincre entièrement, pour au moins deux raisons. D’une part, le « sacrifice » du Christ ne repose pas sur une logique du crédit mais bien sur le principe incommensurable de la rédemption, celui du don – principe qui nous semble, somme toute, assez éloigné de la logique des taux d’intérêts composés ; d’autre part, il ne prend son sens que dans la perspective eschatologique du Jugement Dernier, ce qui met à mal la généalogie chrétienne d’un « entrepreneur de soi » sans terme ni but, accaparé par la gestion de son crédit.
Dette et justice
C’est également sous l’angle de la genèse psychique de la dette et du sentiment de culpabilité qui l’accompagne que Federica Gregoratto aborde, dans un chapitre intitulé « La vie psychique de la dette et les identités traditionnelles de genre »[vii], la manière dont la construction sociale des identités genrées prend appui sur le néolibéralisme. À rebours d’une conception habituelle qui en fait un mouvement de dérégulation des flux financiers et du marché du travail dans une économie mondialisée, Federica Gregoratto s’appuie sur les thèses du géographe David Harvey[viii] qui décrit le néolibéralisme comme un processus de privatisation de la dette publique. Contre le diagnostic de Nancy Fraser[ix], qui pose que le néolibéralisme a trouvé un allié de circonstance dans les critiques féministes de la répartition traditionnelle des genres (le marché vendant aux femmes le rêve d’une émancipation par le travail et l’entreprise), l’auteure suggère que cette répartition a été renforcée par ce nouvel esprit du capitalisme.
En effet, l’identité traditionnelle de la femme, caractérisée par une attitude de soin pour autrui, trouve une place spécifique dans l’économie néolibérale. Partant des analyses de la psychanalyste Melanie Klein[x] sur le cycle de l’amour, de la haine et de la culpabilité dans les relations entre la mère et l’enfant, Federica Gregoratto avance l’idée selon laquelle, face à un fort sentiment de culpabilité, la psyché féminine traditionnelle aura tendance à renforcer le lien de dépendance vis-à-vis d’autrui, en se sacrifiant pour lui au risque de pervertir la relation.
À l’inverse, un sentiment de culpabilité trop fort poussera les hommes à rompre toute lien de dépendance, en se privant de la possibilité de réparer la relation. C’est pourquoi le marché du crédit bancaire, que ce soit celui des subprimes aux Etats-Unis, comme celui du micro-crédit dans les pays en voie de développement, a trouvé parmi les femmes des cibles (ou des partenaires) idéales, « capables à la fois d’endurer les sentiments de culpabilité sans trop se rebeller, et de faire tout ce qu’il faut pour les atténuer. »[xi] Mais, comme le note Gregoratto à la suite de Klein, le sentiment de culpabilité, dans la mesure où il nous pousse à vouloir réparer nos torts, est aussi un affect créatif, tourné vers l’avenir. L’enjeu n’est donc pas tant de répudier toute dette (et, partant, la charge de culpabilité qui l’accompagne) que de rendre juste sa répartition.
Cette préoccupation est également au cœur du chapitre que Jean-François Bissonnette consacre à la tâche difficile d’une régulation de la dette[xii]. Le problème réside précisément dans le fait que « la dette nomme à la fois le mal à traiter et le moyen pour ce faire »[xiii], selon que le crédit se présente comme un moyen d’exploiter les plus faibles ou au contraire de former des liens mutuellement bénéfiques. Or la notion de dette semble échapper à la fois à la logique du don et à celle de l’échange, et la situation actuelle invite à la repenser à nouveaux frais. À la fin du XXe siècle, on a assisté à la fois à un vaste mouvement de privatisation de la dette, le poids des investissements de l’Etat dans les services publics étant progressivement transféré aux particuliers, notamment en matière de santé, et à une vaste extension du crédit à des catégories de la population plus modestes qui n’y avaient pas accès auparavant. Cela a eu pour effet de dépolitiser en grande partie les enjeux de l’accumulation du capital (la dette privée individualisant le processus de domination) mais aussi, paradoxalement, de donner naissance à des mouvements de résistance à la dette, les débiteurs finissant par prendre conscience de la force que leur confère leur nombre.
Or loin de répudier le vocabulaire de l’endettement, ces mouvements de résistance tels que Strike Debt le reprennent à leur compte, parlant de « dette mutuelle » et « commune ». Ne sort-on pas déjà de la logique propre de la dette, pour se rapprocher d’une « économie du don » débarrassée de l’impératif de l’intérêt ? Ne doit-on pas penser la relation contractuelle du crédit comme un échange, capital contre intérêt ? Jean-François Bissonnette n’a pas de peine à montrer que si l’échange marchand repose sur l’équivalence de valeurs échangées ponctuellement, il n’en va pas de même du crédit, qui n’est véritablement profitable qu’à partir du moment où le débiteur, ne parvenant pas à faire face à ses obligations, voit le poids des intérêts s’accumuler et s’étaler dans le temps.
Il est également difficile de penser la dette sur le modèle du don. L’auteur remarque à ce sujet que la notion de don contient la même ambigüité (et donc, potentiellement, la même toxicité) que celle de dette : dans le don, il y a toujours, implicitement, l’obligation de rendre, raison pour laquelle le mot « gift » signifie à la fois, dans les langues germaniques, « cadeau » et « poison ». De fait, dans les deux cas, l’obligation morale de rendre est la même, comme le soulignait déjà Marcel Mauss[xiv]. Néanmoins, si le langage de la dette est celui de l’intérêt calculateur par lequel est rémunéré le crédit, la logique du don vise à perpétuer le lien social de manière pérenne. Autrement dit, la relation de réciprocité qu’on trouve dans le don n’a pas d’autre fin que la relation elle-même.
Certes, dans la mesure où il ne dispose pas des mêmes garanties contractuelles que le crédit, le don est ouvert au risque d’une domination ou d’un défaut de réciprocité, mais il est aussi source d’obligation dans un jeu symbolique où les partenaires sont toujours mutuellement redevables et où les rôles du « créancier » et du « débiteur » ne cessent de permuter. Il s’agit donc de penser, in fine, une dette mutuelle qui n’exclurait pas la logique comptable caractéristique du crédit, mais qui viserait, à terme, une parité de partenaires originairement inégaux.
C’est à cet horizon mutualiste que Roberta Rubino donne une consistance dans un chapitre[xv] consacré au commerce équitable, nourri de ses recherches sur le projet Coton bio-équitable au Mali. À l’instar du concept de « dette mutuelle », celui de « commerce équitable » permet de penser une hybridation des logiques du don et du marché. Il s’agit, en effet, d’ajouter au prix d’achat fixé par le marché un surplus dont le bénéficiaire sera la communauté villageoise productrice. Or la dimension de gratuité apparente de ce « don » est doublement mise à mal, d’une part par le fait que le commerce équitable soit vu, par les acheteurs, comme une entreprise de réparation d’une injustice préalable, celle de la colonisation ; d’autre part, et c’est le point essentiel, par le fait que la « prime sociale » ne soit attribuée aux communautés productrices qu’en contrepartie de l’adhésion à des normes sociales démocratiques.
C’est ainsi que Roberta Rubino a pu observer une inégalité systématique entre les partenaires, non seulement dans sa configuration originelle (ce sont les entreprises occidentales qui ont l’initiative de l’échange et qui en fixent le cadre, non les producteurs) mais dans les conséquences sociales que le commerce équitable implique : les normes démocratiques occidentales (abolition du travail des enfants, organisation égalitaire et paritaire de la production, égalité dans la rémunération individuelle) sont en décalage avec les pratiques culturelles des communautés villageoises maliennes. Non seulement les enfants participent aux travaux des champs sans être rémunérés, mais l’égalité des genres et des individus n’existe pas et l’argent sert exclusivement de moyen d’échange pour des biens mobiliers, le capital foncier étant transmis selon les lois du lignage, ce qui laisse penser que le projet émancipateur du commerce équitable soit manquera sa cible, soit sera vécu comme une violence par les autochtones.
C’est donc le caractère unilatéral du don au fondement du commerce équitable (en l’occurrence, don de normes éthiques correspondant aux usages occidentaux) qui transforme l’échange commercial en relation d’endettement. En contrôlant et évaluant les pratiques des autres sur la base des siennes, les Occidentaux se retrouvent, peut-être à leur corps défendant, dans la position de créanciers. Ce paradoxe d’une solidarité portant en elle les ferments de l’inégalité mériterait toutefois d’être discuté, dans la mesure où Roberta Rubino finit par dénier à ce type de commerce tout caractère équitable en raison de son organisation inégalitaire, sans se fonder sur une conception précise de l’équité. On pourrait objecter à l’auteure qu’il est douteux que l’équité vise l’égalité stricte entre les partenaires, ou qu’elle s’applique à la discussion de normes éthiques. Elle viserait plutôt à attribuer à chacun ce qui lui est dû en adaptant des règles générales déjà établies aux contours d’une situation particulière. Or dans le contexte de pratiques commerciales particulièrement brutales et iniques en Afrique sub-saharienne, les normes éthiques du commerce équitable semblent bien conformes à la vertu d’équité. En outre, on peut douter du fait que le commerce équitable conforte, par ses pratiques, une situation d’inégalité originelle : la relation d’échange s’inscrivant dans la durée, rien n’exclut que les communautés s’approprient de manière originale les normes éthiques imposées par les Occidentaux pour les appliquer à leur organisation sociale, faisant preuve, elles aussi, d’équité.
Dette et solidarité
Reprenant la question du rapport entre dette et solidarité, la dernière section de l’ouvrage porte plus particulièrement sur la manière dont la philosophie politique libérale, plus précisément celle de John Rawls, pense le problème de la réciprocité entre débiteurs et créanciers. Le cadre politique du contrat, qui garantit à la fois le consentement des individus au pouvoir souverain et leur liberté fondamentale, est-il satisfaisant ? C’est ce que se demandent Pierre Crétois et Cédric Rio dans le chapitre[xvi] qu’ils cosignent. Si les critiques des philosophes communautariens, comme celle de Michael Sandel[xvii], montrent avec pertinence que la conception rawlsienne du sujet moral fait de ce dernier un moi capable de formuler des principes formels de justice indépendamment de toute représentation substantielle du bien, elles manquent le fait que, pour Rawls, l’autonomie des individus serait impossible sans un environnement social et des institutions équitables, à l’égard desquelles ils sont donc redevables.
Autrement dit, la célèbre hypothèse de la position originelle derrière le Voile d’Ignorance[xviii] suppose certes une conception problématique du sujet, puisqu’il est moralement autonome dans la mesure où il est capable de se détacher de fins socialement conditionnées, mais il n’en demeure pas moins qu’il doit concrètement son autonomie à certaines institutions justes qui fondent le principe d’une redevabilité, d’une « dette sociale ». Le cadre contractualiste de la Théorie de la justice est par ailleurs mis à mal par l’idée, évoquée par Rawls lui-même[xix], d’une solidarité intergénérationnelle.
C’est cette question que reprend Antoine Verret-Hamelin, dans un chapitre[xx] qui analyse le paradoxe d’une dette mutuelle entre générations. En effet, comment parler de solidarité dans ce contexte, puisque, par définition, les générations futures ne peuvent pas affecter les précédentes ? Ce problème se pose avec d’autant plus d’acuité dans des philosophies (comme celle de Rawls) où la coopération sociale est assujettie au principe de réciprocité, puisque non seulement nous ne pourrons jamais nous acquitter de la dette que nous avons vis-à-vis des générations passées, mais il n’est pas certain que nous devions quoi que ce soit à des individus qui n’existent pas encore. Chaque génération a bien entendu intérêt à ce que la précédente n’ait pas été trop dispendieuse, mais le cœur du problème réside dans le fait que le comportement d’une génération ne changera rien à ce qu’elle a reçu de ses prédécesseurs, et que personne ne pourra revenir dans le passé pour punir ceux qui se sont comportés de manière irresponsable. La situation climatique actuelle nous enjoint à prendre au sérieux ces facteurs d’acrasie, surtout quand on sait que nos comportements délétères sont autant de bombes à retardement dont nous ne verrons pas les effets les plus délétères[xxi].
Pour résoudre ce problème, Antoine Verret-Hamelin commence par montrer les formes de solidarité qui existent entre deux générations contiguës. L’exemple analysé est celui des retraites par répartition fondées, non sur une obligation morale, mais sur un intérêt mutuel : éducation contre retraite. Néanmoins, cet exemple ne suffit pas à résoudre les deux difficultés déjà rencontrées ailleurs. D’une part, rien ne contraint la génération présente à faire peser sur la génération suivante des charges plus équitables, et inversement : chacune est tentée de « tirer sur la corde » jusqu’au point de rupture. D’autre part, cet exemple laisse entier le problème de notre passivité face à certaines de nos actions dont les effets ne se feront sentir que longtemps après notre mort. Or, pour l’auteur, c’est précisément parce que les générations futures représentent à nos yeux des sujets moraux qui seront amenés à évaluer nos actions qu’elles constituent pour nous un « horizon de sens ». En donnant un sens et une valeur à nos actions, ce futur nous oblige ; et si nous nous montrons dignes de lui, il sera, en un sens, notre débiteur.
Conclusion
D’une lecture agréable et stimulante, cet ouvrage se distingue donc par la diversité des approches par lesquelles la notion de dette est abordée, et par les prolongements que celle-ci implique dans des domaines aussi divers que la pensée économique, l’ontologie, la philosophie des religions, ou encore la philosophie politique et morale. Qui plus est, l’abondante bibliographie qui accompagne chacun des chapitres permettra au lecteur de prolonger sa réflexion dans des directions variées. On ne pourra que regretter, dans certains chapitres, la brièveté des conclusions en raison du format même du livre – conclusions qui feront l’objet de publications ultérieures, puisqu’elles sont le fruit de recherches en cours.
[i]Samuel Le Quitte, « La dette comme structure de l’existence : une perspective ontologique », dans Jean-François Bissonnette, Pierre Crétois et alii, La dette comme rapport social : liberté ou servitude, Lormont, Editions Le bord de l’eau, 2017, p. 23-41.
[ii]Id., ibid., p. 31.
[iii] Elettra Stimilli, « Economie de la dette et religion », ibid., p. 43-63.
[iv] Christian Marazzi, « Sulla natura linguistica della moneta », dans M. Pasquinelli (dir.), Algoritmi del capitale. Accelerazionismo, macchine della conoscenza e autonomia del commune, Verona, Ombre Corte, 2014, p. 158-182 ; Paolo Virno, Saggio Sulla negazione. Per un’antropologia linguistica, Torino, Bollati Boringhieri, 2013, p. 45.
[v] Michel Aglietta, André Orléan (dir.), La monnaie souveraine, Paris, Odile Jacob, 1998, p.7.
[vi] Elettra Stimilli, op. cit., p. 59.
[vii] Federica Gregoratto, La dette comme rapport social : liberté ou servitude, op. cit., p. 65-90.
[viii] David Harvey, Brève histoire du néolibéralisme, Paris, Les Prairies ordinaires, 2014.
[ix] Nancy Fraser, Fortunes of Feminism, From State-Managed Capitalism to Neoliberalism Crisis, New York, London, Verso, 2013, p. 220-221.
[x] Melanie Klein, « L’amour, la culpabilité et le besoin de réparation », dans Mélanie Klein et Joan Riviere, L’amour et la haine, trad. Par Annette Stronck, Petite bibliothèque Payot, 1968.
[xi] Federica Gregoratto, op. cit., p. 86.
[xii] Jean-François Bissonnette, « Le cadeau empoisonné : pour une pharmacologie de la dette », ibid., p. 93-122.
[xiii] Id., ibid., p. 95.
[xiv] Marcel Mauss, « Essai sur le don : Forme et raison de l’échange dans les sociétés primitives », dans L’Année sociologique, seconde série, 1923-1924.
[xv] Roberta Rubino, « La part de la dette dans le commerce équitable », dans La dette comme rapport social : liberté ou servitude, op. cit., p.123-144.
[xvi] Pierre Crétois et Cédric Rio, « Est-il conséquent de mobiliser le concept de « dette sociale » dans une approche de la justice libérale ? », dans La dette comme rapport social : liberté ou servitude, op. cit., p. 147-166.
[xvii] Michael Sandel, Le libéralisme et les limites de la justice, trad. par J.-F. Spitz, Paris, Seuil, 1999, p. 83 sq.
[xviii] John Rawls, Théorie de la justice, trad. par C. Audard, Paris, Seuil, 1987 (1971), p. 168-174.
[xix] Id., ibid., p. 329.
[xx] Antoine Verret-Hamelin, « Repenser la solidarité intergénérationnelle », dans La dette comme rapport social : liberté ou servitude, op. cit., p. 167-190.
[xxi] Id., ibid., p. 174-179.













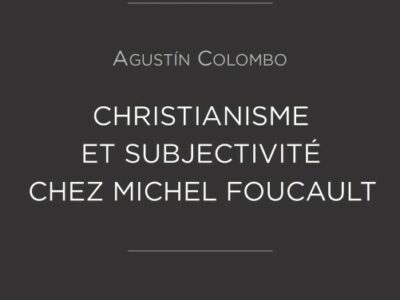

La dette a plusieurs utilités :
– elle permet un contrôle des salaires
– elle permet la baisse des dépenses sociales que l’on ne veut pas
– elle permet de faire taire les revendications
– elle permet de dédouaner le gouvernement (un peu comme l’UE) .
La paupérisation d’une partie de la population suite à cette politique en même temps qu’une publicité savamment orchestrée feront le succès du « moins cher » du « bon marché » ce qui favorisera les importations en provenance de pays aux coûts de fabrication bien inférieurs. Les Français font leur propre malheur.
Bref c’est jouer sur le sentiment d’insécurité et de culpabilité des Français à qui on n’a pas fini de faire honte. (ils sont conditionnés pour ça)
Bonjour,
Sur le même thème, je vous signale le livre de Maurizio Lazzarato, « La fabrique de l’homme endetté : essai sur la condition néolibérale » paru en 2011 aux Éditions Amsterdam. Lazzarato analyse l’emprise de la dette dans le néo-libéralisme en partant du deuxième traité de la « Généalogie de la morale » de Nietzsche, du livre III du Capital de Marx, de l’Anti-Œdipe de Deleuze et Guattari et du concept de biopolitique de Michel Foucault et montre que cette emprise, qui nécessite une subjectivation, est anti-productive et antidémocratique . Ce livre éclaire comment le monde occidental d’aujourd’hui est gouverné par la finance.