Recension – La conversation des sexes. Philosophie du consentement.
Elisa Rossi est étudiante en études anglophones à Sorbonne Université. Elle a également fait des études de philosophie, s’intéressant de manière particulière à la philosophie féministe et à l’esthétique.
Manon Garcia, La conversation des sexes. Philosophie du consentement, Climats, Paris, 2021, 300p
L’ouvrage est disponible ici.
Introduction
L’affaire Weinstein et le mouvement #MeToo ont contribué à remettre la question du consentement au cœur des relations intimes. Désormais, le consentement des parties est communément reconnu comme critère de démarcation entre sexe et viol, mais également sur le plan juridique dans certains pays occidentaux.
L’objectif de Manon Garcia dans La Conversation des Sexes est de proposer une « analyse conceptuelle méliorative »[1] du consentement : en reprenant l’expression de Sally Haslanger, l’autrice vise à dépasser l’analyse descriptive pour « établir à quel type d’entreprise normative et émancipatrice ce concept peut servir » (p.26). Dans un contexte où le consentement semble s’affirmer dans le débat sur les relations sexuelles comme un outil d’émancipation, il s’agit en particulier de préciser à quelles conditions et dans quelle mesure ce concept peut effectivement remplir ses promesses.
I. Conceptualiser les violations[2] sexuelles : le sexe non-consenti est-il du viol ?
1. Contre un binarisme entre sexe et viol
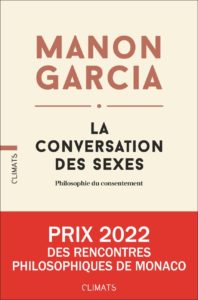 Le mouvement #MeToo s’inscrit dans la continuité d’un effort entamé à la fin des années 1960 par les consciousness raising groups, des groupes de parole féministes ayant pour objectif la prise de conscience de l’oppression du patriarcat. Dans des moments et avec des modalités différentes, ces deux mouvements ont contribué à la déconstruction des croyances liées aux violations sexuelles. En particulier, au « scénario du parking » (p.17) qui verrait le viol comme un évènement relevant de l’exceptionnel et le violeur comme un déviant inconnu de sa victime, ces deux mouvements ont opposé des témoignages d’expériences liées à des (ex-) conjoints, des frères, des pères – en un mot, à des personnes connues de leurs victimes qui ne correspondaient pas à l’image caricaturale du violeur. En parallèle, on assiste à une redéfinition du viol et plus largement des violations sexuelles : la scène médiatique de l’après #MeToo a vu l’apparition de l’expression « zone grise » pour décrire cet ensemble d’expériences qui, sans qu’elles relèvent du viol à proprement parler, correspondent toutefois à des situations problématiques sur un plan moral et potentiellement traumatisantes pour les victimes. En reprenant ici Nicola Gavey, l’autrice qualifie ces expériences comme se trouvant dans un « entre-deux » et contribuant à la perpétuation de « l’échafaudage culturel du viol »[3]. De ce fait, elle s’inscrit dans la continuité de la tradition féministe qui envisage un continuum entre sexe et viol, dont ce dernier serait le cas extrême.
Le mouvement #MeToo s’inscrit dans la continuité d’un effort entamé à la fin des années 1960 par les consciousness raising groups, des groupes de parole féministes ayant pour objectif la prise de conscience de l’oppression du patriarcat. Dans des moments et avec des modalités différentes, ces deux mouvements ont contribué à la déconstruction des croyances liées aux violations sexuelles. En particulier, au « scénario du parking » (p.17) qui verrait le viol comme un évènement relevant de l’exceptionnel et le violeur comme un déviant inconnu de sa victime, ces deux mouvements ont opposé des témoignages d’expériences liées à des (ex-) conjoints, des frères, des pères – en un mot, à des personnes connues de leurs victimes qui ne correspondaient pas à l’image caricaturale du violeur. En parallèle, on assiste à une redéfinition du viol et plus largement des violations sexuelles : la scène médiatique de l’après #MeToo a vu l’apparition de l’expression « zone grise » pour décrire cet ensemble d’expériences qui, sans qu’elles relèvent du viol à proprement parler, correspondent toutefois à des situations problématiques sur un plan moral et potentiellement traumatisantes pour les victimes. En reprenant ici Nicola Gavey, l’autrice qualifie ces expériences comme se trouvant dans un « entre-deux » et contribuant à la perpétuation de « l’échafaudage culturel du viol »[3]. De ce fait, elle s’inscrit dans la continuité de la tradition féministe qui envisage un continuum entre sexe et viol, dont ce dernier serait le cas extrême.
2. « Just say no » : qu’est-ce que (ne pas) consentir ?
Considérer le consentement (ou plutôt, son absence) comme une condition suffisante pour parler de viol nous expose à une difficulté de nature communicationnelle. Manon Garcia mobilise encore une fois le texte de Nicola Gavey, qui montre les failles des slogans contre les violations sexuelles incitant les victimes à « juste dire non ». Cette injonction ne tient pas compte des normes sociales qui entourent le refus : en effet, les normes de politesse et les conventions sociales nous amènent à privilégier une formulation indirecte ou même une excuse plutôt que « non », qui apparaît souvent comme une réponse brusque et abrupte[4]. Plus encore, cette injonction ne tient pas compte des attitudes qui sont normalement associées à la féminité, telles que la complaisance et la gentillesse. Celles-ci sont l’opposé du refus radical, qui impliquerait au contraire une mise en avant de sa propre volonté et, de ce fait, une opposition à la féminité telle qu’elle est construite et perpétuée par l’hétéro-patriarcat. Ce dernier ne peut en fait manquer d’être pris en compte dans une analyse du consentement, dans la mesure où il s’agit d’une force qui façonne à la fois la société tout entière, mais également le concept de consentement lui-même. La manière dont les femmes sont socialisées crée un déséquilibre au sein de la notion de consentement, qui risque de devenir une « coquille vide » (p.181), et « d’être utilisé d’une manière qui dissimule les injustices de genre » (p.27).
II. Pour une conversation des sexes
1. « Safe, sane and consensual » : détour par le BDSM
Dans le troisième chapitre de l’ouvrage, l’autrice propose un rapide détour par l’analyse des pratiques BDSM (acronyme de « bondage et discipline, domination et soumission, sadomasochisme »). Elles constituent un cas pratique intéressant du fait des différents enjeux qu’elles mobilisent (notamment moral et juridique) et de la place centrale qui y occupe le consentement – véritable « pierre de touche » du BDSM (p.87). La validité et la permanence du consentement y seraient garanties par des éléments comme l’utilisation de safe words (c’est-à-dire des mots qui auraient la fonction de manifester sans équivoque la cessation du consentement de l’une des parties et la conséquente demande d’arrêter la scène) et le recours à la pratique contractuelle. Le contrat ici montrerait de manière particulière la nature fictive du rapport de soumission, du fait de son inspiration libérale : contractualiser présuppose en effet que les parties sont sur un pied d’égalité, et qu’elles se reconnaissent réciproquement comme autonomes. Cependant, ces contrats trouvent une limite dans leur manque de valeur juridique contractuelle puisque, dans le domaine du droit pénal, le consentement de la victime n’est pas suffisant pour annuler une infraction. Le droit européen se base en fait sur la notion de dignité humaine qui, élevée à droit fondamental, délimite le champ du choix individuel : or, certaines des pratiques inscrites dans les contrats BDSM seraient passibles de sanctions en vertu de l’article 222-1 du Code pénal contre la torture et la barbarie. À ce propos, Manon Garcia illustre un possible questionnement de la hiérarchie entre dignité humaine et consentement dans le droit européen à travers deux exemples de décisions de la Cour européenne des droits de l’homme. Cependant, malgré le revirement de jurisprudence, il n’est pas question de dépenalisation du BDSM, et le rapport entre consentement et dignité humaine continue de susciter le débat.
Par ailleurs, dans le contexte des dynamiques de pouvoir de l’hétéro-patriarcat, la puissance émancipatrice du BDSM a été remise en question. En particulier, ces rapports qui relèvent à l’origine d’une sexualité subversive finissent souvent par répliquer ces mêmes structures sociales de domination qu’ils visaient à subvertir : à ce propos, Manon Garcia se réfère aux données fournies par une étude quantitative de psychologie[5] qui montre que, si chez les hommes 33,4% se définissent comme soumis et 48,3% comme dominants, de l’autre côté chez les femmes 75,6% se définiraient comme soumises et seulement 8% comme dominantes[6].
2. La conversation comme dépassement du modèle antagoniste
Les rapports BDSM s’inscrivent donc dans une révolution sexuelle inachevée. En reprenant Catharine MacKinnon[7], l’autrice identifie l’un des problèmes fondamentaux de la révolution sexuelle dans son « ambivalence pour les femmes » (p.145). Malgré des avancées fondamentales, la libération sexuelle n’apparaît pas aussi complète pour les femmes que pour les hommes. Le consentement, de plus, « ne remplit pas toutes ses promesses » (p.223) : si le débat contemporain propose de faire du consentement l’étalon pour évaluer la moralité des relations sexuelles, cette solution n’apparaît pas comme complètement dépourvue d’obstacles. Il est nécessaire de tenir compte de la dimension intrusive du genre dans le concept, et cela contre la possible dérive qui verrait le consentement comme un instrument pour freiner le désir incontrôlable des hommes. Cela revient en fait à mobiliser l’idée issue du patriarcat d’un désir masculin naturel et indomptable (« comme une force liquide ou gazeuse irrépressible »[8]), en remettant ainsi la responsabilité de le délimiter entre les mains des femmes. Parallèlement à ce modèle, un format d’inspiration contractualisante apparaît. Celui-ci envisagerait les relations intimes sous le prisme d’un « échange quasi marchand » (p.224), où les participants à l’acte renonceraient les uns envers les autres à leur droit à l’intégrité physique. Dans un tel modèle « capitaliste » comme le définit l’autrice, les risques et les surprises seraient minimisés au profit d’un échange de services. Cependant, cela entraînerait également la disparition de l’amour et du désir, avec un consentement « comme pris entre un modèle sexiste de l’amour à l’ancienne et un modèle capitaliste de la rencontre entre individus absolument indépendants ».
Le dénominateur commun entre ces deux conceptions est leur vision antagonisante du rapport entre partenaires, contre laquelle Manon Garcia propose une troisième voie. En s’inspirant de l’étymologie du mot (cum sentire, « sentir ensemble »), elle envisage le consentement « comme accord et comme respect de l’autre » (p.224) qui se déroulerait sur le modèle d’une conversation.
III. Repenser la sexualité à travers le prisme du consentement comme conversation
1. Les difficultés et les limites du droit pénal
Dans la discussion du dernier chapitre sur le meilleur modèle à adopter pour promouvoir cette nouvelle vision du consentement comme conversation, l’autrice reprend l’analyse de la réponse apportée par le droit. Au cours des chapitres précédents on avait pu remarquer que, contrairement à d’autres pays et malgré une tendance croissante dans ce sens, il n’est pas question de consentement dans la législation française contre le viol. Celui-ci est en fait défini dans l’article 222-23 du Code pénal comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise » : c’est donc à partir du langage commun que la notion de consentement est devenue partie intégrante de la définition du viol et des violations sexuelles. Ce transfert entre sens commun et sens juridique donne lieu à une ambiguïté entre les deux, qui peut donner l’illusion qu’un transfert aisé du problème du domaine moral et politique au domaine judiciaire serait possible. À ce propos, Manon Garcia s’interroge sur la pertinence de la réponse juridique, qui serait en fait insuffisante en raison des difficultés spécifiques intrinsèquement liées à la nature du crime : en particulier, la difficulté de l’établissement à la fois de la preuve du consentement et de l’intention de l’agresseur (ce qui est défini dans le droit comme l’élément moral de l’infraction, et qui la qualifie d’intentionnelle ou non intentionnelle) constituent deux écueils auxquels se heurtent bon nombre de procédures judiciaires portant sur des agressions sexuelles. Si une amélioration dans le domaine est souhaitable (notamment en ce qui concerne l’intention mentionnée ci-dessus), l’autrice souligne qu’aucune solution immédiate ne se présente pour corriger les difficultés rencontrées par la réponse judiciaire.
2. Vers une transformation sociale
Dans la conclusion d’On ne naît pas soumise, on le devient[9], Manon Garcia avait considéré le problème juridique comme l’un des trois problèmes du consentement sexuel. En citant les chiffres fournis par le Ministère de la Justice (selon lesquels seuls 3% des viols déboucheraient sur un procès en cour d’assises), elle avait posé la question suivante : « comment faire pour que les cas de viol, d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel soient effectivement punis comme la loi le prévoit ? […] En somme, comment faire pour s’assurer que la norme juridique qu’est le consentement […] soit respectée ? »[10]. En concluant son excursus sur le consentement dans La conversation des sexes, elle s’interroge de nouveau sur la pertinence de la réponse apportée par le droit. Celle-ci ne serait qu’une solution parmi une pluralité de réponses possibles, et pas nécessairement la plus pertinente : elle semble notamment inapte à corriger les injustices de la « zone grise », et plus encore elle n’apparaît pas comme le meilleur instrument pour accéder à la conversation. En particulier, face aux insuffisances de la réponse apportée par le droit et du fait de la nature politique des problèmes posés par le sexe et le viol, on pourrait trouver davantage de solutions dans le changement des normes sociales. La source de cette déduction de l’autrice se trouve dans le changement « modeste mais réel » inspiré par le mouvement #MeToo vis-à-vis de la « prise en compte sociale » des violations sexuelles. Par conséquent, Manon Garcia indique que plutôt qu’une amplification de la réponse pénale aux violations sexuelles, il serait plus souhaitable d’envisager « un changement social de grande ampleur » et « la remise en cause de la domination sociale des hommes sur les femmes » (p.252). Dans ce cadre, le consentement reste dans son « potentiel émancipateur imparfait mais réel » comme un outil d’une « nouvelle conversation érotique entre égaux » (p.252).
Conclusion
Dans la conclusion de son livre, Manon Garcia revient à « l’analyse conceptuelle méliorative » de Sally Haslanger qu’elle avait citée en ouverture : La conversation des sexes fait du concept de consentement un outil à la fois d’appréciation de la complexité des relations érotiques et de lutte contre les violations sexuelles.
L’autrice observe que « le consentement ne remplit pas toutes ses promesses » (p.223) dans la mesure où il ne correspond pas toujours, dans la pratique, au rôle qui lui est attribué par le sens commun – notamment celui de critère de démarcation net entre sexe et viol, d’outil qui garantirait un accès direct à une sexualité morale et épanouie. Néanmoins, le consentement nous permet de « dessiner un horizon éthique » (p.223) : Manon Garcia conclut son analyse en faisant du consentement sexuel « un concept à manier avec précaution mais qui porte en lui les promesses d’une révolution sexuelle qui, cette fois-ci, serait une libération de toutes et de tous » (p.256).
L’ambition de Manon Garcia est de montrer que la conscience de l’influence des normes sociales de genre sur nos vies est nécessaire si on espère « aimer mieux et plus librement » (p.28). Dans ce sens, La conversation des sexes atteint l’objectif visé : le livre offre un panorama complet de la question du consentement dans ses multiples facettes, en pointant du doigt les difficultés que le concept soulève. Si ces difficultés ne trouvent pas une réponse immédiate dans la reformulation du consentement comme conversation, celle-ci indique tout de même une direction à suivre vis-à-vis de l’objectif à atteindre sur le long terme, c’est-à-dire le changement des normes sociales.
Bibliographie
Garcia, Manon (2018). On ne naît pas soumise, on le devient. Flammarion.
Gavey, Nicola (2019). Just sex? The cultural scaffolding of rape. Routledge, Taylor & Francis Group.
Haslanger, Sally (2000). Gender and race: (what) are they? (what) do we want them to be? Noûs, 34(1), 31–55.
MacKinnon, Catharine A. (1989). Sexuality, pornography, and method: « Pleasure under patriarchy. Ethics, 99(2), 314–346.
Vörös, Florian (2020). Désirer comme un homme : Enquête sur les fantasmes et les masculinités. La Découverte.
Wismeijer, Andreas A.J., & van Assen, Marcel A.L.M. (2013). Psychological characteristics of BDSM practitioners. The Journal of Sexual Medicine, 10(8), 1943–1952.
[1] Haslanger, Sally (2000). Gender and race: (what) are they? (what) do we want them to be? Noûs, 34(1), 31–55.
[2] Nous suivons ici le choix de l’autrice, qui préfère utiliser l’expression « violations sexuelles » car « une partie considérable des violations de l’autonomie et de l’intégrité sexuelle n’est pas violente au sens physique du terme » (p.201).
[3] Gavey, Nicola (2019). Just sex? The cultural scaffolding of rape. Routledge, Taylor & Francis Group.
[4] Ibid.
[5] Wismeijer, Andreas A.J. & van Assen, Marcel A.L.M. (2013). Psychological characteristics of BDSM practitioners. The Journal of Sexual Medicine, 10(8), 1943–1952.
[6] Le restant 18,3% pour les hommes et 16,4% pour les femmes se définissant comme switch (assumant une posture différente selon le cas).
[7] MacKinnon, Catharine A. (1989). Sexuality, pornography, and method: « Pleasure under patriarchy”. Ethics, 99(2), 314–346.
[8] Vörös, Florian (2020). Désirer comme un homme : enquête sur les fantasmes et les masculinités. La Découverte.
[9] Garcia, Manon (2018). On ne naît pas soumise, on le devient. Flammarion.
[10] Ibid.














