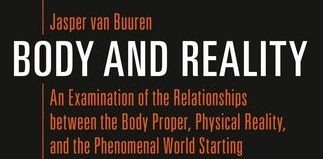Recension – La conscience a-t-elle une origine ?
Florian Forestier
Michel Bitbol La conscience a-t-elle une origine ? Des neurosciences à la pleine conscience : une nouvelle approche de l’esprit Éditions Flammarion Bibliothèque des Savoirs 2014
Directeur de recherches au CNRS, Michel Bitbol a suivi une carrière multiforme. Docteur en médecine en 1980, docteur d’Etat en physique en 1985, habilité à diriger des recherches en philosophie en 1997, il a travaillé longtemps au centre de recherche en épistémologie appliquée de l’École polytechnique (CREA), dont il a été directeur adjoint aux côtés de Jean Petitot. Il est actuellement membre des Archives Husserl de Paris, et participe aux conférences du Mind and Life Institute, qui promeuvent le dialogue entre la science et le bouddhisme.
Ses études de médecine et de physique, ses recherches en biophysique l’ont peu à peu conduit vers la philosophie, à la fois dans le domaine de l’épistémologie (philosophie de la physique et de la mécanique quantique en particulier) et dans celui de la philosophie de l’esprit. Traducteur et introducteur d’Erwin Schrödinger, il publie en 1996 une introduction philosophique à la mécanique quantique, suivie en 1998 par des travaux sur le statut du réalisme en physique, puis en 2000 par une étude aux interfaces de la mécanique quantique et de la philosophie de l’esprit.
Proche collaborateur de Francisco Varela dans les années 1990, il poursuit le travail de celui-ci sur les problèmes de la cognition incarnée et du développement d’une neurophénoménologie et d’une épistémologie de la connaissance en première personne. Ses deux derniers ouvrages, De l’intérieur du monde (Flammarion, 2010) et La conscience a-t-elle une origine (Flammarion 2014) poursuivent le projet plus ambitieux d’une refonte générique de la conception de l’homme dont l’activité, même scientifique, est toujours activité située, contextuelle, à l’intérieur du monde.
Cette contextualité ne compromet pourtant en rien la vocation d’objectivité de la science mais invite à interroger plus finement son statut et sa dimension dispositionnelle.
Les impensés du débat portant sur la conscience
Quel est, demande l’auteur, l’impensé du débat actuel en philosophie de l’esprit sur la possibilité de réduire la conscience à un processus neuronal ? Ce débat n’est-il pas originairement biaisé par la façon dont il se pose, en refoulant toujours déjà l’expérience subjective, fût-elle celle du neurologue ou du philosophe en train de débattre d’elle, pour lui substituer un concept ou une image ?
Pour Michel Bitbol, les stratégies discursives et argumentatives des principaux protagonistes du débat (en particulier D. Dennett, dont les thèses radicales servent de paradigme) sont tout aussi importantes que les débats menés. C’est en effet d’une part par la façon dont sont prédéfinis les concepts (la conscience, la nature, etc.), d’autre part par l’invocation implicite d’évidences de l’esprit scientifique qui sont également ses impensés, que les scientifiques en question défendent, à partir de données factuelles, des conclusions de nature métaphysique.
Plus globalement, suggère Michel Bitbol, ce débat est nourri par une crispation propre à l’ethos occidental tendant à opposer strictement l’objectif et le subjectif. Ce sont ainsi des pulsions d’ordre quasi-culturel qui tendent à réifier l’objet de la connaissance comme un « en face » dont on serait assuré de la stabilité. La rationalité occidentale se caractérise par le triomphe de la pulsion de distanciation, de désengagement, au détriment de la pulsion d’immersion, de connivence, de continuité. Un tel geste de distanciation initial permet certes de traverser le voile des apparences, mais la connaissance parvenue à son niveau actuel de développement, doit apprendre à nuancer cette distanciation.
Il n’est pas question ici de résumer chacune des quatorze parties de l’ouvrage dont on tentera plutôt d’exposer les thèses principales en invoquant à leur appui certains des développements les plus représentatifs.
Décrisper la pulsion à l’objectivation : un projet amorcé dans De l’intérieur du monde
Pourquoi, demandait déjà l’auteur dans De l’intérieur du monde[1], avons-nous tant de mal à tenir ensemble la compréhension naturaliste du fonctionnement de notre conscience, les motivations génétiques et biologiques des processus de mises en forme que nous appliquons à notre expérience pour en faire la science, et les horizons de normativité intrinsèque de ces sciences ? Pourquoi la perspective naturaliste et la perspective transcendantale normative semblent-elles s’exclure, pourquoi nous sentons-nous contraints d’opposer la catégoricité a priori impliquée dans toute pratique scientifique et les déterminations biologiques que ces mêmes sciences décèlent au sein de nos activités de recherche ?
Cette crispation, soulignait Michel Bitbol, procède de la réticence à prendre au sérieux l’inscription subjective de la mise en forme transcendantale. Le transcendantal désigne la façon dont le subjectif s’élève à l’objectivité en en construisant l’horizon. Il est l’horizon de l’absolu et de la vérité, mais n’a pas lui-même à être fondé ; le sujet empirique qu’étudient les sciences cognitives n’est pas le sujet transcendantal révélant les mises en formes a priori que présupposent ces mêmes sciences. Le transcendantal désigne l’inscription de la vérité comme horizon et le cadre au sein duquel celle-ci s’inscrit comme horizon.
L’historicité des motivations de l’institution d’un tel horizon ne préjuge en rien de sa validité une fois ouvert, dans la mesure où il n’est pas autre chose que l’institution de la problématique même de la validité qui n’a pas de sens à être posée hors de lui. Pour autant, cette institution ne peut être sous peine de contradiction performative être relativisée tout d’un bloc. Le rapport au réel qu’institue la science récuse d’avance sa relativisation pragmatico-linguistique ; qu’il n’y ait pas de sens à passer au dessus du dispositif transcendantalo-objectivant n’interdit en rien l’auto-transcendance qu’il implique comme sa propre pratique, sa propre norme téléologique interne.
Ainsi, la pratique scientifique procède de quelque chose de bien plus puissant que l’institution de normes contractuelles grammaticales et opératoires. Elle relève d’une disposition d’ensemble à l’égard du vécu, d’une position subjective orientée vers l’extériorité des choses perçues et la légalisation de celle-ci. C’est dans l’être au monde et dans une structure expérientielle rencontrant non pas des ombres, mais des choses appréhendées sous l’horizon de leur objectivité indépendante que s’enracine leur catégorialisation.
Soulignons-le encore ; cette disposition subjective n’invite pas nécessairement au scepticisme. S’il faut croire en la science pour la pratiquer, ce n’est pas non plus que la science est une croyance (on ne peut pas faire de la science sans y croire), mais bien que l’horizon scientifique s’inscrit dans une configuration subjective qui ne le contredit en rien, du moment que nous reconnaissons l’hétérogénéité et la multiplicité essentielle des dispositions subjectives.
Ici, l’important n’est pas de les préserver les unes des autres, d’opposer à la science toutes sortes de pratiques et de traditions qu’on ne lui oppose qu’en les faisant d’abord parler son langage, mais de réconcilier la science avec une subjectivité qui n’est pas d’abord un domaine parmi d’autre mais l’apparaître comme champ, comme ouverture de toute objectivation. La vérité n’a pas d’autre lieu que la subjectivité, mais elle s’y inscrit en tant que vérité ; en tant que ce à quoi le sujet se soumet comme ce dont il ne décide pas mais qu’il ne peut atteindre que par une discipline.
Il ne s’agit plus ainsi d’opposer l’origine empirique de nos catégories que la science semble nous imposer, à l’horizon d’universalité a priorique qu’ils ouvrent, mais de se demander ce qui nous pousse à considérer comme incompatibles subjectivité et objectivité, origine empirique et mise en forme transcendantale. Ici, c’est la pulsion objectivante à l’origine du développement scientifique qui est amenée à se mettre en contradiction avec elle-même en revenant sur son enracinement subjectif pour lui imposer la même mise en forme qu’aux autres domaines auxquels elle s’est appliquée.
Les contradictions d’une science de la conscience
L’étoffe empirique de la subjectivité constituée en objet cherche à refouler l’indexicalité absolue de positions subjectives de celui qui s’oriente vers des choses qu’il considère comme stables et légalisables.
Pour établir une science de la conscience, il faut à l’instant même être dans une disposition existentielle particulière impliquant de considérer l’étoffe du vécu actuel comme une apparence à traverser. Il faut secondariser le simple fait d’être soi-même là et pensant, en oubliant du même coup que nous visons l’objectivité seulement parce que nous sommes à cet instant en train de croire à la science comme structure de validité absolue, que nous nous fions à un legs intersubjectif de connaissances et d’expériences factuelles à partir duquel nous tirons les conclusions que nous tirons.
Le regard, dès l’enfance, s’éduque par l’incitation d’une société elle-même prise dans un processus historial. Il s’éduque à repérer et poursuivre l’identique dans le divers, à constituer sur cette base des pôles invariants qu’il articule selon des relations logiques et modélisables (Husserl, Expérience et jugement). Mais cette pulsion finit par se mettre en question elle-même avec la science contemporaine, d’une part en mécanique quantique (dont les résultats deviennent ininterprétables en terme d’une réalité indépendante de l’acte qui l’objective, montre l’auteur dans Mécanique quantique, une introduction philosophique[2]) et d’autre part en philosophie de l’esprit où la question du sujet apparaît comme une insoluble aporie.
L’important dès lors n’est certes pas d’opposer à la science toutes sortes de pratiques et de traditions plus ou moins mystiques, mais de réconcilier d’abord conceptuellement la science avec une subjectivité qui n’est pas un domaine parmi d’autre mais l’ouverture de toute objectivation.
La stratégie du réducteur
Les contradictions de la philosophie de l’esprit sont symptomatiques des impensés d’un projet de monde. Qu’il s’agisse de poser la conscience comme un problème difficile hors d’atteinte de tout naturalisme (D. Chalmers), ou de le dissoudre, on est victime de la même confusion d’ordres de discours, car « (…) le langage est à la fois une composante du problème et le moyen de le poser, ce qui précipite la démarche philosophique dans le désarroi et la force à ne mettre aucune de ses prémisses à l’abri de la discussion ; pas même le choix fondateur de parler ou d’écrire » (p. 24, Chapitre 1, Quel langage pour la conscience ?).
La pensée de D. Dennett, qui propose tout simplement d’éliminer la référence à la conscience (qui n’est, au mieux qu’illusion, ou pire encore, rien du tout) offre à Michel Bitbol un terrain de confrontation intéressante. La stratégie de D. Dennett est révélatrice, par la façon surtout dont elle parvient à emporter l’adhésion de son lecteur. Ce sont, montre M. Bitbol, de véritables exercices spirituels auxquels D. Dennett nous convie afin de nous faire nier la réalité de la conscience. Nous sommes invités à nous mettre nous même en état de refouler nos réticences, à les considérer comme autant de traces d’enfance que nous objectivons nous mêmes pour les mettre à distance et nous en préserver.
La conscience, écrit D. Dennett, n’est pas ce que vous pensez. Elle n’a pas d’épaisseur, elle n’est pas positionnelle de contenus objectifs, elle n’est pas connaissable (ou plutôt : seuls sont connaissables les jugements narratifs qui la structurent). Mais précisément, demande M. Bitbol, pourquoi la conscience serait-elle réductible à ce qui en est connaissable, c’est à dire à quelque chose qui n’est déjà plus la conscience mais d’objectivations que nous en faisons-nous même dans nos compte-rendus d’expérience ? Pourquoi caractériser la conscience ainsi ? Et pourquoi, réciproquement, nier la réalité de ce qu’on a en vérité écarté d’emblée : l’expérience vécue elle-même dans sa fugacité et sa labilité ?
Dès le second chapitre (Peut-on « définir » la conscience ?), la thèse de la co-appartenance de la conscience et de la réflexivité est mise en cause à travers une discussion serrée de Descartes, Locke, Hume et Kant. Cette critique est précisée dans les parties 8 (Qu’est-ce que ça (ne) fait (pas) d’être un zombie ?) et 9 (Les théories neurologiques et évolutionnistes). Pourquoi, en effet, refuser toute importance à l’épaisseur vécue sous prétexte qu’elle n’est pas traductible en termes objectivants ?
Pourquoi n’accorder d’importance qu’aux objets et au jugement qui y établit continuité et structure narrative, au point, avec D. Dennett, de pouvoir faire comme s’il n’y avait que ce jugement, comme si on pouvait sans risque passer de la non-narrativité de l’expérience à la non-existence du non-narratif ? Pourquoi ne serait digne d’être appelée conscience que la mise en forme narrative de l’expérience, voire sa reprise méta-cognitive ? Pourquoi la continuité mnésique, la structure temporelle, que seule la reprise narrative impose, serait-elle le fin mot de la conscience ? Pourquoi le non mémorisé (ou non mémorisé dans sa distinction ré-identifiable) ne serait-il pas considéré comme vécu ? Pourquoi refuser d’appeler vécu ce que nous ne stabilisons ni n’extériorisons linguistiquement ?
Là encore, M. Bitbol met l’accent sur les stratégies argumentatives par lesquelles nous sommes conduits par avance à suivre un raisonnement qui omet dès l’entrée ce qu’il prétend réfuter, et sur les impensés (qui sont aussi des impensés sociaux) de ces stratégies. Sur ce terrain en effet, le philosophe autant que l’anthropologue ou le sociologue sont d’emblée placés en position défensive. Ils ne peuvent, dans un premier temps qu’affirmer et réaffirmer l’insistance d’une dimension non directement objectivable, mesurable, quantifiable, que leurs adversaires ont beau jeu de dénoncer comme mystique ou insignifiante.
Nous avançons, nous, au moins, assènent les positivistes dont la structure même d’évaluation des travaux universitaires conforte déjà la position et la démarche. Piégés par leur propre langage, les philosophes risquent de leur côté à tout instant de se laisser déporter d’une objection qu’ils ne peuvent qu’incarner, qu’ils ne peuvent conserver dans une doctrine. Comment défendre le non-objectivable dans un langage sommé jusqu’à l’excès d’être objectif ? : « (…) le physicalisme, chevauchant la fuite en avant de la connaissance scientifique, et épousant un ethos civilisationnel qui nous enjoint de ne pas tenir en place, semble avoir gagné la partie dès l’ouverture » (p. 684).
Le philosophe, à ce point, finit par céder à l’intimidation : la honte de ne pas produire de résultats, la peur de rester sur place quand tout le monde avance, le poussent à son corps défendant sur le terrain adverse de l’expérimentation, de la quantification, de la statistique et de la modélisation.
Ambiguïtés
La définition même de la conscience fait problème, et met en lumière, là encore, de nombreux impensés. On peut en effet selon la conception qu’on en donne faire remonter la conscience aux bactéries, la limiter aux grands singes, voire, la dater à certaines phases proto-historique correspondant à l’institution sociale de la subjectivité comme question (p. 420).
Dès lors, les exemples de situations aporétiques mettant en cause l’unité de la conscience et ses capacités réflexives sont d’un grand intérêt pour affiner la conception qu’on peut en proposer. Une longue discussion sur l’anesthésie (Chapitre 10 : Anesthésie, sommeil, coma : que suspendent-ils ?) précède ainsi une très intéressante discussion sur le statut de l’unité du moment présent. La conscience est-elle originellement synthétique ? N’est-elle qu’originairement synthétique ?
Un exemple illustre particulièrement bien la nécessité de ce réexamen (p. 480 et suivantes, chapitre 11, Quel genre d’unité a le moment présent ?). L’information visuelle, explique l’auteur, est différentiellement traitée. La perception visuelle appréhende séparément le mouvement, la couleur et la forme, au sein chaque fois d’aires cérébrales dédiées. Dans des conditions physiologiques normales, nous percevons des objets colorés et en mouvement. Toutes sortes de lésions mettent à mal cette unité et « dispersent » l’expérience visuelle, au point que certains auteurs invoquent au contraire une myriade pointilliste de micro-consciences dont le statut devient ontologiquement redoutable. En effet, concède Bitbol « (…) universaliser la notion de telles expériences latentes (…) comme est tenté de le faire un phénoménologue, relève dans un premier temps du pari, pour ne pas dire de la spéculation » (p.505), d’autant que la position, à maints égards séduisante, voire, fascinante, du panpsychisme (qui loge la conscience partout), ne peut servir de solution.
Mais alors, quel rapport entretien cette grêle de micro-conscience et la conscience unifiée de soi ? Quels processus invoquer pour comprendre leur liaison, leur mise en rythme, leur intégration, sans pour autant nier leur réalité distincte et granulaire ? Sont examinés, ici, certaines avancées des neurosciences (G. Rizzolati, V. Ramachandran et les neurones miroirs [3]qui s’activent en réaction à des comportements observés chez l’autre) mais ce sont bien finalement, avec P. Ricœur, les traits de l’expérience d’appropriation et de mise en intrigue par le sujet de ses propres vécus que l’auteur examinent avec le plus attention.
Il ne s’agit plus ici de ce qui est narrativement exprimé, mais de la façon dont différentes ébauches narratives s’approprient la conscience, la façon dont des éléments finissent par être reconnus comme vécus et par s’intégrer dans une (ou plusieurs) trames narratives : « (…) tout ce qui n’a pas trouvé place au sein de ce bloc dynamique de l’expérience-actuelle-dans-le-contexte-d’une-chronique-lui-donnant-sens, est soit inaccessible à partir de lui, soit agglutiné autour de lui comme autant de lambeaux de vécus en phase d’oubli ou de rejet dans le quasi-onirique » (p. 531).
Ainsi, « la structuration du vécu en épisodes flottants (…) rend compte du caractère apparemment extra-conscient de certains événements mentaux, sans pour autant limiter la portée du fait élémentaire que rien ne se donne jamais que comme conscient (…). La seule chose dont il s’agisse de rendre raison ici est que j’ai maintenant conscience d’une seule séquence cohérente mais limitée d’événements, alors que le champ d’expérience consciente et a priori tenu pour illimité. (…) La théorie des ébauches conscientes multiples confère aux données neurophysiologiques une signification nouvelle (…) » : ces assemblées de neurones ne sont pas « (…) le corrélat de la conscience (…) mais le corrélat de l’intégration des consciences fragmentaires autour du “centre de gravité narratif (et narrable)” qu’est le moi » (p. 538-539).
Rappeler à l’étoffe de la conscience
C’est bien alors vers la phénoménologie que se tourne l’auteur[4], moins sans doute, comme chez Husserl, comme source potentielle de connaissance que comme exercice d’attention où la conscience relâche sa focalisation et se redécouvre conscience incarnée : « (…) là où on est se montre dans l’apaisement des pulsions vers les ailleurs » (p. 507).
Mais cette phénoménologie est, dans l’influence revendiquée de Merleau-Ponty, élargie pour y trouver un statut aux descriptions produites par les neurosciences (chapitre 12 : Comment la nature est-elle nouée par et avec la conscience ?). Il s’agit, écrit l’auteur, d’enrichir la sémantisation comportementale associée aux événements neurologiques, et de comprendre, avec F. Varela, la signification de la quête de mise en correspondance signifiante des structures neuro-expérientielles (p. 551).
Le concept merleau-pontyen de chair est à cette fin élargi et transposé. La chair, pour Merleau-Ponty, est ce qui est visible et voyant, n’étant réductible ni à l’un ni à l’autre. L’analyse merleau-pontyenne du phénomène des deux mains se touchant est subtile : certes, écrit M. Bitbol, dans l’expérience de la main touchant l’autre chacune des deux mains est touchée et touchante, mais par l’attention portée, chacune l’est précisément à son tour. C’est bien ici la réversibilité que met en évidence Merleau-Ponty à travers le concept englobant de chair signifiant cette dynamique même sans fondement et sans dehors qui est repris. C’est bien la structure en chiasme de la chair que M. Bitbol entend ici reprendre, pour proposer de considérer selon une même grille chiasmatique la relation entre les descriptions en termes neuronaux et les descriptions expérientielles.
Nous devons, écrit-il, considérer les processus neuronaux comme une ligne de négation bordant l’éprouver« (…) le praticien de la phénoménologie hybride se donne pour but d’apprendre à assigner une place aux diverses modalités expressives de la chair constituante dans le système de coordonnées de son environnement d’objets constitués (…) (p. 596). « Dans une culture ayant intégré l’attitude réflexive et la capacité à en échanger verbalement le fruit, on ne recherchera plus l’origine de la conscience dans un processus objectif, mais, conformément à la figure du chiasme, on saura reconnaître le nœud redoublé de l’objectivation et de la conscience originaire en son unique fil de présence » (p. 661-662).
La mécanique d’une expérience déportée d’elle-même
Si l’auteur insiste abondamment sur le caractère anthropologiquement et donc socialement motivé des crispations objectivantes qui déporte la conscience hors d’elle-même, il fait peut-être cependant preuve de trop d’optimisme en espérant que la forme de réconciliation qu’il promeut ne s’impose hors d’un très petit cercle d’intellectuels et d’artistes, au prix, faut-il ajouter, d’efforts intellectuels et physiques intenses. Il se pourrait en effet que la radicalité du clivage de la conscience avec elle-même soit plus intense qu’il ne le postule, que l’itinéraire qu’il nous engage de suivre, absolument fascinant pour les intellectuels et les chercheurs prêts à jouer le jeu, soit par contre impuissant à enrayer un processus civilisationnel mobilisant des forces bien plus puissantes.
Evoquer, à ce titre, la figure de Lacan en contrepoint de celle de Merleau-Ponty est intéressant. Bien des travaux[5] ont montré la proximité des deux penseurs, et l’influence déterminante exercée par le phénoménologue sur le psychanalyste. Cependant, si le chiasme s’impose bien aussi dans la psychanalyse lacanienne sous la forme du ruban de Möbius, c’est, pour sa part, sur les points de rebroussement, de torsion, sur les déchirures de l’entrelacs[6] qu’il insiste. Le langage, insiste Lacan, introduit une coupure radicale.
Plus généralement, sans doute, c’est sur l’interprétation de ce processus de décentrement que M. Bitbol se place en porte-à-faux de ses prédécesseurs. C’est bien, au cours du XXe siècle, sur le caractère inexorable des processus qui arrachent l’homme à lui-même que des penseurs comme Freud, Heidegger, et d’autres encore ont insisté. L’homme est bien cet animal accidentel, dont la nature n’est que de s’indéterminer, de s’évider, de s’extérioriser, de mettre en scène de façon toujours plus complexe l’incapturable vide central de son expérience.
Cette relation à la technique, à l’écosystème de l’humain et du milieu technique, est en effet inséparable de la question ouverte par M. Bitbol. L’humain peut-il simplement se donner le temps quand le temps lui est arraché par la forme même que prend son être au monde ? Dès lors que l’homme ne s’adapte plus seulement à la nature avec l’objet technique, mais à l’objet technique par d’autres objets techniques (B. Stiegler[7]), est-il encore à-même, sinon lorsqu’il est protégé par des conditions exceptionnelles, d’amorcer ce long retour ?
Une autre observation, d’un autre ordre encore, pourrait être faite. Si le langage, comme semble le penser B. Stiegler, n’a pas été à lui seul la source d’un processus de clivage du soi, s’il n’a été qu’un aspect du mouvement plus vaste des processus physico-techniques et de leurs contreparties sociales, il se pourrait aussi que la narration langagière elle-même ne soit plus la forme privilégiée d’appropriation d’un vécu aujourd’hui magnétisé par d’autres processus.
L’atténuation même cérébrale (des travaux comme ceux de S. Dehaene insistant sur la proximité cérébrale des fonctions de la lecture et de l’image) de la distinction de l’écriture, du langage et de l’image amorce peut-être une crise dans la configuration même du soi et de sa narrativité, crise dans laquelle le rôle de la mémoire exacte et littérale (ce que B. Stiegler[8] appelle la mémoire orthographique et orthotétique) serait intégralement à revoir.
[1] Cf. notre recension : http://michel.bitbol.pagesperso-orange.fr/ActuPhilo.pdf
[2] M. Bitbol, Paris, Flammarion, 1997.
[3] Cf. à ce sujet notre recension de V. Ramachandran, Le cerveau fait de l’esprit. Enquête sur les neurones miroirs, Paris, Dunod, 2011 : http://www.actu-philosophia.com/spip.php?article345
[4] Ainsi que vers les démarches psychologiques réhabilitant les pratiques introspectives, trop vite éconduites quand on en examine précisément l’histoire, comme l’entretien d’explicitation mis au point par P. Vermersch (chapitre 13 : L’introspection est-elle possible ?).
[5] Cf. B. Baas, De la chose à l’objet, Peters, Louvain, 1998.
[6] B. Baas, Ibid.
[7] B. Stiegler, Ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue, Paris, Flammarion, 2009.
[8] B. Stiegler, La technique et le temps 2, La désorientation, Paris, Galilée, 1995.