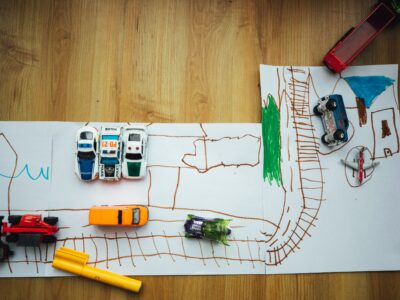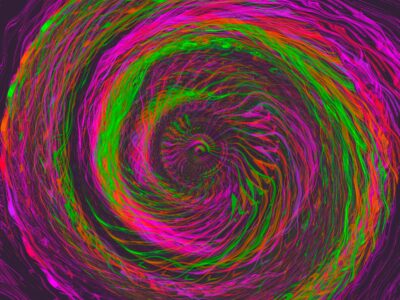Recension – Je est un nous. Enquête philosophique sur nos interdépendances avec le vivant.
Jason Dufrasne est titulaire d’un master en philosophie de l’UCLouvain et sera prochainement agrégé de philosophie. Il a travaillé en tant que chargé de missions pour l’Université de Liège dans le cadre d’un projet de recherche en Science ouverte. Actuellement, il prépare un projet de thèse sur la pertinence de la première personne en éco-phénoménologie.
Jean-Philippe Pierron, Je est un nous. Enquête philosophique sur nos interdépendances avec le vivant, Actes Sud, coll. « Mondes sauvages », février 2021, 176 pages.
L’ouvrage est disponible ici.
Témoin d’une société occidentale dont la culture ne reconnaît plus « son inscription dans la nature » (p. 43), le philosophe français Jean-Philippe Pierron appelle l’être humain, dès le Prologue, à écrire son écobiographie. Entre soi (bios) et l’écriture (graphie), s’intercale donc le milieu naturel (oikos) (p. 15). Cette écriture biographique fondée écologiquement, « faite de chair et de souffles, de parfums et de textures » (ibid.), a pour tâche de démêler et d’expliciter les liens que les êtres humains partagent irrémédiablement avec leur milieu naturel. Ce milieu naturel n’est pas qu’humain, c’est un espace commun où co-naissent et co-existent « diverses formes de vie », qu’elles soient de nature organique ou inorganique (p. 43).
 Il n’est dès lors plus question d’un « anthropocentrisme exalté » (p. 129 et p. 131), mais d’un sujet terrestre qui éprouve et participe aux textures sensibles et singulières de la nature (p. 131). Cette connivence entre sujets et objets, entre un soi et le monde, ouvre la possibilité de penser l’humain à partir de la Terre, plutôt que la Terre à partir de l’humain (p. 55). L’enjeu n’étant toutefois ni de disparaître dans le Tout naturel, ni de délivrer l’individu de ses liens avec l’ensemble des altérités qui l’excèdent (p. 15). Il s’agit plutôt de considérer l’être humain comme partie prenante d’innombrables relations et expériences fondamentalement polyphoniques (p. 17), comme « traversé par toutes les relations qu’il traverse, et qui parfois le bouleversent » (p. 33). Cette interpénétration du sujet avec le monde et ce qui le compose manifeste une énigme inouïe, indépassable, mais d’abord et surtout commune, car elle concerne la vie de tous les êtres. C’est au sein de cette polyphonie du monde que l’être humain éprouve, résonne, s’engage, se découvre et au bout du compte, s’exerce à se raconter par l’écriture et au travers de ses « appartenances charnelles avec la texture des vivants » (p. 16). Le décentrement est ainsi énoncé : le narrateur autrefois omniscient, est aujourd’hui un témoin privilégié de cet attachement polysensoriel au monde naturel (p. 52).
Il n’est dès lors plus question d’un « anthropocentrisme exalté » (p. 129 et p. 131), mais d’un sujet terrestre qui éprouve et participe aux textures sensibles et singulières de la nature (p. 131). Cette connivence entre sujets et objets, entre un soi et le monde, ouvre la possibilité de penser l’humain à partir de la Terre, plutôt que la Terre à partir de l’humain (p. 55). L’enjeu n’étant toutefois ni de disparaître dans le Tout naturel, ni de délivrer l’individu de ses liens avec l’ensemble des altérités qui l’excèdent (p. 15). Il s’agit plutôt de considérer l’être humain comme partie prenante d’innombrables relations et expériences fondamentalement polyphoniques (p. 17), comme « traversé par toutes les relations qu’il traverse, et qui parfois le bouleversent » (p. 33). Cette interpénétration du sujet avec le monde et ce qui le compose manifeste une énigme inouïe, indépassable, mais d’abord et surtout commune, car elle concerne la vie de tous les êtres. C’est au sein de cette polyphonie du monde que l’être humain éprouve, résonne, s’engage, se découvre et au bout du compte, s’exerce à se raconter par l’écriture et au travers de ses « appartenances charnelles avec la texture des vivants » (p. 16). Le décentrement est ainsi énoncé : le narrateur autrefois omniscient, est aujourd’hui un témoin privilégié de cet attachement polysensoriel au monde naturel (p. 52).
À présent investie par toute la « fragilité du monde » (p. 18), l’écobiographie prend la forme d’une écopoétique. Cette dimension poétique de l’écobiographie valorise la pratique de la retranscription du monde vécu à la première personne (p. 17) et elle « travaille à réparer, à rendre visible et soutenir la qualité de tous ces liens à la nature qu’elle intensifie en imagination » (p. 27). En rendant visible cette relation sentie avec la biodiversité, l’écobiographie « rouvre la possibilité de la narration » et cultive une compréhension d’un soi élargi (ibid.). Parallèlement, elle « peut être dénonciatrice des formes de malheurs industriels » (p. 29), en se plaçant en porte-à-faux par rapport au modèle extractiviste de la société moderne tardive (p. 51) qui fonde son lien à la nature à travers l’exploitation et l’épuisement des ressources naturelles (p. 29).
En raison de la distanciation et de l’objectivation du sujet moderne dans son rapport à soi et à l’altérité, Pierron nous invite à vivre une relation sentie avec soi-même au milieu du monde des vivants. De l’objectivation à l’interrelation, de l’égologie à l’écobiographie, de la « vérité de science, objective, argumentée, mais neutre » (p. 41) à la vérité d’existence, subjective, « ayant une portée pour notre vie » (ibid.), ces passages sont autant de chemins empruntés par la philosophie du professeur de l’Université de Bourgogne pour que nous nous mettions « à l’écoute de tous ces êtres et liens qui nous constituent intimement » (p. 18). A contrario, manquer cette relation avec le monde vivant soulève des enjeux psychopathologiques, tels que l’écoanxiété (p. 40), précisément parce que « notre psyché, notre biographie mémorise et incorpore au plus profond de soi ce qui a été abîmé du monde en dehors de soi » (ibid.).
Cette écobiographie n’est pas qu’énoncée et définie rigoureusement, elle est également vécue par l’auteur et racontée par le nouage de trois fils narratifs organisés en deux volets qui s’alternent successivement jusqu’à la conclusion du livre. Le premier volet sert de contrepoint, alors que le second tient lieu de chapitre tissé à l’aune des expériences écobiographiques du philosophe. C’est ainsi que dans les cinq contrepoints, ce sont des philosophes et penseurs/euses de l’environnement qui sont mobilisé·e·s comme exemples, et ce, afin d’évoquer leur écobiographie singulière et de mettre en évidence « une expérience de nature très intime » (p. 18). Ce n’est que dans le second volet, à travers les cinq chapitres qui succèdent un à un aux cinq contrepoints, que Pierron ourdit le fil de son écobiographie, pour finalement glisser son récit dans le sillage des pensées formulées par les auteur·e·s qu’il a réuni·e·s. Par ce troisième fil narratif, il écrit son histoire à partir des « élaborations conceptuelles, parfois très sophistiquées » des autres écobiographes (p. 18). Pierron s’octroie ainsi la possibilité de se raconter et de mettre « en phrases et en textes » (p. 15) ses propres accordages avec la nature. Tout en montrant au passage que la pratique écobiographique n’est ni le bénéfice de certains privilégiés, ni tributaire de la méditation du seul philosophe (p. 17-18). Avant l’écobiographie, et finalement, avant toute philosophie, il y a la vie, car pour écrire son histoire, il faut vivre. Plongeons-nous dès lors dans ce vivre qui se raconte grâce à deux des écobiographes choisi·e·s par notre auteur : le forestier et écologiste étasunien, Aldo Leopold, et la philosophe écoféministe australienne, Val Plumwood.
Avec Aldo Leopold en second contrepoint, Pierron nous partage la complexité d’apprendre à penser comme une montagne[1]. La naissance de toute écobiographie admet la précédence d’une rencontre, c’est-à-dire d’une « jonction des connivences du sujet et du monde » (p. 21). Ancrée charnellement dans et avec le monde, la rencontre de l’être humain avec ce qui l’excède suppose donc un espace dans lequel un décentrement du soi est possible. Ainsi, penser comme une montagne, c’est laisser « quelque chose » d’autre que soi prendre place en nous, par l’imagination, et la laisser naître, apparaître et ultimement (co)exister. Penser comme une montagne, c’est considérer l’existence de l’altérité en termes de participation plutôt que sur le mode d’une séparation (p. 50). Le sujet s’ouvre à ce qui l’entoure et à ce qui se donne dans son champ perceptif. Par cet appui phénoménologique nouveau pour la perception humaine, l’anthropocentrisme devient tout à coup caduque pour donner lieu à une connivence dans laquelle co-naissent et co-apparaissent le sujet autant que la montagne. Ce qui était auparavant décor est devenu, avec Leopold, agent et « personnage principal de l’histoire » (p. 51). L’écobiographie est pénétrée et transformée par ce qui excède l’être humain : vie inorganique, végétaux et animaux, dans toute leur diversité, ont à présent (ré)investi les lieux et ont pris place dans ce régime de co-appartenance au monde naturel au sein duquel l’humain s’ancre dans toute sa chair. D’autres formes de vie s’articulent dans la narration biographique, d’autres temporalités, d’autres rythmes, s’inscrivent dans « la partition invisible de nos existences » (p. 54). À l’instar de la musique jazz qui introduit plusieurs temporalités distinctes qui co-existent harmonieusement, la partition pierronnienne invite à une forme de réesthétisation de la nature et à une multiplication des « approches sensibles du milieu » (p. 53), laissant le champ libre aux sonorités des autres existences pour se chorégraphier (chora) dans des lieux de rencontre singuliers que tous les êtres traversent ensemble (p. 43).
Dans cette logique d’ouverture et de participation de tous les êtres vivants, Leopold insère « un opérateur écobiographique : l’almanach » (p. 50). Contrairement au planning, l’almanach apparaît comme une figure laissant place aux événements du monde et à « une rythmique cosmique » (p. 53), permettant à la temporalité d’être retrouvée et d’accueillir la surprise, ici et maintenant. Par cette autre façon pour l’humain de se comprendre, de se narrer et de se coordonner, le temps vécu qui était jusqu’alors quantifié, devient qualifié (p. 52-53). En instaurant « une logique d’inclusion de l’homme dans la nature, valorisant la présence animale » (p. 50), et en s’extrayant de la « logique d’exclusion, valorisant la figure humaine et préparant exploitation et prédation » (ibid.) instaurée par la modernité, le sujet s’ouvre à un autre ordre du temps, cette fois-ci initié par la nature et par d’autres formes de vie, au point de former ce qu’Aldo nomme « une communauté biotique » (p. 51).
Avec la mobilisation de Val Plumwood en quatrième contrepoint, l’épreuve des diverses formes de vie dans le temps présent atteint son paroxysme. Ce n’est plus un décentrement du point de vue du sujet vers la montagne, mais une perception depuis l’œil du crocodile[2]. La perspective habituelle est tout à coup renversée : ce n’est plus l’humain qui fait de l’animal une proie, mais l’humain qui devient soudainement la proie de l’animal. L’enjeu écobiographique de l’événement qu’a vécu Plumwood dans l’East Alligator River du Kakadu National Park consiste alors à « transformer en événement biographique le fait biologique d’être une proie » (p. 87). Cet exercice de transformation du fait biologique par l’écriture écobiographique n’a pas pour fin d’amenuiser la violence de la rencontre brusque et immédiate avec le crocodile. Même si la réalité vécue fut celle d’être tout bonnement « attaquée (…) pour être dévorée » (p. 88), il s’agit bel et bien de laisser ce vécu singulier résonner en elle, dans et par l’écriture. Ce décalage par l’entremise de la narration autobiographique lui permet de montrer que l’être humain, autant que le saurien, ont tous deux une place dans la chaîne alimentaire (p. 87). Ce vécu a une portée « ontologique et existentielle » (p. 89). Il redéfinit « les contours de l’intériorité » (ibid.) et favorise l’élargissement de la compréhension de soi. Cette « prise de conscience radicale » (p. 88) conduit Plumwood à l’écriture singulière de son entre-affectivité particulière avec un être dont les besoins sont drastiquement opposés. Dans tous les cas, c’est dans cette relation interspécifique que la narration écobiographique de Plumwood offre la possibilité de « laisser résonner la proximité, la connivence non ignorante de la prédation et du tragique avec la multitude des vivants » (p. 94).
De tels regards et de telles attitudes de la part de ces écobiographes à l’égard de la vie ne peuvent qu’entrer en contradiction avec le paradigme dominant de « la physique mathématique et [des] sciences de l’ingénieur » (p. 21) qui ont transformé « les qualités sensibles du monde naturel » en « des propriétés physiques » (ibid.). Or, dans l’écobiographie, il est de prime abord question d’une écriture intime et poétique du monde vécu. C’est par l’exercice de l’écriture que l’œil du crocodile devient une métaphore (p. 95) ;
« une métaphore vive qui dépasse la seule référence aux choses par l’intermédiaire d’un concept, parlant à la fois à notre imagination, à notre sensibilité et à notre conceptualité, pour exprimer des proximités, un air de famille » (ibid.).
Cette écriture de soi dépend d’une intimité qui repose sur les liaisons à d’autres formes de vie, à des lieux et à des moments aussi singuliers les uns que les autres. Revenir à l’expérience vécue à la première personne et à l’attachement à « la polysensorialité de nos expériences de nature » (p. 28), c’est « rouvrir la possibilité de la narration » (p. 30), c’est valoriser l’ouverture à de nouveaux liens ontologiques, s’enrichir de nouveaux imaginaires, plutôt que de faire triompher l’inlassable désir de prédation et d’exploitation marchande (p. 50).
En somme, l’écobiographie pierronnienne est écologique et politique, en plus d’être éthique, car la narration de soi avec la nature environnementale permet à cette dernière de résonner poétiquement en nous (p. 34). Cette résonance des textures de la nature dans notre chair nous densifie et c’est justement cette densification qui octroie au poète, et à tout écobiographe, d’offrir de nouvelles images, sonorités et discours vis-à-vis du monde vécu et des dispositifs technologiques (p. 36). C’est ce travail de l’imagination et de l’écriture qui ouvre la voie à de nouvelles raisons de nous activer et de soutenir l’agir environnemental (p. 27).
Une transformation est cultivée dans cette monographie, celle du déplacement de la rationalité instrumentale vers l’expérience singulièrement et communément vécue, de la relation visible et objectivée vers la relation invisible et sentie avec notre milieu naturel. C’est dans la contiguïté « avec d’autres vivants non humains » (p. 14), autant avec l’organique que l’inorganique, que les êtres humains se découvrent co-existant et co-appartenant à un « faire monde commun » (p. 20). C’est par ce souci ontologique du soi ancré dans des relations singulières et contingentes que nous préservons la spontanéité et l’imprévu constitutifs de la vie sur Terre (p. 100) et que, ultimement, nous vivons authentiquement en laissant les autres êtres vivre. Pour « découvrir ce qui compte par ce que l’on conte » (p. 147), Jean-Philippe Pierron préconise in fine de soutenir les institutions politiques qui organisent des expériences de nature et qui déploient des écobiographies collectives (p. 151). Qu’attendons-nous pour reconnaître que notre capacité à dire Je est éminemment tributaire de l’adhésion à un nous aussi vivant que vivifiant ?
[1] Aldo Leopold, « Penser comme une montagne », dans Almanach d’un comté des sables, trad. fr. Anna Gibson, Flammarion, Paris, 2020, pp. 169-172.
[2] Val Plumwood, L’œil du crocodile, extrait de The Eye of the Crocodile, ANU Press, Acton, 2012, trad. fr. Marie Cazaban-Mazerolles, Terrestres, 16 janvier 2019, https://www.terrestres.org/2019/01/16/loeil-du-crocodile/.