Recension – Dynamique de la manifestation
Thomas Maurice
Renaud Barbaras, Dynamique de la manifestation, Paris, Vrin, 2013, 356 p., 32 €.
Si, pour Marc Richir, le travail phénoménologique consiste en la suspension de la « rage de conclure »[1], selon la belle expression de Flaubert, soit à mettre entre parenthèses toute explication qui pourrait venir trahir le caractère inopiné de la phénoménalité pour s’ouvrir, selon Richir, à son caractère irréductiblement sublime et éphémère, on pourrait dire que Renaud Barbaras se situe aux antipodes de cette conception et fait de cette rage un véritable mot d’ordre de cette discipline (au double sens de méthode et de doctrine), rage seule capable justement de donner libre accès aux tréfonds de la phénoménalité. Il ne s’agit pas, bien entendu, de retomber dans un dogmatisme naïf pré-phénoménologique, mais bien seulement de suivre l’a priori universel de la corrélation jusqu’au bout pour obtenir des acquis définitifs au sujet de la phénoménalité. Tous les travaux de Renaud Barbaras sont en effet sous-tendus par une ferme volonté de faire œuvre de conclusion, c’est-à-dire de trouver des réponses et de ne pas en rester à de simples parenthèses suspendues dans le vide, de fonder la phénoménologie au moment même de son dépassement.
Œuvre de conclusion, Dynamique de la manifestation[2], le dernier ouvrage de l’auteur, l’est au moins à deux titres. Tout d’abord, il l’est d’un point de vue bibliographique. Il clôt, provisoirement, l’entreprise qui s’est initiée en 1999 avec Le désir et la distance, qui s’est poursuivie avec Introduction à une phénoménologie de la vie et qui a été scandée par les “ livres-transition ”, Vie et intentionnalité et La vie lacunaire. Dynamique de la manifestation est une escale sur les terres aventureuses de la métaphysique, c’est-à-dire à ce qui n’est pas attestable phénoménologiquement. Tout était parti de la phénoménologie de la perception et avait mené le penseur et le lecteur sur les sentiers d’une cosmologie de la vie. Nous voici parvenu sur les rivages d’une métaphysique du désir, du sujet, d’une métaphysique respectueuse des coordonnées de la corrélation phénoménologique, mais prenant le risque d’un chemin escarpé sur les bords de l’abîme, puisqu’il s’agit de comprendre au final le sujet des apparitions comme le sans-raison par excellence.
C’est enfin une œuvre de conclusion en un deuxième sens. Dépasser Husserl à partir des principes husserliens. « Il faut demeurer résolument husserlien »[3], malgré et contre Husserl : voilà un des gestes essentiels de Renaud Barbaras. S’il est vrai que le mot d’ordre phénoménologique de « retour aux choses mêmes », initié par Husserl dans les Recherches logiques, implique le recours aux Principe des principes — principe selon lequel toute intuition donatrice originaire, c’est-à-dire toute perception, est source de droit pour la connaissance —, cela requiert de ce fait même la thématisation expresse de l’a priori universel de corrélation entre l’apparaissant transcendant et ses apparitions. Et, en phénoménologie, tout part et doit partir de la corrélation. C’est donc en prenant comme creuset la logique propre de la corrélation entre l’apparaissant et ses apparitions que Renaud Barbaras compte, dans son livre Dynamique de la manifestation, développer la rigueur propre à la phénoménologie, la prolonger vers une cosmologie et la clore en une métaphysique. N’eût été le piétinement méthodologique de Husserl, qui l’empêcha de mener à bien son projet, c’était pourtant bien ce à quoi voulait déboucher le fondateur de la phénoménologie : une authentique métaphysique phénoménologique.
Une stratégie du zigzag, l’antilogique du clignotement
Dynamique de la manifestation est un livre tout à la fois complexe et limpide. Limpide pour celui qui est quelque peu rôdé au jargon phénoménologique et qui n’a pas peur de certains néologismes, mais également pour celui qui aime la clarté d’un raisonnement, qui apprécie la démonstration qui vient nourrir et éclairer l’attestation phénoménologique ; complexe, car la sinuosité de l’argument est l’exacte décalque des entrelacements de la corrélation, qui renvoient sans cesse de l’apparaissant aux apparitions, sans jamais savoir où s’évanouit l’un et où disparaissent les autres.
Ainsi, en un mouvement en zigzag par lequel Husserl lui-même caractérisait la démarche phénoménologique, le sens d’être que nous conférerons aux pôles de la corrélation conformément à celle-ci retentira sur la signification de leur relation, ce qui permettra d’approfondir et d’infléchir en retour le sens d’être initialement défini.[4]
C’est un ouvrage qui se veut aussi récapitulatif, en un sens presque hégélien (malgré l’orientation résolument anti-dialectique de l’auteur). Les auteurs auxquels Renaud Barbaras s’est confronté tout au long de ses livres et articles antérieurs sont convoqués un à un et conjurés, avec respect, mais sans complaisance. Husserl bien sûr, Merleau-Ponty, Bergson, Sartre, Patočka ; tous passent devant le tribunal de la corrélation et doivent répondre de leur fidélité théorique à cette co-appartenance entre l’apparaissant et ses apparitions.
Mais qu’est-ce que cette corrélation phénoménologique qui appelle un « a priori universel » ? Cela signifie tout d’abord qu’il ne s’agit en aucune façon d’une simple relation, que celle-ci soit de nature conjonctive, causative ou simple juxtaposition, mais d’une corrélation au sens fort donc de co-appartenance. Un apparaissant se donne dans ses apparitions, une réalité se monnaie dans ses moments de manifestation ; autrement dit, quelque chose apparaît à quelqu’un, quel que soit le degré d’indéterminité de ces deux pôles, transcendant et subjectif. Voilà l’évidence première et absolue de la corrélation. Une réalité qui n’apparaîtrait pas du tout, d’une quelconque manière, ne pourrait être attestée phénoménologiquement et devrait être rabattue au rang de pure fiction abstraite ou candide. C’est d’ailleurs cette récusation du fantasme métaphysicien ou de la naïveté naturelle en quoi consiste l’épochè phénoménologique, i.e. la neutralisation des croyances concernant la « nature » de la réalité en dehors de son apparaître, ce que Husserl appelle la « thèse du monde ». Ne pas croire à la substantialité en soi du monde n’enlève rien à son apparaître. Il demeure comme structure universelle des apparitions. On l’aura compris : la situation décrite par la corrélation implique un double mouvement ou un clignotement[5], commandant une antilogique du phénomène. Le mouvement de l’apparition est de renvoyer totalement vers l’apparaissant, mais l’apparaissant lui-même n’est pas autre que le flux de ses apparitions. C’est cette oscillation, ce porte-à-faux fondamental faisant glisser de l’un à l’autre, qui fait tout le jeu de l’apparaître. Dans un style très finkéen, Renaud Barbaras résume d’un trait :
Au fond, la scène est celle du monde, les protagonistes en sont les apparitions elles-mêmes et la partie consiste à faire apparaître, à faire et à défaire des choses. Mais celles-ci sont toujours à la merci […] de l’incessant renouvellement des apparitions.[6]
Phénoménologie dynamique et dynamique phénoménologique
Que la corrélation soit en son essence mouvement, cela signifie, selon Renaud Barbaras, que le phénomène est toujours emportement vers quelque chose, malgré son indéterminité radicale, et qu’il faut prendre au sérieux cet élan qui ne se trace un chemin qu’en dépassant toute position. Il ne s’agit pas là d’un mouvement fortuit qui ne chercherait que son aboutissement, c’est-à-dire son extinction, et que nous ne pourrions suivre, en raison du souffle court de la clôture méthodologique stricte de la phénoménologie. Il est bien plutôt question d’un mouvement qui ne trouve son sens que dans ses dépassements et qui doit, en toute rigueur, être suivi par le phénoménologue jusqu’à ses relais cosmologique, puis métaphysique, parce qu’il se présente à nous comme cette série de forçages et de passages à la limite.
C’est également la raison pour laquelle il faut désubjectiviser radicalement le mouvement du phénomène, le mouvement comme condition et effectuation du phénomène, car la conscience n’est finalement que la retenue de ce mouvement, l’indice de son fondamental retard, la trace de la position qui vient d’être dépassée et transcendée — l’indice que toute position ne peut être qu’un écho ou une ombre et que la phénoménalité doit être envisagée de façon exclusivement dynamique.
Être en mouvement, ou plutôt se mouvoir, c’est être du monde sans être nulle part situé en son sein : c’est manifester une appartenance qui n’est pas de l’ordre de la localisation. Seul le mouvement permet donc de penser une appartenance qui n’exclut pas mais fonde au contraire la possibilité d’une phénoménalisation. Le mouvement est la seule modalité d’être permettant d’échapper résolument à l’alternative de l’intériorité et de l’extériorité par rapport au monde, au partage du transcendantal et de l’empirique.[7]
Ainsi donc, si nous n’avons plus à considérer le phénomène comme un vécu, comme ce genre d’étant caractérisé en son essence par l’absoluité de sa position d’être, si nous posons ainsi les fermes fondations d’une véritable phénoménologie asubjective[8], alors il faut admettre un « moment » du phénomène (au sens structural et non chronologique), qui ne relève pas ou plus du vécu. C’est par conséquent ce qui peut jeter les bases, dans le procès de phénoménalisation, d’une différence entre une manifestation primaire, qui n’est pas vécue comme telle mais y participe nécessairement — manifestation primaire qui selon Renaud Barbaras, ne peut consister qu’en un apparaître anonyme, en une radicale absence de destinataire, simple procès d’autodifférenciation, de co-délimitation des étants les uns par rapports aux autres, qui se nourrit de lui-même et en lequel les étants gardent quelque chose du fond, une « charge pré-individuelle » pour reprendre la terminologie de Gilbert Simondon —, et une manifestation secondaire, qui va en revanche constituer le vécu d’un sujet vivant — à condition ici d’entendre « vécu » dans son sens neutre, non spécifique, et comme ce retard originaire, justement, par rapport à la manifestation primaire. En abandonnant ainsi la thématisation étroite du phénomène comme vécu pour penser ce dyadisme de la manifestation (entre manifestation primaire et secondaire[9]), on abandonne par la même occasion tout risque d’idéalisme et de réalisme naïfs[10], par une pensée de l’appartenance d’un sujet dynamique à un monde processuel qui en constitue le sol et, en conséquence, par une position théorique qui assume de devoir considérer tout mouvement comme phénoménalisant. On s’ouvre alors, grâce à cette phénoménologie dynamique — qui est donc tout autant, et même plus, dynamique phénoménologique[11] —, au phénomène de la vie, à la vie comme phénoménalisation :
Il ne s’agit plus d’abandonner l’existence naturelle du monde au profit de la région conscience, ni même l’une et l’autre au profit d’un champ phénoménal autonome, mais bien de suspendre le mode d’être que la conscience et le monde ont en commun et qui les condamne à exister l’un en dehors de l’autre, au profit d’un mode d’être original et plus originaire, qui n’est autre que celui du mouvement lui-même. La radicalisation de l’épochè coïncide avec la mise au jour d’une dimension dynamique au cœur du sujet phénoménalisant et, par voie de conséquence, avec l’instauration d’une phénoménologie dynamique.[12]
L’archi-événement métaphysique de l’avènement du vivant
C’est par cette archi-vie du monde qui engendre le procès unitaire de phénoménalisation, qui génère son propre tissu primordial et toujours palpitant, que nous rencontrons la complicité ontologique du sujet et du monde. Il nous est certes loisible d’abstraire plusieurs moments, mais il n’y a qu’un seul procès vital, et pour ainsi dire cosmogonique. L’unité de cette dynamique de la manifestation est la clef de ce monisme cosmogonique, à comprendre comme procès de mise-en-monde, schématisme aveugle, producteur de phénomènes par individuation et détermination, au sein duquel le vivant n’est qu’un relais terminal mais non suffisant, fondamental mais « imprépensable » (pour reprendre l’expression schellingienne), que rien n’attendait, ni ne pouvait prévoir. Et si le monde produit sans discontinuer des étants qui demeurent en procès d’individuation, il n’en va pas de même du sujet. Sa puissance de phénoménalisation n’est que l’envers de son impuissance radicale de production de réalité. Le vivant est une puissance finie et son autonomie n’est que le signe de sa fragilité ontologique (c’est d’ailleurs exactement ce en quoi consiste sa finitude)[13]. Il ne peut compter que sur lui-même, que sur son mouvement même pour perdurer et c’est à ce prix, d’une mobilité que rien ne peut interrompre en son principe, d’un désir inextinguible, qu’il est porté vers l’étant et le fait paraître. C’est à ce prix que le monde est monde apparaissant. Mais il faut bien comprendre que c’est précisément parce qu’il n’ajoute rien à l’étant, qu’il ne peut le modifier en rien, d’une quelconque façon au niveau ontologique, que le désir peut justement le faire paraître comme tel. Si c’est bien le monde lui-même qui paraît et non une représentation ou un vécu, une image ou un mirage, bref autre chose, c’est parce que, comme le dit Renaud Barbaras, le sujet est ce rien qui vient s’interposer au sein même du procès producteur de monde, ne s’en séparant donc pas, n’y ajoutant rien, mais n’en étant précisément pas que le strict décalque absolument invisible et inconsistant, parce qu’il change toute la donne du monde, tout le donné du paraître. C’est en ne changeant rien à l’apparaître du monde que le désir le transforme du tout au tout, le faisant passer d’un se manifester anonyme à une manifestation pour un destinataire.
Mais d’où peut donc provenir cette événementialité foncière, ce caractère irruptif de l’étant singulier qu’est le vivant, appelé à induire cette rupture, cette séparation totalement inattendue dans le continuum mondain, cette “ baisse de régime ” dans la surpuissance cosmique (puisqu’il faut bien qu’une partie du monde perde, inopinément, de sa surpuissance pour ne plus avoir le pouvoir de rien faire d’autre que de faire paraître) ? Vouloir y trouver une explication, c’est en fait vouloir enchaîner le désir à une causalité et ainsi le rendre esclave du principe de raison suffisante — alors qu’il y est par essence réfractaire : c’est même sans doute cela son seul trait strictement eidétique, comme cela a été démontré dans Le désir et la distance. C’est vouloir réintégrer au tissu du monde ce qui en a été irrémédiablement arraché ; c’est vouloir interpréter en termes ontologiques, c’est-à-dire cosmologiques, ce qui ne peut que relever d’une métaphysique. Au contraire, pour Renaud Barbaras, le sujet, comme désir, est le sans-pourquoi et le sans-raison par excellence ; et il doit en être ainsi, car autrement ce serait le régime de la légalité qui prendrait le pas sur la facticité, transcendantale, et donc absolue, du sujet[14]. L’avènement d’un apparaître pour quelqu’un ne serait plus de l’ordre de la réalité insurmontable et irréfutable, mais une simple itération occasionnelle qui, en droit, pourrait, comme toute règle, être contournée ou brisée. Le Malin génie n’est-il pas, après tout, ce grand tricheur universel[15] ? Si l’on souhaite donc conserver l’apodicticité du sujet, malgré, ou plutôt en vertu même, de sa totale déréification par la prise en compte de sa nature de part en part dynamique, c’est-à-dire désirante, alors il faut faire droit à un archi-événement, qui aura eu fait irruption dans le tissu de l’archi-mouvement du monde et ainsi fêlé l’unité de l’archi-vie, en créant de la sorte la “ place ” du sujet au sein d’une corrélation, qui est ce rien tout à la fois infime et abyssal.
Il ne s’agit cependant pas tant d’un radical dehors, qui instituerait alors un au-delà de la manifestation, mais bien plutôt d’une souveraine contingence, du caractère absolument imprévisible de l’archi-événement. Cet archi-événement produit dès lors un mouvement inverse au mouvement premier, à la manifestation primaire, à la proto-phénoménalisation, tout en venant pourtant l’actualiser dans une phénoménalisation de plein droit, dans un apparaître subjectif. On a donc bien affaire ici à un monisme de la phénoménalisation, monisme ouvert, qui n’est pas refermé sur lui-même, puisqu’il est capable d’accueillir le dyadisme de la manifestation que nous évoquions plus haut, qu’il fait place, bon gré mal gré, à cette irruption qui vient cependant l’accomplir[16]. C’est bien là toute l’énigme qu’il y a à penser.
[1] M. Richir, « De la négativité en phénoménologie », in Annales de phénoménologie 12/2013, Amiens, Association pour la promotion de la Phénoménologie, p. 119.
[2] R. Barbaras, Dynamique de la manifestation, Paris, Vrin, 2013. Noté DM.
[3] DM, p. 62.
[4] DM, p. 31.
[5] Terme que l’on trouve pour la première fois, à notre connaissance, sous la plume de Barbaras et qui est amplement usité chez Richir, jusqu’à se confondre parfois avec le fond de sa propre pensée. Nous y voyons, pour notre part, une possible voie de conciliation entre ces deux phénoménologies asubjectives, qui recherchent dans les profondeurs pulsatives du monde, ou des mondes, le secret de la donation de la réalité.
[6] DM, p. 52.
[7] DM, p. 83.
[8] Nous reprenons bien sûr l’expression de Patočka ; cf. « Le subjectivisme de la phénoménologie husserlienne et la possibilité d’une “ phénoménologie asubjective ” », ainsi que « Le subjectivisme de la phénoménologie husserlienne et l’exigence d’une “ phénoménologie asubjective ” », in J. Patočka, Qu’est-ce que la phénoménologie ?, Grenoble, Jérôme Million, 2002. .
[9] La thématisation expresse des deux genres de manifestation n’a été élaborée par Barbaras qu’au cours de L’ouverture du monde. Nous parlons bien ici d’un “ dyadisme ”, et non pas d’un dualisme, car il est question de la complémentarité et de la polarité, en aucune façon de la seule dichotomie, entre deux moments principiels de la manifestation.
[10] On pourrait avancer que Barbaras élabore en ce sens un archi-réalisme, non pas bien sûr au sens d’une réification de l’archè, mais bien plutôt en tant qu’il y a chez lui, un archaïsme de la réalité. La réalité est toujours plus vieille qu’elle-même, en ce qu’elle est réalisation de l’archè. La réalité se prémédite dans les entrailles du monde, dans les contractions de l’archi-vie. En cela, la philosophie barbarassienne est tout aussi bien un anté-idéalisme, au sens où l’apparition se précède elle-même et se fomente dans un passé toujours plus vieux qu’elle. Pour se convaincre de tout ceci, cf. DM, p. 229 : « Ce n’est pas l’apparaître qui repose sur le sujet, mais le sujet qui repose sur l’apparaître ; il ne peut faire paraître à sa façon que parce que les choses sont déjà apparues, parce que le monde les a fait paraître en les faisant être et, en ce sens, il recueille bien une phénoménalisation qui est plus ancienne que lui ».
[11] « En ce sens, la phénoménologie dynamique, qui comprend le mouvement comme essence de la subjectivité, débouchera nécessairement sur une dynamique phénoménologique qui mettra à profit les acquis de la première pour ressaisir l’essence de tout mouvement et finalement de la mobilité elle-même, pour découvrir en elle cela même qui est à l’œuvre dans le mouvement du sujet, à savoir précisément une phénoménalisation. Alors que, pour la première, la phénoménalisation subjective implique un mouvement, la seconde sera conduite à comprendre tout mouvement comme un mouvement de phénoménalisation. Seulement, il va de soi que la phénoménalisation ne pourra avoir le même sens de part et d’autre, sauf à renoncer au partage même du sujet et du monde et, avec lui, à la phénoménologie. », DM, p. 93. C’est Renaud Barbaras qui souligne.
[12] DM, p. 84.
[13] Cf. DM, pp. 263 sq.
[14] Sur ce point, Barbaras renvoie, à plusieurs reprises, dans DM (cf. par ex. p. 288), à la phrase de von Weizsäcker, que citait souvent Maldiney, à savoir : « Nous ne croyons pleinement qu’à ce que nous n’avons vu qu’une fois […]. Toute répétition affaiblit la croyance. Elle éveille le soupçon d’une légalité, non d’une réalité ».
[15] On notera que c’est sans doute sur cette question de l’apparaître subjectif et de sa radicale événementialité que pourrait s’initier une confrontation entre la pensée de Renaud Barbaras et celle de Marc Richir — l’irruption du Malin Génie jouant en effet chez ce dernier le rôle de la menace hyperbolique, toujours possible et qui pourtant semble impossible que je ne sois pas.
[16] Nous avons jusqu’ici, et nous continuerons à le faire, évoqué le dyadisme de la manifestation, en le contrebalançant par le monisme de la phénoménalisation. Mais il nous faut noter de suite que nous pourrions inverser ces termes et parler d’une proto-phénoménalisation, complétée d’une phénoménalisation de plein droit, comme nous venons de le faire un peu plus haut. Chez Barbaras, le terme de manifestation ou celui de phénoménalisation (et même celui de monstration) sont à peu de choses près interchangeables et leur interversion ne nous est utile que pour montrer l’imbrication de la thèse moniste et de la thèse dyadiste dans ce cadre de pensée, thèses dont la complémentarité sert à les neutraliser l’une l’autre. C’est donc ce que l’on pourrait nommer, à la suite de Barbaras dans différents textes, un monisme phénoménologique post-dualiste.


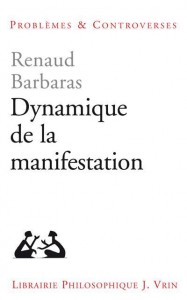













Juste parfait, l’interprétation, l’apparaissant, et le livre corrélatif, l’apparaître : en palpitation. Cependant une remarque : pourquoi disjoncte-t-on (palpitons) entre corrélatifs ? Parce que par exemple, réellement il y a des peintures (surfaces plates / couleurs donnant l’illusion du volume), et des miroirs (original reflété / reflet intelligible). Et une autre : l’original peint et le rendu en peinture ne sont pas corrélatifs parce qu’au moins un coup d’œil physique est nécessaire. Il y a des choses correspondant à l’ontologie, pas seulement du désir.