Recension – Deleuze, penseur de l’image
Florian Gaité est ATER en Esthétique et Philosophie de l’art à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et chercheur associé à l’Institut ACTE.
Judith Michalet, Deleuze, penseur de l’image, Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, 2020.
L’ouvrage est disponible ici.
Philosophe influent du cinéma et de la peinture, exégète des œuvres de Rouch, de Resnais, de Godard, d’Antonioni, de Pasolini comme de Bacon et de Cézanne, Deleuze présente la particularité d’avoir pensé l’image sous le régime exclusif de l’immanence, c’est-à-dire comme une pure présence. Dans un premier ouvrage tiré de sa thèse de doctorat, Judith Michalet questionne avec rigueur les implications conceptuelles de l’affranchissement de Deleuze à l’égard du paradigme traditionnel de la représentation, avec l’idée que l’image renvoie systématiquement à un tiers extérieur (le modèle, Dieu ou l’idée) dont elle signifierait l’absence. L’image est au contraire présentée dans le logiciel théorique deleuzien sans transcendance ou extériorité, ni fonction médiatrice, un paradoxe ici traduit à travers un questionnement net et précis : que signifie « une image qui ne serait ni un signe de quelque chose, ni un signe pour lui-même ? Comment penser une image qui serait directement quelque chose ? » (p. 10). Néanmoins, sous l’apparente simplicité de sa formulation se dévoile rapidement la complexité des enjeux qu’une telle problématisation soulève. Ceux-ci sont d’une part internes à l’œuvre de Deleuze dont rien n’autorise a priori à en faire un « penseur de l’image », ainsi que le qualifie Judith Michalet dans son sous-titre. Si les commentateurs de l’esthétique deleuzienne[1] s’accordent généralement bien avec elle pour souligner l’importance de la conceptualisation de l’image au fil de son œuvre et la particularité de la penser comme strictement immanente[2], force est néanmoins de constater qu’aucun n’en a fait une entrée de premier plan dans le discours de Deleuze sur l’art. La philosophe mobilise de ce fait assez peu leurs travaux et ne discute avec qu’eux que ponctuellement, préférant tracer sa propre voie interprétative. D’autre part, bien que le livre soit clairement un ouvrage de spécialiste, ses enjeux dépassent le seul cadre de l’expertise herméneutique, car c’est en creux une révision de la pensée contemporaine du visuel qui se dessine, fondée sur le constat de la caducité de la désignation traditionnelle de l’image comme icone, signe ou symptôme. Essentiellement abordées à partir du discours de Deleuze sur le septième art, les thèses interrogées par Judith Michalet posent ainsi la question de la postérité de l’image après la métaphysique et de la transformation de ses régimes affectifs, perceptifs et conceptuels qu’elle implique.
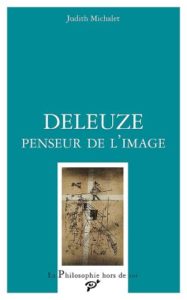 La pertinence de l’ouvrage tient à la position de Judith Michalet, qui pense constamment avec et contre Deleuze, mais aussi à la réévaluation de la proximité de celui-ci avec la psychanalyse et à la mobilisation d’un corpus critique ultra-contemporain (Rancière, Didi-Huberman, Spivak ou Butler) qui en interroge l’actualité. Avec Deleuze, elle déplie scrupuleusement les formes de son immanentisme radical en consolidant notamment la place centrale de Bergson parmi ses sources et ses influences[3]. L’auteur de Matière et Mémoire et de L’évolution créatrice décrit en effet des processus d’intensification vitale produits par la perception que l’autrice présente comme la matrice théorique de la pensée visuelle de Deleuze, celle qui fait de la « rencontre » avec l’image[4] l’événement moteur d’une transformation subjective. Mais Judith Michalet pense aussi contre Deleuze, au sens où elle livre une lecture critique de son œuvre qui n’élude aucune des contradictions soulevées par ses thèses. Elle refuse ainsi de le suivre quand il affirme vouloir produire une « pensée sans image » (une pensée qui ne soit ni ressemblance, ni conforme à un modèle, ni métaphore, ni analogie mais sauvage, vivante, nomade pour reprendre la terminologie deleuzienne) ou procède au relevé des paradoxes, des naïvetés parfois, qui émaillent sa pensée du cinéma[5]. La philosophe assume également un choix interprétatif plus personnel, celui de réhabiliter, malgré le franc rejet de Deleuze, la triade de Lacan (Réel, Symbolique, Imaginaire) comme grille de lecture de son esthétique, revalorisant en creux le rôle de la psychanalyse académique ou traditionnelle dans sa pensée. Si l’influence de Félix Guattari, plus que méfiant quant à cet appareil conceptuel, n’est jamais niée, l’ouvrage se présente ainsi comme une manière de nuancer la critique deleuzienne de la pensée freudienne à partir de L’Anti-Œdipe (son refus de la définition du désir comme manque, son rejet de la discipline psychanalytique comme dispositif normatif ou la promotion de l’intensif contre le narratif) par la réévaluation de leurs affinités souterraines. Malgré l’apparent paradoxe que constitue ce geste, Michalet est loin d’être isolée sur ce point. Slavoj Zizek ou Jerry Aline Flieger, pour ne citer qu’eux[6], ont aussi souligné combien les lectures parfois simplificatrices de Deleuze sur Oedipe ou le postulat matérialiste induit par l’idée de la « machine désirante » ne suffisaient pas à entériner une séparation radicale avec le discours de Lacan. Malgré la relation distendue entre les deux hommes, qui ne s’étaient rencontrés qu’à de rares occasions[7], Lacan reconnaissait lui-même la proximité de ses propres thèses avec celles développées dans La Logique du sens et avait même consacré une séance de ses séminaires à la Présentation de Sacher-Masoch. Dans le présent essai, cette option de lecture motive principalement le choix de traiter l’image deleuzienne comme un « symptôme » de l’inconscient, et jamais comme un simple produit de l’imagination mentale. Etant moins attaché à décrire « l’image du film que les images du film (au pluriel) ont fait naître chez lui » (p. 16), comme le précise Judith Michalet, Deleuze élabore de cette manière une esthétique qui ne repose pas sur le simple commentaire des œuvres mais sur une analyse des effets de subjectivation produits à l’occasion de l’expérience esthétique (plus que créative), c’est-à-dire dans la sensation visuelle, ouvrant sur une catégorisation des forces mises en jeu dans l’image. Celle-ci n’est pas perçue comme l’objet d’une réception passive mais le produit d’une contemplation active, proprement agissante, initiatrice d’une métamorphose vitale.
La pertinence de l’ouvrage tient à la position de Judith Michalet, qui pense constamment avec et contre Deleuze, mais aussi à la réévaluation de la proximité de celui-ci avec la psychanalyse et à la mobilisation d’un corpus critique ultra-contemporain (Rancière, Didi-Huberman, Spivak ou Butler) qui en interroge l’actualité. Avec Deleuze, elle déplie scrupuleusement les formes de son immanentisme radical en consolidant notamment la place centrale de Bergson parmi ses sources et ses influences[3]. L’auteur de Matière et Mémoire et de L’évolution créatrice décrit en effet des processus d’intensification vitale produits par la perception que l’autrice présente comme la matrice théorique de la pensée visuelle de Deleuze, celle qui fait de la « rencontre » avec l’image[4] l’événement moteur d’une transformation subjective. Mais Judith Michalet pense aussi contre Deleuze, au sens où elle livre une lecture critique de son œuvre qui n’élude aucune des contradictions soulevées par ses thèses. Elle refuse ainsi de le suivre quand il affirme vouloir produire une « pensée sans image » (une pensée qui ne soit ni ressemblance, ni conforme à un modèle, ni métaphore, ni analogie mais sauvage, vivante, nomade pour reprendre la terminologie deleuzienne) ou procède au relevé des paradoxes, des naïvetés parfois, qui émaillent sa pensée du cinéma[5]. La philosophe assume également un choix interprétatif plus personnel, celui de réhabiliter, malgré le franc rejet de Deleuze, la triade de Lacan (Réel, Symbolique, Imaginaire) comme grille de lecture de son esthétique, revalorisant en creux le rôle de la psychanalyse académique ou traditionnelle dans sa pensée. Si l’influence de Félix Guattari, plus que méfiant quant à cet appareil conceptuel, n’est jamais niée, l’ouvrage se présente ainsi comme une manière de nuancer la critique deleuzienne de la pensée freudienne à partir de L’Anti-Œdipe (son refus de la définition du désir comme manque, son rejet de la discipline psychanalytique comme dispositif normatif ou la promotion de l’intensif contre le narratif) par la réévaluation de leurs affinités souterraines. Malgré l’apparent paradoxe que constitue ce geste, Michalet est loin d’être isolée sur ce point. Slavoj Zizek ou Jerry Aline Flieger, pour ne citer qu’eux[6], ont aussi souligné combien les lectures parfois simplificatrices de Deleuze sur Oedipe ou le postulat matérialiste induit par l’idée de la « machine désirante » ne suffisaient pas à entériner une séparation radicale avec le discours de Lacan. Malgré la relation distendue entre les deux hommes, qui ne s’étaient rencontrés qu’à de rares occasions[7], Lacan reconnaissait lui-même la proximité de ses propres thèses avec celles développées dans La Logique du sens et avait même consacré une séance de ses séminaires à la Présentation de Sacher-Masoch. Dans le présent essai, cette option de lecture motive principalement le choix de traiter l’image deleuzienne comme un « symptôme » de l’inconscient, et jamais comme un simple produit de l’imagination mentale. Etant moins attaché à décrire « l’image du film que les images du film (au pluriel) ont fait naître chez lui » (p. 16), comme le précise Judith Michalet, Deleuze élabore de cette manière une esthétique qui ne repose pas sur le simple commentaire des œuvres mais sur une analyse des effets de subjectivation produits à l’occasion de l’expérience esthétique (plus que créative), c’est-à-dire dans la sensation visuelle, ouvrant sur une catégorisation des forces mises en jeu dans l’image. Celle-ci n’est pas perçue comme l’objet d’une réception passive mais le produit d’une contemplation active, proprement agissante, initiatrice d’une métamorphose vitale.
Les deux premiers chapitres ancrent donc le propos général dans un dialogue entre Deleuze et la psychanalyse, poursuivi en filigrane tout au long de l’ouvrage. Abordée depuis sa « corporéité » (chapitre 1) et son « inconscient » (chapitre 2), l’image est d’emblée ramenée à sa profondeur « viscérale » (p. 21), organique, sans commune mesure avec l’image-surface, dite « épidermique » (p. 21), de la phénoménologie. Judith Michalet renvoie Deleuze dos-à-dos avec Merleau-Ponty pour mieux saisir la spécificité de sa définition : l’image représente moins un objet qu’elle ne déforme le sujet qui la perçoit. Le « Corps sans Organes » (CsO), expression vitale de cette déformation, est introduit comme la réponse du corps face à la menace de son éclatement, sous l’effet de l’intensification vitale que l’image produit en lui. Judith Michalet reprend l’histoire et le sens de cette notion empruntée à Artaud, souvent galvaudée, adoptée par Deleuze plutôt que par Guattari. L’autrice en rappelle par exemple l’ambivalence constitutive par-delà le sens trop souvent répandu d’une mutilation organique, précisant qu’elle relève autant de « distorsions violentes » que d’un « état pacificateur » (p. 33). On comprend ainsi d’autant mieux en quoi le CsO a permis à Deleuze de penser sur nouveaux frais l’impossible synthèse du sujet, son « effondement » selon ses mots, ici évoqué successivement à travers les formes du « corps anarchique », de l’« hystérique », du « cogito fêlé » ou du « Moi dissous » (p. 34-37). Judith Michalet rappelle en fin de chapitre combien cette subjectivité postkantienne est comparable à la peinture abstraite : toutes deux désorganisent la représentation pour libérer des forces en latence. On note ici que le rejet en fin de chapitre du concept d’« image de la pensée », et sa discrétion tout au long de l’ouvrage, a de quoi surprendre, tant il a marqué la postérité critique du philosophe, et semblait pourtant induit dans le sous-titre de l’ouvrage. Cette relative absence ne trouve en effet son explication qu’en partie seulement dans le fait que la notion soit davantage présente dans Nietzsche et la philosophie ou Différence et répétition que dans les écrits qui portent plus proprement sur l’art (Logique de la sensation ou les deux tomes de Cinéma). Le deuxième chapitre explore plus spécifiquement le nouveau statut d’une image ramenée à sa condition « sub-représentative » (p. 43), en cherchant à faire coïncider contre la doxa philosophique le criticisme kantien avec le structuralisme, à pourvoir en somme le transcendantal de « singularités libres » (p. 46). Cet empirisme transcendantal, désigné comme tel par Deleuze, est présenté comme le cadre de pensée à partir duquel s’organise plus précisément le dialogue critique avec la psychanalyse : depuis la substitution de la « fêlure » à la béance lacanienne et le rejet de la castration symbolique (p. 47-49) jusqu’à la réélaboration avec Guattari des concepts de « machine », de « sublimation », de « transfert » et de « compulsion de répétition ». La signification esthétique de cette entreprise tient selon Judith Michalet à ce qu’elle se fonde sur une sortie du régime de la représentation qui valorise bien plutôt des processus de présentation, et à travers eux, la présence errante, indéchiffrable, de l’image comme « inscription a-symbolique du réel » (p. 64). A ce stade, l’immanentisme deleuzien paraît trouver dans ces concepts dérivés ou subvertis de la psychanalyse un moyen de concilier une physique du sujet et une métaphysique de la présence.
Les chapitres 3, 4 et 5 se focalisent sur l’épistémologie de l’image, sur les approches esthétique, ontologique, poïétique qui délimitent le territoire deleuzien d’investigation. De « l’image-mouvement » de Cinéma 1 à « l’image-temps » de Cinéma 2, on mesure ici combien la philosophie de Deleuze évacue la définition fixiste de l’image au profit du potentiel de violence, de choc, de défiguration ou de fragmentation qu’elle contient, directement indexé sur la rupture du schéma sensori-moteur impliquée dans son expérience, c’est-à-dire sur le délitement du lien entre perception et (ré)action. L’image tient ainsi sa mobilité de l’automatisme cérébral qui se substitue à ce schème, la dynamise et lui confère la dimension d’un flux, d’une vibration ou pour parler avec Bergson, cité par Deleuze, d’une « émanation ». A travers l’analyse de Stromboli ou Europe 51 de Rosselini, Judith Michalet débat avec Deleuze sur le statut de l’image animée : allégorie de la déconnexion cognitive fondatrice de l’expérience du cinéma ou expression purement littérale de la réalité ? Deleuze est mis face à ses contradictions, lorsqu’il est pris « en flagrant délit de métaphoriser » (p. 79) une scène de La Croisière du Navigator de Keaton, malgré ce qu’il affirme, ce qui permet d’ouvrir une discussion sur la notion d’« interprétation ». L’autrice signale à bon escient que le « déchiffrement sémiotique », prôné par Deleuze dans Proust et les signes, avant qu’il ne bannisse violemment la notion avec Guattari, est avant tout « involontaire » (p. 80). La précision est d’importance car elle lui permet de renvoyer l’image deleuzienne au symptôme des psychanalystes, lié par définition à l’inconscient, contre le point de vue cognitiviste pour qui l’interprétation est dévoilement des intentionnalités. L’ontologie de l’image, le discours sur l’être placé entre « coupes » et « flux », projection vibratoire sur un cerveau-écran, est l’objet d’un chapitre où la « profonde affinité » (p. 101) de la pensée bergsonienne avec celle de Deleuze est la plus manifeste, principalement abordée à travers les thèmes de la perception et de la mémoire. L’influence vitaliste, démontrée avec scrupule et technicité, est saisie comme une clé de compréhension essentielle des notions d’affectivité ou de pli, et plus généralement de la production du sujet au cours de l’expérience esthétique. Celle-ci n’est plus pensée comme la subjectivation d’un fondement premier, supposément indéterminé et objectif, mais comme un rapport de force de la subjectivité avec elle-même au cœur de ce que Judith Michalet nomme un « centre d’inhibition et d’absorption » des flux (p. 107). Elle reprend pour l’illustrer l’exposé de la « classification générale des images et des signes » annoncé par Deleuze (dans Cinéma 1. L’image-mouvement, cité p. 112) qui à la fois le rapproche de la sémiotique de Peirce (le signe rapporté à la dimension visuelle plutôt que linguistique), mais l’en distingue aussi nettement, en introduisant notamment la catégorie de « zéroité » (p. 113). La présence de l’image finit par ne pouvoir se fonder que sur la « violence de la sensation » qui s’en empare (p. 130), impliquant plus spécifiquement l’artiste. La création est alors abordée à partir des motifs traditionnels de l’esthétique deleuzienne (le rhizome, l’auto-engendrement du corps sans organes, la dissociation schizophrénique, la machine hallucinée) dont Judith Michalet dégage les ambiguïtés à l’endroit de la virtualité, de la matérialité ou de l’altérité présentes à l’image. La réflexion est illustrée par un rapprochement fécond entre la vision antipsychanalytique de Deleuze et Guattari, l’anticulturalisme de l’art brut et la contre-culture beatnik, soit autant de voies pour penser le geste poétique comme un acte de résistance et d’anticonformisme.
Consacrés à la temporalité et à la spatialité, les deux chapitres suivants prolongent la voie ouverte avec Cinéma 2. L’Image-temps, opus focalisé sur le cinéma d’après-guerre, dont Judith Michalet rappelle que Deleuze y prend beaucoup de libertés avec la chronologie déjà relevées par nombre de commentateurs. Elle examine pour sa part les modalités et formes possibles d’une image dite « directe » par Deleuze (p. 154), c’est-à-dire composée de signes optiques et sonores « purs » (p. 155), correspondant à la rupture nette du schème sensori-moteur chez le regardeur. L’autrice regrette que Deleuze s’en tienne à des références classiques et pointe un débat manqué sur la valeur de pureté dans le modernisme, particulièrement chez Greenberg auquel il semble ne pas s’intéresser, et qui aurait pourtant pu éclairer la compréhension de l’image-temps que Judith Michalet n’hésite plus à présenter comme la « véritable image immanente » (p. 160). Aussi, appréhendé notamment à travers la référence centrale à Resnais, le temps cinématographique qui lui correspond apparaît-il paradoxal : il colle autant avec une temporalité cérébrale faite de ruptures, d’écarts et d’irrésolutions qu’il n’organise l’identité du sujet et de l’objet dans une synthèse contemplative. C’est au cœur de cette dialectique entre séparation et immédiateté que se pense selon l’autrice un régime du sublime rimbaldo-kantien propre à l’image-temps, soit le mouvement libre de l’imagination non relevé dans un tout. Conforme au rejet deleuzien de la dialectique, la suite de l’analyse met en exergue des dichotomies internes à sa pensée qui ne tendent jamais à la résolution de l’opposition sur laquelle elles se fondent. Il s’agit par exemple d’une topologie duelle de la mémoire, placée entre « nappes intérieures de la mémoire » et « strates architecturales extensives » (p. 165), ici illustrée par le conflit de perception entre Robbe-Grillet et Resnais autour de leur film commun, L’année dernière à Marienbad. Physique et mentale, à la croisée du réel et de l’imaginaire, la mémoire est en effet pensée comme une membrane à deux faces, qui met en absolu contact le dedans et le dehors dans une coprésence, déjà posée dans le schéma bergsonien. Le cinéma moderne serait alors ce qui rendrait compte de ce nouvel espace mnésique, duel et dynamique, dans lequel l’image forme le creuset d’une « nappe de transformation », notion que Deleuze tient de La Nouvelle Alliance de Prigogine et Stengers (cité p. 171). Judith Michalet rapproche elle cette idée de celle de « destin » développée dans Différence et répétition et en fait une clé de lecture de la définition de l’image surréaliste selon Reverdy reprise par Godard. La spatialité, introduite dans le septième chapitre avec une analyse du Procès de Welles, d’après le roman de Kafka, n’a donc plus rien d’euclidien. Il est postmoderne selon l’interprétation de Judith Michalet, qualifié par Deleuze de « lisse » dans Mille plateaux et de « baroque » dans Le Pli, signifiant par là qu’il varie en permanence et donne des lignes de fuite au sujet, dont il organise les déterritorialisations et cartographie les symptômes. La philosophe s’appuie enfin sur ces analyses pour préciser le cadre épistémique du penseur, voyant dans Deleuze le promoteur d’une topologie personnelle « néostructuraliste » (p. 192) dont l’image est la pierre de touche. Si Deleuze s’est toujours considéré comme un métaphysicien, l’autrice précise ici les termes d’un immanentisme qui a néanmoins évacué le champ de la transcendance et qui rejoindrait selon elle le projet de Lacan de « concilier le réalisme et l’idéalisme » (p. 192). Cette philosophie qui fait synthèse (plus qua dialectique) se formule en des termes contradictoires « à la fois réaliste et idéaliste, génétique et transcendantale » (p. 192). Judith Michalet désigne ici l’« empirisme transcendantal » promu par l’auteur, et dont Anne Sauvagnargues a détaillé les formes[8], mais aussi un « idéalisme génétique » (p. 192), cette fois non revendiqué de la sorte par Deleuze. Ce second, en grande partie redevable de l’approche de Simondon[9], est posé par l’autrice comme le double symétrique du premier en ce qu’il permettrait de penser la différenciation du transcendantal vers l’empirique, et non plus l’inverse. Judith Michalet remarque que cette façon de concevoir, qui met d’emblée en jeu des notions de « Dedans » et de « Dehors », démarque Deleuze de Guattari comme de Bergson tandis qu’elle le rapproche de Lacan, et par ce biais du néostructuralisme. Si l’on aurait souhaité sur ce point davantage de développement (l’hypothèse du « néostructuralisme topologique » restant finalement énoncé sous la forme d’une question), la mise en lumière de la pensée génétique de Deleuze offre une perspective pour le situer par-delà la tradition métaphysique, dans un geste proche de celui qu’opère notamment Catherine Malabou à l’endroit de la philosophie de Kant[10], peut-être indice d’une actualité de la pensée continentale.
Les chapitres 8 et 9, introduits par l’analyse de l’énonciation dans les films de Rouch, concluent sur le sens de l’image, saisi dans les termes d’une sémiotique de l’a-signifiance, manifestement influencée par Guattari. Ce régime est qualifié par Judith Michalet de « post-signifiant » (p. 199) en ce qu’il dépasse les postulats structuralistes de Saussure (la dichotomie signifié/signifiant est remplacée par le dualisme corps/langage) pour penser un signe sans signifiance, qui interdit de fait de considérer le cinéma comme une rhétorique ou un langage en soi. Le réalisme esthétique que soutient Deleuze pense au contraire une langue propre à l’image qui échappe à la logique du signe, affirmant la possibilité d’une image poétique ou d’un cinéma-vérité qui mettent en jeu un « regard indirect libre » (p. 212). Cet appel à la liberté annonce un chapitre final sans conteste le plus prospectif de l’ouvrage, consacré à la dimension politique de la pensée deleuzienne de l’image, Judtih Michalet se rangeant assurément du côté des commentateurs qui ne voient une continuité entre les écrits politisés des années 70 et le tournant esthétique des années 1980. Ce dernier chapitre fait la synthèse des implications pratiques des énoncés précédents en se plaçant dans le cadre deleuzien de la « micro-politique » (p. 216), qui ne se présente pas selon l’autrice comme une critique de l’instrumentalisation idéologique des images mais comme une « critique radicale de l’action » (p. 220). La démonstration manque peut-être sur ce point d’un développement sur la notion de « cliché » comme image-réflexe, image morte produite par la culture capitaliste et régime de représentation actuel, pourtant présente dans le discours deleuzien dès les deux volumes de Capitalisme et schizophrénie et encore dans ceux de Cinéma. Judith Michalet, suivant l’hypothèse de Dork Zabunyan sur le romantisme de Deleuze[11], privilégie quant à elle la rencontre avec l’image comme un choc ou un décentrement, une expérience qui participe de plain-pied à la praxis transformatrice du spectateur. Il s’agit alors pour l’autrice de comprendre comment, pourtant inspirée par la vision aristocratique nietzschéenne, la version deleuzienne du projet émancipateur rejoint la postérité freudo-marxiste et renoue avec une certaine idée de l’anarchie. Cette partie rappelle la pensée de Deleuze au questionnement central de la force politique et de l’influence des images contemporaines. En le confrontant à un appareil théorique qui inclut les éthiques de Judith Butler, de Michel Foucault et de Gayatari C. Spivak (le « subalterne » apparaissant en creux comme une figure alternative au « peuple à venir »), Judith Michalet connecte ici fortement Deleuze à la pensée critique actuelle. Ces rapprochements posent autrement la question deleuzienne de savoir ce qu’est une représentation politique dans un contexte démocratique : comment prendre la parole sans empiéter sur la visibilité des dominés ? Comment faire droit à sa propre image critique et publique ? L’art documentaire en est-il un moyen ? Judith Michalet entre ici en contradiction avec Deleuze dont la stratégie micro-politique et la critique du « devenir majoritaire » qu’elle suppose ne semblent pas suffisamment comprendre la logique de revendication du sujet minoritaire. Cette critique prend davantage de force dans le dialogue qu’elle organise avec la pensée de Spivak ou Butler. Avec la première, Michalet montre qu’il pas « indigne » comme le pense Deleuze de parler à la place de l’autre » à condition de mettre en scène, par autoréflexion, son statut énonciatif critique (par exemple le documentariste dans Ici et ailleurs de Jean-Luc Godard et d’Anne-Marie Mieville). Elle forme alors la catégorie de « style indirect lié » qu’elle oppose au « style indirect libre » prôné par Deleuze. Avec la seconde, elle prolonge cette réflexion à travers le cas du récit de soi et interroge la possibilité de maintenir un propos critique quand on ne parle qu’en son nom propre. Dans ces dernières lignes de développement, Deleuze s’efface tandis que le spectre de Foucault plane : dans l’œuvre d’Agnès Varda, il s’agit de se déprendre de soi, de comprendre que tout discours sur soi relève autant du portrait que de l’autoportrait, autant du document que de la mise en « je ». Il s’agirait ici selon Michalet d’y voir une « troisième posture énonciative » (p. 234), non envisagée par Deleuze.
Au terme de la démonstration, l’image apparaît finalement moins comme un objet d’étude en soi que comme une clé herméneutique à partir de laquelle pénétrer la pensée de Deleuze. L’ouvrage se remarque par un travail minutieux de contextualisation des idées, de restitution des dialogues internes et des jeux d’influences entre tous les auteurs qui constituent l’écheveau théorique deleuzien. Deleuze. Penseur de l’image accomplit de cette manière un geste généalogique, retraçant la façon dont le philosophe emprunte à la psychanalyse lacanienne, à travers l’entremise de Guattari, à Simondon, Hume, Bergson ou Lyotard, et marque ses distances avec la phénoménologie, tout en maintenant constante la référence au transcendantal. L’accent est clairement mis sur les sources de la pensée plutôt que sur ses commentaires, déterminantes pour en comprendre l’évolution (depuis le structuralisme linguistico-centré des débuts à l’anti-psychanalyse micro-politique de la maturité). L’exercice herméneutique, technique, scrupuleux, pâtit en revanche d’une volonté d’exhaustivité, certes louable mais difficile à réaliser avec Deleuze, qui peut donner parfois l’impression d’un passage en revue d’une trop grande densité conceptuelle et qui prend le risque de rester opaque à des non-initiés. On admettra néanmoins sans mal que cette coupe transversale dans l’œuvre, prolixe en concepts et références, s’avère utile à qui veut mesurer avec précision toute l’ambiguïté et toutes les nuances de son lien paradoxal à l’image, « à la fois sensualisme et intellectualisme » comme l’affirme Judith Michalet en conclusion (p. 237). L’ouvrage parvient à déconstruire une interprétation trop largement répandue qui voudrait réduire l’esthétique de Deleuze à la seule promotion d’une expérience exaltée de l’art et à la définition de l’image comme amplificateur sensoriel. La complexité de la position deleuzienne, tapie sous des contradictions tantôt explicitées, tantôt critiquées, est à la hauteur de sa conception de l’immanence de l’image. Judith Michalet affirme ainsi qu’on ne peut véritablement la comprendre qu’à condition de la saisir à travers la figure de la membrane, du ruban à double face, c’est-à-dire d’une « immanence qui met topologiquement en rapport dedans et dehors » (p. 238), transcendantal et empirisme, idéalisme et réalisme. A son image, la démonstration s’applique tout au long à penser le lieu de contact des architectures effectives de l’édifice deleuzien et des structures invisibles qui les soutiennent. Le penseur de l’image est au bout du compte renvoyé à l’image de sa propre pensée. Peut-être alors le concept d’« image de la pensée » apparaît-il seulement à ce point de l’analyse, en creux d’un discours qui finit par pleinement assimiler la pensée du cinéma à la cinématique de la pensée, la recherche de Judith Michalet nourrissant le projet de Deleuze de comprendre « l’identité du mental et du physique, du réel et de l’imaginaire, du sujet et de l’objet, du monde et du moi[12] ». Par sa capacité à la soumettre à l’épreuve de la pensée critique actuelle, son commentaire de l’œuvre de Deleuze finit par donner d’elle une nouvelle image, une image critique qui comme toutes les autres procède nécessairement, et ici consciemment, par déformation.
[1] Anne Sauvagnargues, Arnaud Villani, Adnen Jdey, Philippe Mengue, Jean-Claude Dumoncel, Véronique Bergen, Guillaume Sibertin-Blanc ou Pierre Montebello pour la scène intellectuelle française.
[2] Depuis « l’image de la pensée » à la trilogie « image-perception/image-action/image-affection, en passant par « l’image cristal ».
[3] Ce dernier apparaissant in fine comme le « soubassement conceptuel le plus profond » (p. 96) de l’esthétique deleuzienne.
[4] Dans Proust et les signes et Différence et répétition, cité p. 66.
[5] L’autrice cite notamment la confusion de l’image comme cause et de son effet, l’idée d’un cinéma classique rempli de « clichés », les nombreuses révisions typologiques ou encore sa défense de la littéralité contredite par un usage récurent de la métaphore.
[6] Cf Slavoj Zizek, Organes sans corps. Deleuze et consequences, trad. Christophe Jaquet, Paris, Éditions Amsterdam, 2008, ou Jerry Aline Flieger, « Overdetermined Œdipus », in Ian Buchanan (éd.), A Deleuzian Century ?, Durham, Duke University Press, 1999.
[7] Deleuze est revenu sur leurs différentes rencontres dans un entretien donné à Didier Eribon peu avant sa mort. Cf Didier Eribon, « Le ‘Je me souviens’ de Gilles Deleuze » (entretien avec Gilles Deleuze), Le Nouvel Observateur. 16–22 novembre, 1995.
[8] Anne Sauvagnargues, Deleuze, l’empirisme transcendantal, Paris, PUF, 2010.
[9] Comme l’autrice l’a soutenu dans son article « Deleuze et Simondon » paru en ligne sur Implications philosophiques en février 2019 : https://www.implications-philosophiques.org/deleuze-et-simondon/ (consulté le 2 septembre 2021).
[10] Dans Avant demain. Épigenèse et rationalité (Paris, PUF, 2014), la philosophe soutient la thèse de la dimension épigénétique du transcendantal à partir de sa lecture du § 27 de la Critique de la raison pure de Kant.
[11] Dork Zabunyan, Gilles Deleuze. Voir parler, penser au risque du cinéma, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2006.
[12] Gilles Deleuze, Cinéma 2. Image-temps, Paris, Éditions de Minuit, 1985, p. 26.














