Recension – Bullshit Jobs, David Graeber
Recension David Graeber, Bullshit Jobs
Travailler au XXIème siècle : Des emplois sans travail ?
Céline Marty, Professeure agrégée de philosophie
Ceci est une recension de l’ouvrage de David Graeber, Bullshit jobs. Vous pouvez trouver l’ouvrage en cliquant ici, aux éditions Les Liens Qui Libèrent.
Thèse sur la centralité du travail versus thèse anti-travail
En philosophie du travail, deux thèses se succèdent et s’affrontent. Tout d’abord, la thèse de la « centralité du travail »[1] est initiée par Marx, des Manuscrits de 1844 au Capital, puis elle est portée par le « marxisme traditionnel » de Lukács à la théorie critique. Le travail est considéré comme une activité anthropologique, « articulation de la théorie de la connaissance, théorie sociale et théorie de la révolution » d’après l’expression d’Honneth[2]. Alors que le travail abstrait est l’activité transhistorique de production de biens nécessaires à la survie de l’homme, le travail salarié aliéné n’est qu’une forme dégradée de travail, dont les caractéristiques d’aliénation, d’exploitation et de domination ne sont qu’historiques, produites par le capitalisme, et non intrinsèques à l’activité même de travail. Le travail constitue le moyen d’émancipation, individuel et collectif, pour dépasser le capitalisme.
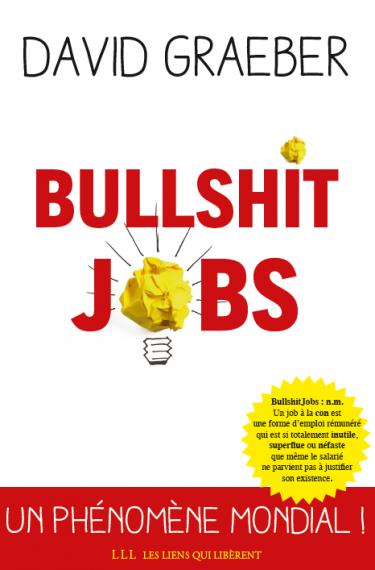 En face, la critique de cette centralité du travail dans la société contemporaine, initiée par Hannah Arendt[3] et soutenue ensuite par André Gorz[4], Moishe Postone[5] et Dominique Méda[6], se fonde sur deux arguments. D’une part, l’activité de travail n’est que poiesis. Il s’agit d’un « asservissement à la nécessité » « inhérent aux conditions de la vie humaine »[7] mais qui ne produit que des ressources transitoires, sans cesse à renouveler. En cela cette activité de subsistance n’est pas spécifiquement humaine, mais partagée avec toutes les vies qui se renouvellent (végétale et animale). A l’inverse, l’œuvre et la politique sont spécifiquement humaines : l’œuvre produit des œuvres artisanales durables,dans des activités libres dégagées des contraintes économiques et sociales propres à l’activité de poiesis, toujours insérée dans le tissu productif. La politique est au cœur du domaine public, hors du domaine privé économique et social[8]. Or, la valorisation contemporaine de la seule activité de travail, sur le plan économique, social et politique, contribue à faire de l’homme un simple producteur-consommateur poïétique, qui ne s’exerce plus aux libres activités d’œuvre et de politique, hors du cadre capitaliste marchand. D’autre part, la centralité de l’activité et du concept de travail dans notre société est historique, spécifique à l’époque industrielle capitaliste. Le travail n’a pas toujours eu ce rôle social fondateur, ce pourquoi il est possible d’envisager une organisation sociale du travail différente de celle propre à la société capitaliste. Dès lors, le travail cesse de représenter une possibilité d’émancipation à laquelle croient les marxistes. La théorie critique se doit alors, non pas de libérer le travail de ses contraintes pour l’humaniser, mais de libérer de la domination idéologique du travail. Les activités spécifiquement humaines à valoriser et à développer sont hors de la sphère de production. La possibilité de réduction du temps de travail est fondée chez Gorz et Postone sur l’augmentation des gains de productivité, qui permet de produire autant avec moins de temps de travail. Ces thèses dessinent alors un nouvel idéal : la réduction du temps individuel et social accordé à la production, pour le développement d’autres activités, hors de la production.
En face, la critique de cette centralité du travail dans la société contemporaine, initiée par Hannah Arendt[3] et soutenue ensuite par André Gorz[4], Moishe Postone[5] et Dominique Méda[6], se fonde sur deux arguments. D’une part, l’activité de travail n’est que poiesis. Il s’agit d’un « asservissement à la nécessité » « inhérent aux conditions de la vie humaine »[7] mais qui ne produit que des ressources transitoires, sans cesse à renouveler. En cela cette activité de subsistance n’est pas spécifiquement humaine, mais partagée avec toutes les vies qui se renouvellent (végétale et animale). A l’inverse, l’œuvre et la politique sont spécifiquement humaines : l’œuvre produit des œuvres artisanales durables,dans des activités libres dégagées des contraintes économiques et sociales propres à l’activité de poiesis, toujours insérée dans le tissu productif. La politique est au cœur du domaine public, hors du domaine privé économique et social[8]. Or, la valorisation contemporaine de la seule activité de travail, sur le plan économique, social et politique, contribue à faire de l’homme un simple producteur-consommateur poïétique, qui ne s’exerce plus aux libres activités d’œuvre et de politique, hors du cadre capitaliste marchand. D’autre part, la centralité de l’activité et du concept de travail dans notre société est historique, spécifique à l’époque industrielle capitaliste. Le travail n’a pas toujours eu ce rôle social fondateur, ce pourquoi il est possible d’envisager une organisation sociale du travail différente de celle propre à la société capitaliste. Dès lors, le travail cesse de représenter une possibilité d’émancipation à laquelle croient les marxistes. La théorie critique se doit alors, non pas de libérer le travail de ses contraintes pour l’humaniser, mais de libérer de la domination idéologique du travail. Les activités spécifiquement humaines à valoriser et à développer sont hors de la sphère de production. La possibilité de réduction du temps de travail est fondée chez Gorz et Postone sur l’augmentation des gains de productivité, qui permet de produire autant avec moins de temps de travail. Ces thèses dessinent alors un nouvel idéal : la réduction du temps individuel et social accordé à la production, pour le développement d’autres activités, hors de la production.
Ces théoriciens de la fin du travail ne se situent pas sur le plan du fait : ils ne diagnostiquent pas une disparition des activités de travail, puisqu’au contraire celles-ci continuent d’exister ; mais ils défendent qu’il serait possible en droit d’organiser socialement la production et la distribution des ressources de façon à diminuer les activités de production nécessaires, pour permettre aux individus de se consacrer à d’autres activités que des tâches productives. Leur présupposé est que certaines activités de production actuelles auxquelles des individus dédient leur vie ne sont pas nécessaires à la reproduction de la vie humaine et pourraient donc être supprimées, pour laisser à chacun plus de temps hors de la production. Ainsi, les théoriciens de la centralité du travail semblent se placer sur le terrain du fait – le travail est actuellement au cœur de notre organisation sociale et des maux psychiques et sociaux – alors que les théoriciens de la fin du travail envisagent l’idéal d’une organisation sociale du travail différente – la société pourrait être organisée de telle sorte que les activités productives ne soient plus au cœur de nos existences, en distinguant celles nécessaires à la reproduction humaine et celles qui peuvent être supprimées. Le problème est alors de distinguer les activités nécessaires des superficielles.
Le livre de David Graeber vient relancer cette discussion, en proposant une critique des bullshit jobs, ces emplois si inutiles qu’ils pourraient être supprimés, qui suggèrent en creux un critère d’importance pour identifier ces activités nécessaires : l’utilité sociale.
Les « bullshit jobs », un argument pour la fin du travail.
Un phénomène social et économique…
Anthropologue américain, actuellement professeur à la LSE, David Graeber est connu pour son engagement anarchiste, sa participation au mouvement Occupy Wall Street et son livre Dette : 5000 ans d’histoire. En 2013, il publie un article à succès sur un phénomène qu’il dit être le premier à exposer : les « bullshit jobs » (traduit par « jobs à la con »), une « forme d’emploi rémunéré qui est si totalement inutile, superflue ou néfaste que même le salarié ne parvient pas à justifier son existence, bien qu’il se sente obligé, pour honorer les termes de son contrat, de faire croire qu’il n’en est rien »[9]. Il les distingue des « jobs de merde » qui sont des emplois pénibles, disqualifiés socialement, mais qui effectuent « des tâches nécessaires et indiscutablement bénéfiques à la société »[10]. En ces temps de « rigueur » où les économies sont de mises et les suppressions de postes nombreuses dans le public comme le privé, comment est-il possible que certains salariés soient « payés à ne rien faire » ? Un appel à témoignages lancé par Graeber via les réseaux sociaux donne lieu dans Bullshit Jobs à une typologie de ces emplois et à une analyse des causes, non seulement économiques, mais aussi politiques, de ce massif problème de société, pour en penser les solutions.
Graeber rejette le préjugé selon lequel ce phénomène serait cantonné au secteur public, où les ressources seraient mal gérées. Il attribue l’existence des « bullshit jobs » dans le secteur privé à l’évolution financière du capitalisme de ces dernières décennies : depuis la frénésie des fusions et acquisitions des années 1980, une forte pression a été exercée sur les entreprises pour qu’elles améliorent leur rentabilité. La stratégie adoptée a alors été de réduire les coûts du travail à la base productive de la pyramide, en demandant à « ceux qui fabriquent, entretiennent, réparent ou transportent des choses »[11] d’augmenter leur productivité. Mais en même temps, le nombre de cols blancs, chargés d’optimiser les coûts, les ressources humaines et les bilans financiers, s’est largement accru : c’est à ce niveau que se trouvent les « bullshit jobs », comme ceux des « petits chefs » et des « cocheurs de cases » [12].
Qui a des conséquences psychologiques sur les travailleurs…
Graeber refuse l’idée selon laquelle être payé à ne rien faire serait le rêve de beaucoup de travailleurs. Il pointe la souffrance de ceux qui ne trouvent pas de sens à leur travail, souffrance accentuée par leur difficulté à distinguer sa cause réelle et à l’expliciter. Il donne une explication naturaliste à cette souffrance, en s’appuyant sur les travaux de psychologie de l’enfant de Karl Groos du début du XXème siècle : les nourrissons éprouvent du plaisir quand ils constatent qu’ils peuvent avoir un effet prévisible sur le monde et qu’ils se reconnaissent auteurs de leurs actes. Graeber en induit que tout être humain éprouverait du plaisir à voir les conséquences de ses actes et de la souffrance à constater que ses actes restent sans effet. C’est pourquoi les employés des « bullshit jobs » souffrent : ils constatent l’inutilité de leurs actions quotidiennes et subissent de surcroît l’avanie d’être traités comme s’ils étaient utiles alors qu’ils savent qu’il n’en est rien.
Graeber en induit un idéal du travail. Travailler devrait servir à quelque chose, c’est-à-dire produire des effets que l’agent peut reconnaître comme les conséquences de ses actes. Comme le dit un des témoignages, « l’absence de but aggrave le stress »[13]. Cette souffrance est décuplée par la contrainte professionnelle et sociale de « garder la face » auprès de la hiérarchie en faisant semblant d’être affairé, et auprès des proches en faisant mine d’avoir réussi professionnellement. Cette attitude de faux-semblant empêche en outre de prendre au sérieux le phénomène et de tenter de le résoudre. Plus largement, les salariés ressentent une pression sociale moralisatrice : il faudrait s’estimer heureux d’avoir un emploi, quel qu’il soit. La demande d’utilité sociale et de reconnaissance au travail ne serait qu’une exigence de quelques privilégiés qui n’accepteraient pas les difficultés inhérentes au monde du travail.
Et des raisons politiques : la société tout travail comme société de domination sociale
Graeber cherche alors les causes de ce phénomène paradoxal, qui semble défier la logique capitaliste de diminution des coûts au profit de la rentabilité. C’est justement parce que les causes ne sont pas économiques, mais politiques[14]. Les gains de productivité des révolutions technologiques n’ont pas eu pour conséquence une réduction effective du temps de travail, comme le prévoyait Keynes. L’hypothèse de Graeber est que l’organisation sociale du travail n’a pas pour but d’être la plus productive, mais la plus disciplinaire possible. Au sein d’une société où le travail en tant qu’emploi est le seul moyen d’acquisition des biens de subsistance, chaque individu se voit contraint d’avoir un emploi pour survivre, but en fonction duquel il va devoir se plier à des contraintes sociales (horaires, normes de travail) et adopter une éthique de travail consistant à obéir aux ordres donnés par les supérieurs hiérarchiques. Chacun est alors soumis à un système de domination, non pas seulement au sens d’une domination interpersonnelle entre les travailleurs et les capitalistes comme dans le marxisme traditionnel, mais au sens d’une domination objective et abstraite qui contraint tous les individus à certaines pratiques.
Postone a longuement théorisé cette forme de domination spécifique au capitalisme. Pour lui, la critique du capitalisme ne peut se réduire à une condamnation de la propriété privée des moyens de production ou du marché, qui produiraient une domination interpersonnelle de classes. Elle doit mener à une analyse systémique de cette forme historique spécifique d’interdépendance sociale, pour en pointer le caractère impersonnel et objectif. Elle crée une nouvelle forme de domination sociale, dite abstraite, qui soumet les hommes à des contraintes structurelles impersonnelles au-delà de la confrontation naïve entre patrons et salariés. La domination sociale sous le capitalisme n’est donc pas une domination d’hommes par d’autres hommes mais la domination des hommes par des structures sociales abstraites que les hommes eux-mêmes constituent et entretiennent. Pour Postone, « le travail social n’est pas seulement l’objet de la domination et de l’exploitation, il est le fondement essentiel de la domination »[15]. Cette forme de domination sociale, telle que les individus sont forcés de produire et d’échanger des marchandises pour survivre, est spécifique au capitalisme. La domination se maintient parce que le travail agit comme activité socialement médiatisante et n’apparaît pas comme socialement créée, ce qui lui donne un caractère nécessaire et naturel, empêchant donc son dépassement. Pour survivre, il faudrait nécessairement travailler. Les contraintes spécifiques au capitalisme apparaissent alors comme l’ordre naturel des choses. Postone nous permet donc d’étendre le concept de domination : ce n’est pas une domination interpersonnelle explicite où il serait aisé de distinguer les dominés des dominants, les travailleurs défavorisés et les professions dites supérieures, car même les cadres se trouvent dominés par cette organisation sociale du travail qu’ils ne choisissent pas mais subissent et entretiennent.
En quoi cette société est-elle alors disciplinaire comme le dit Graeber ? Elle permet de contraindre les individus à n’avoir que des activités productives, sans temps libre, et à leur inculquer une « éthique de travail » fondée sur l’obéissance[16]. Comme le note déjà Marx[17], la totalité du temps passé hors du travail n’est vouée dans le capitalisme qu’à la reproduction de la force de travail. Dès lors, les individus n’ont pas de temps libre hors de la production, pour développer des activités d’œuvre et de politique. La diminution du temps de travail d’une heure par jour ne le permet pas non plus, prévient Gorz : diminuer légèrement le temps de travail quotidien revient à laisser plus de temps disponible pour le divertissement-consommation, qui repose sur le système productif et l’entretient, plutôt que de libérer le temps long nécessaire au développement d’activités et de projets pour soi et pour la collectivité. Or, ne pas laisser de temps libre aux travailleurs pour s’investir en politique serait justement un moyen de consolider la domination politique de ce système abstrait, d’après Graeber. Après les luttes sociales du XIXème et du XXème siècles pour l’amélioration des conditions de travail, le désengagement politique, la diminution de la représentation syndicale et la diminution de la concertation dans les décisions politiques sont des phénomènes qui renforcent la domination politique parce qu’ils permettent de ne pas remettre en question l’organisation sociale du travail et qu’ils laissent les individus impuissants face aux réformes récentes qui détricotent les droits sociaux. L’hypothèse de Graeber est qu’une société où les individus auraient du temps libre hors du travail serait une société plus difficilement gouvernable : le temps libre serait le temps de la réflexion et de la potentielle organisation pour défendre ses droits, temps libre qui représenterait un danger pour la domination établie[18].
Si les raisons sont politiques, alors les solutions le sont aussi.
Dans la lignée de Gorz, Graeber considère que le revenu de base est l’alternative à la « société tout travail ». Il permettrait de dissocier le travail de la distribution des ressources : si certains sont asservis par des « bullshit jobs », c’est parce que l’emploi est le moyen de distribution de la production au sein de notre système économique marchand. Or, décentrer l’organisation sociale du travail, de sorte qu’il ne soit plus considéré comme le fondement de la production et de la distribution, permettrait à chacun de choisir les activités auxquelles consacrer son temps. Les « bullshit jobs », que certains sont forcés de garder pour conserver un revenu, disparaîtront alors. Graeber reprend la piste de l’émancipation que suggère déjà Postone : si le travail n’est pas seulement l’objet de la domination mais son fondement même, alors l’émancipation consiste dans l’abolition du travail lui-même. Celle-ci serait rendue possible par l’augmentation des gains de productivité.
Une telle réorganisation sociale aurait deux conséquences selon Postone : un changement quantitatif dans l’organisation sociale du travail, la réduction massive du temps de travail à l’échelle de la société, et un changement qualitatif, celui de la structure de la production sociale et de la nature du travail individuel. Un autre mode de distribution sociale pourrait être développé, où l’acquisition des moyens de consommation ne dépendrait plus objectivement de la dépense du temps de travail.
Dans la lignée d’André Gorz, de Moishe Postone et de Dominique Méda, Graeber soutient que l’organisation du travail ne relève pas de choix strictement économiques et sociaux, dépendants de variables économiques et sociales comme le taux de chômage ou le taux de la population en âge de travailler, mais relève bien plutôt de choix politiques. En tant que tels, ils devraient être débattus dans l’espace public plutôt que par les seuls experts en économie. Quelle place voulons-nous que le travail ait dans nos vies individuelles et dans notre organisation sociale ?
Les difficultés de l’analyse de Graeber
La qualification subjective ou objective de l’utilité sociale
La définition du « bullshit job » de Graeber repose sur l’impression subjective, chez le travailleur, de faire des activités sans utilité sociale. Graeber donne pourtant cinq types objectifs de « bullshit jobs ». Cette détermination subjective de l’utilité du travail n’est-elle pas incompatible avec la catégorisation objective de certains types d’emploi (honorifiques, stratégiques) foncièrement inutiles ? Il faut pourtant distinguer une utilité d’ordre économique (fonction de production) et une utilité symbolique ou stratégique, auxquelles répondent certains types de « bullshit jobs » qui ne sont donc pas intrinsèquement inutiles mais qui sont plutôt non productifs. Graeber considère que les forces armées font partie des « bullshit jobs » parce que leur existence dépend seulement de celles des autres pays. Mais il pourrait être contredit par des témoignages de militaires qui ont l’impression subjective d’être utiles en « servant leur pays ». A l’inverse, le témoignage d’un pharmacien nous montre qu’un métier apparemment utile peut apparaître inutile à celui qui le pratique puisque ce dernier a l’impression de ne servir que des placebos. Où poser la limite de l’utilité sociale dès lors ? Graeber élude le problème en affirmant qu’il est impossible de développer une mesure absolue de la valeur, valeur qui est toujours à appréhender subjectivement, par le prisme de l’agent. Mais si par ailleurs l’appréciation de toute activité n’est que subjective, comment juger de l’ampleur objective du phénomène social des « bullshit jobs » qu’entend décrire Graeber et comment tenter collectivement de résoudre ce problème ? De plus, Graeber présuppose parfois une conception objective de l’utilité sociale, notamment quand il affirme que plus un emploi comporte des tâches utiles socialement, moins il est bien rémunéré, et inversement[19]. Soit on accepte la compréhension subjective du phénomène, auquel cas la libération passe par la prise de conscience de son état individuel d’aliénation et par des transformations individuelles (quitter son « bullshit job » pour faire un travail qui semble plus utile socialement), mais il n’y a pas de raison objective de le faire plutôt que de ne pas le faire, soit on tente de définir objectivement ce phénomène pour le résoudre politiquement.
Il semble y avoir deux finalités distinctes à cette réflexion critique sur les « bullshit jobs » : soit faire disparaître les « bullshit jobs », pour que tous les emplois aient un sens ; soit libérer toute la société de la domination d’un système social fondé sur le travail. Graeber rassemble ces deux objectifs. Si certains sont asservis par des « bullshit jobs », c’est parce que notre organisation sociale nécessite que chaque individu exerce un emploi, même si son activité ne produit rien. C’est en se libérant de cette domination sociale, en décentrant le travail de notre organisation sociale, ce qui est rendu possible par les gains de productivité, que les « bullshit jobs » disparaîtront. On peut y voir une résolution de la tension entre les acceptions subjective et objective des « bullshit jobs » : en libérant chaque individu de la domination sociale du travail, les activités que choisiront d’exercer les individus auront un sens à leurs yeux.
L’explication naturaliste
Graeber présuppose que les hommes ont un besoin naturel de constater l’utilité de leurs actions, ce pourquoi les « bullshit jobs » font souffrir. Mais dans nos sociétés marchandes, le travail n’est pas une simple activité humaine : c’est une activité rémunérée qui s’insère dans des rapports économiques marchands de production, causant une domination sociale et politique au sein des organisations et à l’échelle de la société elle-même. Dire qu’il est naturel pour l’homme d’avoir un travail qui a une utilité sociale (ce qui est distinct de « entreprendre une activité dont on constate les effets ») risque de naturaliser le travail sous sa forme économique actuelle et de légitimer la domination qu’il produit.
Méda soulevait déjà ce problème : les philosophies du travail du XIXème siècle, incarnées par Hegel et Marx, n’ont-elles pas naturalisé le travail humain, en en faisant le propre de l’homme, alors que ce n’est qu’une phase historique contingente de l’activité humaine qui pourrait être remise en question ? Peut-on réellement appeler toute activité un travail, à l’instar de l’ergologue Yves Schwartz ou de la théoricienne du care Pascale Molinier, et en faire ainsi l’activité humaine par excellence ? Si toute activité est travail, comment distinguer les tâches bénévoles et les loisirs des tâches contraintes et rémunérées ? La définition strictement économique du travail que proposent Gorz et Méda a au moins l’avantage de ne pas étendre le travail à l’ensemble des activités humaines : le travail est spécifiquement cette activité rémunérée qui entre dans des rapports économiques et marchands de production. Naturaliser le travail et étendre la notion à toutes les activités humaines, c’est risquer de perdre sa spécificité : une activité contrainte et nécessaire pour vivre en tant qu’elle s’insère dans un système économique satisfaisant des besoins vitaux.
Il semble qu’on puisse entreprendre une critique de l’organisation actuelle du travail et des « bullshit jobs » sans se référer à des tendances anthropologiques transhistoriques, en développant une critique immanente au capitalisme, comme le propose Postone.
Conclusion
En attirant l’attention sur un phénomène social qui témoigne probablement d’une crise de notre organisation sociale du travail, Graeber nous invite donc à réactualiser le débat entre centralité du travail et fin du travail. Il s’inscrit dans la continuité d’une position anti-travail, qui invite à réduire la place sociale accordée au travail dans nos existences individuelles et collectives. Si Graeber propose certaines pistes d’explication et certaines solutions, comme le revenu de base, il faut néanmoins s’interroger sur ses présupposés théoriques non explicites, comme l’alternative entre l’objectivité et la subjectivité du sens du travail et celle entre la naturalité et l’historicité de la définition de l’activité humaine comme travail. Cette interrogation théorique est nécessaire pour réactualiser le débat entre centralité ou fin du travail à l’aune des nouvelles formes actuelles du travail, décrites par les sciences humaines. A l’heure du chômage de masse, de la stagnation de la croissance dans les pays du Nord et des prophéties de disparition massive des emplois due à l’automatisation, ainsi que des risques psycho-sociaux dus au travail, la réflexion sur la possibilité que le travail ne soit pas le fondement de la production et de la distribution des ressources au sein d’une société semble urgente.
Aller plus loin
Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, Paris : Calmann-Levy, 1983
Antonio Casilli, En attendant les robots, Paris : Seuil, 2019
A. Cukier (dir.), Travail vivant et théorie critique. Affects, pouvoir et critique du travail, Paris, PUF, 2017
Alexis Cukier, Le travail démocratique, Paris, PUF, 2018
André Gorz, Les Métamorphoses du travail, Paris : Gallimard, 1988
Karl Marx, Le Capital, Paris : PUF, 1993
Karl Marx, Les manuscrits de 1844, Paris : GF, 1999
Dominique Méda, Le Travail : une valeur en voie de disparition, Paris : Flammarion, 1995
Moishe Postone, Temps, travail et domination sociale. Paris : Mille et une nuits, 2009.
[1] Selon l’expression d’Emmanuel Renault E. Renault, « Hegel et le paradigme du travail », Revue Internationale de philosophie, 2016/4, p. 486-487.
[2] A. Honneth, « Travail et agir instrumental. Problèmes catégoriels d’une théorie critique de la société » in Un monde de déchirements, trad. O. Voirol, Paris, La Découverte, 2013, p. 39.
[3] H. Arendt, Condition de l’homme moderne, Paris : Calmann-Levy, 1983.
[4] A. Gorz, Métamorphoses du travail. Critique de la raison économique, Paris, Gallimard, 2010.
[5] Moishe Postone, Temps, travail et domination sociale. Paris : Mille et une nuits, 2009. Postone, à la différence de Gorz, se réclame de Marx, dont il propose une réinterprétation radicalement différente de ce qu’il appelle le « marxisme traditionnel ».
[6] Dominique Méda, Le Travail : une valeur en voie de disparition, Paris : Flammarion, 1995.
[7] H. Arendt, Condition de l’homme moderne, Paris : Calmann-Levy, 1983, p. 128.
[8] Précisons, comme Paul Ricoeur, que les catégories de travail, oeuvre et action chez Arendt ne sont pas des structures anhistoriques de l’esprit, mais des structures historiques, qui, malgré de multiples mutations, « conservent une identité flexible qui autorise à les désigner comme des traits perdurables de la condition humaine ». Paul Ricoeur, « Préface » in H. Arendt, La condition de l’homme moderne, Paris : Calmann-Levy, 1983, p. 16.
[9] David Graeber, Bullshit Jobs, Paris : LLL, 2018, p. 37.
[10] David Graeber, Bullshit Jobs, Paris : LLL, 2018, p. 43.
[11] David Graeber, Bullshit Jobs, Paris : LLL, 2018, p. 48.
[12] Graeber présente cinq idéaux-types de « bullshit jobs ».
1. Les « larbins » : ces emplois ont une fonction purement symbolique.
2. Les « porte-flingue » : ces emplois existent en raison de leur présence chez un concurrent (publicité, lobbyistes, marketing).
3. Les « rafistoleurs » : ces emplois règlent des problèmes qui ne devraient pas exister si l’organisation fonctionnait correctement.
4. Les « cocheurs de cases » : leur fonction est de permettre à une organisation de prétendre faire quelque chose qu’en réalité elle ne fait pas.
5. Les « petits chefs » : ils assignent des tâches à leurs subordonnés et vérifient ensuite qu’elles sont effectuées, alors que les subordonnés pourraient organiser leur travail sans lui.
[13] Graeber, ibid, p. 175.
[14] Graeber, ibid , p. 21.
[15] Moishe Postone, Temps, travail et domination sociale. Paris : Mille et une nuits, 2009, p. 189.
[16] David Graeber, Bullshit Jobs, Paris : LLL, 2018, p. 13 et p. 148.
[17] Marx, Manuscrits de 1844, Paris : GF, 1999.
[18] Il cite ainsi p. 343 George Orwell, Dans la dèche à Paris et à Londres « Je crois que cette volonté inavouée de perpétuer l’accomplissement de tâches inutiles repose simplement en dernier ressort, sur la peur de la foule. La populace, pense-t-on sans le dire, est composée d’animaux d’une espèce si vile qu’ils pourraient devenir dangereux si on les laissait inoccupés. ».
[19] David Graeber, Bullshit Jobs, Paris : LLL, 2018, p. 288.














