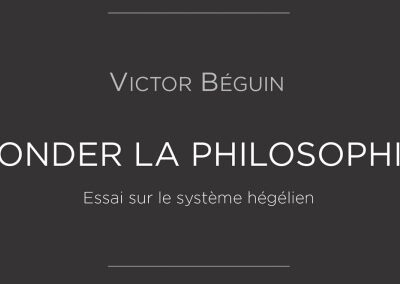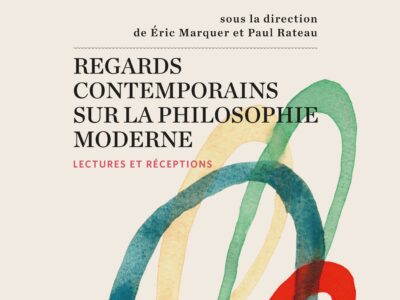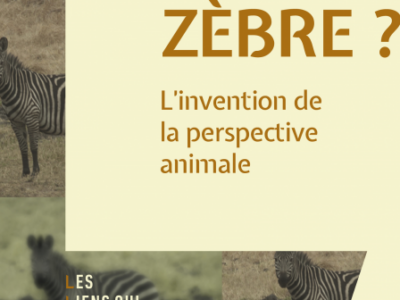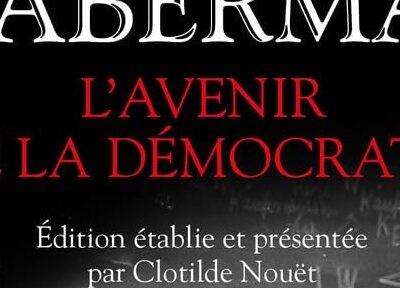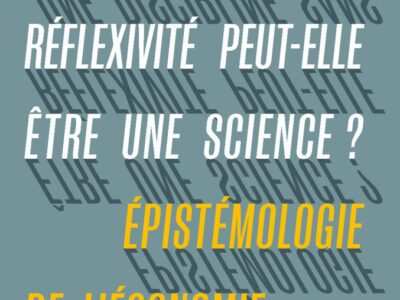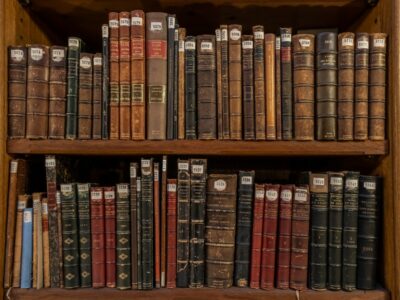Recension – À contre-temps. Révolte, archaïsme et capitalisme
Anton Ajazi est doctorant à l’ENS de Paris (Archives Husserl) et à l’université Laval (Québec). Il travaille sur l’anthropologie philosophique allemande.
Frédéric Rambeau, À contre-temps. Révolte, archaïsme et capitalisme, PUF, Paris, 2023.
L’ouvrage est disponible ici.
Dans son dernier ouvrage, Frédéric Rambeau s’attache à reconsidérer l’archaïsme. Cette redéfinition de l’archaïsme consiste à cesser d’y voir une simple arriération ou régression pour en apercevoir plutôt le potentiel révolutionnaire. En effet, c’est seulement depuis une certaine conception de l’historicité que l’on en vient à définir l’archaïque comme un refus du progrès, ou encore comme une tentation rétrograde. Il s’agit donc d’abord pour l’auteur de se défaire de ce type d’historicité, en mettant en évidence ses insuffisances, pour ensuite se donner les moyens de penser l’archaïsme dans sa positivité. En d’autres termes, il s’agit d’élever cette notion au concept plutôt que d’en faire un simple « signifiant-repoussoir ». L’ouvrage s’attaque donc à la conception dialectique de l’historicité en tant qu’elle repose sur un double postulat : celui de la contemporanéité du temps d’après lequel les éléments du tout existent dans un même temps, ils sont bien contemporains les uns des autres (ainsi le présent n’est que le présent, il est simple et ne peut abriter en lui la coexistence de temporalités hétérogènes) ; puis, celui de la continuité du temps, c’est-à-dire qu’à un instant succède un instant et que le cours du temps ne peut jamais être scandé par la moindre discontinuité (la dialectique comme pensée de la nécessité historique). Or le concept d’archaïsme nous invite, d’après l’auteur, à penser la « non-contemporanéité à soi du temps historique » (p.17). En d’autres termes, l’archaïsme témoignerait de la confluence de différentes temporalités au sein d’un même présent mais aussi de cet empiètement des différentes dimensions du temps sur le présent lui-même. Ainsi le passé n’est pas irrémédiablement derrière nous mais il existe également au présent, il peut faire retour sous la forme d’une réactivation par les sujets en lutte. De même, l’historicité ne peut être pensée indépendamment de cette capacité subjective d’anticipation par laquelle le temps fait un bond en avant. Cette présence du passé est un point que Marx [1] avait déjà aperçu lorsqu’il affirme que tout geste révolutionnaire se veut paradoxalement le prolongement d’une tradition, que toute révolte consiste fondamentalement en une reprise. De même, Engels [2] reconnaît à Thomas Münzer une capacité d’anticipation propre à déjouer la temporalité dialectique puisque dans ce cadre-ci, il ne saurait jamais y avoir de brusque irruption du futur dans le présent alors que c’est précisément cette survenue qu’incarne la guerre des paysans de 1525. Ce thème de la discordance des temps ou du « court-circuit » (p.128) historique est au cœur de l’ouvrage de Frédéric Rambeau.
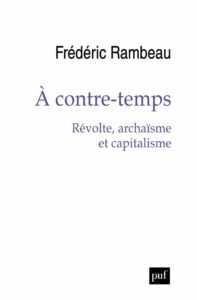 Donc non seulement, le présent abrite en lui différentes temporalités puisqu’il y donc bien une certaine immanence du futur au présent— sur le mode de l’anticipation — et une certaine existence présente du passé — sur le mode de la survivance. Mais cette existence du passé n’est pas vouée par essence à servir des positions conservatrices et ne se cantonne pas non plus à une nostalgie pour une forme de vie prémoderne, supposément caractérisé par un rapport immédiat et harmonieux avec la nature. Comme on le voit avec Marx, le détour par le passé est un fait de la révolution également. Que le passé puisse à la fois servir une posture conservatrice comme révolutionnaire témoigne de l’ambiguïté fondamentale de l’archaïsme. En effet, son potentiel révolutionnaire n’est jamais assuré mais il se donne toujours mêlé, imbriqué à des motifs qui, eux en revanche, sont conservateurs. Ainsi l’archaïque oscille entre un pôle « réactionnaire » et un pôle « insurrectionnel ». D’après l’auteur, il existe donc un lien d’essence entre ces deux concepts : il est de la nature de l’archaïque que d’être ambigu. Or c’est justement l’une des autres lacunes de la dialectique de ne pas réussir à rendre compte de cette ambiguïté. Pour restituer le caractère hybride des luttes concrètes, l’auteur s’appuie sur l’exemple — précédemment étudié par Marx lui-même — de l’Irlande du XIXe siècle. Le pays était sur la voie d’une industrialisation, il cherchait, afin de prospérer, à développer une économie industrielle. Mais il était à cette époque-là une colonie de l’Angleterre qui, afin de pouvoir continuer à puiser dans ses terres, à endigué le développement industriel de l’Irlande et l’a donc maintenue à un état archaïque au sens où elle a été contrainte de demeurer une terre agricole. Si Marx pensait d’abord que les préoccupations nationalistes de l’Irlande constituaient un archaïsme qui freinerait son développement économique, c’est paradoxalement cet attachement à son indépendance qui l’a conduite à refuser cette subordination anglaise, celle-ci la contraignant à rester une terre d’extraction. Ici, un motif archaïque sert l’émancipation. Selon l’auteur, la dialectique s’avère donc incapable de penser ces phénomènes d’oscillation du fait, précisément, de sa conception linéaire et « monolithique » du temps historique (au sens où chaque époque, encore une fois, est une et n’est que ce qu’elle est). Ainsi, comme l’exemple de l’Irlande en témoigne, la transposition d’une historicité dialectique devient rapidement infructueuse dès que Marx s’adonne à des analyses empiriques plus fouillées et bute alors précisément sur cette ambiguïté.
Donc non seulement, le présent abrite en lui différentes temporalités puisqu’il y donc bien une certaine immanence du futur au présent— sur le mode de l’anticipation — et une certaine existence présente du passé — sur le mode de la survivance. Mais cette existence du passé n’est pas vouée par essence à servir des positions conservatrices et ne se cantonne pas non plus à une nostalgie pour une forme de vie prémoderne, supposément caractérisé par un rapport immédiat et harmonieux avec la nature. Comme on le voit avec Marx, le détour par le passé est un fait de la révolution également. Que le passé puisse à la fois servir une posture conservatrice comme révolutionnaire témoigne de l’ambiguïté fondamentale de l’archaïsme. En effet, son potentiel révolutionnaire n’est jamais assuré mais il se donne toujours mêlé, imbriqué à des motifs qui, eux en revanche, sont conservateurs. Ainsi l’archaïque oscille entre un pôle « réactionnaire » et un pôle « insurrectionnel ». D’après l’auteur, il existe donc un lien d’essence entre ces deux concepts : il est de la nature de l’archaïque que d’être ambigu. Or c’est justement l’une des autres lacunes de la dialectique de ne pas réussir à rendre compte de cette ambiguïté. Pour restituer le caractère hybride des luttes concrètes, l’auteur s’appuie sur l’exemple — précédemment étudié par Marx lui-même — de l’Irlande du XIXe siècle. Le pays était sur la voie d’une industrialisation, il cherchait, afin de prospérer, à développer une économie industrielle. Mais il était à cette époque-là une colonie de l’Angleterre qui, afin de pouvoir continuer à puiser dans ses terres, à endigué le développement industriel de l’Irlande et l’a donc maintenue à un état archaïque au sens où elle a été contrainte de demeurer une terre agricole. Si Marx pensait d’abord que les préoccupations nationalistes de l’Irlande constituaient un archaïsme qui freinerait son développement économique, c’est paradoxalement cet attachement à son indépendance qui l’a conduite à refuser cette subordination anglaise, celle-ci la contraignant à rester une terre d’extraction. Ici, un motif archaïque sert l’émancipation. Selon l’auteur, la dialectique s’avère donc incapable de penser ces phénomènes d’oscillation du fait, précisément, de sa conception linéaire et « monolithique » du temps historique (au sens où chaque époque, encore une fois, est une et n’est que ce qu’elle est). Ainsi, comme l’exemple de l’Irlande en témoigne, la transposition d’une historicité dialectique devient rapidement infructueuse dès que Marx s’adonne à des analyses empiriques plus fouillées et bute alors précisément sur cette ambiguïté.
On en vient alors au point d’articulation de deux des concepts centraux de l’ouvrage, à savoir ceux d’archaïsme et de révolte. Ces derniers ont partie liée dans la mesure où, d’après Rambeau, toute révolte est l’expression d’un archaïsme ou en tout cas, plus modestement, manifeste une discordance des temps qui est autre chose qu’un simple retard ou un refus arriéré du progrès. Ce qui noue ces deux concepts d’archaïsme et de révolte tient au fait suivant : ce qui motive la révolte est toujours le sentiment d’un décalage ou d’une inadéquation par rapport à la supposée nécessité historique. La révolte est toujours l’expression d’un contre-temps, d’une arythmie par rapport à l’évolution linéaire que charrie la conception providentielle de l’Histoire. Une partie du travail de Rambeau consiste à identifier ces phénomènes de décalage. Cela passe d’abord par une étude des révoltes communales et autres soulèvements qui précèdent l’ère du capitalisme industriel. Celles-ci manifestent certes un désir subjectif de réactivation d’une époque vouée à passer mais, plus profondément, elles sont animées par le refus que les communes se délitent, qu’elles se laissent désagréger par l’État, sa politique fiscale conduisant à la ruine des solidarités paysannes. Donc le décalage ne désigne pas exclusivement un retard ou une incapacité à se faire moderne. En réalité, on appréhende mal ce phénomène quand on l’interprète en termes de « retour ». « Les procédés qui ressuscitent ne sont jamais les mêmes que ceux par lesquels quelque chose a été suscitée » (p.12). Aussi l’archaïsme n’indique-t-il pas tant la permanence de formes anciennes, historiquement dépassées et qui feraient obstacle à l’émergence des forces d’avenir, que leur capacité à se survivre hors du contexte immédiat de leur apparition, voire à recréer des conditions d’existence de substitution. Il met en question les circonstances présentes qui provoquent la survie des éléments anciens. L’auteur use du terme d’ « inactualité » [3] (p.13) pour désigner cette propriété de l’archaïque. L’inactualité de l’archaïque désigne donc cette capacité qu’il a de subsister par-delà ses différentes instanciations et à demeurer une ressource disponible pour la révolte. Finalement, l’archaïque n’est pas tant une origine fondatrice, recouverte et à laquelle il s’agirait de revenir, qu’un « motif mobile », ré-invoquée dès qu’il y a « conflit de temporalité » [4]. Cette inactualité conduit notamment l’auteur à redéfinir le « communisme primitif » non comme point zéro de l’histoire mais comme idée sans cesse réinvestie par les soulèvements, prolétariens ou non, le communisme n’étant pas une revendication strictement prolétarienne.
Mais affirmer que le décalage produit toujours un regard rétrospectif est une erreur. Ainsi, si Marx fut amené à reconnaître une positivité de l’archaïsme dans le cas de l’Irlande, malmenant le cadre dialectique qui était d’abord le sien, Engels, quant à lui, finit lui-même par trouver ce cadre trop étroit lorsqu’il s’agissait de comprendre la guerre des paysans menée par Münzer. Celui-ci atteste également d’une inadéquation entre ses idées et les conditions matérielles de leur réalisation. Le communisme de Münzer, alors même qu’il est révolutionnaire, déchoit en utopie faute d’une époque à même de le recevoir. C’est d’ailleurs pourquoi il se trouvera contraint de l’exprimer dans l’élément de la religion. Nous avons donc affaire ici à une discordance qui fait signe non plus vers le passé mais vers l’avenir. Cette prodigieuse capacité d’anticipation, par laquelle le futur se fait immanent au présent, court-circuite le cours supposément linéaire et nécessaire de l’histoire. Par ailleurs, le constat de cet écart entre l’idéal et ses conditions historiques de matérialisation peut échauffer encore davantage le soulèvement. Pour conclure sur ce point, nous relevons deux choses : tout d’abord, le décalage n’est pas univoque puisqu’on relève plusieurs « rapports de non-correspondance » [5] possibles entre les différents niveaux de formation sociale (l’économie, l’idéologie, les institutions politiques etc.). Ainsi les mœurs peuvent relever d’un autre temps que le mode de production dominant ou inversement. Ces différents types de décrochage, notamment ceux entre infrastructure et superstructure, constituent d’après l’auteur l’essence même de l’historicité. Penser l’historicité revient donc à penser les transitions. Autrement dit, la dialectique, en tant qu’elle ne pense pas ces transitions (que le marxiste Gramsci s’efforce quant à lui de penser, mais en les qualifiant de « monstrueuses » [6]) ne propose pas de véritable théorie de l’historicité. Elle est toujours, en reprenant la formule d’Althusser, une « dialectique du confort historique. »[7]
L’Histoire avance donc par série de décalages. Ce sont eux qui mettent en branle la machine plutôt que la contradiction objective et on ne peut les comprendre qu’en faisant de l’archaïsme une réalité subjective. La théorie des formes de transition — que l’ouvrage entend exposer — « pense le nouage paradoxal entre survivance et anticipation » (p.190). Or ce nouage prend place dans la subjectivité. Effectivement, c’est toujours par la subjectivité en tant qu’elle est dotée d’un pouvoir d’anticipation et de reprise et donc qu’elle est n’est jamais réductible au contexte socio-historique dans lequel elle se situe, qu’il peut y avoir transition. La science ne peut jamais rendre compte de cette capacité ou en tout cas seulement une fois que c’est advenu. Contre le positivisme d’Althusser, l’auteur fait valoir l’antériorité des luttes concrètes sur ce que le savoir peut en dire, la question de la possible advenue vers un autre mode de production étant d’abord un problème pratique avant d’être un problème scientifique ou théorique. Autrement dit, la théorie ne peut jamais surgir qu’après-coup. Faire tomber la dialectique revient donc à faire tomber le cadre scientiste qui était le sien, enfermant l’action politique dans un dispositif théorique qui était supposé le précéder. Ce positivisme a ceci de contestable qu’il en vient à vider les luttes de leur force et de leur inventivité propres, ce geste d’évidement trouvant son point culminant dans la distinction althussérienne entre science et idéologie. Dans un cadre historique non dialectique (nécessaire pour penser la politique dans son immanence), l’action politique se trouve au contraire frappée d’incertitude. Elle devient ambiguë, pouvant servir des desseins divers voire contradictoires. Elle doit alors trouver en elle-même ses conditions de possibilité et se donner à elle-même son propre langage.
Précisément, l’un des éléments de langage qui revient à dénaturer le sens des luttes concrètes est cette fausse alternative entre modernité et archaïsme, toujours solidaire d’une conception téléologique de l’histoire qui dépeint le capitalisme comme un moment historique nécessaire et revient donc, en ce sens, à le bénir. C’est là une critique supplémentaire que l’auteur adresse à la dialectique. Le temps linéaire tel qu’il est décrit par Hegel [8] puis Marx pense un déploiement successif mécanique des différents modes de production. Il pose donc une nécessité du capitalisme, considéré comme un passage obligé dans l’advenue du socialisme. L’archaïsme permet de court-circuiter cette temporalité qui érige le capitalisme en moment nécessaire de l’émancipation et donc en progrès. Pour l’illustrer, l’auteur s’appuie sur le traitement marxien de la commune rurale russe, d’abord perçue comme une arriération puis finalement comme une forme pré-figurative de rapports sociaux émancipés de la domination capitaliste. Ce passé est toujours disponible pour les soulèvements communistes. Plutôt que d’être perçue comme un frein de l’évolution, elle est ce par quoi on la fait dérailler. La commune rurale n’est plus « un retard, une arriération mais une accélération de l’histoire, un saut vers le communisme qui ne se ferait pas sous la condition de la réalisation nécessaire du capitalisme » (p.128). On comprend alors que l’archaïque est ce qui résiste à la dialectique de l’histoire. C’est à travers lui que l’on parvient à écarter la révolution de toute logique évolutionniste, au profit d’une temporalité dis-chronique, seule à même de penser la contingence des phénomènes historiques ainsi que leur dimension de surgissement (l’histoire ne se laisse pas dérouler).
Cette alternative entre modernité et archaïsme est donc mensongère dans la mesure où l’archaïsme n’est jamais là où on le croit. Ainsi ce ne sont pas tant les paysans qui, incapables de s’adapter à la modernité, sont en quelque sorte en retard de l’histoire, mais le capitalisme lui-même, qui consiste essentiellement en la production de « néo-archaïsmes » (p.13). Afin d’étayer cette thèse — du capitalisme comme « perpétuelle archaïsation » — , l’auteur s’appuie sur la lecture qu’en proposent Deleuze et Guattari [9]. Selon eux, le capitalisme se caractérise également par son ambivalence dans la mesure où il déploie simultanément deux tendances contradictoires : il comporte à la fois un geste de déterritorialisation et un geste de reterritorialisation. C’est ce « double processus simultané de déterritorialisation et de reterritorialisation qui caractérise la tendance contradictoire du capital » (p.206) qu’on trouve par ailleurs déjà abordé dans le livre III du Capital, et ce, concernant le rapport entre basse tendancielle du taux de profit et crises de surproduction. Cette contradiction se joue à plusieurs niveaux, d’abord entre le développement absolu de la productivité sociale du travail (déterritorialisation) et le but de cette production, à savoir la propriété privée (reterritorialisation) ; ensuite à un niveau géographique puisque le capitalisme crée donc simultanément des zones post-industrielles (hautement développées) et des zones dont le développement est arrêté, certaines terres devant par exemple rester agricoles pour constituer la base d’extraction en vue de la production, de même qu’elle entre en contradiction avec le développement d’institutions scolaires de sorte à maintenir disponible une main d’œuvre non-qualifiée. L’ « accumulation primitive » ne désigne donc pas en ce sens une origine fondatrice mais un processus perpétuellement renouvelé. Cette création continuée de néo-archaïsmes trouve sa source dans la relation structurelle entre les formations capitalistes et non capitalistes, dont le cas de l’Irlande nous donnait déjà un exemple probant. De même, parallèlement à cette fluidification de la circulation des marchandises (déterritorialisation), la division du travail à l’œuvre dans l’économie capitaliste est particulièrement rigide, les rapports de subordination y sont inflexibles et relèvent, en ce sens, de la segmentarité dure (reterritorialisation). On voit donc que le capitalisme est toujours solidaire de ce que Rambeau appelle des néo-archaïsmes. En d’autres termes, non seulement la dite modernité déploie des archaïsmes plutôt qu’elle ne les dépasse (dialectiquement) mais elle n’est pas sans reste, c’est-à-dire qu’il y a bien des franges de la population qui demeurent partiellement extérieures au dispositif. Ce sont ces marges ainsi que le rapport ambivalent qu’elles entretiennent à leur époque qui sont « l’accoucheuse de l’Histoire ».
Au sein de cet ouvrage, on ne peut que saluer la discussion serrée avec l’historicisme marxien, puis l’ambition qui est la sienne de conférer à l’archaïsme une extension telle qu’il le situe au carrefour d’une philosophie de l’histoire, d’une philosophie politique et d’une théorie du sujet. Mais c’est précisément cette extension qui, par endroits, affaiblit le propos. Il semble difficile d’affirmer qu’il y a une positivité politique de l’archaïsme tout en lui attribuant l’ambiguïté comme trait fondamental. Si, en effet, aucune époque n’est jamais monolithique, la praxis implique quant à elle l’exclusion de toute ambiguïté et l’institution d’une ligne claire. Cette nécessité politique d’une dissolution de l’ambiguïté, ambiguïté que le fascisme exploite (manière qu’il a d’avancer dissimulé en se parant de thèmes progressistes) constitue, d’après nous, l’angle mort de ce texte. La politique, parce qu’elle est une praxis, exige une détermination univoque.
[1] K. Marx, Le Dix-huit Brumaire de Louis Napoléon Bonaparte, Paris, Éditions sociales, 1992, p.192
[2] F. Engels, La guerre des paysans en Allemagne, Paris, Éditions sociales, 1929, p.312
[3] Si F. Rambeau semble employer de façon équivalente les termes « inactuel » et « intempestif », la référence à Nietzsche demeure ténue au sein de l’ouvrage, le philosophe n’étant cité qu’une fois.
[4] Ibid., p.7
[5] L. Althusser, La Querelle de l’humanisme, dans Écrits philosophiques et politiques, t. 2, Paris, Stock/Imec, 1995/1997, p.515
[6] A. Gramsci, Cahiers de Prison (Tome 3 – Cahiers 10 à 13), Cahier 11, Section 4, Nrf Gallimard, 1978, § 53, p. 277
[7] Lire le Capital, Paris, Maspero, 1965, Puf Quadrige, 1996, p.293
[8] F. Rambeau ne donne pas ici de référence précise mais cette historicité dialectique est exposée et mise en œuvre dans les Leçons sur la philosophie de l’histoire de Hegel (Vrin, « Bibliothèque des textes philosophiques », 1979)
[9] L’Anti-Oedipe, Paris, Minuit, 1972, III. Sauvages, barbares, civilisés, p.306-307