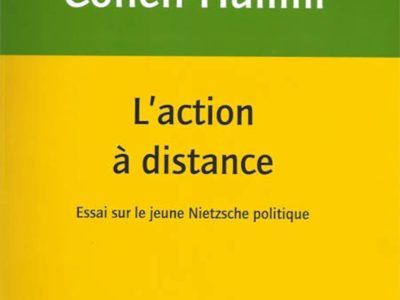Qu’est-ce qu’un objet ordinaire ? (1/2)
Grégoire Lefftz, doctorant à l’université Paris-IV au sein de l’équipe « Sciences, Normes, Décision ».
Réflexion sur le problème du multiple

Le concept d’objet ordinaire peut être caractérisé de manière négative. Tout d’abord, les objets immatériels, tels un ego cartésien ou un nombre, en sont exclus, contrairement à une table ou un arbre. Ensuite, ce concept exclut les référents des termes théoriques : une pierre est un objet ordinaire, mais pas un électron. Bien sûr, des objets ordinaires tels qu’une voiture ou un téléphone peuvent supposer, pour exister, une théorie d’une ampleur considérable ; il demeure que ces objets ne sont pas eux-mêmes les référents de termes théoriques, et qu’un individu absolument exempt de toute éducation scientifique, s’il dispose d’assez d’informations, pourra toujours déterminer sans se tromper s’il est en présence d’un tel objet ou non. Enfin, un objet ordinaire n’est pas un universel, au sens où il n’admet pas d’instanciations : ainsi l’humanité, contrairement à Socrate, n’en est-elle pas un.
Le concept ainsi caractérisé est d’usage courant dans la littérature métaphysique contemporaine de tradition analytique. Sa fonction principale est d’y servir à la construction en série de paradoxes et autres insolubilia. C’est l’un d’eux que l’on se propose d’examiner ici : le problème du multiple (problem of the many) – non point tant pour l’intérêt propre qu’il pourrait présenter, que pour ce qu’il permet de comprendre du concept d’objet ordinaire, et plus largement, de notre notion même d’objectivité.
I. Le problème du multiple
a) Le paradoxe des mille et un chats
Le problème du multiple a été découvert simultanément par Peter Unger (1980) et Peter Geach (1980, 215-16). Ce dernier le formule sous la forme du paradoxe des mille et un chats. Considérons un chat, Tibbles, qui fait tranquillement la sieste sur un tapis. Appelons « Tib » la partie propre de Tibbles qui contient tout son corps moins un certain poil, p1. Tib est un chat. En effet, il est fort possible que Tibbles perde p1, mais il ne cessera pas pour autant d’exister. Autrement dit, la perte de p1 ne fait pas apparaître subitement un nouveau chat ; et pourtant, après cette perte, Tibbles est rigoureusement identique à Tib. Donc ce dernier devait déjà exister avant la perte de p1. Comme cette opération peut être répétée pour chaque poil, et même pour chaque partie propre de Tibbles, nous avons un très grand nombre de chats (au moins mille et un), là où nous avions cru n’en avoir qu’un seul. Il y a donc bien ici un paradoxe, parce qu’il y a trois propositions inconsistantes, mais également plausibles en apparence :
Le paradoxe des mille et un chats – 1
(1) Il y a un unique chat sur le tapis : Tibbles.
(2) Un chat qui possède un certain poil, et un chat semblable en tout point au premier à ceci près qu’il ne possède pas ce poil, sont deux chats distincts.
(3) Lorsque Tibbles perd un poil, cela ne fait ni apparaître ni disparaître aucun chat.
La conjonction des propositions (2) et (3) permet de conclure que Tib est un chat, et qu’il existe déjà avant que Tibbles ne perde son poil ; mais comme, avant cette perte, Tib n’a pas exactement la même composition matérielle que Tibbles, il est distinct de Tibbles (par la Loi de Leibniz[1], qui régit le concept d’identité). Donc, avant la perte de p1, il y a au moins deux chats sur le tapis, et la première proposition, qui exprime par excellence le point de vue du sens commun, est contredite.
Il est par ailleurs possible de donner une autre interprétation de ce problème, en y voyant une instance du paradoxe de la constitution matérielle. Ce dernier apparaît lorsqu’un objet n’a pas les mêmes propriétés temporelles ou modales que la portion de matière qui le constitue. Supposons que l’on façonne à l’instant t une statue à partir d’une motte d’argile : la statue commence à exister à t, mais la motte d’argile existait déjà à t-1. À t+1, la statue et la motte d’argile coïncident exactement d’un point de vue matériel : elles semblent donc identiques. Mais à t+1, la motte d’argile possède aussi la propriété d’avoir pesé un certain poids à t-1 ; or la statue ne possède pas cette propriété, puisqu’elle n’existait pas à t-1. Par la Loi de Leibniz, les deux objets sont donc distincts[2]. Or il semblerait que l’on rencontre avec nos chats un problème semblable. Soit t l’instant où Tibbles perd son poil fatidique. À t+1, Tibbles et Tib coïncident exactement, et doivent donc être identiques ; mais ils ont des propriétés différentes (car ils n’ont pas la même histoire), et ne peuvent donc pas être identiques.
C’est pourquoi David Lewis (1999, 166-7) remarque qu’à ce stade, le paradoxe n’est pas encore très menaçant. Il suffirait pour le dissiper de remarquer que Tibbles et Tib ne sont pas identiques simpliciter, mais sont des parties temporelles distinctes qui, durant une certaine période de leur histoire, se trouvent coïncider. Aussi propose-t-il cette modification des données du problème, qui les rapproche de celles exposées par Unger, fondées sur le vague de nos concepts d’objets ordinaires. Au printemps, Tibbles perd ses poils ; un grand nombre d’entre eux ont déjà commencé à se détacher, mais sont encore légèrement retenus, notamment par les autres poils. Le point de savoir si Tibbles les possède encore ou non est vague. Supposons que chacun de ses mille poils soit dans ce cas, et que chacun caractérise une partie propre différente de Tibbles (comme p1 distinguait Tib de Tibbles). Chacune de ces parties a, dit Lewis, « un titre égal à être Tibbles » (1999, 166) : il semble donc bien que nous ayons, à nouveau, mille et un chats. Dans cette reformulation du paradoxe, c’est la troisième prémisse qui a été remplacée :
Le paradoxe des mille et un chats – 2
(1) Il y a un unique chat sur le tapis : Tibbles.
(2) Un chat qui possède un certain poil, et un chat semblable en tout point au premier à ceci près qu’il ne possède pas ce poil, sont deux chats distincts.
(3’) Il y a sur le tapis, pour chaque poil de Tibbles, une partie (propre ou non) de Tibbles qui le possède et une autre qui ne le possède pas (et qui, ce poil mis à part, recouvre tout le corps de Tibbles), et chacune de ces parties est un chat.
(3’) est justifiée de la manière suivante. Étant donné la situation printanière, chaque poil n’est ni clairement une partie du corps de Tibbles, ni clairement hors de son corps (à chaque fois, la possession du poil est vague). Par conséquent, il y a pour chaque poil deux manières de trancher, ou de « raffiner » notre idée de Tibbles : soit celui-ci le possède, soit il ne le possède pas. Après ce double raffinement, nous avons donc deux idées, singularisant chacune un objet ; or si l’un des deux est un chat, l’autre l’est aussi, car un seul poil ne peut faire une telle différence. Une fois parvenu à ce point, il suffit d’ajouter (2) pour dériver la conclusion recherchée par Lewis : il y a bel et bien mille et un chats sur le tapis.
b) Première solution envisageable : le nihilisme ontologique
Peter Unger (1979, 1980) considère le problème du multiple comme un argument en faveur du nihilisme ontologique : la thèse selon laquelle les objets ordinaires n’existent pas. Le concept d’objet ordinaire suppose selon lui, à titre de condition d’application, qu’il existe des objets nettement délimités, caractérisables de manière univoque. La satisfaction d’une telle condition justifierait les énoncés tels que (1) (« Il y a un unique chat sur le tapis »). Mais pour les objets macroscopiques qui constituent notre environnement habituel, elle n’est jamais remplie : tout objet est vague, sa frontière pourrait toujours être tracée de différentes manières, en incluant ou en excluant sinon tel poil, au moins tel atome. Par conséquent le concept ne s’applique jamais : il n’y a pas d’objets ordinaires.
On peut toutefois douter de la crédibilité d’une telle solution au problème du multiple, pour deux raisons au moins. En premier lieu, il s’agit d’une solution révisionniste qui remplace notre concept ordinaire d’objet ordinaire par une notion homonyme. De fait, le concept que nous avons l’habitude d’employer s’applique : nous disons qu’il y a des chats, et lorsque Tibbles dort sur le tapis, nous disons qu’il n’y en a qu’un. J’écris actuellement sur un ordinateur, et cet ordinateur est un objet ordinaire, au sens habituel du mot. Il est évidemment possible de transformer ce sens par une stipulation, telle que : « appelons objet ordinaire tout objet dont la délimitation ne comporte aucune indétermination ». Sous la règle de cette stipulation, il sera illégitime d’appeler un ordinateur un « objet ordinaire » ; mais c’est un fait constant que notre usage ordinaire de la notion n’obéit pas à la règle ainsi stipulée. Ainsi, lorsqu’Unger déclare qu’il n’y a pas d’objets ordinaires, il parle d’autre chose que nous ne l’entendons couramment par ces mots. Il n’y a certes pas de tables au sens d’Unger, mais cela ne change rien au fait qu’il y a bel et bien des tables au sens habituel du terme ! On peut bien dès lors lui concéder sa thèse, mais il est douteux qu’elle doive nous troubler trop profondément.
Unger lui-même utilise d’ailleurs deux types d’expressions, qu’il a tendance à employer comme équivalentes : il écrit d’une part que notre concept d’objet ordinaire est inconsistant (voir 1979, 121), d’autre part qu’il ne s’applique pas (voir le titre de 1979). Or ces deux affirmations ne sont en aucun cas équivalentes, et doivent plutôt être comprises comme deux étapes distinctes d’un même raisonnement. Unger paraît en effet nous dire ceci : ce que révèle le problème du multiple, c’est l’inconsistance de notre concept d’objet ordinaire, qui donne lieu à des paradoxes liés au vague tels que celui des mille et un chats. Par conséquent, ce concept doit être révisé par stipulation, de manière à échapper à ces problèmes ; et le nouveau concept ainsi obtenu ne s’applique pas. Si on l’interprète ainsi, le caractère révisionniste de la position d’Unger est patent.
La deuxième raison pour laquelle cette solution ne paraît pas satisfaisante est qu’elle semble bien moins une manière de résoudre le problème du multiple, qu’une réinterprétation de ce problème lui-même. Celui-ci nous donnait en effet trop d’objets : mille et un chats, là où nous croyions n’en avoir qu’un. La « solution » d’Unger nous donne, à l’inverse, trop peu d’objets : aucun chat, là où nous croyions en avoir un. En quoi cette solution est-elle préférable au problème lui-même[3] ? Michael Rea peut ainsi écrire (1997, xlviii) : « Le problème soulevé par ce paradoxe est qu’il semble que certaines parties propres, disons, de chats, ont-elles-mêmes toutes les qualités pertinentes pour compter elles-mêmes comme des chats, mais nous ne les comptons pas habituellement comme telles ; par conséquent, on ne voit pas bien si nous devrions admettre qu’il y a infiniment plus de chats, de bateaux et de personnes que nous ne le croyons, ou bien si nous devrions plutôt refuser de compter quoi que ce soit comme un chat, un bateau ou une personne ».
Ce point peut encore être souligné d’une manière différente. Un paradoxe est constitué de plusieurs propositions prima facie également plausibles, mais inconsistantes. Le type le plus courant de solution consiste à sacrifier l’une de ces propositions afin de sauver les autres. Mais la « solution » d’Unger consiste, en un geste étonnant, à les rejeter toutes. (1) est évidemment niée, puisqu’il n’y a pas de chats ; mais (2) et (3’) le sont également, pour la même raison. Enfin, (3) est bien conservée, mais pour une raison qui pervertit totalement son sens : lorsque Tibbles perd un poil il n’y a certes pas un nouveau chat qui apparaît à sa place, mais ce n’est pas parce que Tibbles resterait le chat qu’il est ; c’est parce qu’il n’arrive jamais que Tibbles perde un poil (parce qu’il n’existe pas).
Pour ces deux raisons, le nihilisme ontologique ne paraît donc pas une solution acceptable au problème du multiple.
c) Deuxième solution envisageable : l’essentialisme
Une autre solution envisageable consisterait à trouver une propriété particulière, dont on établirait qu’elle seule singularise des objets. Le paradoxe serait ainsi résolu, parce que la possibilité de faire coïncider un objet avec chaque partie propre de Tibbles serait bloquée (c’est donc les propositions (3) et (3’) qui seraient niées). Il faudrait pour cela réussir à isoler une propriété que possède Tibbles et que ne possède aucune de ses parties propres. On pourrait dire alors que Tibbles est bien un objet, mais qu’aucune de ses parties propres n’en est un, de sorte qu’il n’y a, comme on le voulait, qu’un seul chat sur le tapis.
Cette solution est permise par la thèse de Peter van Inwagen (1990, ch. 9), qui trouve dans la notion de vie la réponse à sa question de la composition spéciale[4]. Les seules parties qui composent un objet sont celles d’un corps vivant : « ( y les x composent y) ssi l’activité des x constitue une vie (ou il y a un seul x) » (1990, 82). Quant à savoir ce qu’est une vie, c’est au biologiste à nous le dire précisément. Mais, prévient van Inwagen, ce concept a du moins l’avantage d’être beaucoup moins vague que ceux ordinairement employés pour singulariser les objets ordinaires, tel que celui de chat : « [U]ne vie est un événement individué de manière raisonnablement nette (“a reasonably well-individuated event”). Il y a souvent une réponse raisonnablement claire à la question de savoir si une vie qui est observée à un certain moment […] est la même que celle qui est observée à un autre moment. » (1990, 87). Cette réponse semble donc nous délivrer de nos hésitations : clairement, Tibbles est un objet, car c’est un être vivant ; et tout aussi clairement, aucune partie propre de Tibbles n’est un objet, car aucune n’est, par elle-même, un être vivant. Les propositions (3) et (3’) sont rejetées, et les propositions (1) et (2) sont sauves : le paradoxe semble résolu.
Cette solution est toutefois confrontée à trois problèmes majeurs, qu’elle paraît incapable de surmonter. Le premier, et le plus grave, est qu’il s’agit d’une solution strictement locale. Si van Inwagen admet les objets vivants, il embrasse une thèse nihiliste à propos de tous les autres objets ordinaires. Mais, comme cela vient d’être expliqué, le nihilisme s’avère incapable de résoudre le problème du multiple : il n’en est qu’une autre version. Dire qu’aucun objet n’existe à l’exception des êtres vivants n’est sans doute pas moins perturbant du point de vue du sens commun que de montrer Tibbles en déclarant : « voici mille et un chats ». Songeons à la phrase : « la table sur laquelle je suis en train d’écrire n’existe pas ». Est-il alors préférable d’adopter la solution locale de van Inwagen sans l’assortir de sa clause nihiliste ? En aucun cas, car le problème du multiple réapparaîtrait sous sa forme initiale à propos de tout objet inanimé : au lieu du problème des mille et un chats nous rencontrerions celui des mille et une tables, en désignant à chaque fois des parties propres d’un tel meuble qui n’auraient par exemple qu’un seul atome de moins que lui. En d’autres termes, si la thèse de van Inwagen constitue bien une réponse (qu’elle soit ou non satisfaisante) au paradoxe des mille et un chats, elle ne peut même pas prétendre résoudre le problème plus général du multiple, dont le précédent n’était qu’un cas particulier.
Un deuxième problème apparaît lorsque l’on considère que la deuxième formulation du paradoxe, suggérée par Lewis, est fondée sur le vague de notre idée de chat, qui justifie la proposition (3’) : du fait de ce vague, nous ne savons pas quelle partie de Tibbles doit être singularisée comme le constituant (à l’exception de toutes les autres), et nous semblons donc obligés d’admettre que chacune d’entre elles est Tibbles. Pour être certain que le problème du multiple ne se repose pas à un autre niveau, il serait donc nécessaire que la propriété « extraordinaire » choisie pour répondre à la question de la composition spéciale ne comporte absolument aucun vague. Ce n’est clairement pas le cas de la notion de vie, dont van Inwagen écrit lui-même qu’elle correspond seulement à un événement « raisonnablement bien individué » (1990, 87 ; je souligne). Il est toujours possible d’imaginer des cas où la légitimité de l’application du concept serait indéterminée, et même d’en découvrir dans la nature. Les grenouilles d’Alaska Lithobates sylvaticus se laissent prendre dans la glace et demeurent entièrement gelées durant l’hiver, de sorte que leurs organes vitaux s’arrêtent complètement de fonctionner, jusqu’au dégel où elles repartent sans séquelle. Alors qu’elles sont gelées, sont-elles encore vivantes ? Notre concept de vie paraît trop indéterminé pour imposer une réponse. Par le raisonnement de Lewis, il faudrait dire alors que nous avons ici deux grenouilles, l’une vivant et l’autre non-vivante[5] ; ou plus exactement, puisque selon la thèse de van Inwagen la seule grenouille est celle qui est en vie, que notre grenouille existe et n’existe pas à la fois, ce qui ne paraît guère mieux. Le problème du multiple réapparaît donc, ou empire. Une stratégie envisageable pour défendre ce type de solution serait alors de rechercher une autre notion que celle de vie. Mais pour éliminer ainsi définitivement le problème, il ne suffirait pas que cette nouvelle notion soit moins vague que la précédente, il faudrait qu’elle ne le soit pas du tout. Il est douteux qu’une telle stratégie puisse réussir, sauf à retomber dans le nihilisme, en avançant que seuls les atomes sont des objets véritables[6], de sorte que rien ne compose rien, et que les objets ordinaires n’existent pas.
Le troisième problème auquel cette solution fait face est qu’elle implique une forme d’essentialisme extrêmement forte, que ses défenseurs choisiront peut-être d’accepter, mais qui obère néanmoins gravement sa crédibilité. La notion de vie permet en effet de tracer une délimitation plus ou moins nette dans l’espace et dans le temps entre ce qui est un objet authentique et ce qui n’en est pas un : c’est par exemple le cas de Tibbles, mais ce n’est celui d’aucune de ses parties propres. Mais il faut remarquer qu’outre cette délimitation spatio-temporelle, une délimitation passe également dans la dimension modale. Si Tibbles cessait d’être vivant, il ne serait plus un objet du tout, donc il ne serait plus Tibbles ; en d’autres termes, il est nécessaire que Tibbles soit vivant, s’il existe. Il s’agit bien d’une propriété essentielle. Distinguons ici deux types d’essentialisme :
Essentialisme individuel fort (ou singulier) : Au moins certains individus ont une essence singulière, i.e. une propriété (ou une conjonction de propriétés) à la fois nécessaire et suffisante pour que cet individu possède son identité.
Essentialisme individuel faible (ou sortal) : Au moins certains individus ont une essence sortale, i.e. une propriété (ou une conjonction de propriétés) nécessaire (mais non suffisante) pour que cet individu possède son identité.
C’est bien ici d’essentialisme faible, ou sortal, qu’il s’agit ici : il est nécessaire à Tibbles d’être vivant, mais d’autres individus que lui peuvent l’être aussi, donc être vivant n’est pas une condition suffisante pour être Tibbles. Si cet essentialisme est faible, ne paraît-il pas alors d’autant plus acceptable ? Il y a lieu d’en douter. Si l’essentialisme sortal est bien une thèse faible en comparaison de l’essentialisme singulier, il demeure que ces deux positions sont encore des essentialismes individuels, c’est-à-dire que c’est à des individus qu’elles attribuent une essence. Elles sont donc toutes deux très fortes en comparaison d’un essentialisme générique, qui se contente d’attribuer une propriété essentielle à une sorte (kind), plutôt qu’à un individu :
Essentialisme générique : Au moins certaines sortes ont une essence générique, i.e. une propriété (ou une conjonction de propriétés) nécessaire et suffisante pour que cette sorte possède son identité.
L’essentialisme générique consiste, par exemple, à considérer qu’une substance est de l’eau ssi elle est constituée de molécules H2O. On annexe donc l’identité d’une sorte à la présence d’une propriété essentielle. Mais l’essentialisme sortal dont il s’agit ici doit être nettement distingué de cet essentialisme générique : il annexe quant à lui l’identité d’un individu à son appartenance à une certaine sorte. Or ces deux opérations logiquement distinctes diffèrent crucialement en ceci que plusieurs manières de justifier la première ont été proposées[7], mais que nous n’avons aucune idée de ce qui pourrait justifier la seconde, si ce n’est le recours à notre intuition. Ce problème a été résumé par David Lewis en ces termes (1986, 251) :
Je pense qu’il y a un grand nombre de cas dans lesquels il n’y a pas de réponse déterminée aux questions concernant les représentations de re, et par conséquent pas de réponse correcte aux questions de modalités ou de contrefactuels de re. Hubert Humphrey aurait-il pu être un ange ? Un humain né de parents différents ? Un humain né de parents différents en Egypte ancienne ? Un robot ? Un âne intelligent et parlant ? Un âne ordinaire ? Un œuf poché ? Étant donné certaines informations contextuelles, ces questions pourraient recevoir des réponses sensées. […] Le problème est que la bonne manière de représenter cet individu est déterminée, ou peut-être sous-déterminée, par le contexte – et je n’ai indiqué aucun contexte.
La réponse essentialiste au problème du multiple doit donc expliquer pourquoi Humphrey aurait pu être un âne parlant mais pas un œuf poché, si du moins elle choisit comme propriété particulière celle d’être vivant. Elle doit aussi expliquer comment justifier la vérité de la thèse selon laquelle c’est une propriété qui fait passer la frontière entre le possible et l’impossible à cet endroit-là plutôt qu’à un autre (e.g. entre le robot et l’œuf poché, ou entre l’Egyptien et l’âne parlant) qui constitue l’essence des objets. Si cette thèse a besoin d’un vérifacteur, où se trouve-t-il ? Si elle n’en a pas besoin, pourquoi est-ce le cas ? A moins d’avoir résolu ces questions (et il y a lieu de suspecter que c’est impossible), toute solution essentialiste au problème du multiple semblera profondément arbitraire.
II. La racine du problème
a) Un présupposé commun au problème et à ses solutions
Le raisonnement semble donc avoir atteint une impasse : chacune des solutions envisagées au problème du multiple semble rencontrer des problèmes extrêmement graves. Il serait possible de continuer à chercher des solutions de première venue en espérant, par tâtonnements, en découvrir une qui résiste à toute objection. Mais une autre stratégie est disponible, qui sera ici préférée : tenter de procéder méthodiquement en examinant rétrospectivement les solutions jusqu’ici envisagées, dans le but de déterminer les raisons de leur échec, et de proposer ensuite seulement une solution qui en admette les leçons.
Il nous faut donc tenter de mettre au jour la racine du problème. Dans cette perspective, il est clair qu’un présupposé substantiel qui serait partagé à la fois par la position du paradoxe et par ses solutions putatives constituerait, s’il était découvert, un bon suspect. Il serait au moins raisonnable de se demander si ce n’est pas ce présupposé qui, tout à la fois, fait naître le problème et condamne ses solutions à l’échec. Or un tel présupposé substantiel existe bel et bien. Admettre le problème du multiple aussi bien que tenter de le résoudre de manière nihiliste ou essentialiste nécessite d’admettre que l’identité des objets est, dans son entièreté, un donné. Parce que nous ne pouvons pas décider par nos stipulations de ce qui existe hors de nous, les objets doivent être entièrement déterminés par le monde, sans dépendre aucunement de nos choix sémantiques et conceptuels. De là dérive la possibilité des trois raisonnements suivants.
Considérons en premier lieu le problème du multiple lui-même. Celui-ci suppose l’idée que tout amas de matière, toute somme méréologique, constitue un objet. Tibbles est lui-même un objet, mais toute partie propre de Tibbles qui exclut l’un de ses poils en est un également. Par quelle raison le justifier ? C’est que faire de l’une de ces sommes méréologiques, mais non de l’autre, un objet, semblerait faire dépendre les objets existant dans le monde de nos décisions : si certaines sommes méréologiques constituaient des objets, et d’autres non, cela signifierait que la délimitation des objets serait stipulée par nous. Pour éviter cela, on dira alors qu’aucune délimitation n’est privilégiée. Le raisonnement est en somme le suivant : toute manière de privilégier une délimitation sur une autre semblerait signifier que l’identité des objets n’est pas donnée, mais est arbitraire (de quel droit choisirions-nous une délimitation particulière ?) ; on dira donc qu’aucune délimitation n’est privilégiée, et que chacune définit un objet. On échappe ainsi à l’idée que le découpage des objets serait arbitraire, et l’on sauve ipso facto la thèse que tous les objets sont donnés, en refusant de discriminer entre les manières possibles de les délimiter. Ce raisonnement apparaît clairement dans la deuxième formulation du paradoxe, suggérée par Lewis : chacune des manières possibles de singulariser Tibbles a « un titre égal » à être Tibbles. De quel droit choisirions-nous ? La délimitation de Tibbles doit nous être donnée (ou ne pas être) ; et comme il y a mille et une manières possibles de tracer cette délimitation, il y a mille et un Tibbles.
Cette conception de l’identité des objets est également présupposée par la tentative nihiliste de résolution du problème du multiple. Le raisonnement est simple : si l’on souhaite éviter tout choix arbitraire entre les délimitations possibles des objets, une solution est de les admettre toutes ; une autre, de n’en admettre aucune. Cette remarque permet de mieux comprendre en quoi le nihilisme n’est au fond qu’une autre version du problème du multiple. Ce problème ne réside, en réalité, pas vraiment dans le fait d’admettre de très nombreux objets là où il semblait n’y en avoir qu’un. Le cœur du problème consiste plutôt dans l’idée que tout choix entre différentes manières de délimiter des objets est arbitraire et illégitime. Une fois ce point admis, il existe deux façons symétriques de lui donner corps. L’une est d’admettre ce que Sosa (2003) appelle une « ontologie explosive », c’est-à-dire (informellement) une ontologie qui multiplie contre-intuitivement les objets, en admettant tous les découpages : on aura alors mille et un chats, là où il semblait n’y en avoir qu’un. L’autre est d’accepter une ontologie nihiliste, qui n’en admet aucun : on n’aura alors aucun chat, là où il semblait y en avoir un. La première option donne lieu au problème du multiple, la seconde, à ce qu’il faudrait appeler le problème du néant. Mais ces deux problèmes ne sont en réalité que deux manières possibles d’interpréter cette thèse fondamentale : tout choix entre différentes manières possibles de délimiter des objets est arbitraire et illégitime.
Il existe toutefois une manière envisageable de sauver l’idée d’une préférence pour certaines délimitations plutôt que d’autres, sans admettre aucun choix arbitraire : c’est de dire que certaines délimitations, contrairement à toutes les autres, sont tracées par le monde lui-même, sont des délimitations vraies, qui nous sont donc données. C’est en somme le choix de l’essentialisme : certaines propriétés d’élite donnent des objets, car elles seules tracent de vraies limites – tandis que toutes les autres limites sont fausses. Le problème fondamental que pose cette solution a déjà été souligné : on ne voit pas ce qui rendrait vraie ou fausse la délimitation d’un objet. Il semble en quelque sorte que parler de vrai et de faux en cette matière relève d’une erreur de catégories. Van Inwagen rejette plusieurs manières envisageables de délimiter les objets, et admet celle fondée sur l’idée de vie, comme s’il s’agissait d’un fait établi, comme si l’on pouvait découvrir que cette manière de délimiter les objets était la vraie. Mais où découvrira-t-on ce fait ? Dans quel endroit du monde se cache-t-il ? Ce qui importe ici n’est toutefois pas le manque de plausibilité de cette thèse essentialiste ; c’est, précisément, qu’elle présuppose que la bonne manière de délimiter les objets doit être découverte comme un fait, c’est-à-dire, qu’elle doit nous être donnée. La thèse essentialiste reprend ainsi à son compte le présupposé d’où naissait le problème qu’elle s’attache à résoudre. Comment, dès lors, serait-elle couronnée de succès[8] ?
On peut résumer ce qui précède en présentant chacun des trois raisonnements sous forme synoptique. Il apparaît alors que tous trois partagent leur première prémisse :
Le problème : (i) Les délimitations doivent nous être imposées (ou ne pas être) ; (ii) or le monde nous impose de nombreuses manières de délimiter Tibbles (il nous en donne au moins mille et une) ; (iii) donc il y a mille et un chats sur le tapis.
La solution nihiliste : (i) Les délimitations doivent nous être imposées (ou ne pas être) ; (ii) or le monde ne nous impose aucune délimitation privilégiée de Tibbles ; (iii) donc Tibbles n’existe pas.
La solution essentialiste : (i) Les délimitations doivent nous être imposées (ou ne pas être) ; (ii) or le monde nous impose bien une délimitation privilégiée de Tibbles (celle qui constitue une vie) ; (iii) donc Tibbles existe, mais Tib n’existe pas.
La comparaison de ces trois raisonnements permet par ailleurs de diagnostiquer quel principe précis donne lieu au problème du multiple. Le premier raisonnement se distingue en effet des deux autres dans la mesure où il donne une interprétation différente de sa première prémisse, qui lui permet d’aboutir à une conclusion différente. Les deux tentatives de solution supposent en effet qu’un authentique objet doit être singularisé par une délimitation « privilégiée » (qu’une telle délimitation existe ou non) ; à l’inverse, la position du problème suppose que toute délimitation, privilégiée ou non, singularise un objet. Dans un cas comme dans l’autre, tout est fixé par le monde, aucun choix ne nous revient. Mais ce sont là deux manières différentes de ne pas choisir. D’après l’interprétation qui engendre le problème, à chaque zone spatiale correspondra un objet distinct : car choisir, entre plusieurs zones spatiales, celle qui délimite un objet, serait déjà déroger à l’idée que le point de savoir quels objets existent dans le monde ne dépend aucunement de nous. Laisser paraître le problème du multiple présuppose donc d’admettre ce principe : à chaque délimitation spatiale distincte correspond un objet distinct. Ce principe donne évidemment lieu à une ontologie explosive : le monde déborde d’objets (car il déborde de délimitations spatiales qui se chevauchent et ne diffèrent que très légèrement les unes des autres), et là où nous croyions n’avoir qu’un chat, il y en a en fait une infinité. Il est le cœur même du problème du multiple. Mettre au jour une raison convaincante de rejeter ce principe, c’est donc résoudre ipso facto le problème. Mais il se pourrait que l’enjeu excède ici largement la question de ce seul paradoxe : car entre ce qui est purement donné et ce qui ne l’est pas tout à fait, c’est notre concept même d’objet ordinaire, et plus largement d’objectivité, qui est ici en jeu.
b) La thèse
Lorsqu’une conception apparemment absurde est dérivée à partir d’une prémisse qui n’est pas totalement évidente, il est rationnel d’interpréter cette dérivation, non comme une preuve de la conception absurde, mais comme une reductio de la prémisse. La thèse que je propose est que nous nous trouvons précisément dans cette situation. Aussi bien le problème du multiple que son interprétation nihiliste et sa tentative de résolution essentialiste apparaissent lorsque l’on présuppose qu’il ne peut y avoir aucun choix entre les différentes manières possibles de délimiter les objets. Or il a été établi que ces trois positions doivent être rejetées. Nous tenons donc une reductio du présupposé qui les suscitait.
Mais s’en tenir là serait philosophiquement insatisfaisant. Il ne suffit pas d’affirmer la fausseté de ce présupposé : il faut encore (i) tenter d’expliquer où réside exactement l’erreur qu’il commet, et (ii) proposer au moins l’esquisse d’une conception qui pourrait le remplacer. La fin de cette section a pour objet d’élucider le premier point ; la prochaine entreprendra le second.
Sans doute les objets ordinaires n’ont-ils pas de limite qui nous serait imposée de manière déterminée. La meilleure présentation de ce fait est sans doute donnée par Richard Feynman (1964, ch. 12), dans la citation que van Inwagen place d’ailleurs en épigraphe de son livre :
… Qu’est-ce qu’un objet ? Les philosophes disent toujours : “prenez par exemple une chaise”. Dès qu’ils disent cela, on sait qu’ils ne savent plus de quoi ils parlent. Qu’est-ce qu’une chaise ? Eh bien, une chaise est une certaine chose par là-bas… certaine ? comment cela, certaine ? Les atomes s’en évaporent régulièrement – pas beaucoup d’atomes, mais quelques-uns -, de la saleté tombe dessus et se dissout dans la peinture ; ainsi, définir précisément une chaise, dire exactement quels atomes lui appartiennent, et lesquels sont de l’air, lesquels sont de la saleté, ou lesquels sont de la peinture répandue sur elle, est impossible.
Les objets ordinaires sont vagues : le monde ne nous en impose aucune délimitation unique. De ce fait, le partisan de l’ontologie explosive infère qu’il y a partout une infinité d’objets ; celui du nihilisme, qu’il n’y en a aucun ; celui de l’essentialisme, que certains objets font exception (parce que le monde nous en impose après tout une délimitation), et que ceux-là sont les seuls à exister. Mais pour passer de cette prémisse à chacune de ces trois conclusions, il faut à chaque fois une prémisse supplémentaire : à savoir, que seule une délimitation imposée par le monde est, tout simplement, une délimitation.
Or que suppose cette prémisse ? Son inspiration, ou son sens philosophique, réside dans l’idée qu’entre le donné et l’arbitraire, le tiers est exclu. Si l’on veut résister à la thèse selon laquelle le point de savoir quels objets existent dans le monde devrait être réglé arbitrairement (et il ne fait guère de doute que l’on veut y résister), alors il faudrait admettre que la délimitation des objets est, tout simplement, donnée, sans aucune marge de manoeuvre. C’est en quoi cette prémisse est fourvoyée. Le conventionnel n’est pas l’arbitraire (une limitation de vitesse est une convention, mais il n’est pas indifférent de la placer à 50 km/h ou à 200km/h en centre-ville). Ainsi, dire que la délimitation des objets ordinaires ne nous est jamais imposée de manière univoque n’est pas encore affirmer que le monde ne pose aucune contrainte sur nos manières de tracer ces délimitations. Le tiers n’est tout simplement pas exclu. Pour cette raison, il est au moins envisageable de rejeter le présupposé selon lequel l’identité des objets nous est donnée si elle n’est pas arbitraire. Mais alors, en quoi cette identité consiste-t-elle ? Et par quel substitut de meilleur aloi faut-il remplacer ce présupposé problématique ?
La seconde partie de l’article est accessible ici.
[1] Selon laquelle si deux objets sont identiques, alors ils ont exactement les mêmes propriétés (ce qui traduit le fait que s’ils sont identiques, alors ils ne sont en fait qu’un seul et même objet). D’où l’on peut conclure par contraposition que si deux objets diffèrent quant à l’une au moins de leurs propriétés, ils sont numériquement distincts.
[2] Ici, le paradoxe est volontairement formulé en termes de propriétés temporellement indexées, pour que le cas de la statue et de l’argile soit parallèle à celui de Tibbles et Tib. Il est également possible de construire le paradoxe de la constitution matérielle en utilisant des propriétés modales : la motte d’argile pourrait être écrasée (et ne pas perdre son identité, c’est-à-dire, rester néanmoins cette motte d’argile) ; la statue, suppose-t-on, ne le peut pas.
[3] Le souci d’économie ontologique dont la tradition analytique est imprégnée pourrait conduire à accorder malgré tout sa préférence au nihilisme. Mais il ne faut pas perdre de vue qu’une théorie A plus économique qu’une théorie B ne lui est préférable que ceteris paribus : notamment, si B parvient mieux que A à rendre compte des données disponibles, elle peut être lui être préférée en dépit de son caractère ontologiquement dispendieux. Or, quelle donnée est-elle plus intangible que celle de l’existence des objets ordinaires ? De même, l’ensemble vide est moins coûteux, ontologiquement parlant, que la relativité générale ; mais il est surtout beaucoup plus stérile. Ce type d’économie au rabais ne présente, évidemment, aucun avantage théorique (mais devrait plutôt conduire à abandonner toute théorie, rien n’étant plus économique qu’une page blanche).
[4] Cette question s’énonce : « Quand est-il vrai que : les x composent y ? », où les x sont les parties de n’importe quelle somme méréologique (1990, 30).
[5] On hésite à dire « morte », puisque le dégel la voit se ranimer. L’indétermination du concept de mort est symétrique de celle du concept de vie.
[6] Du fait de la discrétion quantique qui les sépare, être un atome d’une certaine sorte est sans doute un exemple de propriété absolument déterminée. Aucun spectre intermédiaire n’existe entre l’atome d’hydrogène, qui ne comporte qu’un électron, et celui d’hélium, qui en comporte deux.
[7] Une telle essence serait soit découverte, comme le veut Brian Ellis (2001), soit stipulée, comme le veut Joseph LaPorte (2004). Il se peut que ces deux solutions s’appliquent à des sortes de différents domaines : e.g. la découverte pour les sortes physiques, et la stipulation pour les sortes d’autres types, notamment biologique.
[8] Il est vrai que les conditions d’identité de certaines sortes, notamment physiques (e.g. électron, hélium, gaz parfait) pourraient bien être découvertes comme des faits (voir note 7). Mais il importe de garder à l’esprit que l’examen porte ici sur l’identité des objets ordinaires, qui sont, comme cela a été précisé en introduction, des objets à la fois individuels et non-théoriques.