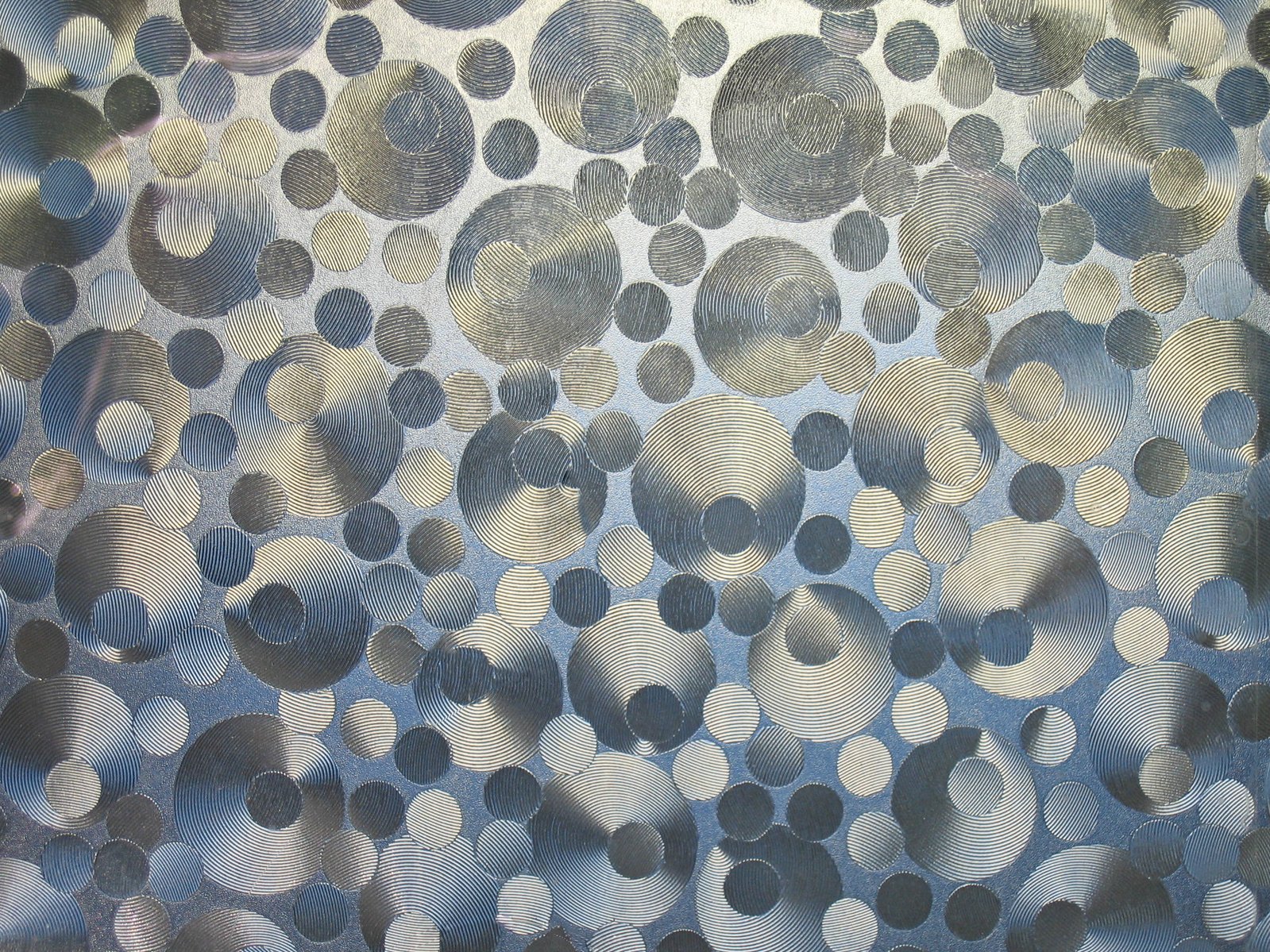Quels apports de la neuroéthique pour penser et traiter les addictions ?
Mélanie Trouessin, ENS de Lyon
Introduction
Les neurosciences semblent avoir bouleversé notre manière de comprendre nos comportements de la vie quotidienne, qu’ils soient normaux ou pathologiques. L’addiction, caractérisée notamment par la perte de contrôle d’un comportement, à savoir l’impossibilité ou la grande difficulté à l’arrêter ou le réduire lorsqu’on le voudrait, est une bonne illustration de ce bouleversement. Longtemps, elle fut envisagée d’un point de vue moral, comme relevant de la faute des individus et engageant du même coup leur responsabilité personnelle. L’addiction a en outre souvent été comprise comme une maladie, sans qu’aucun consensus sur ce point n’ait jamais vraiment été accepté. Cela semble changer avec l’avènement de la neuroimagerie et le progrès des neurosciences qui établissent, au milieu des années 1990, des preuves en faveur d’une conception de l’addiction comme maladie cérébrale chronique, caractérisée par la compulsion (Leshner, 1994).
L’impact de cette conception n’est pas seulement théorique : il devrait aboutir à une nouvelle manière de considérer la responsabilité des addicts (morale comme pénale) mais aussi à des innovations en matière de clinique et de politiques publiques. En effet, si l’addiction est fondamentalement un trouble cérébral chronique qui se traduit par une perte de contrôle du comportement, alors les addicts ne devraient plus être tenus pour responsables de quelque chose qu’ils ne peuvent pas ne pas faire. En outre, les progrès de la neuropharmacologie et de la neurochirurgie semblent tendre vers la possibilité d’une guérison de l’addiction ; les politiques publiques devraient alors allouer le plus de financements possibles à ce type de recherche et œuvrer à une déstigmatisation des comportements addictifs.
Cependant, ces prédictions ne se sont pas encore réalisées et cette conception de l’addiction comme maladie cérébrale n’est peut-être pas dépourvue de conséquences néfastes, tant sur le plan sociétal que sur le plan clinique. Tel est le constat que dressent Adrian Carter et Wayne Hall, auteurs d’un ouvrage intitulé Addiction neuroethics, paru en 2011. Ils y proposent un tableau présentant les principaux résultats neuroscientifiques en matière d’addiction et soulèvent les différentes implications et conséquences qui en découlent. La neuroéthique de l’addiction, tout comme la neuroéthique en général, possède une dimension éthique dans un sens large, qui englobe des questionnements sur les présupposés éthiques des travaux neuroscientifiques, mais aussi des interrogations liées aux plans clinique, médical ou sociétal. La neuroéthique intervient donc autant sur le plan théorique, lorsqu’elle évalue la façon dont les neurosciences peuvent effectivement modifier notre compréhension de nous-mêmes, que sur le plan pratique, où c’est alors la démarche même des neurosciences qui est inspectée.
Nous pensons que la méthode interdisciplinaire et les outils proposés par la neuroéthique offrent un cadre adéquat pour une évaluation des résultats des neurosciences de l’addiction. Cette approche semble permettre d’éviter le double écueil de l’optimisme démesuré et du scepticisme. L’aspect multidimensionnel et complexe de l’addiction semble d’emblée justifier l’intervention de la neuroéthique dans son étude en ce qu’elle aurait pour enjeu général de limiter la prétention de certains travaux neuroscientifiques à parfois vouloir dire le tout de l’addiction. Toutefois, quels seraient les apports spécifiques possibles de la neuroéthique ? En quoi pourrait-elle vraiment permettre de mieux comprendre et de mieux traiter les addictions ?
Dans un premier temps, nous essaierons de mettre au jour, sans prétendre à l’exhaustivité, les traits qui nous paraissent essentiels pour cerner la démarche générale de la neuroéthique : ces traits ne constituent pas des thèses fixes qui définiraient une fois pour toute la neuroéthique mais tendent à introduire à un nouveau champ de recherche, actuel et de fait mouvant, à ses domaines principaux et aux questionnements qu’il couvre. Dans un deuxième temps, nous suggérons trois lieux possibles de l’intervention de la neuroéthique par rapport aux addictions, correspondant aux trois branches majeures de la neuroéthique en général. Il s’agit seulement ici de contribuer à présenter un nouveau champ théorique et ses possibles applications pour appréhender le phénomène addictif ; nous ne proposons donc pas ici d’évaluation critique sur la réussite ou l’échec de l’intervention neuroéthique dans le champ de l’addiction.
Qu’est-ce que la neuroéthique ?
Discipline à caractère interdisciplinaire, mêlant entre autres les contributions et les outils des neurosciences, des spécialités de la médecine et de la philosophie, la neuroéthique est une discipline neuve. Elle est en effet née, institutionnellement, lors des conférences Mapping the field de mai 2002 organisées par la Fondation Dana. C’est son président de l’époque, William Safire, qui est à l’origine du nom « neuroéthique ». Les réflexions sur le lien entre éthique et neurosciences sont cependant bien antérieures (pour une histoire de ce lien, voir Illes, 2006) et pour Éric Racine, le terme lui-même de neuroéthique aurait été inventé et utilisé au moins depuis le début des années 1970, notamment par une femme médecin dans le contexte d’un travail sur les nourrissons (Racine, 2010). Par ailleurs, la question de la nouveauté de la neuroéthique est redoublée par celle de son lien avec la bioéthique. Si pour certains, la neuroéthique ne serait qu’un renouvellement de la bioéthique, certes attaché à de nouvelles (neuro)-techniques mais pas fondamentalement différente dans sa démarche, pour d’autres la neuroéthique constitue une « nouvelle manière de faire de l’éthique » (Levy, 2011) et serait radicalement différente des autres branches de l’éthique biomédicale, en raison du statut spécifique de notre cerveau, organe de notre personnalité (Roskies, 2002). Une voie médiane reviendrait à dire qu’une partie de la neuroéthique se situe dans la droite lignée de la bioéthique : c’est l’ « éthique de la pratique », subdivision de l’une des deux branches de la neuroéthique « appliquée » (Evers, 2009) ou de ce qu’Adina Roskies appelle « l’éthique des neurosciences » (Roskies, 2002). « L’éthique de la pratique » s’attache aux problèmes éthiques de la conduite neuroscientifique, comme par exemple la question du consentement éclairé. Éric Racine semble diviser cette partie en deux, selon qu’il s’agit du champ de la recherche (« Neuroéthique de la recherche ») ou de la clinique (« Neuroéthique clinique ») estimant que les problèmes liés au soin diffèrent fortement de ceux du champ de la recherche, dans la mesure où les professionnels de santé sont liés à des codes déontologiques et ont des responsabilités différentes envers leurs patients que celles que les chercheurs ont avec les volontaires (Racine, 2010).
La réflexion sur « les implications éthiques des neurosciences » vient compléter ce versant « appliqué » de la neuroéthique en s’attachant à l’essor des techniques des neurosciences ainsi qu’à leurs implications du point de vue de la société. C’est la partie de la neuroéthique la plus novatrice, qui prend en charge les réactions de la société et du grand public face à la conception de l’être humain que les neurosciences sont en train de façonner, ainsi que les implications et questions sociétales qui en découlent : les neurosciences ont-elle un impact sur la responsabilité pénale et juridique ? Quelles sont les ressources qui doivent être allouées à la recherche en santé mentale ? Il s’agit également de s’interroger sur les implications potentielles de la neuroimagerie sur la vie privée : n’est-il pas problématique de vouloir créer des détecteurs de mensonge qui pourraient « lire dans le cerveau » et « décoder nos pensées » ? C’est encore le problème de l’amélioration des capacités cognitives et de l’humeur par la neuropharmacologie : est-il juste, moralement et socialement, de chercher non plus seulement à restaurer le normal mais à aller au-delà du normal, vers le meilleur ?
Tandis que l’éthique vient se mêler aux neurosciences dans ces deux branches (« l’éthique des neurosciences »), les neurosciences opèrent en retour à l’intérieur du champ de l’éthique : elles modifient nos conceptions philosophiques éthiques traditionnelles en apportant des informations sur le fondement biologique de notre comportement moral. Ce sont les « neurosciences de l’éthique » qui reprennent des questions aussi anciennes et importantes que celles du libre arbitre et de la responsabilité, de l’identité et de la personnalité ou encore de la prise de décision et du jugement moral. Pour faire référence à cet aspect plus ‘fondamental’ de la neuroéthique, Éric Racine préfère parler de « Neuroéthique réflexive et théorique ». En effet, l’expression de Roskies dénote l’idée d’un passage direct des neurosciences à l’éthique qu’il ne cautionne pas tout à fait.
Derrière ce qui peut sembler n’être qu’une question de mots se cache en fait une véritable question à laquelle la neuroéthique doit répondre : en postulant que les neurosciences puissent se mêler d’éthique, ne va-t-on pas contre la thèse classique de la distinction entre sciences et éthique, les premières étant descriptives et la seconde normative ? Ce serait postuler que les sciences peuvent nous informer non plus seulement sur ce qui est mais aussi sur ce qui doit être. Il serait possible de dériver des jugements de valeur à partir des jugements de faits sans commettre de faute logique ou de « paralogisme naturaliste ».
Cette question est précisément l’occasion de formuler un point qui nous semble important chez la plupart de ceux qui font de la neuroéthique et que l’on peut identifier comme une sorte de « principe de précaution ». Bernard Baertschi en propose une formule adéquate en empruntant à Leibniz l’idée selon laquelle les neurosciences « inclinent sans nécessiter » aux conclusions éthiques (Baertschi, 2009). Baertschi considère tout à la fois que l’imagerie cérébrale produit un impact non négligeable sur nos conceptions métaphysiques et anthropologiques mais que les problème de l’interprétation de ces résultats doivent être pris en charge par la neuroéthique : l’on doit bien insister sur le fait que ce que l’on observe, ce sont des corrélats neuronaux des états psychologiques, dont le type de causalité reste difficile à établir. On peut aussi parler de « plausibilité neurobiologique » : les données neurobiologiques ne déterminent pas, mais elles peuvent invalider certaines hypothèses psychologiques. Éric Racine ne semble pas dire autre chose quand il propose une neurophilosophie de l’éthique méthodologique, qui doit reposer non pas sur un « rapport de contrainte, mais [sur] un rapport d’échange et de collaboration entre les neurosciences et l’éthique » (Racine 2005). Surtout, Racine suggère que les neurosciences ont en fait une pertinence non pas au niveau de l’éthique normative – c’est-à-dire ne peuvent pas se prononcer au niveau de ce qui est bien ou mal ni dire quelle action il faut accomplir pour être moral – mais seulement au niveau métaéthique, où l’on s’attache à la signification des termes moraux. Pour Racine en effet, les neurosciences peuvent nous apporter des données sur la nature proprement éthique de l’homme et donc amener à éclairer voire à modifier la façon dont nous nous voyons comme agents moraux (Racine 2005). Les neurosciences peuvent par exemple nous dire que les émotions jouent un rôle dans la prise de décision mais pas quel type de décision il faut prendre dans une situation en particulier.
La neuroéthique adopte donc une attitude modérée, une sorte d’ « équilibre correctif » (Room, 2013) entre un enthousiasme pour les travaux des neurosciences et une attitude pessimiste, qui pourrait amener à les rejeter. Cette attitude s’exprime également dans le choix des positions adoptées par ceux qui travaillent au sein de la neuroéthique. Par exemple, si le matérialisme naturaliste est communément accepté par les neuroéthiciens, au sens où le mental est nécessairement corrélé à du cérébral, ils n’admettent pas de stricte équivalence entre les deux et s’opposent donc en général à une approche radicalement réductionniste qui impliquerait une position métaphysique. Au contraire, ils adhèrent à une forme de réductionnisme modéré ou méthodologique, qui est nécessaire à toute entreprise scientifique, et qui, lui, peut être compatible avec une position émergentiste par exemple (Schaffner, in Neuroethics : mapping the field). Certains neuroéthiciens adhèrent ainsi à une théorie « incarnée » et « située » de l’esprit, selon laquelle il faut davantage prendre en compte le corps particulier des organismes et les environnements dans lesquels ils évoluent. C’est le cas par exemple de Walter Glannon qui revendique le titre explicitement antiréductionniste de son ouvrage, Brain, body and mind, en luttant non seulement contre une réduction de l’esprit au cerveau mais aussi contre une réduction métonymique du corps au cerveau. Cet antiréductionnisme est dû en partie à la remise en cause de ce que l’on peut appeler le dogme de l’irréversibilité cérébrale, qui a dominé les années 1990. La neuroéthique hérite en effet d’une approche moins rigide des neurosciences, grâce notamment à la mise en évidence de la plasticité cérébrale, propriété cruciale du système nerveux qui permet à ce dernier de s’adapter tout au long de la vie de l’individu grâce aux connexions entre les synapses qui se font et se défont au gré des expériences de l’individu. La neuroéthique pour Evers s’appuie sur la conception d’un cerveau comme « organe plastique, projectif et narratif, agissant consciemment et inconsciemment de manière autonome et résultant d’une symbiose socio-culturelle-biologique ». Le cerveau est donc loin d’être « une sorte d’automate rigide (Evers, 2009) déterminé par avance et la neuroéthique se retrouve de fait également solidaire d’un anti-déterminisme radical. De manière générale, et cela est vrai pour les neurosciences comme pour les sciences dans leur ensemble, nous avons, selon Éric Racine, tendance à avoir une conception erronée du déterminisme en science : nous comprenons le déterminisme au sens de Laplace, comme étant strictement causal, tout évènement étant la cause d’un autre selon un enchaînement remontant jusqu’à une cause première (Racine, 2005). Les sciences et a fortiori les neurosciences adoptent en réalité un déterminisme plus souple, d’autant plus que les systèmes biologiques et en particulier le système nerveux en vertu de sa plasticité, sont complexes, dynamiques et interactifs.
En définitive, la neuroéthique revendique une démarche modérée interdisciplinaire, ce qui lui permettrait de mettre à profit l’outil de la philosophie, à savoir l’analyse conceptuelle, dans d’autre champs afin, selon Vanessa Nurock, de « remettre en cause des oppositions binaires classiques » :
« La neuroéthique propose des éléments susceptibles d’enrichir la réflexion sur l’éthique en nous faisant remettre en jeu des catégories un peu trop aisées à opposer » (Nurock, 2014).
Certes, cet outil ne semble pas être un outil majeur utilisé par les neuroéthiciens actuels, mais nous pensons que cela peut servir de point de départ pour penser la pertinence et l’apport de l’intervention de la neuroéthique dans le champ de l’addiction, dont une des principales caractéristiques est d’être marquée par une opposition binaire entre des modèles moraux et des modèles médicaux.
Apports éventuels d’une neuroéthique de l’addiction
L’addiction, objet privilégié de la recherche en neurosciences, peut sans doute aujourd’hui bénéficier de l’approche modérée mais non sceptique de l’investigation neuroéthique. Si elle l’a d’abord été de manière secondaire, au gré de certains travaux plutôt généraux sur la neuroéthique (Farah, 2005 ; Levy, 2007), l’addiction s’est ensuite imposée comme un objet d’étude central pour de nombreux articles de neuroéthique (Hyman, 2007, 2011, 2013 ; Herdova, 2015), voire d’ouvrages à part entière (Carter & Hall, 2011 ; Illes, Hall & Carter, 2012). Ces réflexions ont donné lieu à la création d’une branche de la neuroéthique spécifiquement dédiée à l’addiction dont un des enjeux peut être défini comme suit :
« La neuroéthique de l’addiction consiste en une considération critique des avancées neuroscientifiques, afin d’empêcher une interprétation trop simpliste de ce qu’elles révèlent à propos de l’addiction » (Carter, 2013).
A titre d’exemple s’est établi en janvier 2009 le Oxford Centre for Neuroethics, dirigé par le professeur Julian Savulescu, centre qui fait partie de la faculté de philosophie d’Oxford et du Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics. Un des cinq domaines clés d’investigation de ce centre de recherche s’intitule « libre arbitre, responsabilité et addiction » et examine la remise en cause de la responsabilité – notamment criminelle – des addicts, remise en cause qui est fondée sur certains travaux neuroscientifiques qui tendent à mettre en avant le caractère compulsif de l’addiction. Les chercheurs de ce centre cherchent à répondre à des questions telles que : dans quelle mesure notre compréhension croissante des corrélats neuronaux de la prise de décision a-t-elle des implications pour la responsabilité morale ? Est-ce que les neurosciences nous donnent de bonnes raisons pour atténuer la responsabilité des personnes qui ont une capacité de contrôle de soi diminuée ? Comment cette atténuation affecte-t-elle la compréhension sociale de l’agentivité et de la responsabilité ? Comment le contrôle de soi pourrait-il être renforcé ?
On le voit avec ce type de questionnements actuellement pris en charge, il nous semble que la neuroéthique en premier lieu dans son aspect fondamental fournit un cadre adéquat pour repenser le lien délicat qui unit le phénomène addictif au débat philosophique sur le libre arbitre. L’addiction a en effet de tout temps été liée aux questions de liberté et de responsabilité ; très vite rattachée à une perte de contrôle, ce phénomène n’a cependant pas été affranchi de toute responsabilité, ne serait ce que parce que cette perte de contrôle était vue comme le résultat d’un choix libre et d’un comportement au moins initialement volontaire. Les premières conceptions médicales de l’addiction elles-mêmes ont éprouvé de la difficulté à s’affranchir des aspects moraux du phénomène. Benjamin Rush, par exemple, considéré comme le pionner de la conception de l’addiction-maladie associe cette idée à celles du vice et de la punition, conséquences des « abus de l’alcool » (1785).
À partir des années 1990, certaines conceptions neuroscientifiques de l’addiction cherchent à entériner une fois pour toute ce débat – l’addiction est-elle une maladie ou un choix libre ? – en montrant, grâce à des données neurobiologiques, qu’elle est « un désordre cérébral récidivant caractérisé par la recherche et la consommation compulsives de drogues » (Leshner, 1994). C’est la naissance de la conception de l’addiction comme maladie cérébrale, qui postule une négation totale de l’agentivité des addicts. La véritable innovation consiste à identifier la perte de contrôle, depuis longtemps envisagée par les conceptions médicales de l’addiction, sous la forme d’une force neurobiologique. Cependant, le sens sous-jacent à cette notion, dont le caractère flou n’a de cesse d’être souligné, semble rester métaphysique puisqu’il fait référence à des désirs irrésistibles face auxquels on ne peut rien. Or la question de savoir si des désirs peuvent avoir la force de nous ôter notre liberté est avant tout une question philosophique. Nous pensons que la mise à jour de cet aspect philosophique pourrait aider à repenser une notion de compulsion peut-être un peu moins rigide. C’est en tout cas la direction que semble prendre un article très récent d’une revue de neuroéthique qui s’attache à distinguer, parmi les désirs irrésistibles, ceux qui sont proximaux et ceux qui sont permanents. Pour l’auteur de cet article, les addicts auraient bien des « désirs irrésistibles proximaux » mais pas des « désirs irrésistibles permanents » (Herdova, 2015), c’est-à-dire qu’il y aurait des moments où les addicts ne sont pas pris du désir irrépressible mais qu’ils profitent de « moments de répits » pendant lesquels ils seraient sensibles au coût monétaires par exemple, pourraient demander de l’aide extérieure etc. On voit comment la méthode philosophique de l’analyse de concepts peut participer d’une analyse neuroéthique : ici c’est la notion de compulsion qui est repensée grâce à l’introduction de la référence à la temporalité. L’on pourrait objecter ici que nous n’avons pas besoin de la neuroéthique pour cela, et qu’une analyse philosophique classique est tout à fait suffisante. Mais nous ne cherchons pas à défendre la thèse selon laquelle la neuroéthique serait un champ de recherche totalement neuf et révolutionnaire ; au contraire, la neuroéthique par définition entrecoupe la philosophie, avec comme cible particulière les travaux neuroscientifiques. Reste à savoir si ce genre de reconceptualisation peut jouer un rôle heuristique pour de futures études en neurosciences.
En outre, évaluer ce que nous apprennent les neurosciences au sujet de l’addiction implique de se poser la question de savoir si l’étude de notre cerveau épuise la compréhension que nous avons de nous-même et de notre esprit. Carter et Hall soulignent ainsi que, tandis que la question fondamentale de la relation entre esprit et cerveau est encore très loin d’être résolue, certains adoptent une approche rigoureusement réductionniste et neuroessentialiste selon laquelle le cerveau est à la fois nécessaire et suffisant pour expliquer l’esprit et selon laquelle les maladies mentales peuvent être comprises comme le résultat de la perturbation de processus cérébraux. Les auteurs de Addiction Neuroethics expliquent ainsi que si cette approche est plausible dans le cas d’un lien direct entre changement comportemental et lésion cérébrale (par exemple ventromédiane), « cette relation n’est ni aussi claire ni aussi directe dans la plupart des désordres psychiatriques, tels que l’addiction » (2011). En outre, la neuroéthique de l’addiction s’oppose également à une forme d’internalisme selon lequel l’addiction serait seulement « neurologique et non liée à des facteurs externes » ce que proposait par exemple la définition de l’ASAM en 2010. Un article inaugural d’une grande revue de recherche sur l’addiction met ainsi en lien le fait que les hypothèses de la théorie psychologique actuelle sont rarement discutées avec les débats courants sur la nature de l’addiction et avance que si la nouvelle psychologie – c’est-à-dire les systèmes incarnés – est acceptée, alors l’ensemble du débat sur l’addiction devrait être différent :
« Finalement, la tentative pour voir l’addiction comme un « état cognitif interne » que l’on a ou non sera au mieux simpliste et au pire grossièrement trompeuse pour décrire l’addiction. A la place, l’addiction devrait être vue comme un processus fluide, incarné, dans lequel un organisme à la fois s’approche et s’éloigne de l’homéostasie » (Wallace, 2004).
Si la cognition doit effectivement être située, alors ce sont bien tous les aspects sociaux du comportement qui doivent être mieux intégrés encore aux théories neuroscientifiques de l’addiction. Ces aspects semblent pourtant être de plus en plus pris en charge par les travaux actuels en neurosciences. Un article récent explique par exemple pourquoi, en raison des connaissances limitées que nous fournissent les modèles animaux sur « le psycho-social et les facteurs cognitifs plus hauts impliqués dans l’initiation de la consommation de la substance et dans la progression du mésusage », les chercheurs essayent de construire des modèles qui intègrent des données sur la vie personnelle et l’environnement des usagers, leur personnalité ou encore les facteurs génétiques et cognitifs (Whelan & al., 2014). Mais ces aspects intégratifs des nouveaux modèles des neurosciences de l’addiction restent parfois relativement inaperçus et il semble exister un gouffre entre ce qui se passe dans les laboratoires de neurosciences et ce qui est véhiculé auprès du grand public. Ce serait donc une certaine interprétation par le grand public des résultats des neurosciences qui serait à l’origine d’une vision déterministe stricte des modèles neuroscientifiques de l’addiction. Au contraire, il semble que la recherche actuelle en neurosciences de l’addiction se tourne vers une intégration de plus en plus large des facteurs non-biologiques. À cet égard, il serait intéressant de pouvoir évaluer quel a été l’impact de la neuroéthique dans cette évolution.
Enfin, il nous semble que la recherche sur le caractère volontaire ou non des comportements addictifs pourrait bénéficier du renouvellement actuel du débat sur le libre arbitre. Les avancées neuroscientifiques, vers le milieu des années 1980, notamment avec les travaux de Benjamin Libet, ont conduit à un certain renouvellement, voire un durcissement des positions autour de la question du libre arbitre, entre ceux qui nient complètement son existence et entre ceux qui en font un principe certain. Le thème du libre arbitre est un thème majeur pour la neuroéthique fondamentale, qui s’attache à comprendre ce que les neurosciences peuvent (et doivent) vraiment nous dire au sujet du libre arbitre. Il nous semble que cette évaluation critique sous le giron de la neuroéthique a conduit à une reconfiguration du débat autour de la question du contrôle de soi. Même les philosophes défendant une position matérialiste éliminativiste, comme Patricia Churchland, semblent admettre la plausibilité d’une position compatibiliste du libre arbitre, à la condition de modifier radicalement les termes du débat. Pour Churchland, il faut remplacer la « métaphysique du libre arbitre par quelque chose comme une neurobiologie du contrôle de soi » (Churchland, 2006). Les travaux sur le contrôle de soi et sur l’inhibition de l’action se multiplient aujourd’hui et on peut en voir une influence directe sur les conceptions neuroscientifiques qui font de l’addiction le résultat d’un déséquilibre entre le système exécutif et le système impulsif (Noël & Bechara, 2006). De tels travaux mettent en évidence la façon dont le contrôle de soi peut être altéré mais non nié et peut-être même retrouvé, ce qui va de pair avec l’idée selon laquelle le contrôle de soi comporterait des degrés. On est donc loin de l’opposition traditionnelle entre liberté et déterminisme au sein de laquelle on a eu tendance à vouloir penser les addictions. Ces travaux s’insèrent bel et bien dans une perspective neuroéthique qui cherche à dépasser les oppositions binaires pour progresser sur la question de la nature d’un phénomène. Mais en réfutant une conception entièrement réductionniste et déterministe des addictions, réfutation qui est adoptée par de plus en plus de travaux actuels en neurosciences, ne court-on pas le risque, en redonnant un peu de liberté aux addicts, de leur redonner une pleine et entière responsabilité et du même coup la stigmatisation sociale qui l’accompagne ?
Cette nouvelle question relève plutôt du champ des « implications éthiques des neurosciences » qui appartient au versant appliqué de la neuroéthique de l’addiction, niveau auquel se posent des questions sur la compréhension des addictions, sur la façon de les soigner ou encore sur la façon dont on doit faire de la recherche sur l’addiction. Dans le cas de l’addiction, la question de la réaction de la société et du grand public est une question majeure. Face à la stigmatisation des addicts, les conceptions de l’addiction comme maladie cérébrale des années 1990 mettent en évidence le fait qu’il y a un « gouffre dans les implications entre la conception de la ‘personne mauvaise’ et celle du ‘patient souffrant d’une maladie chronique’ » (Leshner, 1994) et qu’il faut y remédier parce que la stigmatisation aggrave la situation des personnes addictées. Il s’agit de « met(tre) l’accent sur la nature déterministe et physiologique de ces comportements et ainsi, rédui(re) le stigmate social » (Farah, 2005). On pourrait craindre qu’une remise en cause, dans le cadre de la neuroéthique, des conceptions déterministes et réductionnistes de l’addiction, aille dans le sens inverse de l’effort de déstigmatisation. Or l’analyse neuroéthique montre premièrement que ce but n’a pas été atteint par les conceptions de l’addiction (et d’autres troubles psychiatriques) comme troubles du cerveau car cela conduit à essentialiser une différence de cerveau, à produire une coupure entre les cerveaux et entre les comportements dits ‘normaux’ et ceux dits ‘pathologiques’, coupure qui ne gomme pas les réactions de peur et la connotation de risque associées aux personnes souffrant d’un trouble psychiatrique chronique. En outre, la conception déterministe de l’addiction a un impact sur la façon dont les addicts peuvent envisager la possibilités d’une guérison. De nombreuses études montrent qu’ils sont plus pessimistes (Pescosolido & al., 2010), ce qui se comprend aisément puisque les conceptions neuroscientifiques qui nient toute agentivité auraient tendance à instaurer une forme de fatalisme qui conduirait les addicts à se considérer « addict un jour, addict toujours », sans leur donner la force de changement possible. La conviction que l’on est un agent, doté d’une capacité de prise de décision et de contrôle de soi (même diminué), est essentielle pour amorcer la possibilité d’un changement et la demande d’une aide extérieure. Enfin, Carter et Hall soulignent que ce modèle peut aussi miner le soutien à des politiques sociales qui ont pour but de réduire la souffrance liée à la drogue. En se concentrant sur l’addiction comme une maladie du cerveau et en ne prenant pas en compte la nature dimensionnelle de la consommation de drogue et de la dépendance, nous pouvons négliger les effets préjudiciables de la drogue qui peuvent arriver en l’absence d’addiction. Il convient d’être attentifs aux discours portant sur l’addiction-maladie qui considèrent que cette dernière n’est un risque que pour une minorité de personnes. Cela pourrait laisser croire aux buveurs non-vulnérables que l’on peut consommer et abuser de l’alcool sans conséquence, ou aux joueurs de casinos que l’on peut continuer à jouer sans craindre de tomber dans l’addiction.
Enfin, la neuroéthique peut aussi jouer un rôle dans le traitement de l’addiction. Une question majeure de « l’éthique en pratique » dans le cadre des neurosciences consiste ainsi dans la reprise de la question classique du consentement du patient. Il s’agit d’un principe traditionnel de bioéthique concernant la relation du chercheur au volontaire ou du médecin au patient. Pour toute recherche ou pour toute intervention clinique, le consentement de la personne doit être libre, c’est-à-dire dégagé de toute pression quelle qu’elle soit, et éclairé, c’est-à-dire effectué en toute connaissance de cause des conséquences ou des effets de l’étude ou de l’intervention clinique. Cette question peut être abordée selon différents angles à propos de l’addiction. Tout d’abord, elle peut être posée de manière générale, concernant toutes les formes de traitement : c’est la question que posent Carter et Hall de savoir si les addicts ne sont pas « le plus souvent sous une forme de contrainte externe pour entrer en traitement, contrainte qui serait due aux membres de la famille, aux employeurs ou au tribunal » (Carter & Hall, 2011). Surtout, cette question se pose de manière encore plus aiguë concernant l’émergence de nouvelles formes d’interventions, liées aux progrès des neurosciences, à savoir des interventions directes sur le cerveau, ce que l’on appelle la « stimulation cérébrale » c’est-à-dire l’implantation d’électrodes délivrant un faible courant électrique ciblant certaines structures cérébrales. Si la stimulation cérébrale était surtout utilisée au départ pour soigner des troubles neurologiques comme celui de Parkinson, son utilisation dans des troubles psychiatriques, dont la réduction à des troubles neurologiques fait encore pleinement débat, pose d’autres problèmes. Cela présuppose d’abord que l’addiction serait bel et bien fondamentalement une maladie du cerveau c’est-à-dire un trouble neurologique au même titre que l’est la maladie de Parkinson, prérequis pour qu’une intervention neurochirurgicale puisse guérir entièrement de l’addiction (une approche moins rigide de la clinique propose cependant une complémentarité entre ce type d’intervention et des thérapies plus classiques). Cela pose ensuite la question de savoir quelles structures il faut viser dans le cas de l’addiction où plusieurs mécanismes cérébraux sont en jeu. Enfin, cela pose le problème de savoir quelle est la validité d’un consentement éclairé donné par un patient dont le trouble concerne justement sa capacité de prise de décision. C’est notamment une des questions qui est prise en charge par un très récent article publié par des chercheurs du Oxford Centre for Neuroethics, intitulé « l’éthique de la stimulation cérébrale dans le cas de l’anorexie nerveuse ». Dans cet article, la question est ainsi posée de savoir si le consentement obtenu dans le cadre d’une stimulation cérébrale est valide. En d’autres termes, un patient souffrant d’anorexie nerveuse serait-il à même de refuser une telle intervention ? De manière générale, quelle serait la validité d’un consentement donné par une personne dont les capacités cognitives sont précisément celles qui sont détruites ou diminuées par le trouble en question ? Nous voyons bien ici comment la neuroéthique et sa branche centrée spécifiquement sur l’addiction rejoignent des questions d’éthique médicale traditionnelles, comme celle, fondamentale, de savoir si les cliniciens peuvent soigner les patients malgré eux et parfois faire preuve de paternalisme en matière de guérison et ce, contre l’autonomie des patients.
Conclusion
Les neurosciences ont bien évolué depuis leur essor fulgurant des années 1990 : elles s’appuient désormais sur des postulats moins rigides du fonctionnement du système nerveux, notamment grâce à la mise en évidence de la plasticité cérébrale. La neuroéthique semble au moins accompagner cette évolution, et offrir un nouveau cadre théorique et de recherche pour les travaux actuels en neurosciences et la compréhension des implications qui en découle, auprès du grand public et de la société. Comme tout objet d’étude neuroscientifique, l’addiction se prête bien à l’examen neuroéthique, parce qu’il permet d’évaluer les données issues des études de neuroimagerie ou de questionner de manière éthique ces études ou encore les traitements possibles qui pourraient émerger grâce aux travaux des neurosciences. Il s’agit là d’un apport important pour penser les addictions, mais qui n’a cependant rien de spécifique par rapport à d’autres objets d’études. Mais parce que l’addiction a cette particularité de se présenter à l’intersection des problématiques de la maladie et de la liberté, nous pensons qu’un champ théorique comme la neuroéthique peut surtout nous aider à articuler ces différentes dimensions qui font de l’addiction « une maladie pas comme les autres », une articulation qui peut avoir tendance à faire défaut dans certaines conceptions de l’addiction, subordonnées parfois à une finalité – sociale ou clinique – qui exige de trancher.
Bibliographie
Baertschi, Bernard. La neuroéthique : ce que les neurosciences font à nos conceptions morales. Paris: La découverte, 2009.
Carter, Adrian, and Wayne Hall. Addiction Neuroethics: The Promises and Perils of Neuroscience Research on Addiction. 1 edition. New York: Cambridge University Press, 2011.
Churchland, Patricia. “The Big Questions: Do We Have Free Will?” New Scientist, 2006.
Evers, Kathinka. Neuroéthique : Quand la matière s’éveille. Paris: Editions Odile Jacob, 2009.
Farah, Martha J. Neuroethics: An Introduction with Readings. 1 edition. Cambridge, Mass: The MIT Press, 2010.
———. “Neuroethics: The Practical and the Philosophical.” Trends in Cognitive Sciences 9, no. 1 (2005): 34–40.
Glannon, Walter. Brain, Body, and Mind: Neuroethics with a Human Face. 1 edition. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2011.
Herdova, Marcela. “Simply Irresistible: Addiction, Responsibility, and Irresistible Desire.” Journal of Cognition and Neuroethics 3, no. 1 (2015): 195–216.
Hyman, Steven E. “Addiction and Responsibility.” In Neuroethics in Practice, edited by Anjan Chatterjee and Martha J. Farah, 96–102. Oxford University Press, 2013.
———. “The Neurobiology of Addiction: Implications for Voluntary Control of Behavior.” American Journal of Bioethics 7, no. 1 (2007): 8–11.
Illes, Judy, and Stephanie J. Bird. “Neuroethics: A Modern Context for Ethics in Neuroscience.” Trends in Neurosciences 29, no. 9 (2006): 511–17.
Illes, Judy, Wayne Hall, and Adrian Carter. Addiction Neuroethics: The Ethics of Addiction Neuroscience Research and Treatment. London, Waltham, San diego: Academic Press, 2012.
Leshner, A. I. “Addiction Is a Brain Disease, and It Matters.” Science (New York, N.Y.) 278, no. 5335 (1997): 45–47.
Levy, Neil. “Neuroethics: A New Way of Doing Ethics.” Ajob Neuroscience 2, no. 2 (2011): 3–9.
———. Neuroethics: Challenges for the 21st Century. 1 edition. Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 2007.
Marcus, Steven J. (éd.). Neuroethics: Mapping the Field : Conference Proceedings, May 13-14, 2002, San Francisco, California. Dana Press, 2002.
Maslen, Hannah, Jonathan Pugh, and Julian Savulescu. “The Ethics of Deep Brain Stimulation for the Treatment of Anorexia Nervosa.” Neuroethics 8, no. 3 (2015): 215–30.
Noël, X., & Bechara A. “The Neurocognitive Mechanisms of Decision-Making, Impulse Control, and Loss of Willpower to Resist Drugs.” Psychiatry (Edgmont) 3, no. 5 (2006): 30–41.
Nurock, Vanessa. “Faut-il décerveler la morale ? Un examen philosophique de la neuroéthique.” Cités 4, no. 60 (2014): 43–52.
Pescosolido, Bernice A., Jack K. Martin, J. Scott Long, Tait R. Medina, Jo C. Phelan, and Bruce G. Link. “‘A Disease like Any Other’? ” The American Journal of Psychiatry 167, no. 11 (2010): 1321–30.
Racine, Éric. “Pourquoi et comment doit-on tenir compte des neurosciences en éthique ? Esquisse d’une approche neurophilosophique émergentiste et interdisciplinaire.” Laval théologique et philosophique 61, no. 1 (2005).
Racine, Eric. Pragmatic Neuroethics: Improving Treatment and Understanding of the Mind-Brain. Cambridge, Mass: The MIT Press, 2010.
Room, Robin, “Neuroethics, psychoactivity and addiction” (conference), University of Queensland Centre for Clinical Research, Neuroethics Down-under, Brisbane, 2013.
Roskies, Adina L. “Neuroethics for the New Millennium.” Neuron 35, no. 1 (2002): 21–23.
Wallace, Brendan. “Editorial Addiction.” Addiction Research and Theory 12, no. 3 (2004): 195–99.