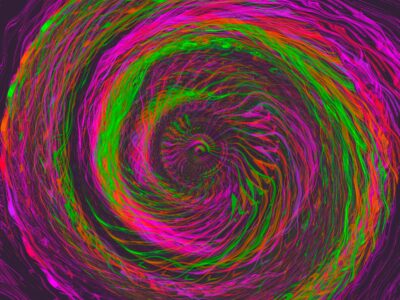Quelle place pour le langage dans le « nouveau réalisme » ?
Biographie : Agrégée de philosophie et ancienne élève de l’ENS, Iris Brouillaud est doctorante à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et ATER à l’Université de Tours. Sa thèse porte sur la notion de relativisme dans la philosophie contemporaine, plus précisément sur l’influence de la philosophie du langage dans la reconfiguration des débats autour de cette notion.
Résumé
Dans Emergence comme dans le Manifeste du Nouveau Réalisme, Maurizio Ferraris défend la nécessité de ne pas accorder une importance philosophique de premier plan au langage : cela risquerait, selon lui, de reconduire l’idéalisme ou le constructivisme qu’il s’efforce de critiquer. Reconsidérer le langage à partir du concept d’émergence est présenté comme une approche plus réaliste, dont l’article tâche d’évaluer les mérites et les limites.
Mots-clés : nouveau réalisme ; tournant linguistique ; schème conceptuel ; signification ; épistémologie ; ontologie
Summary
In Emergence as well as in the Manifesto of New Realism, Maurizio Ferraris argues that language does not deserve any special philosophical importance, otherwise one runs the risk of promoting idealism and constructivism – two things that “new realism” should absolutely avoid. Applying the concept of emergence to language aims at providing a realist approach of it, whose merits and limits are examined in the article.
Keywords : new realism; linguistic turn; conceptual scheme; meaning; epistemology; ontology
Même si Emergence n’a pas pour objectif premier de traiter de la place du langage dans le « nouveau réalisme » (Ferraris, 2014, p. 4-5), la nécessité de remettre le langage à sa place, à savoir de le considérer comme un « morceau de réalité » sans prééminence ontologique ni épistémologique, revient comme un leitmotiv dans les trois parties de l’ouvrage (Ontologie, Epistémologie, Politique). Il s’agit de prendre le contrepied des excès d’un certain constructivisme linguistique propre à la postmodernité (Hassan, 1971 ; Ferraris, 2014) : « dans le postmodernisme, on a vu se créer un idéalisme par default selon lequel être philosophe, c’est soutenir que les choses dépendent des mots » (Ferraris, 2018, p. 129).
Dans Emergence comme dans le Manifeste du Nouveau Réalisme, Maurizio Ferraris vitupère ainsi contre le « tournant linguistique » qui a marqué le paysage philosophique du siècle dernier (Ferraris, 2014, p. 5), déclarant que la « fin du tournant linguistique » est un trait marquant de la nouvelle ère réaliste qui s’ouvre (Ferraris, 2014, p. 32). L’expression « tournant linguistique », rendue célèbre par le titre de l’anthologie The linguistic turn : recent essays in philosophical method éditée par Richard Rorty en 1967, renvoie historiquement et en premier lieu à un virage méthodologique propre à la philosophie analytique, consistant à traiter, ou dissoudre, les problèmes philosophiques à partir d’une « réforme » ou d’une « meilleure compréhension du langage » (Rorty, 1967, p. 3). Un « premier tournant » (Ambroise et Laugier, 2009), préparé par les travaux de Frege et Russell, et acté avec le Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein publié en 1921, a pour but de clarifier grâce au formalisme logique un certain nombre d’ambiguïtés de la langue naturelle, sources de confusion philosophiques. Un « second tournant », dont Wittgenstein et J.L. Austin sont les inspirateurs centraux, préconise au contraire l’attention au langage ordinaire, aux usages et normes propres de la pluralité des « jeux de langage » (Wittgenstein, 2004) et à « ce que nous dirions quand » (Austin, 1994, p. 144). Parallèlement à ces développements de la « philosophie analytique », ladite « philosophie continentale » (Hacker, 2013, p. 926-947) de la seconde moitié du XXème siècle a également été caractérisée par un intérêt multiforme pour le langage et l’expression « tournant linguistique » a parfois été reprise pour caractériser ces développements. Maurizio Ferraris se récrie ainsi contre la « complicité » qui existe selon lui entre idéalisme et « tournant linguistique » continental[1], dont la déclaration heideggérienne « le langage est la maison de l’être » (Heidegger, 1970, p. 85) lui semble une incarnation particulièrement manifeste. Une telle complicité se serait également manifestée du côté analytique, le Tractatus de Wittgenstein renouvelant par exemple à ses yeux l’a priori kantien. Pour Ferraris, le « tournant linguistique » a ainsi constitué un moment de « grande alliance » entre philosophie analytique et continentale : les deux traditions ont donné une « importance excessive au langage » (Ferraris, 2018b) au point de résorber l’ontologie dans la philosophie du langage.
Nous nous intéresserons dans cet article à la manière dont Emergence participe de la volonté de rompre avec le tournant linguistique et manifeste l’ambition de traiter du langage d’un point de vue réaliste. Il s’agira d’abord de préciser pourquoi la mise au premier plan du langage peut être suspectée de conduire inévitablement à l’idéalisme ou au constructivisme. Nous verrons ensuite comment Emergence cherche à réintégrer le langage au sein d’une ontologie réaliste, en faisant du langage un « morceau de réalité » et en proposant une genèse de la signification à partir du « sens » compris comme « direction ». Nous nous demanderons enfin à quel point cette approche « émergentiste » du langage est satisfaisante et s’il est vraiment « réaliste » (Ambroise et Laugier, 2009, p. 24) de balayer les apports du tournant linguistique.
I. Le langage, un allié potentiel du constructivisme et de l’idéalisme
Mettre au premier plan le rôle de médiation du langage dans notre rapport au réel semble promouvoir l’idéalisme ou le constructivisme. Maurizio Ferraris déclare ainsi que l’idée d’une « prédominance des schémas conceptuels sur le monde externe » est au cœur d’un « tournant culturel qui coïncide en bonne partie avec la modernité » (Ferraris, 2014, p. 16) et qui conduit ultimement aux excès de la postmodernité où la « médiation opérée par des schémas conceptuels et représentations (…) s’est durcie pour devenir une construction » (Ferraris, 2014, p. 25). La notion de « schéma conceptuel » ou « schème conceptuel » telle que la convoque Maurizio Ferraris a pour source, dans l’esprit sinon dans la lettre, la Critique de la Raison Pure de Kant, puisqu’elle renvoie au système de concepts qui nous permet de mettre en forme notre expérience. De là provient l’idée que la réalité serait construite, en tant que sa définition et son appréhension dépendraient de la conceptualisation qui en est faite. Si Kant ne mettait pas le langage au premier plan de sa réflexion dans la Critique de la Raison Pure[2], l’idée de « schème conceptuel » a été reformulée en termes linguistiques dans le cadre du « tournant linguistique ». Ce que nous appelons « concept » n’est ainsi, selon le second Wittgenstein, que l’ensemble des usages d’un certain mot. Quine déclare quant à lui qu’en parlant de « schème conceptuel », il aurait tout aussi bien « pu parler de langage ». Kuhn compare les théories scientifiques de paradigmes concurrents, dont les concepts n’ont pas la même signification, à des langues différentes, en renvoyant à Quine, aux travaux de l’ethnologue Nida et à ceux de B.L.Whorf. Dès lors qu’une pluralité de schèmes conceptuels est possible, la question de leur incommensurabilité ou intraduisibilité se soulève et le problème du relativisme conceptuel se pose. Dans son article Sur l’idée même de schème conceptuel, Davidson soutient à la fois que la seule manière de rendre intelligible la notion de « schème conceptuel » est de l’assimiler à un « langage » donné et que l’existence de « schèmes conceptuels » incommensurables signifierait que certains langages sont radicalement intraduisibles (Davidson, 1993, p. 267-289), Rorty pourrait quant à lui être considéré, à première vue du moins, comme le parangon d’un constructivisme issu d’une radicalisation et d’une linguicisation de l’idée même de « schème conceptuel ». Il défend en effet la contingence et le rôle constitutif de ce qu’il appelle « vocabulaires » sur ce que nous sommes, déclarant que « les êtres humains ne sont jamais que des vocabulaires incarnés » (Rorty, 1997 p. 53) : nous sommes incapable de saisir la réalité « sans qu’elle soit médiatisée par une description linguistique » en tant qu’« il n’y a pas de façon dont est le monde qui soit indépendante d’une description, pas de façon dont il est hors de toute description. » (Rorty, 1998, p. 90).
Contre l’idée que la réalité serait construite par les schèmes conceptuels dont dépendrait notre expérience, Maurizio Ferraris introduit au début de la première partie d’Emergence une « distinction essentielle » entre les « individus » que sont les existants (sur le plan de l’ontologie) et les « objets » que sont ces existants connus par nous (sur le plan de l’épistémologie). Après avoir indiqué que « la première caractéristique des individus est d’être extérieurs à l’égard des autres individus », Maurizio Ferraris ajoute : « par « extérieur » je veux dire extérieur à l’égard de nos schèmes conceptuels » [3] (Ferraris, 2018, p 49) ; les objets, quant à eux, supposent les schèmes conceptuels. S’il est indéniable que nous utilisons des ensembles de concepts pour décrire des états de choses – « la phrase ‘Turin se trouve à 140 kilomètres de Milan’ requiert plus d’un schème conceptuel, en particulier la mesure kilométrique des distances » (Ferraris, 2018, p. 101)– , l’important est de rappeler que « le schème conceptuel ne détermine pas l’état de choses » (ainsi, si je dis, en adoptant un autre système de mesure des distances: « « Turin se trouve à 86, 991966913226 miles de Milan », je prononcerais une phrase vraie, bien que prolixe, qui se réfère au même état de choses. »). Maurizio Ferraris ne récuse donc pas l’idée même de schème conceptuel mais veut plutôt réguler son usage, la remettre à sa juste place. N’est-ce pas ce que Kant lui-même préconisait déjà lorsqu’il insistait sur l’écart entre la « chose en soi » et ce que nous en connaissons ? Bien qu’auteur d’un ouvrage intitulé Good bye, Kant ! (2009), Maurizio Ferraris reconnaît que « Kant était un géant » mais déplore le fait qu’il « a ouvert la voie à une foule de nains. » (2018, p. 129). Dans Emergence, Kant est ainsi innocenté de l’idéalisme transcendantal décrit comme « l’idéalisme né – contre son gré – de l’héritage de Kant » qui consiste à soutenir que « le monde est le fruit de la construction d’un Je pense omniprésent et, au moins sur le papier, omnipotent. » (p. 126-127) Selon Ferraris, Kant se serait tout de même dangereusement approché d’un tel constructivisme comme en témoignent les notes de l’Opus postumum où le « Je » est déclaré « propriétaire de l’Univers » (p. 128). Tout tient à la manière dont on interprète la fameuse déclaration selon laquelle « l’intuition sans concept est aveugle » : si Kant maintient que le concept a un rôle constitutif dans toute expérience (et pas seulement dans cette activité linguistique qu’est la science), « se déclenche alors un processus qui conduit à un constructionnisme absolu. Dès que nous assumons que les schémas conceptuels ont une valeur constitutive par rapport à tout genre d’expérience, nous pouvons affirmer qu’ils ont une valeur constitutive par rapport à la réalité (au moins si nous assumons, comme Kant, qu’il y a une réalité phénoménale du monde qui coïncide avec l’expérience que nous en avons.) A ce point-là, ce qu’il y a résulte déterminé par ce que nous en savons dans une pleine réalisation de la falsification de l’être-savoir. » (2014, p. 63)
Il s’agit alors de ne pas tomber dans le piège de ce que Maurizio Ferraris appelle « default-idéalisme » ou « idéalisme par default », cet idéalisme un peu trop facile et trop vague dans lequel s’est complu le postmodernisme en faisant du langage son meilleur allié puisqu’il consiste à « soutenir que les choses dépendent des mots » (2018, p. 129). Trois formulations possibles de  la teneur de ce default-idéalisme, dont un des problèmes tient précisément à la « difficulté de clarifier ce en quoi il consiste » sont examinées. La « dépendance causale » brute est vite écartée : elle consiste à affirmer que « la condition suffisante de l’existence de X est sa causation par un sujet » (p. 130). Aucun post-moderne ne se permettrait cette formulation trop forte. La « dépendance conceptuelle » est une formulation d’inspiration kantienne, en apparence plus prudente : « la condition nécessaire (non suffisante) de l’existence de X est sa conceptualisation par un sujet » (p. 131). Cette dépendance se prête à deux interprétations : soit le concept est reconstructif par rapport à l’expérience (« sans le concept de ‘dinosaure’, nous ne reconnaîtrions pas un dinosaure si nous en voyions un »), soit le concept est constitutifpar rapport à l’expérience. Si le concept est constitutif, la dépendance conceptuelle « peut être reconduite à la dépendance causale, et elle encourt les mêmes critiques » (p. 132) car elle tend à affirmer que le concept crée, au sens le plus littéral du terme, la chose[4]. Si le concept est seulement reconstructif, il n’est finalement pas question de dépendance ontologique : c’est tout au plus « le mot Tyrannosaurus rex » qui « dépend de nos schèmes conceptuels » (p. 132). Une troisième formulation possible du default-idealisme serait la « dépendance représentationnelle » c’est-à-dire une « dépendance conceptuelle faible selon laquelle la condition nécessaire (mais non suffisante) de l’existence de X est sa représentation par un sujet. » (p. 132-133). La dépendance représentationnelle a pour caractéristique d’être « programmatiquement vague » en suggérant que « nos vocabulaires exercent une certaine influence sur le monde extérieur » (p. 132) mais elle n’échappe pas aux critiques déjà adressées à la « dépendance conceptuelle » : « ou bien « dépendance représentationnelle » signifie que le nom « dinosaure » dépend de nous et dans ce cas il ne s’agit pas d’une dépendance en un sens sérieux du terme. Ou bien elle signifie que l’être des dinosaures dépend de nous. » (p. 132). Le default-idéalisme exploiterait une « dépendance de pure nomenclature, qui consiste à affirmer que les noms des objets connus dépendent des sujets connaissants » (p. 140). A rebours de la toute-puissance constructive que la postmodernité a complaisamment attribuée au langage, le nouveau réalisme réaffirme au contraire la leçon du Cratyle de Platon : il importe de ne pas confondre le mot et la chose en 440c-d.
la teneur de ce default-idéalisme, dont un des problèmes tient précisément à la « difficulté de clarifier ce en quoi il consiste » sont examinées. La « dépendance causale » brute est vite écartée : elle consiste à affirmer que « la condition suffisante de l’existence de X est sa causation par un sujet » (p. 130). Aucun post-moderne ne se permettrait cette formulation trop forte. La « dépendance conceptuelle » est une formulation d’inspiration kantienne, en apparence plus prudente : « la condition nécessaire (non suffisante) de l’existence de X est sa conceptualisation par un sujet » (p. 131). Cette dépendance se prête à deux interprétations : soit le concept est reconstructif par rapport à l’expérience (« sans le concept de ‘dinosaure’, nous ne reconnaîtrions pas un dinosaure si nous en voyions un »), soit le concept est constitutifpar rapport à l’expérience. Si le concept est constitutif, la dépendance conceptuelle « peut être reconduite à la dépendance causale, et elle encourt les mêmes critiques » (p. 132) car elle tend à affirmer que le concept crée, au sens le plus littéral du terme, la chose[4]. Si le concept est seulement reconstructif, il n’est finalement pas question de dépendance ontologique : c’est tout au plus « le mot Tyrannosaurus rex » qui « dépend de nos schèmes conceptuels » (p. 132). Une troisième formulation possible du default-idealisme serait la « dépendance représentationnelle » c’est-à-dire une « dépendance conceptuelle faible selon laquelle la condition nécessaire (mais non suffisante) de l’existence de X est sa représentation par un sujet. » (p. 132-133). La dépendance représentationnelle a pour caractéristique d’être « programmatiquement vague » en suggérant que « nos vocabulaires exercent une certaine influence sur le monde extérieur » (p. 132) mais elle n’échappe pas aux critiques déjà adressées à la « dépendance conceptuelle » : « ou bien « dépendance représentationnelle » signifie que le nom « dinosaure » dépend de nous et dans ce cas il ne s’agit pas d’une dépendance en un sens sérieux du terme. Ou bien elle signifie que l’être des dinosaures dépend de nous. » (p. 132). Le default-idéalisme exploiterait une « dépendance de pure nomenclature, qui consiste à affirmer que les noms des objets connus dépendent des sujets connaissants » (p. 140). A rebours de la toute-puissance constructive que la postmodernité a complaisamment attribuée au langage, le nouveau réalisme réaffirme au contraire la leçon du Cratyle de Platon : il importe de ne pas confondre le mot et la chose en 440c-d.
Le default-idéalisme repose sur ce que Ferraris nomme le « sophisme transcendantal », qui consiste en « l’identification entre ontologie et épistémologie » et débouche sur l’affirmation d’une « dépendance de l’être à l’égard de la pensée. » (2018, p. 24). Or la distinction entre ontologie et épistémologie est la première « distinction essentielle » rappelée au début d’Emergence: « L’ontologie, ce qui existe, diffère de l’épistémologie, ce que nous savons ou croyons savoir ; cette différence est en même temps une dépendance du connaître à l’égard de l’être : il faut que quelque chose existe pour que quelque chose soit connu. » (p. 19) Cette distinction est également explicitée à l’aide du concept d’inamendabilité : « contrairement à l’épistémologie, qui est en permanence disponible aux corrections, l’ontologie est inamendable. » (p. 53) Dans le Manifeste du Nouveau Réalisme, un tableau synthétise un certain nombre de différences et oppositions entre épistémologie et ontologie (2014, p. 51) : on y voit notamment que l’épistémologie étudie un « monde interne aux schémas conceptuels » et que la science est « linguistique », tandis que l’ontologie étudie un « monde externe au schémas conceptuels » et l’expérience n’est « pas nécessairement linguistique. » Cela témoigne du fait que le langage a une importance épistémologique mais non ontologique : si le langage est indispensable à la connaissance et donc à l’épistémologie, en est une condition de possibilité, il n’en va pas de même pour l’ontologie. Ainsi une philosophie qui accorde une grande importance au langage peut immédiatement être suspectée de faire la part trop belle à l’épistémologie et de contrevenir à ce qui est le principe même de tout réalisme selon Maurizio Ferraris.
Il conviendrait dès lors d’accuser d’antiréalisme toutes les philosophies qui, du côté analytique comme du côté continental, auraient perpétué sous le couvert d’une réflexion novatrice sur le langage les séductions de l’idéalisme et en auraient même accentué la pente constructiviste. Maurizio Ferraris déclare ainsi que l’« idéalisme transcendantal » qu’il critique « a poursuivi son cours » dans « l’herméneutique » et la « philosophie analytique » alors même que cette dernière est née en « opposition ouverte à l’idéalisme » (2018, p. 135-136). Le « tournant linguistique » est décrit comme ayant eu lieu « dans le cadre » d’un « idéalisme représentationnel » selon lequel « les représentations ne sont peut-être pas la seule chose qui existe » mais « sont la seule chose qui compte, ne serait-ce que parce qu’elles sont la seule chose à laquelle nous avons accès. » (p. 137) Ce raisonnement a la fâcheuse conséquence de dissoudre toute possibilité de débat sur le réalisme puisqu’il conduit à « affirmer que le problème du réalisme ou de l’antiréalisme est dépassé, ou que l’on cherche une troisième position par-delà le réalisme et l’antiréalisme », qui prend souvent la forme d’une absolutisation de la « corrélation » ou la « relation ». Le « tournant linguistique » s’inscrirait dans cette dynamique puisqu’il aurait promu l’idée qu’il n’y a rien à chercher hors du langage ou « hors du texte » pour reprendre la célèbre formule de Derrida (Derrida, 1967, p. 232) citée par Ferraris. Le tournant linguistique n’aurait pas seulement succombé à la tentation du « sophisme transcendantal » mais aussi à celle du « sophisme herméneutique » que Ferraris définit comme « la confusion entre l’importance axiologique de quelque chose (le langage est important, l’histoire et le sujet sont importants, et plus important encore est d’avoir un toit au-dessus de la tête et de pouvoir se préparer à déjeuner et à dîner) et l’importance ontologique. » (2014, p. 137)
II. Le langage comme « morceau de réalité » soumis à l’émergence
La nécessité de ne pas accorder une place d’honneur au langage au sein du nouveau réalisme apparaît comme une conséquence directe de la primauté de l’ontologie sur l’épistémologie, martelée par le Manifeste du Nouveau Réalisme et rappelée au début d’Emergence. Du point de vue ontologique, le langage n’est et ne doit être considéré que comme un élément du réel parmi d’autres : le langage n’est qu’un « morceau de réalité » pour reprendre une expression utilisée dans l’introduction d’Emergence (p. 10), il n’est pas en décalage par rapport à elle ou d’une nature différente.
La première partie d’Emergence, intitulée « Ontologie », renvoie ainsi le langage parmi les vagues de l’émergence, sans lui réserver de place particulière. Ainsi, ce n’est que la « pénurie de temps » – le fait de se représenter par exemple un monde qui n’aurait pas plus de 6000 ans, comme le laisse imaginer la Bible – qui nous pousse à considérer « l’existence de structures complexes -qu’il s’agisse du monde, de l’esprit, du langage ou de la société » comme si extraordinaires qu’elles ne pourraient que procéder d’un « grand artisan », d’une « création surnaturelle », d’une « construction conceptuelle » (p. 28). C’est parce que l’on néglige la « sublime surabondance de temps et d’espace » dont la science contemporaine nous a aidés à prendre conscience que l’on est obligé de « postuler l’intervention d’un logos » (p. 29). Au contraire, en donnant « du temps au temps, et de l’espace à l’espace », il est possible de rendre compte de tout ce qui est par le moyen d’une « émergence extrêmement contingente » qui procède d’un « patrimoine incalculable de temps, de matière et d’énergie » (p. 29). Ainsi, le langage ne doit être considéré ni comme une émanation d’un logos originaire ni comme une structure si extraordinaire qu’on ne pourrait l’expliquer que par une intervention surnaturelle.
Le principe de l’émergence est décrit selon une dialectique en trois temps : inscription / itération / altération. L’inscription est caractérisée par « la permanence : quelque chose existe et résiste » (p. 37) : les inscriptions sont des « traces » laissées sur différents supports (la matière, l’ADN, la mémoire, les documents écrits…). L’itération est la reconduction active de ce qui est présent de manière passive dans l’inscription : « ce qui est passif et inerte persiste cependant, et s’itère » (p. 38), par exemple l’ADN se réplique. L’itération ouvre ainsi la voie à « l’altération » : quelque chose de nouveau surgit à partir de ce qui précédait – de même qu’une mutation génétique donne naissance à une nouvelle espèce (p. 28). La dialectique inscription/itération/altération constitue la clé de voûte de ce que Maurizio Ferraris décrit comme « l’empirisme transcendantal qui est à la base de cet ouvrage » (p. 39)[5] et du « réalisme transcendantal » dont « le problème n’est pas d’expliquer comment l’esprit se réfère au monde mais plutôt comment l’esprit émerge du monde. » (p. 41). Le sens du « transcendantal » s’en trouve modifié : il renvoie désormais à l’« enregistrement », défini comme la propriété ontologique de « garder trace » de tout ce qui est, de tout ce qui a eu lieu, et non pas aux structures a priori du sujet connaissant. Replacer le langage dans la dynamique ontologique de l’émergence plutôt que d’en faire le principe de la construction du monde ou de l’expérience d’un sujet connaissant joue un rôle important dans le basculement de l’idéalisme transcendantal vers le réalisme transcendantal.
La deuxième partie d’Emergence, intitulée « Epistémologie », fournit des éléments plus détaillés sur l’émergence du langage puisqu’elle propose une genèse de la « signification ». Les significations linguistiques ne sont cependant pas l’objet d’une attention particulière : l’un des enjeux est de les réinscrire au sein d’un processus plus global de « sens »[6]qui trouve sa source dans le sens compris comme « direction ». Il s’agit de défendre une théorie de la « signification émergentiste » qui s’oppose à la théorie de la « signification pentecôtiste » d’après laquelle « il existe un sens antérieur et indépendant à l’égard des formes dans lesquelles il s’exprime et des manières dans lesquelles il s’imprime – une signification qui tombe du Ciel tel l’Esprit Saint au jour de la Pentecôte. » (p. 63) C’est une telle conception « pentecôtiste » de la signification que l’on retrouverait dans la « théorie classique de l’expression » énoncée par Aristote (De l’interprétation 16 a1-10) : « dans l’esprit, seules existent des significations qui se manifestent à travers des mots, lesquels sont à leur tour symbolisés par le biais de l’écriture » (p. 63-64). Ferraris isole deux partis-pris problématiques dans la « signification pentecôtiste » : premièrement, il peut y avoir une signification bien qu’elle soit inexprimée ; deuxièmement – ce qui constitue un trait « plus important encore » –, « la signification n’a pas de genèse : elle est là depuis toujours, ou elle est tombée du ciel. ». La théorie de la « signification pentecôtiste » accorde une primauté à la signification qui précéderait l’expression et l’inscription, en favorisant l’ordre « signification → expression → inscription ». La signification est l’originaire, l’expression n’en est que la manifestation, et l’inscription la fixation sur un support matériel : la théorie de la « signification pentecôtiste » n’aborde jamais la question de l’origine, de la genèse de la signification qui est vue comme principielle, terminus ad quem de l’explication. Du fait que cette question n’est pas abordée frontalement, la théorie a tendance à supposer une origine transcendante, mystérieuse, presque hors-réalité. La signification serait un don merveilleux fait à la réalité par quelque chose de plus haut qu’elle ou de différent d’elle : le logos, l’Esprit….
Le nouveau réalisme ne peut faire sienne cette théorie de la signification qu’auraient défendue d’une manière ou d’une autre la philosophie classique et l’idéalisme. Dans la théorie de la « signification émergentiste », l’ordre d’explication est tout simplement inversé : « inscription → expression → signification. » Les récits « spéculatifs » développés dans Emergence viennent illustrer cet ordre par des « évidences, prouvées par l’histoire, la physique, le sens commun » (p. 14-15). Une « évidence » de ce genre est invoquée à propos des peintures murales dans les grottes de Lascaux : « il en va ainsi de toute évidence dans les grottes de Lascaux : la faculté de tracer précède les formes par lesquelles elle se manifeste, ainsi que la signification qu’elle reçoit. » (p.65) Les pyramides seraient un autre exemple en faveur de la théorie émergentiste de la signification : « La genèse de la pyramide manifeste l’émergence de la signification. Il s’agit au début d’un hypogée ; on crée ensuite un amoncellement pour protéger l’hypogée ; on commence alors à donner un sens à cet amoncellement : échelle vers le ciel, rayon de soleil. » (p. 65). Ce processus s’inscrit dans le mouvement inscription (hypogée)/ itération (amoncellement)/ altération (signe, symbole).
Maurizio Ferraris propose même de remonter aux tout premiers rudiments de « sens » dans la première division d’« Epistémologie », intitulée « Direction ». Ainsi, suivre une direction est la première manière de « donner un sens à [son] existence » et c’est ce qu’auraient expérimenté les trilobites à l’ère cambrienne lorsqu’ils « cessèrent de tourner en rond et commencèrent à suivre une direction » (p. 67). Le sens compris comme direction et mouvement est la première étape qui rend possible les suivantes. Dans un raccourci un peu surprenant, Ferraris mentionne à l’appui de cette idée le rôle de la prosodie (assimilée à une sorte de mouvement, de progression des sons) dans la poésie : « la signification ne précède pas la prosodie mais en dérive, ce qui justifie les théories relatives à l’origine poétique du langage. » (p. 67-68) Avant même l’émergence de la conscience (rapportée à l’émergence d’une direction temporelle et non plus seulement spatiale) , le monde est « déjà ordonné », ce qui signifie, à un premier niveau qu’il « possède des directions », indépendamment de « l’intervention de nos intentions et nos concepts. »[7] Le sens comme direction émerge « du corps et de l’environnement » (p. 74), bien avant l’apparition des concepts. L’interaction constitue l’étape suivante dans l’histoire du sens : « un jour ou l’autre, la direction conduit quelque part, et détermine une interaction. » (p. 75) Par exemple, « la tique se laisse tomber d’une branche et rencontre (si le stimulus olfactif ne l’a pas abusée) un mammifère » ou, « à un niveau plus complexe, mon chat Cleo cherche à attraper une guêpe et la guêpe cherche à lui échapper, Cleo joue à la balle soit dans son coin, soit avec moi… ». Maurizio Ferraris insiste, dans le sillage de l’ « expérience du chausson » présentée dans le Manifeste du Nouveau Réalisme (p. 43 sq.) sur le fait que de telles interactions ne dépendent pas de « schèmes conceptuels » qui seraient communs aux différents individus mais requièrent simplement « le partage d’un espace commun, et d’objets doués de positivité indépendants de nos conceptualisations. » (2018, p. 76). Les interactions laissent des traces « sur la matière (le verre de ma montre s’est légèrement rayé en dérapant contre un mur), et dans cette forme spécialisée de matière qu’est la mémoire » (p. 76) : elles débouchent donc sur une « fixation ». Ainsi « l’instinct animal » résulte de la stabilisation des interactions avec un certain environnement. Dans tous les cas, les interactions donnent lieu à une « sédimentations d’informations », décrites comme des « sens minimaux qui enrichissent le niveau des interactions » (par exemple, le jeu avec le chat Cleo devient « le jeu habituel ») (p. 76).
Un autre élément fondamental dans la genèse du sens consiste en « l’invitation qui provient des individus » : des individus peuvent représenter « des invitations, des affordances, pour d’autres individus : typiquement, une poignée invite à être saisie, via une propriété qui ne se trouve pas dans le sujet, mais dans l’objet. » (p. 78-79) Le concept d’invitation permet d’introduire une autre formulation de la théorie émergentiste de la signification, sous la forme: « résistance → invitation → signification. »[8]
Après avoir proposé une genèse des premiers moments du sens, dont il souligne qu’ils n’ont rien à voir avec de quelconques concepts ou un quelconque logos, Maurizio Ferraris propose dans la deuxième section d’ « Epistémologie », intitulée « Itération », une genèse du logos, qui n’est pas défini précisément mais associé à « l’abstraction » et au « monde des significations » (p. 93). Le logos se distingue de l’historia et du mythos dont il provient, selon la direction « historia→ mythos→ logos » : « au commencement, il n’y avait pas le logos (…) ; mais il n’y avait pas non plus le mythos : il y avait, justement, l’historia. Des individus accidentels dans le monde réel.» (p. 86). Le passage de l’historia au mythos se produit par l’exemplification : un individu particulier est pris comme exemplaire d’une certaine propriété[9], et acquiert par là une portée générale, le rôle de représentant d’une classe ; par exemple, Hector est le modèle du guerrier courageux et loyal. Le passage du mythos au logos s’accomplit quant à lui lorsque « l’individu disparaît » et qu’« il ne nous reste plus que la classe, l’abstrait ». Le passage de l’historia au mythos et du mythos au logos procèdent d’une itération c’est-à-dire la répétition de l’identique, qui permet de faire surgir la nouveauté (selon la dialectique inscription/itération/altération) : « à partir de la tête de bœuf, on en est venu à sa représentation à Lascaux, c’est-à-dire à l’usage exemplaire de cette représentation, et enfin à la stylisation (et au retournement : la tête est tournée vers le haut, les cornes vers le bas) dont est sorti le A que vous lisez en ce moment. » (p. 87) Ferraris se réfère ici au travail de I.J. Gelb (1952).
La troisième division d’ « Epistémologie », intitulée « Signification », insiste sur le fait que la signification ne procède pas d’une « intentionnalité » ou d’un « vouloir-dire » qui serait « antérieur à l’expression et l’inscription. » (p. 97) Le refus d’une primauté de l’intentionnalité est le principe général de l’ « ichonologie » dont il était question au début d’ « Epistémologie » : « avant la psychologie, il y a l’ichnologie, la doctrine de la trace qui n’est pas encore psychè ; avant l’esprit il y a la lettre : en premier lieu il y a des traces, ces dernières commencent ensuite à avoir une signification pour les hommes et pour les animaux, et enfin émergent les signes et leur vouloir-dire dont descendent le langage, l’écriture au sens courant, la signification, la responsabilité, la vérité. » (p. 66) Ainsi, la société n’a pas été créée par un contrat social né d’une « intentionnalité collective », la tendance à la coopération naît bien plutôt de « l’imitation et du partage de coutumes » (p. 102). L’intentionnalité repose sur la « documentalité », concept développé par Maurizio Ferraris pour penser l’ontologie du monde social dont la théorie est exposée dans son ouvrage Documentalité (Ferraris, 2021) : « nous commençons par recevoir une formation documentale (rites, éducation), et ce n’est que dans un second temps que ce qui est reçu peut se transformer en intentionnalité. » (2018, p. 102-103). L’« enregistrement » propre au monde social se sédimente non seulement dans la mémoire des acteurs sociaux mais aussi dans de nombreux « supports externes », que ce soit dans des « rites » ou dans « l’écriture » et ses multiples applications. L’écriture, plus que le langage parlé, joue ainsi un rôle fondamental dans le développement de la science et de ce que Maurizio Ferraris conceptualise comme l’« émergence de la vérité » : même si le Mont-Blanc mesurerait bien 4810 mètres même en l’absence d’humanité, « il est indéniable que la proposition ‘Le Mont-Blanc mesure 4810 mètres’, la socialisation de cette proposition, et donc son évaluation épistémologique, dépendent du langage et, davantage encore, de l’écriture. » (p. 106)
La question de l’origine du langage, le souci d’en proposer une genèse, de le replacer dans un processus plus global d’émergence du « sens », apparaît comme l’axe de questionnement principal qu’adopte le nouveau réalisme défendu et illustré dans Emergence quant au langage. S’intéresser à la question de l’origine du langage est en effet une manière d’en faire un « morceau de réalité », d’en subvertir toute prééminence ou différence par rapport à l’ensemble de ce qui est. On peut cependant s’interroger sur certaines limites de ce projet. Tout d’abord, il convient de souligner que tout discours sur l’origine du langage doit reconnaître son caractère hypothétique – ce que fait bien Maurizio Ferraris lorsqu’il souligne le statut « spéculatif » des récits développés dans Emergence. Par ailleurs, se focaliser sur la question de l’origine du langage ne résout pas le problème de l’usage du langage, de ce que le langage nous permet de connaître ou de faire. Ce constat remonte au Cratyle de Platon : tout discours sur l’origine empirique ou la constitution interne du langage, outre son caractère hypothétique, ne saurait jamais nous apprendre à faire un bon usage du langage (439c). Si le langage et les schèmes conceptuels se voient attribuer un rôle particulier dans la connaissance et la vérité, ce rôle n’est pas clarifié dans la seconde partie d’Emergence.
III. Parler avec réalisme du langage, est-ce parler de champignons ?
En se concentrant sur une approche ontologique du langage qui le définit comme « morceau de réalité » soumis à la dialectique de l’émergence, le réalisme de Maurizio Ferraris a pour but de nous détacher de l’emprise d’une vision « pentecôtiste » de la signification et de nous amener à considérer le langage comme ces champignons plusieurs fois pris en exemple pour illustrer le principe de l’émergence : toutes choses « émergent de la réalité à la façon dont poussent les champignons. » (p. 10) Mais une philosophie réaliste peut-elle vraiment mettre de côté tout questionnement sur la manière dont notre usage du langage se réfère à la réalité et se contenter de proposer un récit spéculatif sur la manière dont le langage en aurait émergé ?
Il convient de souligner que la définition des termes d’« ontologie » et d’ « épistémologie » par Maurizio Ferraris prête à équivoque : leur suffixe en –logie , dérivé du grec logos, est négligé lorsque l’ontologie est définie comme « ce qui est » et l’épistémologie comme « ce qui est connu ». En effet, l’ontologie est bien plutôt un discours sur ce qui existe et l’épistémologie un discours sur les conditions de la connaissance. Ferraris semble donc ontologiser, ou désépistémologiser, pour ainsi dire, les définitions de l’ontologie et de l’épistémologie, en faisant abstraction de leur statut de discours : ces discours sont en quelque sorte réduits à leurs objets respectifs (« ce qui est » ou « ce qui est connu », autrement dit les « individus » ou les « objets »). Une telle considération est bien prise en compte dans le Manifeste du Nouveau Réalisme : « on pourrait certes objecter que l’ontologie n’est pas ce qu’il y a, mais un discours sur ce qu’il y a. Il y aurait donc toujours un résidu épistémologique dans l’ontologie et un résidu ontologique dans l’épistémologie. » (2014, p. 50) L’auteur du Manifeste répond à l’objection de la façon suivante : « Cela est indiscutable : l’ontologie n’est jamais sans épistémologie exactement comme on ne peut pas vivre sans savoir. Toutefois, si l’ontologie est aussi un discours, elle est un discours qui doit marquer une différence par rapport à l’épistémologie, sans insister sur leur continuité. Ceux qui tombent dans la falsification de l’être-savoir ont souvent ce travers. » Dès lors, « le geste théorique intéressant n’est pas l’affirmation qu’ontologie et épistémologie se confondent, mais la recherche des manières dont ontologie et épistémologie se distinguent. » (2014, p. 50-51) Ces manières sont résumées dans un tableau :
| Epistémologie | Ontologie
|
| Amendable
Ce qu’on peut corriger |
Inamendable
Ce qu’on ne peut pas corriger
|
| Monde interne
(= interne aux schémas conceptuels) |
Monde externe
(=externe aux schémas conceptuels) |
| Science
Linguistique Historique Libre Infinie Téléologique |
Expérience
Pas nécessairement linguistique Non historique Inamendable Finie Pas nécessairement téléologique |
Maurizio Ferraris reconnaît donc que l’ontologie est aussi un discours : cela ne compromet-il pas le projet de faire du langage un simple « morceau de réalité » comme les autres ? A force de vouloir « marquer une différence » de l’ontologie à l’épistémologie, le nouveau réalisme ne risque-t-il pas d’en revenir à la confusion des deux, même si c’est au profit de l’ontologie et non de l’épistémologie, au contraire de ce qui se passe dans l’idéalisme et le constructivisme ?
Intéressons-nous de plus près à la troisième section du tableau, c’est-à-dire à la distinction entre l’expérience (placée du côté de l’ontologie) et la science (placée du côté de l’épistémologie). Ce serait en effet « en laissant de côté la différence entre science et expérience » que « les postmodernes ont pu soutenir que rien n’existe hors du texte, du langage, ou d’une quelconque forme de savoir. » (2014, p. 58) Le langage est placé du côté de la science, « nécessairement linguistique », tandis que l’expérience ne l’est « pas nécessairement » comme le montrent particulièrement bien les illusions d’optique : je n’ai « aucun moyen de corriger une illusion d’optique, même si je suis conscient de son caractère illusoire ». L’inamendabilité « se manifeste avec une évidence particulière dans la sphère de l’expérience perceptive » (2014, p. 70)[10]. Cependant, les formulations employées n’excluent pas totalement la possibilité que le langage intervienne également au niveau de l’expérience: il est affirmé que l’expérience n’est pas nécessairement linguistique (et non pas qu’elle ne l’est nécessairement pas), que l’inamendabilité se manifeste avec une évidence particulière dans la sphère de l’expérience perceptive (ce qui ne veut pas dire qu’elle ne se manifesterait pas en dehors, en particulier dans une expérience impliquant le langage), que nous pouvons « imaginer des expériences qui adviennent sans langage ni écriture » (2014, p. 58-59) – ce qui sous-entend qu’il existe aussi, voire surtout pour un être humain, des expériences qui impliquent le langage et l’écriture. Cet entrelacement entre le langage et le simple niveau de l’expérience n’est-il pas aussi ce que Ferraris reconnaît en déclarant qu’« on ne peut vivre sans savoir » ? Le simple vécu ne relève pas de la science, mais le langage est présupposé par la science : le langage serait alors ce qui, au sein de l’expérience, prédispose à la science. On peut donc relever une certaine hésitation sur la manière dont est défini le rapport entre le langage et l’expérience : si Maurizio Ferraris est soucieux de dégager une couche non langagière de l’expérience, il n’exclue pas la possibilité que le langage intervienne dans l’expérience même s’il n’est pas une condition de possibilité de toute expérience. Le langage constitue un maillon entre l’expérience et la science, comme l’illustre bien ce passage : « La falsification de l’être-savoir n’appréhende pas la différence cruciale entre faire l’expérience de quelque chose, parler de quelque chose et faire science (par exemple, avoir mal à la tête, le décrire à quelqu’un et formuler un diagnostic). Dans le cas du parler – et à plus forte raison du faire science – nous sommes confrontés à une activité linguistique (les scientifiques parlent), historique (ils exercent une activité cumulative), libre (on peut ne pas faire de la science), infinie (la science n’a jamais de fin) et téléologique (elle a un but). Ce n’est pas le cas de l’expérience. » (2014, p. 58). Le langage joue un rôle d’intermédiaire entre l’expérience et la science, et plus largement entre l’ontologie et l’épistémologie d’après les distinctions synthétisées dans le tableau. Refuser d’accorder une grande place à la réflexion sur le langage au sein du nouveau réalisme pourrait être une conséquence de la volonté de mettre en valeur « la manière dont ontologie et épistémologie se distinguent » : si le langage se retrouve, au moins pour une part, à la fois du côté de l’ontologie et de l’épistémologie, une réflexion sur le langage pourrait avoir pour effet de les rapprocher dangereusement. Mais on peut rétorquer à cela qu’une clarification du rôle épistémologique du langage – puisque le langage se trouve bien plus dans le camp de l’épistémologie plutôt que dans celui de l’ontologie d’après les distinctions effectuées– permettrait aussi de rendre compte de la distinction entre ontologie et épistémologie de manière plus précise. Cela serait d’autant plus nécessaire que Maurizio Ferraris ne déclare pas renoncer à toute épistémologie, mais revendique le maintien d’une distinction essentielle entre ontologie et épistémologie, à l’encontre des philosophies « corrélationnistes » qui auraient délibérément confondu les deux.
Par ailleurs, si le réalisme se définit, en premier lieu, par la reconnaissance de l’inamendabilité du réel et cherche à mettre en évidence des expériences où nous sommes indéniablement confrontés à une telle inamendabilité, il paraît important de souligner que l’usage du langage, sur un autre plan que la perception, nous amène aussi à faire l’expérience de l’inamendable : on ne peut pas dire ce qu’on veut, de même qu’on ne peut pas percevoir ce qu’on veut. Même si le langage se caractérise par une marge de liberté plus grande, cela ne veut pas dire qu’il n’est pas soumis à certaines normes : l’une de ces normes n’est-elle pas précisément de s’ajuster à la réalité, au sein des expériences particulières que nous en faisons ? Lorsque nous cherchons le mot juste, n’éprouvons-nous pas bien la résistance du réel qui ne nous permet pas de dire n’importe quoi, en même temps que l’invitation à dire ce qui est ? Ne pourrait-on alors soutenir que l’expérience de la parole, indépendamment même d’une entreprise scientifique, nous met aux prises avec cette réalité inamendable dont le « nouveau réalisme » veut nous faire reprendre une claire conscience ? De ce point de vue, il n’y aurait pas de bonne raison « réaliste » de négliger la « philosophie du langage » pour se consacrer uniquement à la « philosophie de la perception ». La perception nous met peut-être dans un rapport plus immédiat avec l’inamendable. Mais le langage nous conduit aussi à en faire l’expérience et cette piste mériterait d’être davantage explorée dans le cadre d’une investigation réaliste du langage. « Schèmes conceptuels » et « apparats perceptifs » sont d’ailleurs à plusieurs reprises regroupés au sein d’une même expression dans le Manifeste du Nouveau Réalisme (2014, p. 38 et 51) : tous deux possèdent un rôle modélisant qui n’altère cependant pas l’inamendabilité de la réalité avec laquelle ils se confrontent.
Le « nouveau réalisme » devrait alors prendre davantage au sérieux la visée réaliste à partir de laquelle se sont développées plusieurs philosophies du tournant linguistique. Maurizio Ferraris adopte en effet une certaine vision extrêmement tranchée et négative du tournant linguistique qui en simplifie la teneur et néglige la diversité des approches que ce label recouvre.
Du côté analytique, le « premier tournant linguistique » est tributaire de la réflexion conduite par Frege qui se caractérise par le refus d’un traitement idéaliste et psychologique de la logique et du langage. Frege rejette les définitions des jugements analytiques et synthétiques données par Kant car il les estime trop subjectives[11], s’oppose à l’idée que le sujet est le fondement de toute réalité et a le souci de mettre en évidence la visée réaliste dont le langage est porteur : tout proposition « présuppose » une référence. Frege s’oppose aussi à une compréhension mentaliste de la signification, initiant par là un axe fondamental du tournant linguistique dont la critique de la « signification pentecôtiste » conduite dans Emergence est l’héritière indirecte. On pourrait s’amuser à relever une phrase d’Emergence qui entre en consonance avec l’idée frégéenne d’exhiber le noyau logique essentiel du langage sous son vêtement linguistique superficiel : commentant le fait que « iter « à nouveau » et alter « autrement » dérivent d’une même racine sanscrite, itara », Maurizio Ferraris écrit : « cela n’est pas étonnant, puisque l’on touche ici à un aspect qui est logique et ontologique, et pas seulement linguistique. Itérer, c’est en même temps altérer (…) ». Une autre comparaison plus sérieuse entre Frege et Ferraris serait possible à propos de ce que Ferraris dit de la vérité : « que le sel soit NaCl a toujours été vrai même lorsque personne ne le savait ou ne l’affirmait » (Ferraris, 2018, p. 95), même si Ferraris insiste sur l’« émergence » de la vérité là où Frege parlerait simplement de sa « saisie ». Malgré ces rapprochements possibles, le « premier tournant linguistique » que les travaux de Frege ont participé à promouvoir fait partie de ce que Ferraris dénonce comme des « philosophies qui pensaient n’avoir rien en commun avec les idéalistes transcendantaux voire qui (comme dans le cas de la philosophie analytique) étaient nées en opposition ouverte à l’idéalisme. » (p. 135-136)
Des rapprochements plus évidents qu’avec le « premier tournant linguistique » sont cependant possibles avec le « second tournant linguistique » de la philosophie analytique, notamment avec la philosophie du second Wittgenstein. Dans les Recherches Philosophiques où Wittgenstein critique le préjugé de la « pureté de cristal de la logique » (Wittgenstein, 2004), est en effet introduite la thématique du « mythe de la signification » – expression rendue célèbre par Quine : il s’agit de dénoncer l’inanité de la « signification » comprise comme une entité mystérieuse, invisible, insufflée par l’esprit aux mots, ce qui s’articule à la dénonciation du « mythe de l’intériorité » (Bouveresse, 1976). La critique de la « signification pentecôtiste » dans Emergence entre fortement en consonance avec le rejet du « mythe de la signification », au point qu’il paraît étonnant que cet héritage ne soit même pas mentionné. Par ailleurs, la dimension « anthropologique » du second Wittgenstein qui caractérise l’apprentissage du langage comme un « dressage » rejoint la manière dont Emergence décrit l’éducation humaine : « l’humanité de l’humain passe par des processus de dressage, d’imitation et de motivation (…) » (Ferraris, 2018, p. 111). La volonté wittgensteinienne de voir ce qui est sous nos yeux, à nos pieds, contre toute recherche d’idéal ou de fondement, devrait aussi, semble-t-il, pouvoir trouver un écho favorable auprès du nouveau réalisme: l’incitation wittgensteinienne à prêter attention à l’usage du langage procède d’une volonté réaliste puisqu’il s’agit « d’examiner la réalité « mondaine » du langage, ses usages et son action dans et/ou sur le monde. » (Ambroise et Laiugier, 2009, p. 22)
La critique du primat de l’intentionnalité dans l’explication de la signification est une thématique que l’on retrouve aussi du côté « continental » du tournant linguistique. Pour ne citer qu’un exemple, l’Archéologie du Savoir de Foucault manifeste la volonté de considérer les discours dans leur existence positive, sans les rapporter à une intentionnalité sous-jacente. C’est le sens de l’opposition mise en œuvre par Foucault entre le « monument » et le « document » (Foucault, 2015, p. 15) : les discours devraient être traités comme des « monuments » c’est-à-dire être pris dans leur simple positivité, et non comme des « documents » car le concept de document renvoie trop selon Foucault à l’idée d’intentionnalité. Le sens que Maurizio Ferraris confère au concept de « document » rejoint ce que Foucault préfère appeler « monument » et en partage le refus d’une primauté de l’intentionnalité. Dans l’Archéologie du Savoir, Foucault recourt aussi à une forme d’émergentisme : c’est parce que certains discours ont existé que d’autres vont pouvoir venir au jour, chaque nouveau discours étant tributaire de possibilités ouvertes par ceux qui l’ont précédé.
Bien que Richard Rorty soit aux yeux de Ferraris le parangon de ce qu’il critique dans son attaque du « tournant linguistique » et du « postmodernisme », il serait également possible de relever une certaine convergence entre les deux philosophes. Rorty a beau être celui qui a mis en circulation l’expression « tournant linguistique », il prend ses distances, dès l’introduction de l’anthologie de 1967, avec les promesses du projet consistant à résoudre ou dissoudre les problèmes philosophiques à l’aide d’une méthode enfin sûre. Dans ses ouvrages ultérieurs, il critique dans le projet initial du « tournant linguistique » la reconduction de la philosophie transcendantale de Kant puisqu’il s’agit de se mettre en retrait des débats philosophiques en prétendant exhiber leurs conditions de possibilité, en l’occurrence les conditions de la signification : le langage serait un nouvel « a priori » permettant de maintenir à la philosophie le statut d’une « discipline architectonique et enveloppante » (Rorty, 2017, p. 296). Rorty aussi veut en finir avec tout « idéalisme transcendantal » ou « idéalisme représentationnel » et se montre même plus radical dans sa critique de l’idée de « représentation » que Ferraris : pour Rorty, l’opposition entre le réalisme et l’idéalisme est elle-même dépendante d’un certain cadre de lecture « représentationnaliste » avec lequel il s’agit de rompre. D’un point de vue rortyen, Ferraris, dans sa volonté de défendre la prééminence de l’ontologie sur l’épistémologie, pourrait être considéré comme restant tributaire de distinctions traditionnelles en définitive peu analysées. Contrairement à Ferraris, Rorty défend que certains aboutissements du (second) « tournant linguistique » fournissent des instruments fructueux pour sortir des problématiques de l’idéalisme et du représentationnalisme : ainsi, la considération du langage comme une pratique sociale qui n’a pas une fonction définie (telle que la représentation de la réalité ou l’expression de l’essentialité de la nature humaine) mais une pluralité de fonctions qui varient en fonction de nos intérêts et nos buts contingents permet d’en finir avec l’idée que le langage (ou l’esprit) devrait se faire « miroir de la nature » sans jamais y parvenir. Ferraris et Rorty se rejoignent à nouveau concernant leurs conceptions de la vérité : tous deux donnent un sens positif à l’idée de « faire la vérité » (plutôt que de la découvrir) en repartant du fait que la vérité est une propriété des phrases, qui sont elles-mêmes le produit des êtres humains. C’est pour Ferraris une composante de l’ « émergentisme » qu’il veut placer au cœur de son nouveau « réalisme » : la vérité est « l’ensemble des propositions vraies qui émergent de la réalité » (Ferraris, 2019, p. 163). « Faire la vérité » suppose une structure « à trois termes » : « l’ontologie, l’épistémologie et la technologie » qui « assure le passage à l’ontologie à l’épistémologie » et qui se compose de « l’ensemble des instruments nécessaires » (2019, p. 135) et des « opérations » (2019, p. 140) à mettre en œuvre pour accéder à la vérité. Tout comme Rorty, Ferraris prend ses distances avec l’idée que les faits ou la réalité seraient les « vérifacteurs » (truth makers) des propositions (truh bearers),préférant classer l’ontologie du côté des « truth bearers », confiant à la « technologie » le rôle de « truth maker » et à l’épistémologie celui de « truth teller » (2019, p. 170). Ferraris incline aussi vers le pragmatisme cher à Rorty : pour savoir quelle « technologie » nous « donne la vérité », il faut juger « d’après les effets » car « des technologies erronées produisent des effets indésirés » (2019, p. 163).[12]
Notons pour finir un important point de divergence entre le traitement du langage dans Emergence et dans ces différentes versions de tournant linguistique : il s’agit de la place accordée à la question de l’origine du langage. L’interrogation sur la genèse et l’ « émergence » du langage à partir de premiers rudiments de « sens » est tout à fait centrale dans l’ « Epistémologie » d’Emergence. Cette démarche semble cependant rencontrer certaines limites : premièrement, la question de l’origine (ultime) est-elle réellement soluble ? Deuxièmement, cette question nous éclaire-t-elle vraiment quant à notre usage du langage ? Wittgenstein, dans les Recherches Philosophiques, déclare ainsi que les « jeux de langage » dont nous héritons constituent le « roc dur » en-dessous duquel il n’est pas possible de creuser concernant les justifications que nous sommes capables de donner (Wittgenstein, 2004). D’une manière particulièrement intéressante et révélatrice, Maurizio Ferraris fait allusion dans le Manifeste du Nouveau Réalisme à ce célèbre paragraphe, dont il modifie cependant radicalement le sens en en faisant une illustration de l’inamendabilité de la réalité non linguistique : « Bref, l’inamendabilité est la sphère à laquelle Wittgenstein se réfère dans ce passage célèbre : « Dès que j’ai épuisé les justifications, j’ai atteint le roc dur, et ma bêche se tord. Je suis alors tenté de dire : C’est ainsi justement que j’agis » » (Ferraris, 2014, p. 54). Or, ce que Wittgenstein a en vue dans ce paragraphe est l’impossibilité de trouver des justifications ultimes, au-delà des « jeux »du langage ordinaire qui s’ancrent dans une « forme de vie ». Si le langage est bien le résultat d’une émergence, il ne faudrait pas oublier qu’« une propriété est dite émergente à partir d’une certaine base de faits lorsque, bien qu’elle en dépende, elle ne peut être entièrement expliquée dans les termes des faits en question (…) » (2018, p. 8). Ainsi, en vertu même du principe de l’émergence, il ne suffit pas d’expliquer le langage dans les termes de ce dont il provient pour en rendre pleinement compte.
Conclusion
Si Emergence n’a pas pour but premier de traiter de la place du langage dans le nouveau réalisme, des remarques sur le langage sont égrenées tout au long de l’ouvrage, dessinant en creux une forme de philosophie du langage négative. Le tournant linguistique est accusé d’avoir perpétué l’idéalisme et prêté main forte au constructivisme, d’avoir réduit l’ontologie à l’épistémologie alors qu’il importe, selon le Manifeste du Nouveau Réalisme, de distinguer clairement le discours ontologique du discours épistémologique. Pourtant le propos d’Emergence semble plutôt tisser une continuité de l’« Ontologie » à l’« Epistémologie », titres respectifs des deux premières parties de l’ouvrage, en les faisant reposer toutes deux sur la même dialectique ontologique de l’émergence, avec pour conséquence une possible dissolution de l’épistémologie dans l’ontologie. Accorder une plus grande place à la réflexion sur le langage, reconnu comme un maillon entre l’ontologie et l’épistémologie, pourrait permettre de clarifier les positions du nouveau réalisme sur ce point. Par ailleurs, le tournant linguistique semble trop rapidement et unilatéralement condamné, alors que certains de ses thèmes structurants se retrouvent dans la critique de la « signification pentecôtiste » : il n’y a donc pas nécessairement solution de continuité entre tournant linguistique et nouveau réalisme. Il paraît judicieux de réexaminer l’héritage du tournant linguistique dans cette perspective.
Bibliographie
Bruno Ambroise et Sandra Laugier, Philosophie du Langage, t.1, Paris, Vrin, 2009.
John Austin, « A Plea for Excuses » (1956), dans Philosophical Papers, Oxford, Oxford University Press, 1979, p. 175-204 ; trad. fr. L. Aubert & A.-L. Hacker, « Plaidoyer pour les excuses », in John L. Austin, Écrits philosophiques, Paris, Seuil, 1994.
Jacques Bouveresse, Le Mythe de l’intériorité : Expérience, signification et langage privé chez Wittgenstein, Paris, Minuit, 1976.
Donald Davidson, « On the Very Idea of Conceptual Scheme », dans Inquiries into Truth and Interpretation, p. 183-198, Oxford: Clarendon Press, 1974 ; tr.fr. Pascal Engel, Enquêtes sur la vérité et l’interprétation, Nîmes, Éditions Jacqueline Chambon, 1993, p. 267-289.
Jacques Derrida, De la Grammatologie, Paris, Minuit, 1967
Ignace Gelb, Pour une théorie de l’écriture, Paris, Flammarion, 1973.
Michel Foucault, L’Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 2015.
Maurizio Ferraris, Good bye, Kant ! Ce qu’il reste aujourd’hui de la Critique de la raison pure, tr.fr. Jean-Pierre Cometti, Paris, L’Eclat, 2009.
Maurizio Ferraris, Manifeste du Nouveau Réalisme, Paris, Hermann, 2014.
Maurizio Ferraris, Émergence, Paris, Éditions du Cerf, 2018.
Maurizio Ferraris, Postvérité et autres énigmes, Paris, Presses universitaires de France, 2019.
Maurizio Ferraris, Documentalité : pourquoi il est nécessaire de laisser des traces, Paris, Cerf, 2021.
Gottlob Frege, Fondements de l’arithmétique, Paris, Seuil, 1969
Gottlob Frege « Sens et dénotation », dans Écrits logiques et philosophiques, Paris, Seuil, 1971, p. 102-126.
Peter Michael et Stephan Hacker, « The Linguistic Turn in Analytic Philosophy », dans Michael Beaney (éd.), Oxford Handbook for the History of Analytic Philosophy, Oxford, Oxford University Press, 2013.
Martin Heidegger, Lettre sur l’humanisme, Paris, Aubier, 1983.
Ihab Habib Hassan, « Postmodernism : a paracritical bibliography », New Literary History, automne 1971, p. 5-30.
Thomas Kuhn, Reflections on my critics, in I. Lakatos & A. Musgrave (ed.), Criticism and the growth of knowledge, Cambridge University Press, 1970.
Thomas Kuhn, La Structure des Révolutions scientifiques, Paris, Flammarion, 2018.
Richard Rorty, The linguistic turn – recent essays in philosophical method, Chicago, The University of Chicago press, 1967.
Richard Rorty, Contingence, ironie et solidarité, tr.fr. P-E. Dauzat, Paris, Armand Colin, 1997.
Richard Rorty, Truth and Progress, Philosophical papers, vol. 3, Cambridge University Press, 1998.
Richard Rorty, La Philosophie et le miroir de la nature, tr.fr. T. Marchaisse, Paris, Seuil, 2017.
Ludwig Wittgenstein, Recherches philosophiques, trad. fr. Françoise Dastur et alii, Paris, Gallimard, 2004.
[1] Maurizio Ferraris a été l’élève de Vattimo, de Gadamer et de Derrida : c’est contre son passé philosophique qu’il se retourne en critiquant ce qu’il estime être les abus du « tournant linguistique » dans sa version continentale.
[2] Kant souligne tout de même le rôle du langage dans l’acquisition ou l’actualisation des concepts. Voir à ce sujet le livre de Raphaël Ehrsam, Le Problème du langage chez Kant, Paris, Vrin, 2016.
[3] En français dans le texte.
[4] C’est cette « forme forte » qu’ont reprise à leur compte les postmodernes selon Ferraris. Kant distinguait quant à lui dans la lettre à Marcus Herz du 21 février 1771 l’idéalisme transcendantal de toute création. Je remercie le relecteur anonyme de cet article pour l’indication de cette référence.
[5] Bien qu’il n’y fasse pas directement référence ici, Maurizio Ferraris reprend ce terme à Deleuze, l’un des auteurs qu’il a travaillés durant sa thèse, publiée en 1981 sous le titre Differenze. La filosofia francese dopo lo strutturalismo, Milan, Multhipla ; 2nde édition, Milan, AlboVersorio, 2007. Deleuze emploie l’expression pour la première fois dans Différence et répétition (1968) même si elle est en germe depuis Empirisme et subjectivité (1953).
[6] Le réalisme de Maurizio Ferraris s’oppose sur ce point au réalisme développé par Jocelyn Benoist, qui maintient que « le sens, initialement, c’est ce qui se dit dans un énoncé » ( Voir notamment Autour de Husserl, Paris, Vrin, 1994, chapitre « L’Origine du sens », p. 268-269 : « (…) s’il peut nous sembler naturel que l’on parle de nos perceptions, de nos vécus et de notre rapport aux choses et au monde, éventuellement aux autres et à nous-mêmes en termes de “sens”, il faut rappeler qu’il y a là transposition et usage métaphorique. Le modèle subrepticement employé dans de tels énoncés est clairement linguistique. Le sens, initialement, c’est ce qui se dit dans un énoncé. »)
[7] Ferraris attire l’attention (p.73-74) sur une observation fondamentale faite par Kant lui-même dans les Prolégomènes à toute métaphysique future (§13) : une main droite et une main gauche, bien qu’ « identiques dans le concept », « occupent nécessairement des parties différentes dans l’espace, dans la mesure où elles ne sont pas superposables. » ; Kant avait aussi raison de souligner que « la division de l’espace dépend étroitement de notre constitution physique, du fait que nous ayons une tête et des pieds (haut/bas), un front et une nuque (devant/derrière), une droite et une gauche. » dans son texte Du premier fondement de la distinction des régions de l’espace.
[8] La « résistance » est associée au « réalisme négatif » et l’« invitation » au « réalisme positif ». L’idée d’invitation semble directement inspirée de ce que Heidegger a développé sous le concept de Zuhandenheit : Heidegger est d’ailleurs directement cité à l’appui de l’idée qu’il existe une « solidarité profonde » entre « le sens comme direction et le sens comme compréhension », de la même manière qu’entre « la main, symbole de la compétence et la conscience, symbole de la compréhension » (même si Ferraris, contrairement à Heidegger, suggère que « même le singe a une main et que pour cette raison même il a une âme. »). Le terme de « phénoménologie » est par ailleurs repris pour désigner « la doctrine selon laquelle quelque chose se manifeste comme quelque chose » : la phénoménologie est décrite comme un « moment intermédiaire » entre « l’être (qui n’a pas nécessairement de sens) et le savoir (qui en a nécessairement). » (Ferraris, 2018, p. 69-70) Ferraris loue également le courant philosophique du pragmatisme pour avoir insisté « sur le fait que notre rapport au monde n’est pas seulement cognitif, mais implique une action, une disponibilité de la part du sujet, qui ne se limite pas à contempler mais exploite des ressources, cherche des solutions, transforme des situations. » (p. 79)
[9] Ferraris donne ainsi raison à Berkeley contre Locke sur la question de la genèse de l’idée générale.
[10] Sur ce point, Maurizio Ferraris indique être redevable à la psychologie de la Gestalt, en particulier au concept de « réalité rencontrée » développé par Wolfgang Metzger (Ferraris, 2014, p. 54-55).
[11] Frege accuse Kant d’avoir fondé cette distinction sur une appréhension trop psychologique du « contenu du jugement » et non sur la « légitimité de l’acte de juger » (Frege, 1969, §3).
[12] Ferraris cite la célèbre déclaration de William James : « Vraies sont les idées que nous pouvons assimiler, valider, corroborer et vérifier. Les idées qu’on ne peut soumettre à tout cela sont fausses. » (in La Signification de la vérité. Une suite au pragmatisme, Lausanne, Antipodes, 1998)