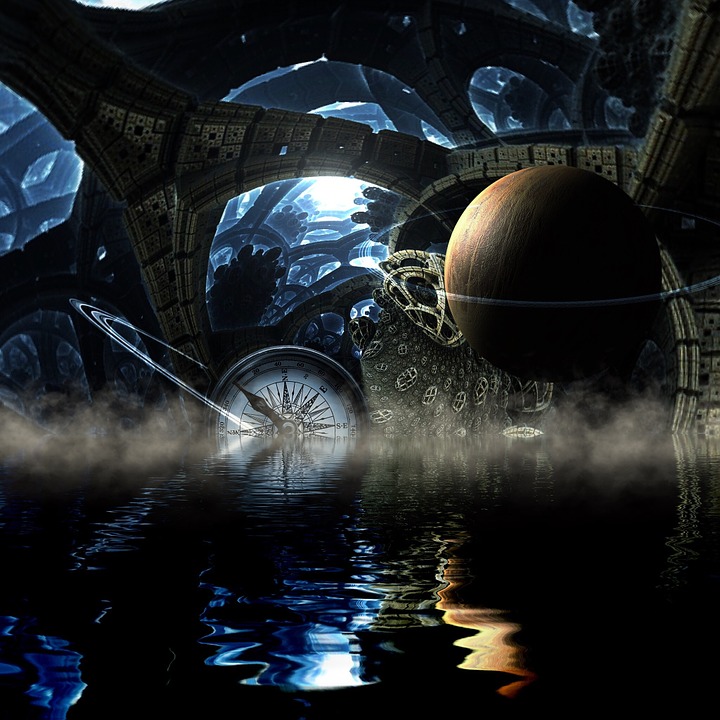Politique de la monnaie
« C’est la monnaie et le marché, la vraie police du capitalisme ».
L’Anti-Œdipe.
Marie Cuillerai, Professeur des Universités, Université Paris 7 / LCSP et LLCP
La réflexion sur la monnaie des 2 volumes de Capitalisme et Schizophrénie, a encore de quoi frapper une époque où des dizaines de documentaires et dessins animés expliquent « la crise des subprimes ». Il faut écouter le rap d’Anthem « Fear the Boom and Bust » (crains le cycle, expansion/récession) chantant l’opposition théorique « Hayek vs Keynes », comme si cette opposition qui structurait la reprise du problème de la monnaie dans les années 70, n’avait pas été entendue.
Aujourd’hui, la question de la monnaie reçoit plus d’échos qu’alors. Le refrain de la crise se compose des mots souveraineté, dette, finance, confiance, sortie de l’euro. Des mots familiers d’une théorie économique hétérodoxe qui a fait de la monnaie un objet central dans l’économie de marché. Lorsque les économistes hétérodoxes s’emparèrent de la question de la monnaie, dans la France de fin 70, c’est la question du désir de monnaie, chère à Keynes, et celle du signe emportée par la linguistique, chère au structuralisme, qui s’installent au cœur de leur propos. Il n’est pas possible dans le cadre de cet article de confronter La Violence de la monnaie, de M. Aglietta et A. Orléan aux productions de Deleuze, Foucault et Guattari, Klossowski, qui lui sont contemporaines. Il s’agira ici seulement de repérer quelques correspondances, oppositions, traductions bifurcations, entre le vocabulaire d’une hétérodoxie critique à l’autre.
Le propos de cet excursus se situe dans l’horizon ouvert par cette constellation de penseurs qui abordent le désir et la monnaie dans le dépassement de Freud et de Marx. Les économistes sortent l’économie de son champ disciplinaire pour l’ouvrir aux sciences humaines ; en sens inverse Deleuze et Guattari fouillent dans l’ethnologie, l’archéologie, l’histoire pour retracer le fonctionnement « d’une économie du désir » qui ne se cantonne pas à définir un « désir économique ». À l’horizon de ce double décentrement, un même attachement à identifier une redéfinition du politique ouvrant à l’action collective des perspectives positives.
I Désir de monnaie et désirabilité
L’ambition générale de Capitalisme et Schizophrénie est de montrer le désir, sa dynamique et ses effets, dans l’économie politique ; plus singulièrement, il s’agit, en suivant Keynes, de « réintroduire le désir dans le problème de la monnaie » [1]. L’hétérodoxe A. Orléan, ne procèdera pas différemment lorsque, cherchant ailleurs chez R. Girard, il s’emploie lui aussi à déterminer la nature du désir de monnaie. En un sens tout oppose ces deux démarches parties pourtant de la même ambition de renouveler le discours économique marxiste. L’une se refuse à la « maladie »[2] du structuralisme et fait du désir le contraire d’un manque – un « flux germinal intense »-, à l’origine de toutes les productions « Boom and Bust » ; tandis que l’autre fait de la désirabilité – « l’aptitude à être désirée par les autres »[3]-, la condition pour qu’un objet soit une monnaie. Réintroduire le désir n’est assurément pas la même chose que définir la monnaie par la désirabilité. Toutefois, l’écart entre ces deux perspectives fait fond sur une même ouverture de la question par Marx.
Conformément à l’analyse marxiste des formes de la valeur, la valeur d’échange ne saurait, pour l’économiste hétérodoxe, être une qualité spécifique de l’objet, mais seulement l’expression d’un rapport entre deux objets. Un rapport que le signe = n’autorise que par l’abstraction de toute singularité objectale, la monnaie étant la matérialisation de cette égalité, l’équivalent général déterminé en fonction des évaluations requises pour l’obtenir. Pour A. Orléan aucune substance spéciale telle que par exemple l’or n’explique l’élection d’une marchandise spéciale destinée à servir de monnaie. Mais aucune valeur substantielle, comme le serait chez Marx la force de travail, ne peut non plus consister en une valeur quantifiable et commensurable qui permettrait de calculer l’égalité entre deux objets. On ne mesure pas des valeurs préalablement déposées dans les choses. Mais c’est au contraire l’opération de la mesure qui fait naître la valeur des choses, et c’est donc dans la relation de confrontation des choses, dans l’échange, que la valeur née et se révèle n’être que le rapport de ces choses entre elles.
Par quoi rendre commensurable des objets disparates ? Marx répondra par quelque chose : une substance la quantité de travail, de dépense physique, contenue en elle. Réponse qu’il modulera jusqu’à l’oublier parfois au profit d’une autre, conduisant à une alternative radicale entre ses deux réponses. Indiquons brièvement cette autre solution. Rien de tangible, l’historico-social lui-même saisi dans le mode de production.
A. Orléan s’engouffre dans cette solution qui donne sa place aux formations sociales et où valeur d’usage et valeur d’échange sont des productions historico-sociales. S’inspirant des travaux de René Girard, il refuse la conception d’un individu souverain clairvoyant sur un désir « vécu sur le mode de la plénitude et de la transparence ». Pour lui, « l’individu ne sait pas ce qu’il désire […], il souffre d’une infirmité du désir qui le pousse à chercher en autrui les références qu’il ne réussit pas à se donner lui-même […] ». Il va donc recourir « à l’imitation d’un modèle. Aussi bien la critique que René Girard adresse à la psychanalyse freudienne s’appliquerait-elle tout aussi bien à la théorie économique. » [4]. Suivant ce modèle du désir mimétique, A. Orléan déporte la question du désir dans une relation d’imitation avec un alter ego qui sert d’opération de mesure.
L’opérateur de mesure de la valeur est bien l’expression d’une socialité, mais elle dérive en quelque sorte de la socialité inhérente à la nature du désir d’un être toujours déjà social, toujours déjà en concurrence avec les autres, mu par un désir pour ce qu’il n’est pas et ce qu’il n’a pas.
Le désir rapporté à autrui le métamorphose en désirable. Si tant est qu’on puisse aussi nommer désir « l’influx germinal intense », alors il semble avoir disparu de ce processus pour céder la place au désirable, puisque le désir des choses ne tient ni à une de leur qualité, ni ne se trouve individuellement rapporté au sujet désirant. Parce que les sujets désirants sont séparés entre eux, et croyant désirer des choses, désirent en réalité le désir des autres, leur désir « infirme » n’a d’autres solutions que de se reporter tout entier dans la relation mimétique et concurrentielle qui les unit. Le désir se retrouve toujours vectorisé par l’autre à qui l’on octroie ce que l’on n’a pas, le rendant ainsi désirable. Seule demeure cette opération de mesure de l’un qui n’a rien à l’autre qui semble mieux doté. En quoi consiste une telle opération ? En une comparaison ; d’une part, de ce que l’on est prêt à sacrifier pour obtenir quelque chose, et d’autre part, à cet autre qui rend l’objet désirable.
Que le manque, la distance, le simple fait de ne pas le posséder rendent un objet désirable, révèle la dimension relationnelle du désir, mais fait disparaître toute la dimension productive du désir. Loin d’être un flux indifférencié d’énergie, une libido sans fixation, le désir mimétique est manque, mais un manque relatif et relationnel, engendré par la concurrence des manques. C’est l’union entre concurrence et manque qui tourne le désir en désirable. Félix Guattari en donne la formule : « Est désirable ce qui est invariant dans l’échange. Ainsi on peut considérer que le structuralisme se constitue implicitement dès que l’échange entend s’emparer du désir »[5].
À y regarder de près, la phrase de Guattari vise au-delà de telle ou telle école du structuralisme. La notation fait ressortir comment l’échange est à sa racine un concept structurel qui ne peut s’appuyer que sur une conception du désir manque.
Un manque qui rend l’échange doublement contraint et que les économistes, hétérodoxes et orthodoxes confondus, appellent « la double contrainte de coïncidence des désirs ». Dans son texte « La valeur, la monnaie, le symbole. L’échange généralisé », Guattari reste vague sur le structuralisme, et ne se réfère que rapidement à la vulgate keynésienne, mais il permet de comprendre l’opération de glissement qui code le désir en désirabilité, en manque modelé sur le besoin. C’est l’échange lévi-straussien, qui est alors visé, « l’échange généralisé », sous-jacent à toute forme de dépense ou de don, et tel qu’il se constitue implicitement en solution matricielle du social, adjointement rationalisé entre deux manques. Le social comme système du manque, les productions de l’un pour combler les besoins de l’autre. À ce préjugé C & S ne cessera d’opposer les hésitations de Mauss, la « véritable ethnologie » de Généalogie de la morale, de Nietzsche[6], le tranchant de Bataille, le don de Clastre et celui de Leach.
Pour autant, on ne peut négliger le front commun qui unit ces démarches contre un freudisme simplifié, contre un individualisme du sujet souverain, contre la rationalité pacificatrice de l’échange généralisé. La séparation se fait sur le désir dompté par le désirable. La comparaison entre désir manque et désir flux fait ainsi ressortir comment la problématique d’une économie du désir, conduit à « introduire » la dimension de la violence et des rapports de force.
Pour A. Orléan, le désir n’est pas directement productif, il est directement mimétique, au point qu’on ne sait plus si c’est le désir qui est médiation ou si c’est la concurrence qui est productrice. Médiation des autres, organisée selon la structure du manque et son dynamisme imitatif. « Si chacun désire selon le désir de l’autre, n’importe quel objet est à même de les satisfaire dès lors que ce désir est partagé. Le fait même d’être partagé assure la désirabilité de l’objet considéré »[7]. La violence de la rivalité selon une mimétique sans orientation, conduirait à une lutte continuelle et insensée, si dans la confrontation des désirs concurrents ne se forgeait pas un processus de polarisation sur un objet qui va devenir désirable par tous. Ce processus immanent de constitution d’un désirable est pour l’économiste la matrice de toute institution. Les institutions sont des productions immanentes à la rivalité génératrice du désirable. De sorte que les institutions se déportent toujours vers la neutralisation de la rivalité, mais demeurent néanmoins exposées à son retour, étant fondées sur elle.
L’économiste voit dans ce processus une façon de comprendre la « genèse conceptuelle de la monnaie ». Penser la monnaie comme une institution, c’est lier monnaie, violence et désir. Se trouve ainsi redéfini ce qu’est une monnaie. Non pas un instrument rendu nécessaire par la contrainte de double coïncidence des désirs selon « la fable du troc », mais une institution engendrée dans l’immanence d’un social concurrentiel. Pas non plus une voile ou un signe exprimant les rapports réels de quantité de valeur que toutes les choses échangeables contiendraient. La monnaie est une institution spécifique, celle du commun désirable. Il ne s’agit pas seulement de faire d’une qualité particulière, que serait la désirabilité intrinsèque d’un objet, le trait distinctif d’un objet monétaire, sa différence spécifique par rapport aux autres objets économiques, ou autres marchandises. Cela, les marginalistes et néo-marginalistes l’ont fait depuis longtemps. Les économistes appellent cette « aptitude à être généralement acceptée », la liquidité d’un objet. Mais il s’agit de repérer comment la liquidité désigne pour un individu « ce que les autres considèrent comme liquide et désirent comme tel »[8]. Car il s’agit pour chacun de faire du désir d’autrui à la fois une orientation – savoir ce qu’il désire, et une contrainte – soumettre son désir à ce qu’il désire. La désirabilité, ou la liquidité est entièrement extérieure aux désirs individuels. Ainsi définie la monnaie est l’enjeu d’une rivalité mimétique spéculaire à laquelle elle vient mettre fin. « Cette liquidité ultime à laquelle tous adhèrent par la grâce d’une de la polarisation mimétique est ce qu’on nomme monnaie »[9]. « Par la grâce de », selon un euphémisme qui couvre la double dimension à la fois agonistique et rationnelle du processus qu’A. Orléan qui dote la monnaie d’une violence constitutive.
II Violence originaire et valorisation
Si on suit le fil de la violence, une même ambivalence se précise entre proximité et hétérogénéité des démarches pour renouveler la théorie monétaire. Dans la réflexion des économistes comme dans celle de Deleuze et Guattari, une même défiance est portée au concept de valeur et, dans les deux cas, la question de la valeur est liée à celle de la violence.
Ce soupçon critique a clairement été exprimé dans La Généalogie de la morale. Nietzsche y expose la racine du problème de la valeur. Qu’il s’agisse de valeur morale ou de valeur économique : sa difficulté n’est pas tant de définir tel ou tel contenu de la valeur, (égalité, vertu, ou force de travail, utilité, etc.), mais le fait qu’il existe plusieurs contenus possibles pour la définir. Car une valeur est un principe servant à évaluer (des conduites ou des choses) et en tant que tel, elle doit être soustraite à l’évaluation. Mais en tant qu’un principe a une valeur, il faut bien supposer qu’il a été lui-même le fruit d’une évaluation. De cette circularité, Nietzsche déduisait qu’il fallait distinguer d’une part, le fait de valoriser telle ou telle conduite (vertu, courage, etc.), ou telle ou telle chose (travail, utilité, désirabilité, etc.) ; et le fait d’évaluer, telle ou telle réalité en fonction de la norme qu’on s’est fixée. L’évaluation est une opération de mesure entre réalités existantes, tandis que la valorisation est un acte créatif. La valorisation est une déclaration de la valeur qui transforme la réalité, en lui ajoutant un caractère qui la distingue d’elle-même comme des autres. C’est pourquoi la méthode généalogique de Nietzsche consiste à pointer le moment premier, le proto-moment qui conditionne les évaluations sociales ultérieures. Évaluer ce n’est pas créer, mais c’est hiérarchiser ce qui est donné et qui n’est « donné » que par la sélection première, arraché à l’indifférencié par une proto-valorisation. On commence toujours par évaluer le donné, percevoir un différentiel entre le haut et le bas, le bon et le mauvais, et ce n’est qu’ensuite que se créer la valeur. Comment ? En hypostasiant, en faisant passer un adjectif pour un substantif : le Bien et Le Mal. Et non le bon et le mauvais. On évalue par des différentiels et ensuite on valorise, on crée.
Qu’en est-il chez A. Orléan, lorsqu’il cherche à se débarrasser de toute conception substantielle de la valeur économique, pour lui substituer une définition purement relationnelle ? Sa démarche génétique modélise un moment de création qui est un moment d’institution. Il renvoie la valeur à l’opération de valorisation en insistant sur le caractère collectif et conflictuel du processus. C’est « l’aptitude [d’un bien] à être accepté dans l’échange » qui le rendra susceptible d’être recherché par n’importe qui, et partant permettra de pallier cette contrainte de double coïncidence des désirs. Lorsque l’économiste rappelle cette définition de la liquidité, il s’empresse d’ajouter. « Est liquide pour un individu ce que les autres considèrent comme liquide et désirent comme tel. En conséquence […], il vient que la liquidité ne renvoie à aucune qualité substantielle particulière, définissable antérieurement aux relations interpersonnelles. On retrouve la même logique autoréférentielle : la liquidité est une création du désir de liquidité »[10].
Une auto-réferentialité qui désigne le fait que la monnaie tient son efficace et sa consistance d’être une désirabilité communautaire, qui ne traduit pas dans un langage quantitatif une qualité préalable des marchandises, commensurables en raison d’une valeur substance travail ou utilité intrinsèque. La monnaie, telle qu’on vient d’en voir la genèse, définit une solution de pacification de rapports concurrentiels : en ce sens elle stabilise une violence inhérente à la structure du désir-manque mimétique, ce qui lui confère le caractère structuraliste d’une institution.
Mais il ne faudrait pas s’arrêter à une lecture simplificatrice de l’institution. Car il ne s’agit pas ici de faire de l’institution la marque de la coupure entre nature violente du désir et acculturation sociale. Si la monnaie est une institution, et pourrait-on dire la quintessence même de toute institution, ce n’est pas en résorbant la violence, mais en lui donnant une interprétation[11] ; c’est au sens où elle est le produit de la valorisation d’un objet qui devient une norme d’évaluation socialement reconnue. Ses fonctions d’unité de compte de réserve de valeur et de moyen de paiement ne fonctionnent que parce qu’elle est le produit de la polarisation mimétique définie pour un temps et dans une communauté donnée.
Lorsqu’ils cherchent à élucider les modes de sémiotisation de la valeur, Deleuze et Guattari procèdent eux aussi en généalogistes fidèles à la leçon nietzschéenne. Ils traquent un moment où le processus de déclaration de la valeur se montre dans les agencements réels de son énonciation, dans son contexte économico-social ou dans son champ micro-politique. D’une manière générale, Capitalisme et Schizophrénie cherche à élucider les processus de sémiotisation de la valeur en les décalant du site de l’échange généralisé, où le capitalisme le montre tout en dissimulant les déclarations de valeurs et leurs systèmes d’asservissement au niveau de la production et de la consommation.
III Dette, crédit, scription
Capitalisme et Schizophrénie est un grand livre sur l’inscription, le ‘coin’ dans l’étrangeté d’une non-traduction, entre pièce de monnaie coin de la langue anglaise, et ce coin qu’on enfonce, qui frappe ou disjoint et qui en même temps estampille, marque et code. « Sauvages, Barbares, Civilisés » propose ainsi une lecture à double vue entre Généalogie de la morale, et Chronique des Indiens Guayaki de P. Clastre.
Comme pour A. Orléan, il ne s’agit pas là non plus seulement de déposer la substantialité de la valeur et une métaphysique du valable absolu. N’est plus en cause la capacité à évaluer de la monnaie or, la « relique barbare » selon l’expression de Keynes, ni les succédanés qui l’ont précédée, du bétail ou des coquillages. Il s’agit de reprendre le fil qui lie monnaie et violence une fois que la valeur s’est vue définie dans des processus de valorisation qui sont des marquages ; une fois que le mystère de sa substance s’est vu démystifié et ramené à sa source : des relations sociales qui la produisent comme norme socialement reconnue, mais oublieuse de son origine, fétiche. Il s’agit de reprendre le fil et la nature de ce fil, de métaphore en métaphore, monnaie-signe, monnaie-convention, monnaie-voile, et de comprendre l’inscription du désir de monnaie sur le corps du socius. Il s’agit en somme de changer d’attitude. Non plus démystifier les fétiches, mais puisqu’ils fonctionnent, les faire marcher jusqu’à ce que ça dysfonctionne.
Là se trouve aussi la tournure à la fois généalogique et génétique de l’Anti-Œdipe.
«Jamais [avant Nietzsche] on n’a posé de manière aussi aiguë le problème fondamental du socius primitif, qui est celui de l’inscription, du code, de la marque. L’homme doit se constituer par le refoulement de l’influx germinal intense, grande mémoire bio-cosmique qui ferait passer le déluge sur tout essai de collectivité. Mais, en même temps, comment lui faire une nouvelle mémoire, une mémoire collective, qui soit celle des paroles et des alliances, qui décline les alliances avec les filiations étendues, qui le dote de facultés de résonance et de rétention, de prélèvement et de détachement, et qui opère ainsi le codage des flux de désir comme condition du socius ? La réponse est simple c’est la dette, ce sont des blocs de dettes ouverts, mobiles et finis, cet extraordinaire composé de voix parlante, de corps marqué et d’œil jouissant. »[12]
Les paires à marier deux à deux, désignent toujours en premier, le passage de « l’influx germinal intense » dans ce qui le recode en flux, qualitatif et extensif. Selon la puissance germinale de l’influx, qui à chaque fois peut se décaler, des paroles pour ritualiser des alliances, des alliances verticalisées en filiations selon des descendances stratégiques, pour qu’une poupée de chair puisse s’apparier et s’apparenter, se marier, engendrer « opérer le codage des flux de désir », et instituer le socius.
À l’anthropomorphiser ainsi, la lecture peut sembler un peu simplificatrice ; néanmoins, cela permet de pointer l’incongruité de faire de la dette l’opérateur continu dans l’enchaînement d’une dynamique de socialisation.
Nietzsche avait eu le mérite de faire le trajet en sens inverse ; ramener la morale, le devoir, la faute et la culpabilité à la cruauté arbitraire d’un utilitarisme radical des maîtres créditeurs. Ramener la culpabilité et la faute à la relation créancier – débiteur en jouant de l’ambivalence de la langue allemande qui conserve dans la racine schuld, la confusion d’une faute morale (le coupable schuldiger) et d’une dette économique (schuldner).
Derrière cette dette et cette faute confondues, Nietzsche retrouve ce que Shakespeare ne fera jamais apparaître sur scène, la valorisation meurtrière d’une livre de chair, exigée par Shylock sur le corps de l’armateur Antonio. La valorisation par laquelle le paiement peut être honoré, même lorsque le débiteur n’plus rien pour s’en acquitter. Car, comme le fait subrepticement remarquer le commentaire du texte de Nietzsche dans l’effet de la profondeur des marquages initiatiques des adolescents Guayaki, le révélateur du système, c’est le mauvais débiteur. Loin d’être le plus immoral, il est au contraire le plus innocent, celui qui se trouve le moins pris dans la violence de l’inscription. À Antonio ruiné, Shylock demande un paiement en « monnaie vivante », en part de son corps. Cette inscription sur le corps qui met en équivalence dommage subit = douleur à contempler. La dette n’est pas une relation bilatérale d’échange, mais toujours l’emprise cruelle du social sur le corps d’un désir intensif. La dette n’est jamais un échange, elle est toujours une prédation et le dû, une extorsion cruelle. Aussi bien ne s‘agit-il pas vraiment de rendre, mais de pouvoir le faire, de promettre ce dû, d’en conserver trace, de le voir inscrit dans une « mémoire tendue par l’avenir »[13]. C’est par cette inscription sur le corps, créatrice de mémoire, marquant la relation d’endettement que le social se tisse. Telle est la violence rieuse repérée par Mauss dans la cérémonie du Potlatch. Une violence que plus rien « n’euphémise », mais qui ressortit elle aussi de la capacité à créer la monnaie d’échange qui permet le paiement.
IV Inscription, violence, souveraineté
Entre les deux manières de nouer à la monnaie le désir (désir manque et désir productif) la divergence porte sur la violence.
D’un côté, une violence mimétique de la genèse de monnaie comme institution produit par une agonistique et sa rationalisation ; et de l’autre une violence de l’inscription d’où naît l’institution d’une équivalence arbitraire, une sémiotisation de la valeur qui surligne l’arbitraire de sa rationalité. Les deux institutions de la monnaie procèdent par un même oubli ou recouvrement de l’acte originel de valorisation. La monnaie, comme médiation des évaluations, stabilise la violence originaire de la valorisation en se soustrayant à cela même qui l’a fait naître. La dette devient faute, oublieuse de la valorisation insensée par où le « crime [serait] rétabli par le spectacle du châtiment » et par où « douleur à subir = dommage causé »[14].
D’un côté, l’inconnu de l’objet du désir de l’autre, ce désir qu’il faut susciter si l’on veut obtenir de lui quelque chose, devient désir d’un objet-monnaie, en tant que norme reconnue par tous. La monnaie institution d’une désirabilité horizontale qui fait communauté. De l’autre, la monnaie inscription sur le corps du socius d’un code commun qui fait coupure. Une coupure, figurée par Nietzsche dans les « fondateurs d’Etat »[15] instaurant « un appareil de refoulement », des « formes de dressage » qui rend « la dette infinie ». Shylock, en butte à l’antisémitisme, jaloux du destin de sa fille échouera à obtenir la valorisation non monétaire de son crédit, selon une dette finie qu’il veut se voir payer une fois pour toutes par une monnaie vivante, la contrepartie cruelle d’un crédit d’argent qui ne lui procure même pas la reconnaissance sociale des Grands de Venise. Ils lui feront savoir que le pouvoir de décider de ce qui fait monnaie ne peut pas s’acheter, qu’il ne saurait s’imposer à autrui tant que l’objet monétaire n’est pas appréciable dans un échange. Les florins et marchandises exotiques demeureront la norme, avantageuse aux puissants, du dédommagement du marchand de Venise. Un dédommagement en monnaie marchande, puisque pour s’enrichir, le créancier préférera toujours attendre un dû échangeable, engendrant ainsi l’infinitisation de la dette par la valorisation de l’équivalence elle-même. La monnaie comme équivalent général, c’est une valorisation au carré, la création de la commensurabilité ou de l’équivalence ‘en soi’; la valorisation qui se déterritorialise. Ce n’est pas le corps de l’endetté ou de l’esclave qui compte, mais ce qu’il peut promettre de comptabilisable (de la production industrielle aux services sexuels), dans le temps de son existence, son inscription dans le socius, sa dette d’existence.
Deux formes de pouvoir monétaire se dessinent que le chapitre « La Machine capitaliste civilisée » de l’Anti-Œdipe, et l’introduction de Violence de la Monnaie prend soin de distinguer en se référant de part et d’autre aux travaux de S. de Brunhoff[16]. Il s’agit de singulariser le pouvoir de la monnaie, isoler la dimension et la nature de sa souveraineté.
Selon la matrice des économistes, l’indifférenciation du désirable ne conduit à une polarisation mimétique qu’au prix dynamique instable. La convergence sur un objet unique, l’enclenchement de l’autoréalisation de la croyance qui conduira à la reconnaissance d’un objet comme norme monétaire commune restent soumises au « maléfice » de la violence de l’indécision dans laquelle chacun cherchant ce qui est désirable pour tous, cherche en même temps à imposer comme désirable ce qu’il peut le plus facilement détenir. La crise de « l’anarchie marchande » représente la latence de tout ordre monétaire hégémonique et « la contrainte qui pèse sur la reproduction de la monnaie »[17]. Les effets de cette latence constituent l’histoire des économies marchandes comme le récit non dialectisable de l’opposition entre monnaie centrale et monnaies privées. Une histoire des formes prises par l’institution de la souveraineté monétaire. Une monnaie sera souveraine lorsque désirable par chacun et tous les sujets d’une communauté d’échange.
Aglietta et Orléan tiraient toutes les conséquences de cette instabilité lorsqu’ils avançaient que le processus, pour se stabiliser, implique la production d’une méconnaissance nécessaire qui place l’économie politique en une situation intenable. « L’économie politique est le discours générique qui accomplit ce déplacement mystificateur »[18]. Une science mystificatrice puisque le savoir de ce processus n’étant en soi d’aucune utilité aux acteurs qui le vivent et le connaissent clairement, il s’agit pour eux de déterminer comment ils pourraient lui trouver un usage dans leur stratégie de conquête de contrôle de la normativité.
Le pragmatisme des économistes producteurs d’une théorie du social en attente de son utilisation dans une politique économique, va-t-il jusqu’au bout de son pessimisme ? À balancer en aval du « savoir positif » l’alternative de « l’applicabilité concrète » ou de la « dégénérescence mécaniste[19] » de ses productions, ne s’exempte-t-on pas de remonter selon la radicalité nietzschéenne jusqu’à l’amont de cette connaissance positive pour interroger la nature de cette « volonté de savoir » ? Cependant, on peut remarquer la convergence de vue avec les développements de Mille plateaux concernant le rôle de la monnaie dans les appareils de capture. Car ce qui est en question, la souveraineté de la monnaie pour les uns, la définition de l’Etat pour les autres, se trouvent ici s’accorder sur un « refus de réifier l’Etat»[20].
Certes la souveraineté de la monnaie peut se confondre historiquement avec celle de l’État, selon la thèse d’une origine non marchande de la monnaie. Cette thèse qui fait de la monnaie une institution liée à l’impôt, Deleuze et Guattari la reprennent principalement de l’historien E. Will, et des commentaires qu’en fait M. Foucault au Collège de France dans ses Leçons sur la volonté de savoir[21]. Mais l’apport historique permet plus profondément de dissocier, pour les économistes, des formes de souveraineté -celle de l’État et celle de la monnaie-, et pour les philosophes, de diffracter l’État dans ses « appareils » : territorialité, travaux publics, finance, ou selon le vocabulaire Foucaldien plus tardif et moins marxiste, de saisir « l’étatisation » à l’œuvre dans les « technologies de pouvoir ». Les deux approches mettent l’accent sur le pouvoir selon un déplacement qui permet une continuité du micropolitique à l’institution centrale, du moléculaire au molaire. Une articulation qui coiffe un champ de conflictualités et de pluralité monétaire où l’unicité du compte et du moyen paiement peuvent se dissocier du monétaire stockable, et où les flux peuvent se différencier.
Pour les deux approches, cette dualité se révèle nettement dans l’évolution d’un capitalisme industriel à un capitalisme financier, et dans la recomposition qu’il inflige à l’État-providence. D’un côté, des dettes sociales, organisée par l’institution de l’impôt pour notre sécurité et bien être social ; de l’autre, les flux de capitaux, sous formes de dettes privées. L’État assure la convertibilité de l’un dans l’autre par l’unité de compte souveraine, le signe valorisé de l’État qui garantit l’unité de la société. Mais de ce double régime de dettes, les auteurs tirent des conclusions opposées.
Pour les économistes, la tension entre monnaies privées et monnaie centrale, ne peut être résorbée que par l’institution d’une souveraineté telle qu’elle soit identifiée, sinon dans l’État au sens administratif, du moins dans la Souveraineté de la monnaie comme institution garante de l’unité collective. À ce titre, cette monnaie est un bien commun, c’est elle qui opère la valorisation, à partir de quoi les dettes privées peuvent être évaluées et rendues commensurables. La souveraineté de la monnaie, peut être une souveraineté sans État, puisqu’elle ne se définit pas seulement structurellement par l’expression de la totalité sociale, mais aussi substantiellement, sa souveraineté tenant au fait que la monnaie est une « institution du sens »[22], elle porte en elle une orientation, une rationalité « en finalité » : la cohésion de la totalité sociale. Mais conformément au réalisme de la matrice mimétique, les monnaies privées peuvent aussi bien devenir hégémoniques, et tourner à leur profit le gain de ce prêteur en dernier ressort qui maîtrise le destin de la dette sociale[23].
Selon Deleuze et Guattari, en effet, cette distinction entre les monnaies se nomme différence entre monnaie de paiement, expression du « pouvoir d’achat impuissanté »[24] et monnaie capital, expression de commandement, ou de valorisation sur les productions du social ; c’est alors la Banque qui devient l’opérateur de conversion. La différenciation renvoie au fonctionnement du capital selon des puissances différentes, la monnaie marchande (monnaie capital, crédit, ou toutes formes de liquidité), ne se confond pas avec la monnaie de paiement, qui assure l’inscription de l’endettement individuel dans le compte de la société. Ici le crédit n’est pas associé bi-univoquement à une dette, délivrant un pouvoir d’achat ou de production. Le crédit s’autonomise et représente la forme la plus déterritorialisée de la monnaie. Un pouvoir que par définition la monnaie souveraine ne peut pas représenter, liée qu’elle est à la cohésion d’une communauté, fut-elle une communauté de marchands nomades.
C’est ce surcroît de puissance qui fait de la monnaie-crédit, la véritable « police » du capital dans la mesure où, elle représente la valorisation indéfinie de la valorisation elle-même, son autoréférentialité. Non pas son absence de bornes, la finitude d’une matière à valoriser, d’un existant, d’un produit déjà-là, mais l’exemption des limites de l’espace et du temps ou l’appropriation sociale de l’espace et du temps capital. Par cette fonction de police, la monnaie capital peut tourner l’État aux guises de sa reproduction.
Bibliographie
Abélès Marc, Penser au-delà de l’État, Belin, 2014.
Aglietta M., Orléan, A. La violence de la monnaie, [1982], PUF, -1984.
Aglietta M. Orléan A., La Monnaie souveraine, Odile Jacob, 1998.
Brunhoff, S. de L’Offre de monnaie, Paris, Maspero, 1971.
Cuillerai, M. « Simulacre et institution. Des Leçons sur la Volonté de savoir de M. Foucault à La Monnaie vivante de P. Klossowski. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00924845
Deleuze, G., Instincts et Institutions, Hachette, 1955.
Deleuze G., Guattari, F., L’Anti-Œdipe, Minuit, 1972.
Deleuze G., Guattari, F., Mille Plateaux, Ed de Minuit, 1982.
Foucault, M. Leçons sur la volonté de savoir. Cours au Collège de France, 1970-1971, Seuil, 2011.
Guattari F., « La valeur, la monnaie, le symbole. L’échange généralisé », in Verdiglione A., (ed.), La Jouissance et la Loi,, 10/18.
Lazzarato M. Gouverner par la dette, Les Prairies ordinaires, 2014.
Orléan, A. L’empire de la valeur, Seuil, 2011.
Will. E, Korinthiaka, de Bocard, Paris, 1955.
[1] Deleuze G., Guattari, F., L’Anti-Œdipe, Paris Minuit, 1972. « Un des apports de Keynes fut de réintroduire le désir dans le problème de la monnaie; c’est cela qu’il faut soumettre aux exigences de l’analyse marxiste » p. 272-73
[2] Guattari F., « La valeur, la monnaie, le symbole. L’échange généralisé », in Verdiglione A., (ed.), La Jouissance et la Loi, Paris, 10/18, p. 290.
[3] Orléan, A. L’empire de la valeur, Paris, Seuil, 2011. p. 154.
[4] Orléan, A. p. 73-74.
[5] Guattari F., op. cit, p. 291-292.
[6] L’Anti-Œdipe, p. 224.
[7] L’Empire de la valeur, op. Cit, p. 135.
[8] L’Empire de la valeur. op. cit, p. 155.
[9] Ibid., p. 161.
[10] L’Empire de la valeur., p. 155.
[11] Deleuze, G., Instincts et Institutions, Hachette, 1955. Cf. Cuillerai, M. « Coder-Décoder l’institution, Lévi-Strauss lu par Deleuze », in BilbaoA., Gras, S.-E., Vermeren P., (ed.), Claude Lévi-Strauss en el pensimiento contemporàneo, Colihue, SRL, 2009.
[12] L’ Anti-Oedipe, p. 224.
[13] Ibid., p. 224.
[14] Ibid., p. 225.
[15] Ibid., p. 227.
[16] S. de Brunhoff, La politique monétaire, Paris, Puf, 1974
[17] Aglietta M., Orléan, A. La violence de la monnaie, [1982], -1984, Paris, PUF, p. 128.
[18] Ibid, p. 135.
[19] Ibid, p. 131-133.
[20] Abélès Marc, Penser au-delà de l’Etat, Belin, 2014, p. 33
[21] Deleuze, G. Guattari, F., Mille Plateaux, Ed de Minuit, 1982, pp. 535-542. Will. E, Korinthiaka, de Bocard, Paris, 1955. Foucault, M. Leçons sur la volonté de savoir. Cours au Collège de France, 1970-1971, Gallimard-Seuil, 2011. Cuillerai, M. « Simulacre et institution. Des Leçons sur la Volonté de savoir de M. Foucault à La Monnaie vivante de P. Klossowski. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00924845 et Cuillerai M. Kakogianni M., « Bancocratie », in Symptôma Grec, Lignes, Paris, 2014.
[22] Descombes, V. Les Institutions du sens, Paris, Ed. de Minuit 1996, et Douglas, M. Comment pensent les institutions ?, réedition, La Découverte.
[23] Les économistes l’assument pleinement pour qui le pouvoir de la souveraineté monétaire est contenu dans d’étroites limites. « IL lui est difficile, voire impossible de ne pas valider la création monétaire privée », Aglietta M. Orléan A., La Monnaie souveraine, Odile Jacob, 1998.
[24] L’Anti-Œdipe, p. 284.