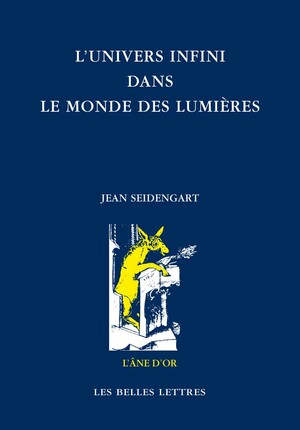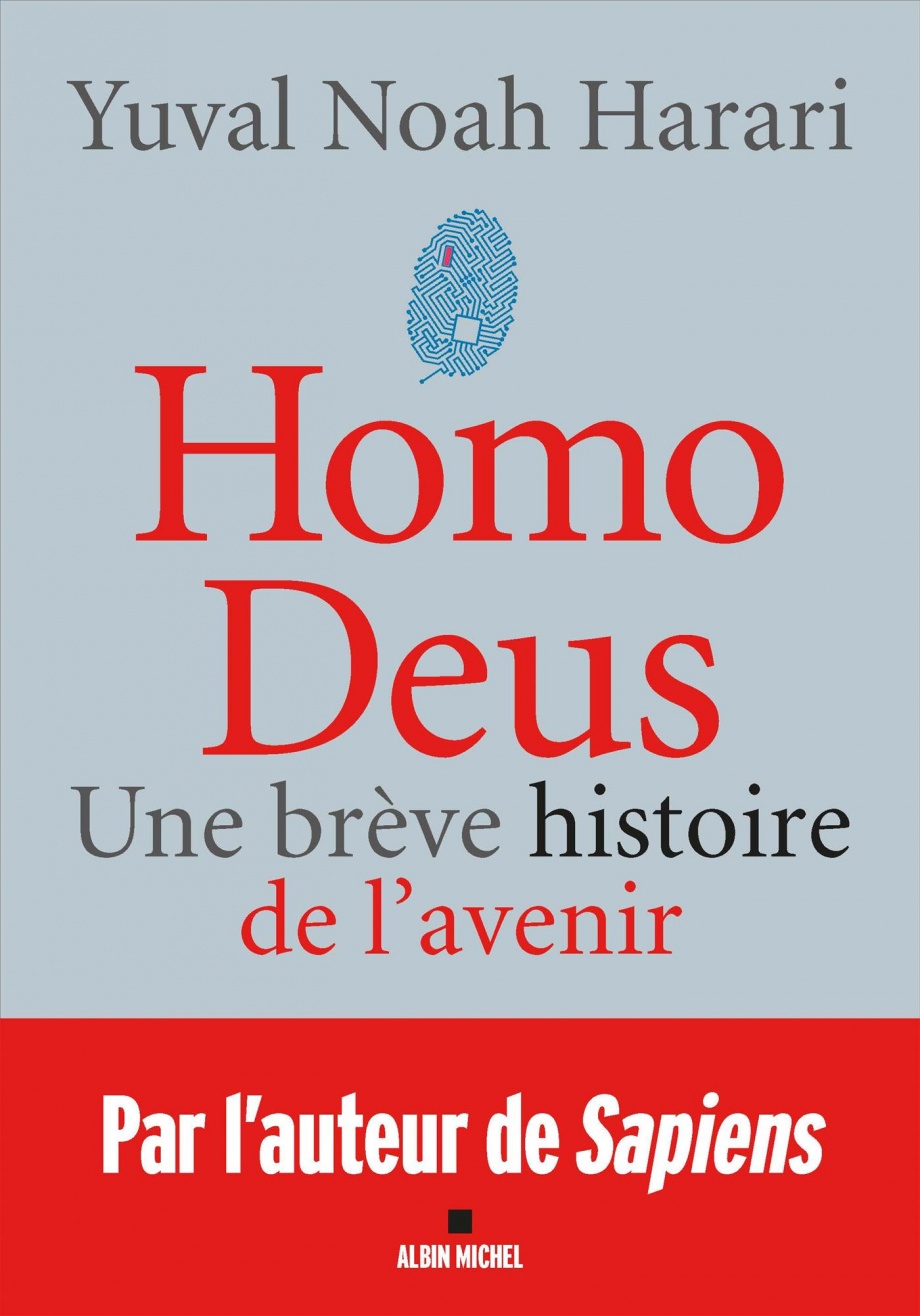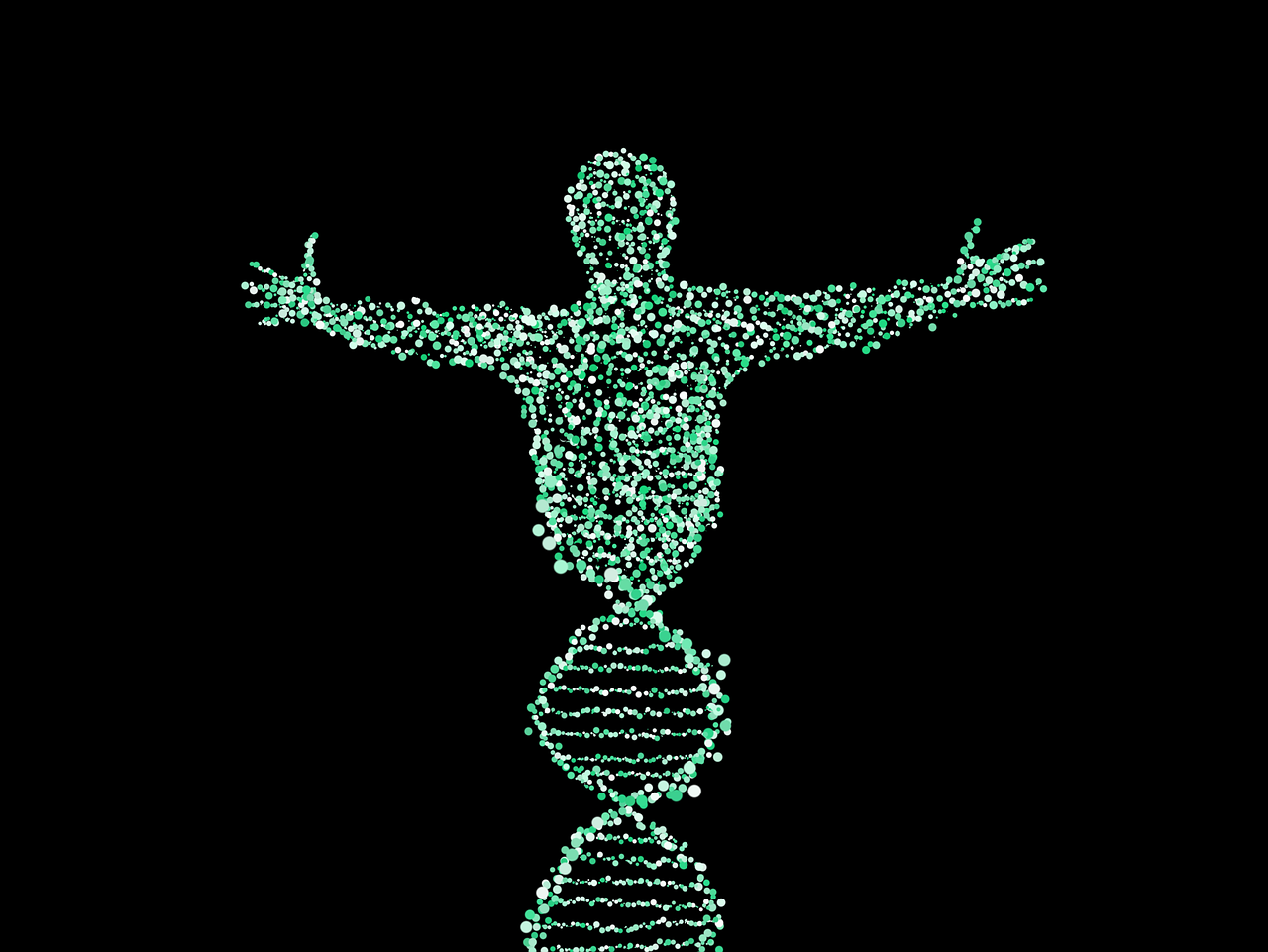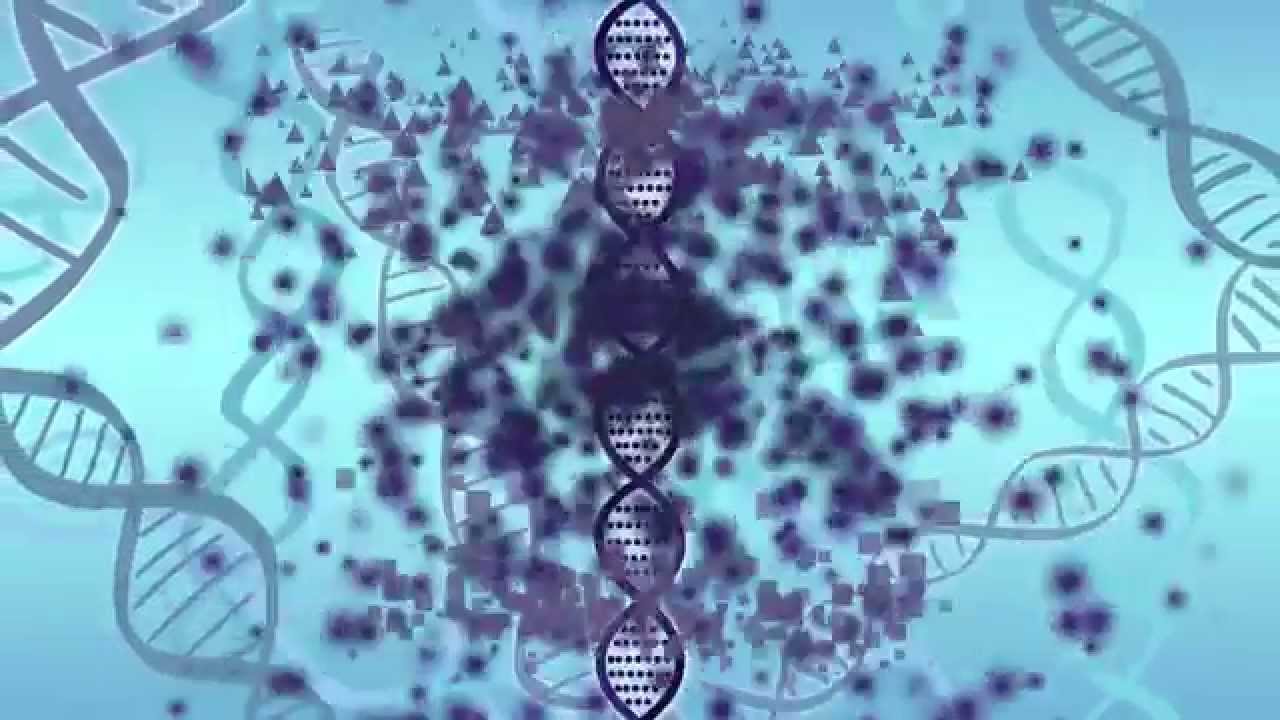Phénoménologie de la vie et enseignement de l’histoire.
De l’apport de la phénoménologie radicale de la vie à une nouvelle philosophie de l’enseignement de l’histoire
Olivier Terwagne
« Quand on aime la vie, on aime le passé, parce que c’est le présent tel qu’il a survécu dans la mémoire humaine. »
Marguerite Yourcenar
« Sous l’histoire, la mémoire et l’oubli
Sous la mémoire et l’oubli, la vie.
Mais écrire la vie est une autre histoire. »
Paul Ricœur
Introduction
Nous allons tenter ici d’esquisser ce qui pourrait constituer une contribution de Michel Henry à une philosophie de l’enseignement de l’histoire. Si Jean-Michel Longneaux s’est attaché en son temps à dégager les implications de la phénoménologie radicale de la vie dans la pratique enseignante[1], nous allons de notre côté nous concentrer sur l’apport de Michel Henry à une nouvelle approche de l’enseignement de l’histoire. À notre sens, cette étude n’a encore jamais été réalisée. Cette médiation par sa phénoménologie pourrait nous aider à décrire autrement (au sens que Richard Rorty donne au terme de description) ce qui est l’enjeu de cet enseignement à propos duquel les intellectuels français, mais également belges, ne cessent de polémiquer. Certains, en effet, déplorent la perte du grand récit national, et sont accusés de véhiculer une vision « réactionnaire » de l’histoire au détriment des histoires plurielles, des récits des vaincus, conception qui peut elle-même être dénoncée comme instrumentalisation de l’histoire par des « politiques de reconnaissance », de « concurrence victimaire », de « guerres des mémoires » et des communautarismes divers. Par ailleurs, un autre débat a lieu sur le terrain de l’épistémologie entre les défenseurs d’une pédagogie de la transmission et les adeptes d’une vision socioconstructiviste de la pédagogie en histoire. C’est ce que nous appellerons le débat entre « pôle humaniste » et « pôle cognitiviste ».
Le cœur de la phénoménologie radicale consiste à dire que tout acte de vie, toute médiation, toute représentation, tout rôle, sont affectés d’une intrigue originaire, l’énigme de l’adhésion de la vie à elle-même dans son épreuve à la fois pathique et joyeuse[2]. L’enseignement n’y échappe pas. Comme le souligne Raphaël Gély, « l’enseignant n’a pas seulement pour tâche de transmettre un savoir. Il lui incombe plus fondamentalement encore de générer en lui et en ses étudiants l’épreuve d’une certaine forme de vie liée à la transmission du savoir et à son accroissement »[3]. L’apport de Michel Henry à cette contribution permet de lever certaines oppositions idéologiques entre plusieurs écoles d’enseignement de l’histoire et de répondre à une urgence de notre temps : ce que François Hartog nomme dans son dernier livre le « présentisme »[4]. Selon lui, dans une société soumise à l’accélération de l’histoire, qui, tout à la fois, refuse ou criminalise son passé et ne veut pas connaître son futur, il ne reste que la jouissance du présent. Comment dès lors faire sens dans l’acte même d’enseigner l’histoire à une génération qui, structurée par l’esprit du temps, est portée à craindre le futur et à ignorer le passé ?
Notre étude se divisera en trois parties. Dans un premier temps, nous établirons un diagnostic sur la philosophie de la culture et sur les apprentissages tels qu’ils sont pensés aujourd’hui dans le monde de l’enseignement[5]. Nous montrerons que deux grands courants tendent à occuper le devant de la scène des débats en ce qui concerne le fondement épistémologique des programmes : le pôle cognitiviste, aujourd’hui dominant et à la source de la « pédagogie par compétences », et le pôle herméneutico-humaniste[6]. À ce débat épistémologique en sciences de l’éducation vient se greffer un débat opposant une vulgate bourdieusienne et relativiste à une vulgate humaniste et universaliste. Nous montrerons en quoi ces deux pôles aboutissent à une impasse dans leur conception de la philosophie de la culture, en raison de leur “idéologisation” et de leurs présupposés concernant l’apprentissage. Dans un deuxième temps, nous mettrons en évidence l’apport critique de Michel Henry à un tel débat en rappelant les thèses phénoménologiques fondamentales de sa Trilogie à partir du concept d’Archi-Soi. Forts de l’approche henryenne, nous renverrons dos-à-dos ces deux pôles qui naturalisent la vie et présupposent que les individus en apprentissage ont toujours déjà adhéré à la vie. Par cette naturalisation de la vie, ces philosophies de la culture la dépouillent de l’intrigue originaire, de l’énigme qui habite son adhésion à elle-même. Henry quant à lui définit autrement la culture et l’apprentissage. Après ce geste négatif, nous terminerons, dans un troisième temps, par un geste positif : nous mesurerons la fécondité des thèses henryennes pour une philosophie de l’éducation, et en particulier pour une nouvelle manière d’enseigner l’histoire. Nous dégagerons ainsi quelques applications concrètes de la philosophie de l’histoire henryenne pour l’enseignement de l’histoire, mais aussi pour le métier d’historien.
Partie I : Opposition pôle humaniste/pôle cognitiviste
L’enseignement des sciences humaines dans les discours sociaux ou dans les débats à son propos est traversé par une opposition récurrente entre ce que nous nommerons un “pôle cognitiviste” et un “pôle humaniste”. Les programmes actuels incorporent les thèses cognitivistes et fondent le savoir des experts de l’enseignement en la personne des conseillers pédagogiques et autres formateurs. Mais l’expérience vécue de beaucoup d’enseignants est encore aujourd’hui celle de la transmission, d’où l’opposition qui surgit dès qu’il est question de la méthode à adopter et du contenu à transmettre quand il s’agit d’enseigner de l’histoire.
Dans les sciences de l’éducation, le courant dominant est en effet actuellement celui du socioconstructivisme et du cognitivisme. Dans les pays membres de l’OCDE, l’approche cognitiviste est incorporée dans les programmes afin de satisfaire aux exigences d’une « pédagogie par compétences », afin de tendre, non plus simplement à l’égalité des chances, mais à l’égalité des résultats. Les tests « PISA » évaluent désormais l’efficacité et l’équité des enseignements dans les pays membres de l’OCDE. Dans le cadre du cognitivisme, l’apprentissage est vu comme une construction du savoir : construire signifie être actif dans l’acquisition de la connaissance. L’élève n’est pas un être passif qui “se remplit” de connaissances, mais il travaille au contraire de façon dynamique lors du traitement de l’information. Il est également actif dans la résolution de « tâches problèmes » ou de « situations d’intégration » au cours desquelles il mobilise de façon adéquate le savoir et le savoir-faire qu’il s’est construit[7]. L’approche conceptuelle est centrale dans la pédagogie des compétences cognitives[8].
Négativement, trois grands types de reproches sont adressés à la « pédagogie de la transmission » : le premier est de léguer des savoirs morts que les élèves assimilent uniquement pour les restituer à l’examen ; le deuxième est de considérer l’apprentissage comme un contenu déjà découpé par l’enseignant et donc tributaire de sa « métaphysique » et de sa « liberté pédagogique », le troisième est de ne pas créer des situations concrètes d’apprentissage permettant une construction de savoirs en réponse à un intérêt direct des élèves, utiles à la vie quotidienne. De façon plus générale, la pédagogie de la transmission est suspectée de reproduire les inégalités de répartition du capital culturel. C’est l’argument central des « pédagogues », alimenté par une certaine vulgate bourdieusienne, qui influence la sociologie officielle et l’interprétation des statistiques[9].
Le pôle des pédagogues et le pôle des humanistes aboutissent tous les deux à une polarisation idéologique qui mutile la raison. Comme le note Jean de Munck, l’idéologie est un « discours impuissant à ouvrir l’espace des apprentissages », ou encore un « processus de raréfaction du sens », c’est-à-dire qu’il s’agit d’un discours qui ne parvient pas à dégager des réponses satisfaisantes à des problèmes théoriques et pratiques, parce qu’il mutile les potentialités de la raison. Il répète des solutions toutes faites à des problèmes nouveaux et concentre tout son savoir substantiel dans des référentiels cognitifs hypostasiés. Dès lors, des zones entières de savoirs, en particulier les intuitions perceptives du vécu des autres acteurs et les formalisations discursives qui pourraient en être données, sont refoulées aux marges du non acceptable, du non argumentable, du non pertinent[10]. Les deux camps en présence se stigmatisent l’un l’autre : le pôle cognitiviste est accusé de participer à la décadence de la culture, à la soumission à la société de consommation en raison du rapport utilitariste au savoir qu’il défend ; le second pôle est renvoyé dans le cortège des pleureuses réactionnaires, nostalgiques d’un âge d’or républicain qui n’aurait jamais existé et d’une aristocratie désuète de la culture.
Pour sortir de cette impasse, nous allons tenter à présent de redécrire les enjeux de ce débat et de proposer une refondation de la philosophie de la culture et de l’apprentissage à partir de thèses de Michel Henry. En effet, les deux conceptions opposées présupposent également que les élèves se mettent en apprentissage : pour les tenants de la première, du fait de leur dynamique interne de construction du savoir, pour leurs adversaires, du fait du savoir substantiel de la tradition. Les antinomies corrélées à ces débats, entre socialisation et humanisation, savoir vivant et savoir mort, vie active et vie théorique, hétéronomie et autonomie, culture populaire et culture bourgeoise, autorité et égalité, etc., doivent être dépassées, car elles saturent le débat et produisent des contradictions insolubles[11]. Nous tenons de plus qu’elles occultent un niveau que la phénoménologie peut mettre en évidence et à partir duquel il serait possible de refonder les apports du pôle cognitiviste et du pôle humaniste en les articulant entre eux. Michel Henry propose à cet effet une phénoménologie radicale de la vie, dont certains auteurs contemporains dégagent des implications anthropologiques[12], voire politiques[13]. Nous privilégierons ici l’œuvre du dernier Henry, celui qui élabore le concept d’Archi-Soi dont Benoît Kanabus a récemment élaboré la généalogie.
Partie II : Phénoménologie henryenne, geste négatif et positif
Relativement à notre propos, le premier apport d’Henry est son geste négatif. Il permet de renvoyer les deux pôles dos-à-dos dans ce qu’ils ont de commun : ils naturalisent la vie. Ils font comme si l’adhésion à la vie allait spontanément de soi et la dépouillent de toute l’intrigue interne qui se joue dans son adhésion et dans sa réadhésion à elle-même. Le pôle cognitiviste présuppose que les individus ont toujours déjà adhéré à la vie, qu’ils veulent construire leur savoir, se socialiser dans un monde changeant, être flexibles et mettre en place des stratégies “rationnelles” pour s’adapter à ce monde, y consommer et y accroître leur épreuve de la vie. Pour cela, ils ont besoin d’outils utiles à la vie. De même, le pôle humaniste considère que la vie est trop immédiatement attachée aux individus et qu’il est nécessaire pour ces derniers d’opérer un détour par les médiations de la culture pour accéder à eux-mêmes et se détacher de cette vie qui les rive trop à leurs besoins. La vie étant trop attachée à elle-même, elle doit s’extérioriser pour se réapproprier ensuite.
C’est précisément selon cette conception qu’il faut replacer les critiques henryennes de la « barbarie » qui opère à l’Université. On pourrait projeter les critiques contenues dans La Barbarie dans le débat opposant pôle cognitiviste et pôle humaniste sur le terrain de l’enseignement secondaire. Il y opère une critique d’inspiration nietzschéenne et heideggerienne d’une Université soumise à un réseau “des faibles” et au Gestell de la culture par une métaphysique de la technique qui prolifère dans le zapping, les NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication) et les productions de masse. Il constate la barbarie dans une société fondée sur l’oubli des lois de la vie et rabattue sur les lois de la société technique. Greffé à ce geste négatif, le geste positif d’Henry propose une articulation entre le plan de la phénoménologie radicale et le plan herméneutique.
Henry fait apparaître l’enjeu d’une philosophie de la culture sous un autre jour : ce qui se joue dans la culture, c’est l’épreuve dramatique ou l’énigme de l’adhésion de la vie à elle-même. Au lieu de présupposer que les individus adhèrent à la vie de façon telle que la culture dissymétrique ou l’autorité seraient une entrave à leur immédiateté – comme le soutiendrait le courant « relativiste – égalitariste » − ou, au contraire, les détacheraient de ce conatus d’intensification de la vie qui les rive trop à leurs besoins immédiats – comme le concevrait le pôle humaniste –, Michel Henry pense la culture comme un lieu où l’épreuve de la vie, dans son pâtir originaire, trouve un lieu d’accroissement. La culture n’est rien d’autre que « l’autotransformation de la vie », le « mouvement par lequel elle ne cesse de se modifier elle-même afin de parvenir à des formes de réalisation et d’accomplissement plus hautes afin de s’accroître »[14]. La culture est un medium par lequel l’adhésion et la réadhésion à l’épreuve de la vie sont possibles. Si on présuppose l’adhésion à la vie dans une philosophie de la culture, on ne peut comprendre comment celle-ci peut se retrouver en elle-même.
C’est à partir de sa phénoménologie qu’il faut comprendre le geste négatif d’Henry que nous avons esquissé plus haut. Il voit la « barbarie » dans la restauration de certaines œuvres, dans la dévastation des paysages par des pylônes, dans la production de masse. Outre une nouvelle philosophie de la culture, Henry met en évidence l’épreuve de la vie qui se joue dans l’apprentissage : l’apprentissage se fonde sur une réflexivité inférentielle à partir du savoir auto-affectif de la vie elle-même. Henry ne présuppose pas d’être rationnel sortant de sa minorité pour se mettre en apprentissage, à l’instar du grand récit des Lumières qui guide notre éducation moderne.
Selon Henry, l’enseignement a une double vocation : celle de socialiser et d’humaniser, c’est-à-dire de donner un métier, mais aussi les conditions de possibilité de déployer ses dons et ses capacités de façon à réaliser son individualité propre, soit l’humanité en nous[15]. La transmission c’est la répétition dans la contemporanéité qui produit au niveau théorique des évidences apodictiques[16] et, au niveau pratique, des certitudes pathiques, celles du pathos dans lequel l’acte d’évidence vient s’ancrer[17]. Cette définition se décline également dans une sémantique temporelle. Au niveau temporel, Henry définit la contemporanéité comme étant toute répétition théorique ou affective en laquelle consiste toute transmission et toute acquisition possibles d’un savoir quel qu’il soit, corporel[18], sensible, cognitif, axiologique ou affectif. En ce sens, celui qui entre en relation avec une vérité, que ce soit le professeur qui incorpore le savoir et le transmet ou l’élève qui le reçoit, devient le contemporain de la vérité. Henry distingue la temporalité de l’ekstase s’il s’agit de vérité théorique, de la temporalité inextatique s’il s’agit du pathos[19]. Pour que la transmission puisse s’ancrer dans l’apprentissage inféré du savoir auto-affectif de la vie, il est dès lors nécessaire que l’enseignant fasse droit à cette affectivité originaire[20].
Partie III : L’apport de michel henry à l’enseignement de l’histoire
Continuons dès lors dans le geste positif de Michel Henry : après avoir redéfini la culture et l’apprentissage, comment repense-t-il l’éducation et, plus précisément l’éducation par l’histoire ? Si « la vie est tributaire de l’éducation »[21], nous allons montrer que les définitions de l’éducation et de l’histoire par Henry peuvent être fécondes s’agissant de l’enseignement.
L’enseignement de l’histoire a pour destinataires des sujets dont l’objet d’étude est eux-mêmes, en tant qu’ils ne se connaissent pas encore. Telle est la description humaniste ou herméneutique : l’élève est toujours déjà interprété et capable d’accéder à lui-même par la médiation des œuvres. Henry, plutôt que d’annuler ce plan phénoménologique, le refonde. Il ne parle pas de sujet mais d’Archi-Soi. Selon lui, se sentir sujet, c’est se sentir radicalement habité par la puissance de la vie en soi et c’est recevoir ce pouvoir d’être soi par la force même de l’auto-affection de la vie qui se joint en elle-même dans son ipséité. Ce rapport entre Vie absolue et soi vivant n’est pas un rapport de causalité qui prendrait place dans un cadre spatio-temporel : il est celui d’une « conativité » qui renvoie à l’historialité de la vie, laquelle précède le temps et l’histoire. Puisque la Vie absolue est intrinsèquement habitée d’un appel à la partageabilité, l’Archi Soi est également ce qui conditionne mon rapport à l’autre : il est en effet ce pouvoir d’être un Soi qui s’effectue en moi comme dans l’autre, afin que s’accroisse l’expérience de la vie. Si le soi vivant est radicalement singulier, ce n’est qu’en éprouvant la vie comme étant partagée avec d’autres qu’il peut faire l’épreuve d’une vie qui s’accroît. Par ailleurs, l’Archi-soi inscrit dans notre subjectivité une réflexivité inférentielle sur la donation originaire de la vie et sur son pouvoir d’être un soi dans chaque vivant. Immergés dans le savoir auto-affectif de la vie, les acteurs sont en capacité de produire un acte inférentiel sur la force originairement singularisante qui les constitue comme vivants. L’individu ne pouvant échapper à cette épreuve radicale de la vie, par laquelle il fait à la fois l’épreuve de sa singularité radicale et en même temps de la partageabilité de cette vie − dont il n’est pas la cause − avec les autres, il n’a « plus d’autre voie possible pour se saisir que d’explorer son unité première avec l’auto-affection de la vie et tenter de concevoir réellement cette épreuve comme l’unité essentielle de son existence, comme don de la Vie »[22].
Dès lors, toute mise en apprentissage part de ce savoir auto-affectif de la vie qui se donne en nous dans son pâtir et dans sa joie, et à partir duquel les acteurs produisent un acte réflexif inférentiel, et non pas purement référentiel. C’est ainsi qu’on peut réinterpréter les habitus fondamentaux déterminés par notre vie transcendantale : cette détermination est donnée à elle-même dans la vie. Quand la vie est blessée, quand il y a une « maladie de la vie », les individus doivent se remettre en apprentissage pour y adhérer de nouveau et réinvestir leurs apprentissages de l’épreuve de cette vie qui, par ailleurs, ne cesse d’adhérer à elle-même. Engagé dans la même destinée, chaque soi vivant forme une communauté dans la partageabilité de la vie.
Chez Henry, l’historialité est définie par la vie, qui précède précisément le temps et l’histoire. La temporalité de la philosophie de l’histoire henryenne est la temporalité immanente de la vie, de sorte qu’une communauté des morts vient se nouer à la communauté des vivants dans l’épreuve de la vie. Une relation réelle peut s’établir entre des Soi transcendantaux qui ne se sont jamais vus et appartiennent à des époques différentes[23]. De même, une relation vivante peut être étroitement entretenue avec un auteur mort. Comme le note Benoît Kanabus, « nous sommes alors unis dans une contemporanéité, dans un « Présent vivant » qui n’est aucunement limité par le présent historique »[24]. Se reconnaître dans un rapport d’auto-engendrement avec la Vie, c’est être le fils d’un présent vivant de la vie s’auto-affectant, où tout rapport mondain ou intersubjectif est reçu dans la médiation de l’Archi Soi qui s’affecte en nous. Par ailleurs, à la différence du modèle intentionnel d’une communauté fondée sur la réciprocité, dans lequel chacun a besoin des autres pour s’auto-réaliser au sein de relations intersubjectives, le modèle de la « communauté originaire » pense un niveau auquel se joue l’ipséité d’un même « pouvoir éprouver » et « pouvoir éprouvé » de la vie. L’énigme même de ce soi vivant radicalement singulier que je suis ne peut prendre possession de la vie qu’en s’éprouvant comme partageant cette vie avec les autres, comme partageant l’énigme d’un même pâtir originaire.
Qu’en est-il des savoirs à transmettre ? Chez Henry, on peut, selon Longneaux, en repérer trois domaines : l’art, l’éthique et la religion. Nous tenons qu’il est possible d’aller plus loin : Henry trace un sentier pour refonder un cours d’histoire scandant les modélisations de la vie ou les péripéties dramatiques de la vie productrice de biens matériels et spirituels, en les articulant à l’historialité des « soi vivants » d’individus qui éprouveraient dans ce lieu leur appartenance à une communauté contemporaine de soi vivants et de «morts ». Au sein de cette communauté des vivants et des morts dans l’autogénération de la vie, la culture et l’histoire sont dévoilées sous un jour nouveau et la manière pour les élèves de se les réapproprier devient celui d’une épreuve de la vie.
Comment comprendre Henry quand il affirme qu’« il n’y a ni Histoire, ni Société mais seulement des individus vivants dont le destin est celui de l’Absolu, lequel n’advient jamais, en tant que subjectivité absolue, qu’à travers la multiplicité indéfinie des monades dont il constitue l’unique fondement » ? Si, au niveau de la représentation, on parle d’époques historiques, c’est parce qu’en chaque monade la vie n’est pas seulement conservation mais accroissement. La culture naît quand l’homme subvient à ses besoins[25]. Mais, précisément, l’histoire naît des péripéties de cet accroissement. Le fondement de l’histoire n’est donc ni le concept, ni l’économie, ni les faits bruts de l’histoire événementielle, mais l’individu vivant, en tant que vivant, « portant en lui l’essence souffrante et agissante de la vie » et produisant constamment une société qui n’est que sa propre vie[26].
Nous relevons chez Henry une quadruple définition de l’histoire :
(1) D’abord, l’histoire raconte les péripéties des individus vivants dans leur réitération infinie du désir et du besoin dont la poussée, au sein même du corps, suscite le travail et la production de biens de subsistance[27], qu’ils soient matériels ou spirituels. Pour Henry, le fameux « matérialisme historique » de Marx n’est rien d’autre que cela et aucunement un « grand récit » d’infrastructures et de superstructures[28]. Henry énonce encore cette conception de manière plus tragique, affirmant que l’histoire n’est rien d’autre que « les façons diversifiées et successives dont au cours des siècles les hommes ont tenté de répondre aux questions pathétiques sous lesquelles la vie n’a cessé de les écraser »[29]. Nous retrouvons la description phénoménologique de la vie en tant que joie et, en même temps, pâtir, comme ivresse ontologique en même temps que souffrance.
(2) L’histoire économique constitue une heuristique pertinente pour reconstituer les péripéties dramatiques de l’individu dans la réitération de son épreuve de la vie. Dans l’histoire de l’économie, il y a deux cas de figure pour la vie et il appartient à l’historien d’en « consigner les péripéties dramatiques » : soit celle-ci se trouve dans l’impossibilité de produire l’absolument nécessaire à la satisfaction de ses besoins – ce que recouvre le concept de « crise » –, soit elle « desserre l’étau de la nécessité », car la production croît tant et si bien qu’elle produit un écart entre « ce dont la vie a besoin » et « ce qu’elle est capable de produire. C’est dans cet écart que se déploie la culture »[30]. Cette possibilité de l’écart est encore la possibilité de la vie. L’histoire est donc aussi la constitution de la culture qui se forme par la réplique ou la répétition que font les hommes d’existences-ayant-été et de leurs expériences les plus hautes[31].
(3) La troisième définition d’histoire introduit le concept d’Archi-fait. L’histoire du monde n’est pas « une histoire événementielle » mais une histoire principielle. Elle ne repose pas sur des « faits ordinaires » ou accidentels, que l’on peut reconstruire a posteriori avec les concepts kantiens de l’espace et du temps, mais sur des « faits originaires » nommés « Archi-faits », situés dans un cadre supra temporel, toujours présents et toujours agissants au cœur de l’histoire et la déterminant a priori. L’histoire n’avance pas au hasard. Elle obéit à une « tendance » toujours présente qui traduit en elle une action animée d’un même principe : c’est la « téléologie de la vie ». De fait, l’Archi-fait fondamental est la vie, « historique parce qu’avec chaque individu, elle semble naître et mourir dans l’histoire » et métahistorique, car c’est en elle que la réitération indéfinie du besoin et du travail fait à chaque instant de cette histoire ce qu’elle est, une histoire de la production et de la consommation[32].
Cette histoire principielle se présente “derrière” l’histoire événementielle et même derrière toute philosophie de l’histoire. Dans l’histoire occidentale, quatre archi-faits peuvent être repérés. Cependant, cela n’est pas réductible à une simple histoire chronologique : il s’agit d’une histoire transcendantale qui pourrait survenir n’importe où. D’abord, on repère l’Archi-fait du travail commun dans lequel les moyens de production sont collectifs. Ensuite, celui de l’accaparement du travail social dans la division du travail et la privatisation des moyens de production (on pense au Moyen Âge féodal). Vient ensuite l’Archi-fait galiléen de la mathématisation du réel et, enfin, l’Archi-fait du machinisme qui correspond à une aliénation de l’individu qui ne fait plus l’épreuve de la vie dans son travail[33].
(4) L’histoire de la vie est aussi l’histoire de notre chair. La chair n’oublie rien. C’est ce niveau de la chair qui définit la passivité[34]. On peut relier cette définition de l’histoire aux deux premières. Dans La Barbarie, Henry va un peu plus loin dans sa définition de l’histoire en affirmant qu’elle est l’histoire des individus non pas à partir d’un terminus post quem précis, mais à partir de leur naissance transcendantale. C’est à partir de ce point initial de la Parousie que la vie se déploie, se développe dans son pâtir, dans son jouir et dans son accroissement. Le corps, prenant appui sur le pathos immobile de sa corporéité originelle, s’éveille, et les puissances de l’âme sont les lieux du développement. Le développement de la vie est donc double : il est d’une part auto-activation du pathos en laquelle notre être s’édifie intérieurement et, d’autre part, culture[35].
Le niveau de la phénoménologie radicale n’exclut pas la pertinence de l’histoire événementielle, de l’histoire économique ou de l’histoire de la pensée. Simplement, elle la refonde[36]. Il ne s’agit donc pas d’insérer dans les nombreux débats d’écoles entre historiens l’école de « l’histoire de la vie ». Cependant, comment comprendre, dès lors, l’attaque contre l’histoire sociologisante ? Pour Henry, un concept est une « objectivité idéale, étrangère comme telle à la réalité et notamment à celle de la vie ». Il reconnaît bien sûr, sous peine de contradiction performative, l’usage nécessaire du concept dans le cas de toute théorie. Mais, dans le marxisme comme dans les sciences humaines inspirées par une vulgate marxiste, Henry se méfie de la tendance à réduire métaphysiquement la société au concept. Ce diagnostic paraît encore d’actualité : la façon d’envisager l’enseignement de l’histoire corrélée à cette conception est aujourd’hui incorporée dans les programmes, dans les formations des professeurs et dans les évaluations des examens. Or, selon Michel Henry,
L’histoire sociologisante n’est plus celle des individus vivants mais des structures transcendantes sous le poids desquelles ils succombent. La possibilité pour l’historien d’acquérir une vue plus profonde et plus claire de l’humanitas de l’homme, et cela dans la répétition, en se faisant la réplique d’existences-ayant-été et de leurs expériences les plus hautes, cette possibilité-là, qui faisait de l’histoire une forme de culture, n’existe plus[37].
De même qu’il conteste une lecture de l’histoire de la philosophie comme une simple histoire des idées, Henry conteste l’histoire sociologisante qui nie les péripéties des individus vivants dans l’épreuve de la Vie qui se donne en eux.
Henry dévoile donc l’histoire sous un autre angle : celui de la vie. Il invite à un nouveau récit, une nouvelle ligne du temps scandée par les modélisations de la vie. Chaque Archi-fait cause une rupture ontologique. Par ailleurs, à l’intérieur d’une histoire scandée par les Archi-faits, on peut redécrire des moments de la micro-histoire. Prenons pour exemple la narration historique du lien entre agriculture et culture. Selon Henry, quand l’histoire du climat fait la balance des bons et des mauvais hivers, compare des courbes démographiques, des rendements à l’hectare, elle mesure à travers ces données dites objectives les conditions de la conservation ou de l’accroissement de la vie, ou celles de la mort. Bref, elle décrit toujours, sans en avoir conscience, sous le masque des appareils conceptuels ou statistiques, une histoire de la praxis et de son angoisse. C’est l’essence de la vie[38]. De même, les champs cultivés sur un sol aride par un labeur dur et muet pour survivre et pour donner une beauté à taille humaine à une nature plus majestueuse, ainsi que les premiers temples, églises ou couvents, ne disent rien d’autre que cette « nécessité de vivre » donnée dans chaque soi vivant.
Donnons pour terminer un cas d’application concret de la méthode phénoménologique d’Henry pour la science historique. L’épistémologie marxisante, déconstructionniste ou réductionniste, d’une certaine science historique manquent dans leur pertinence respective une partie de la compréhension d’une réalité anthropologique comme celle du paysan-soldat-citoyen sous la Haute République à Rome et des valeurs substantielles qui seront sédimentées dans le mos maiorum. Certains historiens assimilent la culture du paysan-soldat-citoyen à un mythe, à une superstructure légitimant le pouvoir de ceux qui se posent en héritiers de cette mythologie, tels que Caton l’Ancien au IIe siècle av. Or, en décrivant les conditions de vie des paysans, la généalogie des valeurs de temperantia, de fides ou de pietas se comprend aisément car ces valeurs sont directement produites par les effectuations subjectives de la vie via le corps du paysan. Elles permettent d’adhérer à la réitération du geste de production. Elles n’en sont pas la simple superstructure, elles permettent d’adhérer à l’épreuve radicale de la vie qui se joue dans la culture de la terre, la politique et la guerre, dont le lien est articulé par un même terme « census »[39].
Michel Henry applique lui-même cette épistémologie à la vie du paysan français. Il renverse l’épistémologie de l’histoire sociologisante qui va jusqu’à affirmer que l’appartenance à une classe détermine les actions subjectives de l’individu vivant. Pour Henry, c’est le contraire : c’est l’épreuve de la vie radicale du paysan qui « laboure et sème, affronte les rigueurs des saisons, vit avec sa famille replié sur un lopin de terre » qui détermine ses valeurs et sa classe, concept représentationnel qui ne sera par ailleurs élaboré que beaucoup plus tard[40]. Henry nous met donc en garde contre tout anachronisme en proposant de lire le déploiement de l’économie en lien avec la culture. Il nous met aussi en garde contre toute utilisation frauduleuse des concepts. Comme le note Raphaël Gély, « c’est à l’idée de l’individu qu’on peut chercher à assigner une date de naissance dans l’histoire, en aucune façon aux individus eux-mêmes dont le matérialisme historique a montré que l’histoire commence avec eux »[41]. Il faut donc distinguer la représentation que les individus peuvent se faire de leur individualité et l’individualité pratique et affective de leur vie même.
L’heuristique henryenne ne réduit pas l’histoire au concept et fait droit, pour le dire dans les termes de Ricœur, à une « mise en intrigue » des individus vivants dans leur production de biens matériels et de biens spirituels. Grâce à elle, il est possible d’éviter des lectures “conceptualisantes” qui ont tendance à réécrire l’histoire comme un long processus téléologique, scandé par des « crises » et des « croissances » et conduisant au monde heureux du libéralisme[42]. Cependant, encore une fois, il ne s’agit pas de nier, dans toute reconstitution, la réalité socio-économique et les jeux de pouvoir au sens de Foucault, ni de réduire l’histoire à une « mise en intrigue » des individus vivants faisant l’épreuve de la vie en eux. Le propos ici consiste bien plutôt en un enrichissement du vocabulaire dans l’enseignement de l’histoire, comme dirait Rorty, et qui serait fécond pour repenser l’histoire et la transmission de l’histoire comme un lieu où la vie s’éprouve et non une simple narration qui surplombe les individus en apprentissage.
Conclusion
Nous avons tenté de montrer l’apport critique et positif des thèses de Michel Henry pour repenser la philosophie de la culture et l’apprentissage de l’histoire en dehors des impasses du débat entre un pôle cognitiviste et sa « vulgate bourdieusienne » et relativiste, d’une part et, d’autre part, un pôle humaniste basé sur la transmission des « classiques ». Le geste négatif d’Henry nous a permis de renvoyer dos-à-dos ses deux pôles, en ce qu’ils présupposent tous les deux une adhésion à la vie dans l’apprentissage, à partir de sa naturalisation. Chez Michel Henry, l’apprentissage se construit d’abord au niveau radical de la réflexivité inférentielle des élèves à partir du savoir auto-affectif de la vie. C’est en faisant droit à ce niveau qu’un dispositif d’apprentissage cognitiviste et herméneutique peut être repensé. Dès lors une nouvelle philosophie de la culture devient possible. Loin d’être une superstructure, une entrave au conatus ou une médiation qui permet à l’individu de se détacher d’une vie trop immédiate, la culture est un lieu où s’éprouve l’énigme de l’adhésion à la vie, elle est l’autotransformation de la vie, le mouvement par lequel elle ne cesse de se modifier elle-même afin de parvenir à des formes de réalisation et d’accomplissement. L’éducation qui la transmet est la répétition dans la contemporanéité d’évidences apodictiques et de certitudes pathiques. De ce fait, le savoir se fait présent au soi vivant en tant qu’il est transmis par un enseignant qui, en incorporant un certain rôle, comme le dirait Raphäel Gély, et une certaine façon d’habiter celui-ci, fait l’épreuve d’adhésion à la vie dans l’acte même de transmettre le savoir.
Nous avons tenté de montrer que la phénoménologie henryenne était opératoire au niveau d’une proposition sur les contenus d’enseignement : outre l’art et la religion, traditionnellement mis en avant par certains commentateurs, l’histoire trouve place dans un enseignement repensé à partir des thèses henryennes. En effet, le concept d’Archi-Soi dévoile l’existence d’une communauté potentielle des Fils et Filles de la Vie. Dans cette communauté, l’apprentissage des individus vivants, immergés dans le savoir auto-affectif de la vie, se construit à partir d’une réflexivité inférentielle sur cette Vie absolue qui, consubstantiellement, se donne en eux, les singularise et les met en relation avec les autres. L’enseignement s’articule précisément à ce niveau radical d’apprentissage. Il est ce lieu où les évidences apodictiques et les certitudes pathiques sont répétées et se font contemporaines aux Soi vivants. L’enseignement de l’histoire, précisément, occupe une place importante dans ce mouvement. Dans un premier temps, Henry ramène l’histoire à une péripétie dramatique de la réitération infinie du besoin et du désir qui s’exerce dans la poussée du corps et se matérialise dans les biens de subsistance et dans la culture. C’est son interprétation du matérialisme historique. Si le savoir de l’histoire s’articule à cette chair vivante qui se souvient de tout, à ce savoir primitif, l’histoire du soi vivant peut s’identifier dans la contemporanéité avec l’histoire de tous les soi vivants depuis la nuit des temps : à chaque fois, il s’agit de l’individu qui adhère à l’épreuve de la vie en lui par la réitération infinie du désir et du besoin qui s’exerce dans le corps et se matérialise dans les biens de subsistance et dans la culture. Dans un deuxième temps, l’histoire est vue comme étant scandée par des « Archi-faits » qui à chaque fois crée une rupture ontologique, une nouvelle modélisation de la vie. Cette définition trouve un point d’ancrage dans l’acte d’apprentissage car elle renvoie à la propre historialité de tous les soi vivants mais également à cette histoire principielle des Archi-faits qui, qu’ils le veuillent ou non, détermine leur rapport à la vie.
Cette narration de la vie selon ses ruptures ontologiques en modélisations de la vie peut être opératoire dans l’enseignement de l’histoire tant au niveau de l’interprétation d’une certaine anthropologie mais également au niveau de la chronologie. La ligne du temps de l’histoire scandée en modélisations de la vie pourrait compléter voire remplacer le traditionnel découpage de l’histoire depuis l’Antiquité jusqu’à l’époque contemporaine – construit par les intellectuels de la Renaissance et prolongé par les Lumières et les historiens du XIXe siècle, selon nous dénué de sens dans le décryptage de notre conjoncture historique. Une proposition d’histoire des modélisations de la vie, dévidant l’écheveau des Archi-faits, décrit l’histoire comme celle des individus vivants en prise avec l’épreuve de la vie en eux et non pas comme un enchaînement téléologique de concepts qui, selon Henry, n’est plus l’histoire des individus vivants, mais celle des structures transcendantes sous le poids desquelles ils succombent.
[1] J.-M. Longneaux, « La vie tributaire de l’éducation » dans J.-F. Lavigne (dir.), M. Henry. Pensée de la vie et culture contemporaine. Actes du colloque international de Montpellier 3 -5 décembre 2003, Beauchesne, Paris, 2006, p. 131-145.
[2] M. HENRY, Du communisme au capitalisme. Théorie d’une catastrophe, O. Jacob, Paris, 1990, p. 28 : « Ce qui caractérise la vie, c’est qu’elle s’éprouve elle-même, ne cessant ainsi de souffrir ce qu’elle est, c’est-à-dire aussi bien d’en jouir ».
[3] R. GÉLY, Rôles, action sociale et vie subjective. Recherches à partir de la phénoménologie de Michel Henry, Peter Lang, Bruxelles, 2007 (Philosophie &Politique n°13), p. 124.
[4] F. Hartog, Croire en l’histoire, Flammarion, Paris, 2013.
[5] Nous n’établirons pas de distinction au cours de ce travail entre éducation et enseignement car il s’agit bien ici d’une éducation par la culture et en particulier par la culture de l’histoire.
[6] Nous l’appellerons « pôle humaniste ».
[7] C. MEYOR, L’affectivité en éducation. Pour une pensée de la sensibilité, De Boeck Université, Bruxelles, 2002, p. 99-101.
[8] J.-L. JADOULLE, M. BOUHON A. NYS, Conceptualiser le passé pour comprendre le présent. Conceptualisation et pédagogie de l’intégration en classe d’histoire, Louvain-la-Neuve, 2004.
[9] P. Bourdieu et J.-C. Passeron, Les héritiers. Les étudiants et la culture, Les éditions de Minuit, Paris, 1985 (1964) ; P. Bourdieu et J.-C. Passeron La reproduction. Éléments pour une théorie du système d’enseignement, Les éditions de Minuit, Paris, 2007 (1970) ; A. Bruno, Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron. Les héritiers, les étudiants et la culture. Un renouveau de la sociologie de l’éducation, Ellipses, Paris, 2009 ; M. Romainville, « Les implications didactiques de l’approche par compétences », in Enjeux (2001), n°51, p. 199-223.
[10] J. DE MUNCK, L’institution sociale de l’esprit. Nouvelles approches de la raison, PUF, Paris, 1999, p. 159-162.
[11] J.-P. Le Goff, La barbarie douce. La modernisation aveugle des entreprises et de l’école, La Découverte, 2e éd., Paris, 2003 et J.-C. Michéa, L’enseignement de l’ignorance et ses conditions modernes, éd. Climats, Paris, 1999.
[12] R. Gély, op. cit.
[13] Nous nous basons ici sur les articles de B. KANABUS, « Généalogie du concept henryen d’Archi-Soi », dans Les Carnets du Centre de Philosophie du Droit, n°139, Louvain-La-Neuve, 2008 et Id., « Individualité et communauté selon une phénoménologie de l’Archi-Soi », dans Les Carnets du Centre de Philosophie du droit, n°141, Louvain-La-Neuve, 2009.
[14] M. HENRY, La barbarie, PUF, Paris, 2001 (2e édition), p. 14.
[15] M. HENRY, La barbarie, op. cit., p. 213.
[16] R. KÜHN, « Crise de la culture et vie culturelle », dans J.-M. LONGNEAUX (dir..), Retrouver la vie oubliée. Critique et perspectives de la philosophie de M. Henry, Acte du colloque international 17/18 mai 1999, PUN, Namur, 2000 (coll. Philosophie n°7), p.153 : « L’imitation pédagogique qui gouverne la vie sociale n’est qu’une façon spécifique pour éprouver l’apodicticité d’une découverte humaine antérieure ».
[17] M. HENRY, La barbarie, op.cit., p. 238 et p. 217.
[18] Id., Philosophie et phénoménologie du corps, PUF, Paris, 1965, p. 135.
[19] Id., ibid., p. 218.
[20] C. MEYOR, op. cit., p. 200-239.
[21] J.-M. LONGNEAUX, « op.cit. », p. 131-145.
[22] M. MAESSCHALCK, « La forme communautaire du jugement éthique chez Michel Henry », dans J.-M. LONGNEAUX (dir.), Retrouver la vie oubliée. Critique et perspectives de la philosophie de M. Henry, Acte du colloque international 17/18 mai 1999, PUN, Namur, 2000 (coll. Philosophie n°7), p.183-206.
[23] B. KANABUS, « Individualité et communauté selon une phénoménologie de l’Archi-Soi », op. cit., p. 29.
[24] Id., « Généalogie du concept henryen d’Archi-Soi », op. cit., p. 17.
[25] M. HENRY, La barbarie, op. cit., p. 203-204.
[26] Id., ibid., p. 32.
[27] Pour Henry, la vie se caractérise par trois éléments : sa subjectivité (le fait de se sentir soi-même), sa force productive (la praxis selon Marx) et, enfin, son caractère individuel : toute vie ne s’actualise que sous la forme d’un « individu vivant, » lieu même où la vie s’éprouve ou s’auto-affecte : c’est la vie qui commande la réitération du besoin et du désir, qui, à leur tour, doivent être satisfaits dans le travail et les modes de production. M. HENRY, Du communisme au capitalisme, op. cit., p. 29-32.
[28] M. HENRY, Le socialisme selon Marx, Sulliver, Paris, 2008, p. 49.
[29] Id., ibid., p. 49-50.
[30] M. HENRY, Du communisme au capitalisme, op. cit., p. 149-150.
[31] Id., La barbarie, op. cit., p. 235.
[32] M. HENRY, Du communisme au capitalisme, op. cit., p. 156-157.
[33] B. KANABUS, « La possibilité de la transformation de la communauté dans l’histoire. Henry lecteur de Marx », Inédit, Séminaire de philosophie des sciences humaines, Louvain-La-Neuve, 29 mai 2009.
[34] M. HENRY, Philosophie et phénoménologie du corps, Paris, PUF, 1965, p. 135.
[35] Id., La barbarie, op. cit., p. 204-205
[36] R. KÜHN, « Crise de la culture et vie culturelle », op. cit., p. 139-182. Pour Rolf Kühn, pour être radicale, une telle phénoménologie de l’essence culturelle de la vie ignore comme instance généalogique pure l’histoire empirique qui, basée sur des documents incomplets et partiels, connaît plus de lacunes dans la reconstruction du passé qu’une approche approximative de la réalité de tous les individus existant et ayant existé. L’historialité du s’éprouver absolu se connaît toujours totalement d’elle-même sans lacune. S’il y a une histoire à écrire, c’est celle des émotions possibles à l’infini.
[37] M. HENRY, La barbarie, op. cit., p. 235.
[38] Id., ibid., p. 223-224.
[39] Qui signifie à la fois une unité de vote, une parcelle de terre et un rang dans l’armée.
[40] M. HENRY, Du communisme au capitalisme, op. cit., p. 78.
[41] R. GÉLY, op. cit., p. 46-47.
[42] Dans un prochain article, je tenterai de montrer l’idéologie implicite de certains manuels d’histoire qui ont tendance à mettre en avance une lecture télélologique de l’histoire. En France, le débat est particulièrement explicite entre des ouvrages de vulgarisation style Lorant Deutsch et la vision véhiculée par certains manuels. Un prochain article tentera de montrer les limites épistémologiques de cette “guerre des histoires” sur laquelle, par ailleurs, plane les pressions juridiques.