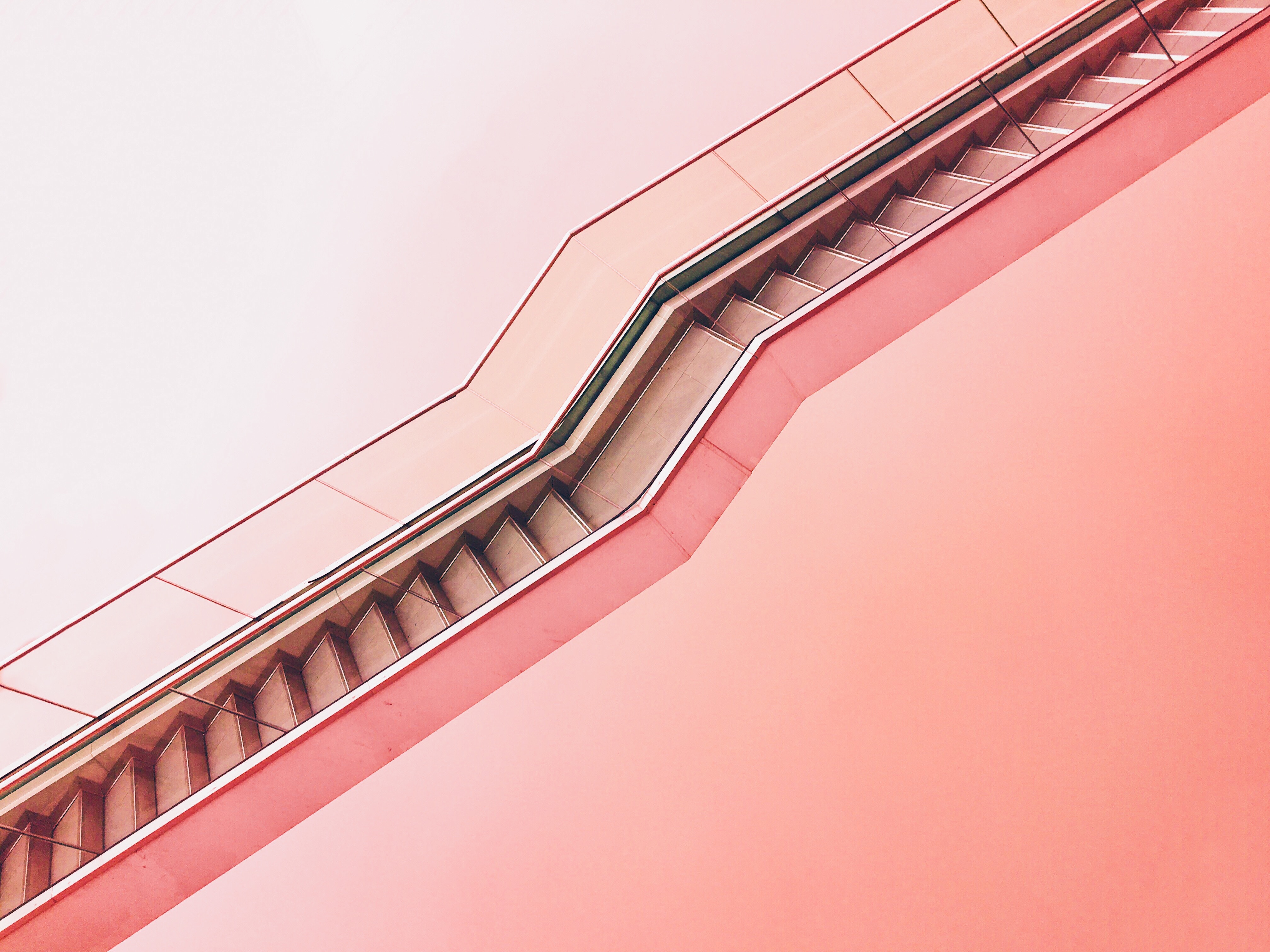Penser intelligemment la bêtise
Penser intelligemment la bêtise : de Deleuze à Stiegler
Jean-Baptiste Vuillerod. Ancien élève de l’ENS Lyon, agrégé de philosophie, rédige actuellement une thèse sur « L’anti-hégélianisme de la philosophie française des années 1960 » sous la direction d’Emmanuel Renault à l’Université Paris Nanterre (laboratoire Sophiapol).
Introduction
 États de choc de Bernard Stiegler a pour sous-titre « bêtise et savoir au xxie siècle ». Or il faut bien remarquer le paradoxe qui hante un tel geste. Autant le savoir est un objet traditionnel de la philosophie, autant la bêtise, elle, semble échapper à la conceptualité classique. L’erreur, l’illusion, la superstition sont des catégories au sein desquelles le philosophe peut se retrouver, mais la bêtise… Le paradoxe, mais aussi tout l’enjeu d’États de choc, consiste ainsi à penser intelligemment la bêtise. Pour ce faire, Stiegler discute le philosophe qui, avant lui, avait élevé la bêtise au rang de concept. Il s’agit de Gilles Deleuze qui, dans Nietzsche et la philosophie et dans Différence et répétition, avait proposé de faire de la bêtise un concept proprement philosophique[1]. Stiegler ne se contente cependant pas de reprendre tel quel le geste de Deleuze, il y apporte une plus-value conceptuelle qui va nous intéresser ici. Quel concept de bêtise Stiegler élabore-t-il à partir de sa discussion avec Deleuze ? Pour répondre à cette question, il convient, dans un premier temps, de dégager la signification de la bêtise chez Deleuze. Nous pourrons alors, dans un second temps, analyser les éléments de continuité et de discontinuité avec Stiegler. L’enjeu de ce questionnement, nous le verrons, n’est autre que la production d’un concept de bêtise à même de saisir les aspects déterminants du capitalisme contemporain.
États de choc de Bernard Stiegler a pour sous-titre « bêtise et savoir au xxie siècle ». Or il faut bien remarquer le paradoxe qui hante un tel geste. Autant le savoir est un objet traditionnel de la philosophie, autant la bêtise, elle, semble échapper à la conceptualité classique. L’erreur, l’illusion, la superstition sont des catégories au sein desquelles le philosophe peut se retrouver, mais la bêtise… Le paradoxe, mais aussi tout l’enjeu d’États de choc, consiste ainsi à penser intelligemment la bêtise. Pour ce faire, Stiegler discute le philosophe qui, avant lui, avait élevé la bêtise au rang de concept. Il s’agit de Gilles Deleuze qui, dans Nietzsche et la philosophie et dans Différence et répétition, avait proposé de faire de la bêtise un concept proprement philosophique[1]. Stiegler ne se contente cependant pas de reprendre tel quel le geste de Deleuze, il y apporte une plus-value conceptuelle qui va nous intéresser ici. Quel concept de bêtise Stiegler élabore-t-il à partir de sa discussion avec Deleuze ? Pour répondre à cette question, il convient, dans un premier temps, de dégager la signification de la bêtise chez Deleuze. Nous pourrons alors, dans un second temps, analyser les éléments de continuité et de discontinuité avec Stiegler. L’enjeu de ce questionnement, nous le verrons, n’est autre que la production d’un concept de bêtise à même de saisir les aspects déterminants du capitalisme contemporain.
La bêtise chez Deleuze
L’attention que Deleuze porte à la bêtise vient de la nécessité qu’il y a, selon lui, à nous débarrasser de l’opposition simpliste entre la vérité et l’erreur. Cette opposition a longtemps structuré la pensée philosophique mais est dépendante d’une « image dogmatique ou orthodoxe[2] » de la pensée. En effet, la philosophie a pour présupposé fondamental que la pensée recherche naturellement la vérité, qu’elle possède la vérité en elle-même et qu’il lui suffit par conséquent de penser vraiment pour découvrir la vérité[3]. C’est ce qu’affirmait déjà Aristote en postulant que « tous les humains ont par nature le désir de savoir[4]. » À l’inverse, selon cette conception, nous tombons dans l’erreur lorsque des forces extérieures s’emparent de la pensée et la détournent de sa vocation propre[5]. Il faudrait dès lors une bonne méthode pour que la pensée puisse s’exercer à la recherche de la vérité sans être détournée de son droit chemin. Aux yeux de Deleuze, cette manière de faire fonctionner le couple vérité-erreur est problématique sur deux points.
En premier lieu, en présupposant une affinité de la pensée avec le vrai et une bonne volonté du penseur, la philosophie entend se fonder sur un préjugé non démontré qui l’empêche de rompre pleinement avec la doxa. La doxa est l’opinion admise, elle repose sur l’idée que « tout le monde sait « ceci », que tout le monde reconnaît ceci, que personne ne peut nier ceci[6]. » Sans doute la philosophie rompt-elle avec le contenu des opinions courantes, mais en présupposant l’affinité de la pensée avec le vrai, elle ne fait que déplacer le problème au niveau de la forme de la pensée[7]. Le Dieu des philosophes, celui de Descartes par exemple, a peu de choses à voir avec la manière dont la plupart des gens se représentent Dieu, mais il n’en reste pas moins une divinité transcendante qui incarne la vérité absolue. L’Idée de justice qui structure la cité platonicienne rompt avec la démocratie athénienne de son temps, elle s’inscrit néanmoins dans un idéal d’harmonie et de beauté qui représente la vérité de l’ordre du monde pour les Grecs de l’époque. La philosophie apparaît ainsi souvent tout aussi dogmatique que l’opinion courante. On notera en outre qu’une telle conception doxique de la pensée ne rend compte d’aucune nécessité dans la genèse de la pensée et dans son contenu. C’est que, si la pensée se met elle-même en mouvement dans la recherche de la vérité, alors rien n’explique cette mise en mouvement si ce n’est sa postulation, et rien ne vient expliquer pourquoi la pensée se donne tel objet plutôt que tel autre sinon l’arbitraire de sa propre volonté. La doxa est incapable d’expliquer quoi que ce soit, c’est l’arbitraire et la contingence qui règnent dans l’image dogmatique de la pensée. Elle n’explique ni pourquoi l’on pense, ni ce que l’on pense.
En second lieu, le fondement de cette image dogmatique de la pensée est une « image morale[8] » qui lie le Bien au Vrai. Cette image morale affirme qu’il est bon de se livrer à la recherche désintéressée de la vérité, mais par là il s’agit avant tout d’arracher le penseur aux problèmes du présent pour ne pas que la pensée s’en prenne aux valeurs en cours, pour ne pas qu’elle s’intéresse au monde réel : « Fait troublant : le vrai conçu comme universel abstrait, la pensée conçue comme science pure n’ont jamais fait de mal à personne. Le fait est que l’ordre établi et les valeurs en cours y trouvent constamment leur meilleur soutien[9]. » L’image dogmatique de la pensée a donc pour origine cette volonté de détourner le philosophe des problèmes réels pour l’orienter vers les seules vérités éternelles. Ainsi, tant en raison de sa charge doxique que de sa justification morale du monde, l’image dogmatique de la pensée qui repose sur l’opposition de la vérité et de l’erreur est à abandonner au profit d’une « nouvelle image de la pensée[10] ».
Quelle nouvelle image de la pensée nous propose Deleuze ? Dans Nietzsche et la philosophie, l’opposition qui vient remplacer la vérité et l’erreur est celle du sens et du non-sens, le non-sens étant l’autre nom de la bêtise[11]. Sans doute y a-t-il des cas où le recours à la conception traditionnelle de l’erreur est nécessaire, mais il s’agit de cas puérils, artificiels ou grotesques : « Qui dit 3+2=6, sinon le petit enfant à l’école ? Qui dit « bonjour Théétète », sinon le myope ou le distrait ?[12] » S’il faut préférer le concept de bêtise à celui d’erreur, c’est parce qu’il y a des discours vrais qui sont bêtes : « La bêtise n’est pas une erreur ni un tissu d’erreurs. On connaît des pensées imbéciles, des discours imbéciles qui sont faits tout entiers de vérités ; mais ces vérités sont basses, sont celles d’une âme basse, lourde et de plomb. » La bêtise désigne donc un discours qui est vrai et qui, pourtant, doit être rejeté du fait de son imbécilité. Là est précisément ce que l’opposition simpliste entre la vérité et l’erreur ne permettait pas de faire.
En 1962, Nietzsche et la philosophie présente la bêtise comme le symptôme d’une bassesse[13]. Cette bassesse est « le règne des valeurs mesquines ou la puissance d’un ordre établi », elle indique les discours imbéciles qui, bien que vrais, légitiment l’ordre existant. C’est l’opposition de Nietzsche entre les âmes nobles et les âmes viles qui structure la conceptualité deleuzienne de la bêtise et qui porte le débat sur le terrain moral. Différence et répétition, en 1968, conserve la dimension morale de la bêtise[14] mais aborde aussi l’autre aspect de la bêtise, qui se situe sur un terrain purement épistémologique. Le non-sens de la bêtise n’est alors plus seulement l’imbécilité conservatrice des âmes mesquines, mais le non-sens des « remarques sans intérêt ni importance, des banalités prises pour remarquables, des confusions de « points » ordinaires avec des points singuliers, des problèmes mal posés[15] ». Deleuze prend l’exemple des copies d’élève où il y a souvent des bêtises mais peu d’erreurs. Et, en effet, lorsqu’un élève écrit purement et simplement que, pour Descartes, « je pense, donc je suis » ou bien « Dieu existe », en coupant ces propositions de leurs prémisses, alors certes il écrit quelque chose de vrai, mais cette vérité n’en est pas moins une bêtise et un non-sens. Ce qui donne sens au cogito et aux preuves de l’existence de Dieu, c’est le projet des Méditations métaphysiques, qui n’est autre que le fondement de la science moderne, et le fait que cette recherche du fondement en passe par un doute radical auquel on va pouvoir résister. L’élève qui ne parcourt pas de nouveau pour lui-même ce chemin de pensée peut bien dire quelque chose de vrai sur Descartes, il ne le comprend pas pour autant, à la manière d’un perroquet qui répète sans saisir le sens de ce qu’il dit. C’est cette incompréhension du sens que désigne la bêtise. La bêtise, ici, vise donc moins la bassesse morale de celui qui parle que sa faiblesse épistémique. Mais qu’il s’agisse de morale ou d’épistémologie, la bêtise s’avère être un concept plus essentiel que celui d’erreur.
Comment la bêtise est-elle possible ? « Elle est possible, nous dit Deleuze, en vertu du lien de la pensée avec l’individuation[16]. » Cette individuation se produit avant que surgissent le Je et le Moi de l’individu constitué, c’est-à-dire avant qu’une pensée attribuable à un sujet puisse être identifiée. Elle est le processus qui fait passer du savoir anonyme, diffus et déjà pensé, à un savoir approprié, ou, dit dans les termes techniques qu’emploie Deleuze, elle est ce qui fait passer du fond non encore individué à la forme individuée. Le fond non-individué, chez l’homme du moins[17], ne disparaît pas une fois l’individu apparu mais continue de le hanter à la manière d’une ombre qu’il draine derrière lui[18]. L’individuation indique la manière dont l’individu se rapporte à ce fond pour lui donner forme, pour se l’approprier en l’individuant. Ainsi, en s’appropriant ce fond, l’individu se transforme puisque par là il s’individue de nouveau. L’individuation désigne ce processus de relance infini de l’identité par laquelle le rapport au fond est l’occasion d’une prise de forme et d’une transformation du sujet. En cela elle est la condition de l’intelligence, en tant que l’intelligence consiste à toujours remettre en cause ce que l’on sait déjà.
La bêtise est précisément ce qui vient bloquer un tel processus. En elle, le fond est certes mobilisé, mais il n’est plus individué, il n’est plus approprié par le sujet de sorte à transformer son identité. Au contraire, le fond non-individué s’impose comme un déjà-là à accepter tel quel. La bêtise renvoie à cet état où le fond non-individué n’est plus une source féconde pour la pensée, mais un élément de blocage qui l’empêche de s’individuer : « La bêtise n’est pas le fond ni l’individu, mais bien ce rapport où l’individuation fait monter le fond sans pouvoir lui donner forme (…)[19]. » La bêtise apparaît ainsi comme une fixation, une consolidation stérile de la pensée qui ne sait plus se relancer, mais qui épouse passivement la doxa qui lui préexiste. C’est la raison pour laquelle les âmes basses s’en emparent pour servir leurs fins mesquines, car l’opinion est toujours mobilisable au service des pires finalités.
Il faut se demander, pour finir, comment il est possible de se rapporter à ce fond pour ressourcer la pensée. Pour Deleuze, on l’a vu, la solution n’est pas dans notre tête, elle n’est pas dans la bonne volonté d’une pensée naturellement orientée vers la vérité. Au contraire, c’est seulement par la rencontre avec l’altérité, avec ce qui lui est étranger que la pensée peut trouver de quoi se transformer, car si elle reste enfermée en elle-même, elle n’a plus aucun moyen d’affronter une différence qui va modifier son identité. Ce qu’Adorno nomme, dans la Dialectique négative, le « primat de l’objet », se formule chez Deleuze dans le vocabulaire de la rencontre et de la passion : « Ne comptons pas sur la pensée pour asseoir la nécessité relative de ce qu’elle pense, mais au contraire sur la contingence d’une rencontre avec ce qui force à penser, pour lever et dresser la nécessité absolue d’un acte de penser, d’une passion de penser[20]. » Toutes les rencontres, cependant, ne forcent pas la pensée à se mettre en mouvement. Seule la rencontre de problèmes rend une telle chose possible, car le problème confronte la pensée à une difficulté dont elle n’a pas encore la solution et l’oblige ainsi à se faire violence à elle-même. Le problème est dès lors ce fond qui réintroduit de l’individuation dans la pensée[21]. Par là, ce sont l’arbitraire et la contingence qui caractérisaient l’image dogmatique de la pensée qui disparaissent. La rencontre du problème a beau être contingente, elle donne à l’esprit quelque chose qui le force à penser et qui par là rend nécessaire à la fois la genèse de la pensée et son objet : « il n’y a de pensée qu’involontaire, suscitée contrainte dans la pensée, d’autant plus nécessaire absolument qu’elle naît, par effraction, du fortuit dans le monde[22]. » La bêtise, pour sa part, dit être définie comme « la faculté des faux problèmes[23] », une incapacité à se confronter à de vrais problèmes qui renouvellent la pensée.
Stiegler lisant Deleuze
Que fait Stiegler du concept deleuzien de bêtise ? Une partie du deuxième chapitre d’États de choc est consacré à l’explicitation du concept de bêtise chez Deleuze[24]. Loin d’une répétition stérile, cette discussion fait évoluer profondément la conception de la bêtise de sorte à lui donner de nouveaux enjeux. Pour le comprendre, il nous faut marquer les continuités et les discontinuités qui s’instaurent lorsque l’on passe de Deleuze à Stiegler.
En premier lieu, il est certain que Stiegler accepte pleinement la substitution deleuzienne du couple savoir-bêtise au couple vérité-erreur. Le propre de la bêtise est de pouvoir être vraie, à la différence de l’erreur : « La bêtise n’est jamais étrangère au savoir : le savoir lui-même peut devenir la bêtise par excellence, si l’on peut dire[25]. » Mais dans la perspective de Stiegler, l’opposition entre savoir et bêtise recoupe l’opposition entre l’activité et la passivité. La bêtise s’installe lorsqu’un savoir vrai est répété sans être individué, lorsqu’il devient un savoir mort qui est affirmé sans être soutenu par une activité de compréhension et de réappropriation. Autrement dit, la bêtise est du côté de la passivité alors que le savoir est du côté de l’activité, mais parce que cette activité peut s’épuiser, s’oublier, se mortifier, alors le savoir lui-même peut devenir bêtise[26]. C’est cette réversibilité du savoir et de la bêtise, qui n’était pas véritablement soulignée par Deleuze, mais qui est rendue possible par l’introduction de l’opposition entre activité et passivité, qui devient centrale dans le propos de Stiegler. Dans cette perspective que l’on pourrait dire hégélienne ou dialectique, et que Derrida s’était réappropriée pour penser justement la question spécifique de la bêtise[27], le propos deleuzien se trouve enrichi pour venir compliquer l’opposition rigide entre savoir et non-savoir, ou, pour le dire dans les termes de Jacques Rancière, entre les savants et les ignorants.
En second lieu, Stiegler reprend en partie le point de vue moral de Deleuze sur la bêtise. Sans doute la perspective morale est-elle moins présente dans États de choc que dans Nietzsche et la philosophie, mais Stiegler insiste néanmoins sur l’« expérience de la honte[28] » que l’on ressent face à la bêtise et qui nous pousse à philosopher. Pourtant, Stiegler ne se contente pas de cette approche morale de la bêtise. Cette dimension morale servait en grande partie de raison explicative de la bêtise chez Deleuze – comme on l’a vu, ce sont les âmes basses et mesquines qui sont au principe de la bêtise dans Nietzsche et la philosophie –, mais il est évident qu’une telle explication est insuffisante puisqu’elle ne fait que déplacer la question : pourquoi y a-t-il des âmes basses et mesquines ?[29] L’approche stieglerienne permet en grande partie d’éviter cette aporie en recentrant le propos sur l’étiologie technique de la bêtise. Pour Stiegler, en effet, la bêtise résulte de l’écriture, de ce processus de prolétarisation qui désigne l’inscription graphique de la pensée dans l’extériorité : « Ce processus est celui de la grammatisation, où la prolétarisation du penser et de l’entendement qui échappe ainsi à la raison, c’est-à-dire au « règne des fins » (et c’est ce que signifie essentiellement la rationalisation que décrit Weber[30]) est ce qui, tout en développant une sorte d’intelligence pragmatique, de métis, d’ingéniosité où chacun semble devenir plus « malin », conduit à un abêtissement généralisé (…)[31]. » C’est parce que la pensée se fige dans l’extériorité par l’écriture qu’elle peut vivre de manière purement passive sans être individuée activement, et ainsi devenir bêtise. Ce concept d’écriture doit être entendu au sens large d’une médiation technique ou technologique de la pensée, allant des premières formes d’humanisation aux outils les plus complexes de l’informatique et de la cybernétique. Cette médiation technique, pour Stiegler, est nécessaire afin que la réflexion puisse se développer, mais fait toujours courir à la pensée le risque d’une solidification, d’une mortification dans cette mémoire externe. Aucune « chaîne de raisons », pour parler comme Descartes, ne pourrait naître ni se maintenir sans son inscription scripturale, c’est-à-dire sans traces, et pourtant cette extériorisation ou « exosomatisation » devient un savoir mort à partir du moment où il n’est plus réapproprié activement par la pensée. Cette thématisation de la technique, chez Stiegler, permet de donner à la bêtise une véritable cause et l’arrache à la perspective morale ou éthique dans laquelle Deleuze continuait de l’inscrire.
En troisième lieu, Stiegler reprend à Deleuze la dimension politique qu’il donne à la bêtise. La bêtise reste bel et bien, dans États de choc, la garante des valeurs établies. Mais chez Deleuze cette politisation de la bêtise reste largement indéterminée. Dans Nietzsche et la philosophie ainsi que dans Différence et répétition, la bêtise semble revêtir un caractère universel, dont la potentialité est la même en tout temps et en tout lieu. Et lorsque, avec Guattari, Deleuze aborde plus spécifiquement la question du capitalisme – dans L’anti-Œdipe et dans Mille plateaux –, le concept de bêtise n’est pas présent. C’est une telle indétermination politique de la bêtise qui disparaît chez Stiegler, qui en fait un concept central de l’analyse du capitalisme contemporain. Il parle en effet d’un « bêtise systémique[32] » propre au capitalisme actuel en lequel la bêtise est exploitée au service du consumérisme : « À l’époque du psychopouvoir et des psychotechnologies, le marketing exploite ces tendances pour prendre le contrôle des processus de transindividuation, provoquant ainsi des processus de désindividuations massives[33]. » Cela signifie que, dans le capitalisme contemporain, le profit repose sur l’abrutissement généralisé de la population, qui n’est autre que l’impossibilité pour les individus de se réapproprier le savoir de manière active et l’imposition acceptée passivement de la consommation vers laquelle on veut les orienter.
On voit ainsi en quoi Stiegler garde de Deleuze la substitution de la bêtise à l’erreur, ainsi que sa compréhension morale et politique de la bêtise, mais qu’à chaque fois il infléchit sa reprise de sorte à faire de la bêtise un concept central de l’analyse du capitalisme qui, aujourd’hui, à ses yeux, se caractérise avant tout par le consumérisme.
Conclusion
L’évolution du concept de bêtise de Deleuze à Stiegler nous permet de saisir toute la pertinence et l’actualité de ce concept que rien ne destinait à un avenir philosophique, compte tenu de la faible importance que lui avait accordée la tradition. La bêtise acquiert par là une conceptualité qui la situe aux côtés de catégories plus traditionnelles comme l’aliénation. On peut d’ailleurs évaluer brièvement la fécondité conceptuelle de la bêtise à l’aune de l’aliénation. En effet, à la différence de l’aliénation, la bêtise ne présuppose aucune théorie de la nature humaine. Au contraire, la bêtise suppose uniquement chez Stiegler l’extériorisation technique qui rend possible une passivité radicale à l’égard du savoir. Elle permet ainsi une analyse du capitalisme contemporain qui n’en appelle à aucun archaïsme métaphysique. Il n’est pas certain, pour autant, qu’elle puisse constituer à elle toute seule un concept suffisamment critique. Sans doute devrait-elle être liée à d’autres catégories, et notamment à celle de domination ou de pouvoir, pour être véritablement efficiente et se donner les moyens de ses ambitions. Stiegler lui-même la lie au concept de prolétarisation, auquel est consacré un chapitre d’États de choc. Ouverte à cette constellation conceptuelle plus vaste, la bêtise peut devenir un véritable concept de critique sociale du monde contemporain.
[1] Sur la bêtise chez Deleuze, on pourra consulter F. Zourabichvili, Deleuze. Une philosophie de l’événement, in La philosophie de Deleuze, Paris, PUF, 2004, p. 30-32 ; et I. Krtolica, Gilles Deleuze, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2015, p. 41-41.
[2] G. Deleuze, Différence et répétition (1968), Paris, PUF, 2011, p. 172.
[3] Ibid. : « D’après cette image, la pensée est en affinité avec le vrai, possède formellement le vrai et veut matériellement le vrai. »
[4] Aristote, Métaphysique, livre A, 980a 21, Paris, Flammarion, 2008, tr. fr. M.-P. Duminil et A. Jaulin, p. 71.
[5] G. Deleuze, Nietzsche et la philosophie (1962), Paris, PUF, 2005, p. 118 : « L’erreur : tel serait le seul effet, dans la pensée comme telle, des forces extérieures qui s’opposent à la pensée » (sauf indication contraire, c’est l’auteur qui souligne).
[6] G. Deleuze, Différence et répétition, op. cit., p. 171.
[7] Ibid. : « Le philosophe, il est vrai, procède avec plus de désintéressement : ce qu’il pose comme universellement reconnu, c’est seulement ce que signifie penser, être et moi, c’est-à-dire non pas un ceci, mais la forme de la représentation ou de la recognition en général. »
[8] Ibid., p. 172.
[9] G. Deleuze, Nietzsche et la philosophie, op. cit., p. 119.
[10] Ibid.
[11] Ibid., p. 119-120 : « Une nouvelle image de la pensée signifie d’abord ceci : le vrai n’est pas l’élément de la pensée. L’élément de la pensée est le sens et la valeur. (…) Il en découle une seconde conséquence : l’état négatif de la pensée n’est pas l’erreur. (…) La bêtise est une structure de la pensée comme telle : elle n’est pas une manière de se tromper, elle exprime en droit le non-sens dans la pensée. »
[12] Ibid., p. 120.
[13] Ibid. : « La bêtise et, plus profondément, ce dont elle est symptôme : une manière basse de penser. »
[14] G. Deleuze, Différence et répétition, op. cit., p. 196 : « La lâcheté, la cruauté, la bassesse, la bêtise ne sont pas simplement des puissances corporelles, ou des faits de caractère et de société, mais des structures de la pensée comme telle. »
[15] Ibid., p. 198-199.
[16] Ibid., p. 197.
[17] Deleuze différencie sur ce point l’homme et l’animal : alors que l’homme maintient un rapport à la différence qui lui permet de relancer indéfiniment son individuation, l’animal est coupé de ce rapport au fond. Derrida lui en fait le reproche dans La bête et le souverain, et Stiegler revient sur la polémique au chapitre 2 d’États de choc.
[18] Ibid., p. 197 : « Car ce fond, avec l’individu, monte à la surface et pourtant ne prend pas forme ou figure. Il est là, qui nous fixe, pourtant sans yeux. L’individu s’en distingue, mais lui, ne s’en distingue pas, continuant d’épouser ce qui divorce avec lui. Il est l’indéterminé, mais en tant qu’il continue d’embrasser la détermination, comme la terre au soulier. »
[19] Ibid.
[20] Ibid., p. 182.
[21] Ibid., p. 210 : « Les problèmes sont des épreuves et des sélections. L’essentiel est que, au sein des problèmes, se fait une genèse de la vérité, une production du vrai dans la pensée. Le problème, c’est l’élément différentiel dans la pensée, l’élément génétique dans le vrai. » On voit ici, que le dépassement du couple vérité-erreur de l’image dogmatique de la pensée rend possible, dans la nouvelle image de la pensée que propose Deleuze, un réinvestissement du concept de vérité. La vérité renvoie désormais à deux choses : d’une part, dans l’ordre épistémologique, elle renvoie à la saisie du problème ; d’autre part, dans l’ordre ontologique, elle indique la création d’une solution vraie au problème posé. Sur ce point, cf. ibid., p. 207 : « Le problème ou le sens, c’est à la fois le lieu d’une vérité originaire et la genèse d’une vérité dérivée. »
[22] Ibid., p. 181.
[23] Ibid., p. 207.
[24] B. Stiegler, États de choc, Paris, Mille et une nuits, 2012, p. 83 sq.
[25] Ibid., p. 79.
[26] Ibid., p. 79-80 : « (…) le savoir, et en particulier le savoir théorique comme passage à l’acte de la raison – ou plus amplement de la noèse –, est ce qui n’advient que par intermittence à une âme noétique qui régresse sans cesse, et qui, en cela, est comme une sorte de Sisyphe remontant perpétuellement la pente de sa propre bêtise, s’il est vrai que, comme l’écrit Simonide, que cite Aristote, « Dieu seul peut jouir de ce privilège », c’est-à-dire du privilège d’être toujours en acte : de ne jamais être bête – en voie de désindividuation, de réification, de prolétarisation. »
[27] Derrida, déjà, soulignait la réversion du savoir en bêtise, cf. Séminaire La bête et le souverain, Volume I, Paris, Galilée, 2008, p. 216-218.
[28] B. Stiegler, États de choc, op. cit., p. 81.
[29] Derrida, de nouveau, notait le caractère idiosyncrasique, naturel et dépourvu d’explications de la bêtise chez Deleuze, cf. Séminaire la bête et le souverain, op. cit., p. 204. Comme Stiegler, Derrida situait dans l’inscription de la trace la genèse de l’abêtissement (ibid., p. 217).
[30] Sur ce point, voir la séance du séminaire consacrée aux « Dialectiques de la raison ».
[31] B. Stiegler, États de choc, op. cit., p. 78.
[32] Ibid., p. 77.
[33] Ibid., p. 103.