Penser dans l’après-coup de la postmodernité (1/2)
[box] Anne Alombert. Doctorante à l’Université Paris Nanterre.
Faute d’eschatologie, la mécanicité et la contingence (…) laissent la pensée en souffrance de finalité. Cette souffrance est l’état postmoderne de la pensée, ce qu’il est convenu d’appeler ces temps-ci sa crise, son malaise ou sa mélancolie.
J.-F. Lyotard, « Une fable postmoderne ».
Nous n’avons pas affaire à la crise de la modernité : nous avons affaire à la nécessité de moderniser les présupposés sur lesquels la modernité est fondée.
A. Gorz, Métamorphoses du travail. Critique de la raison économique.
Il n’y a pas lieu de craindre ou d’espérer, mais de chercher de nouvelles armes.
G. Deleuze, « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle ».
Cet ouvrage a pour but de fournir des armes conceptuelles, c’est-à-dire pacifiques, et d’ouvrir des perspectives d’actions fondées sur des arguments rationnels, c’est-à-dire politiques…
B. Stiegler, États de choc. Bêtise et savoir au XXIème siècle.
| Remarque préliminaire |
Cet article se compose des quatre parties suivantes :
I. La déconstruction aux limites de la philosophie
II. La déconstruction du concept de sujet
III. La déconstruction du concept d’histoire
IV. L’avenir de la déconstruction
Il est publié en deux parties :
-la première publication (1) comprend l’introduction ainsi que les deux premières parties
-la seconde publication (2) comprend les deux dernières parties et la conclusion
Introduction
 Dans l’introduction d’États de choc. Bêtise et savoir au XXIème siècle, Bernard Stiegler décrit la coïncidence de la crise de l’éducation et de l’enseignement public et de la crise de la souveraineté économique et politique qui caractérise les sociétés occidentales contemporaines. Alors que « l’état de délabrement de la recherche, de l’instruction publique et de l’éducation » fait l’objet de manifestes et de pétitions issues de la sphère académique, « l’effondrement de la crédibilité économique et politique du monde occidental » apparaît quant à lui à travers les « notes » attribuées aux États par les agences privées de notation[1] . Selon Stiegler, cette liquidation de la souveraineté n’est pas dissociable de la dégradation des conditions d’exercice de la recherche universitaire et scientifique et de l’enseignement public : il rappelle que dans la philosophie des Lumières, à l’origine de la conception de la souveraineté moderne, la constitution d’une puissance publique souveraine va de pair avec la formation, à travers l’éducation et l’instruction publique, de citoyens autonomes et majeurs, c’est à dire, pour reprendre les termes de Kant, rendus capables de « se servir de leur entendement sans la direction d’autrui », grâce à la fréquentation et à l’acquisition de savoirs rationnels. Bref, la fondation d’une communauté politique souveraine suppose la formation et l’éducation publiques comme ses conditions même de possibilité. La double crise actuelle (de la souveraineté et de l’enseignement) semble ainsi impliquer de revisiter en profondeur « la question de savoir ce qui lie recherche universitaire, instruction publique, éducation, politique et économie », afin de repenser les fonctions politiques de l’enseignement et de la recherche, face aux immenses transformations que le développement des technologies numériques fait subir aux sociétés[2] .
Dans l’introduction d’États de choc. Bêtise et savoir au XXIème siècle, Bernard Stiegler décrit la coïncidence de la crise de l’éducation et de l’enseignement public et de la crise de la souveraineté économique et politique qui caractérise les sociétés occidentales contemporaines. Alors que « l’état de délabrement de la recherche, de l’instruction publique et de l’éducation » fait l’objet de manifestes et de pétitions issues de la sphère académique, « l’effondrement de la crédibilité économique et politique du monde occidental » apparaît quant à lui à travers les « notes » attribuées aux États par les agences privées de notation[1] . Selon Stiegler, cette liquidation de la souveraineté n’est pas dissociable de la dégradation des conditions d’exercice de la recherche universitaire et scientifique et de l’enseignement public : il rappelle que dans la philosophie des Lumières, à l’origine de la conception de la souveraineté moderne, la constitution d’une puissance publique souveraine va de pair avec la formation, à travers l’éducation et l’instruction publique, de citoyens autonomes et majeurs, c’est à dire, pour reprendre les termes de Kant, rendus capables de « se servir de leur entendement sans la direction d’autrui », grâce à la fréquentation et à l’acquisition de savoirs rationnels. Bref, la fondation d’une communauté politique souveraine suppose la formation et l’éducation publiques comme ses conditions même de possibilité. La double crise actuelle (de la souveraineté et de l’enseignement) semble ainsi impliquer de revisiter en profondeur « la question de savoir ce qui lie recherche universitaire, instruction publique, éducation, politique et économie », afin de repenser les fonctions politiques de l’enseignement et de la recherche, face aux immenses transformations que le développement des technologies numériques fait subir aux sociétés[2] .
Néanmoins, une telle exigence pose problème, puisque, comme l’écrit Stiegler, « ces questions – souveraineté, minorité, majorité, raison et même histoire – semblent ne plus pouvoir être posées en ces termes de nos jours, comme si (…) la ‘postmodernité’ les avait vidées de leur contenu[3] ». En effet, la philosophie du XXème siècle aura majoritairement consisté à mettre en doute la philosophie des Lumières, qui voyait dans la modernité et la modernisation un progrès politique, économique et social. C’est ce dont témoigne le geste d’Adorno et Horkheimer, qui posent dès 1944 que le mouvement historique et social des Lumières conduit à un renversement ou à une inversion de ses finalités, à travers la transformation de la raison en rationalisation, conduisant au processus de réification qui caractérise les sociétés industrielles capitalistes[4]. Les concepts fondamentaux de la philosophie moderne, ceux de raison, de sujet, d’histoire, de vérité ou de souveraineté commencent alors à vaciller.
Cet ébranlement s’accentue encore à l’époque dite « post-moderne », que Lyotard caractérise en 1979 par « l’incrédulité à l’égard des métarécits » spéculatifs ou émancipateurs, c’est-à-dire à l’égard des philosophies de l’histoire qui avaient eu pour fonction de légitimer la science moderne, mais que les transformations techno-scientifiques amorcées dès la fin du XIXème siècle auraient rendues obsolètes[5]. En effet, selon Lyotard, le récit des Lumières, la dialectique spéculative (ainsi que la dialectique marxiste qui lui succédera) auraient pour point commun de mettre en œuvre un imaginaire finalisé et cyclique du temps. Qu’il s’agisse de « la loi de la Nature dans le droit naturel fantasmé par Rousseau », ou de « la société sans classes, avant la famille, la propriété et l’État, imaginée par Engels », « c’est toujours un passé immémorial qui se trouve promis comme fin ultime »[6]. Les « grands récits » modernes renoueraient ainsi avec le principe eschatologique du christianisme, en projetant l’horizon d’une émancipation ou d’une perfection, qui apparaît comme la réappropriation d’une origine perdue et constitue le motif d’un espoir. Au contraire, la pensée postmoderne, frappée par les dérives impérialistes des démocraties occidentales et consciente des menaces générées par le développement techno-scientifique, ne peut que s’inquiéter du projet moderne et de l’idée même de progrès[7] : l’avenir ne fait plus pour elle l’objet d’une espérance, l’historicité qui caractérisait l’imaginaire moderne du temps lui paraît intenable et les philosophies qui portaient cet imaginaire se voient décrédibilisées.
Selon Lyotard, la postmodernité correspond donc à une « crise de la philosophie métaphysique », laissant la pensée « en souffrance de finalité »[8] : il soutient en effet que si « la voie de la métaphysique est sans issue » et « fait, tout au plus, l’objet de la critique »[9] , une telle critique conduit elle-même à un état de « malaise » ou de « mélancolie », qui engendre des incertitudes et suscite en retour « un désir de sécurité, de stabilité, et d’identité[10] ». Bref, alors que les concepts modernes apparaissent comme autant de catégories périmées, il semble que, comme le souligne Stiegler, « l’héritage des pensées issues du XXème siècle laisse les humains du XXIème siècletotalement désarmés, face à une situation qui paraît dès lors désespérée[11]».
Néanmoins, lorsque l’on s’intéresse à la déconstruction amorcée par Derrida à la fin des années 60, et à sa poursuite paradoxale à travers la « déconstruction de la déconstruction » entreprise par Stiegler une trentaine d’années plus tard[12], il semble que ce que Lyotard décrivait en 1979 comme la fin des grands récits corresponde aussi au début d’autre chose – à la formation de nouvelles questions et à l’émergence d’un nouveau type de pensée. En effet, si la déconstruction derridienne se caractérise évidemment par une mise en question radicale de la conceptualité philosophique traditionnelle, elle n’en implique pas moins une tentative de transformation et de renouvellement des catégories et de la logique qui ont caractérisé la philosophie occidentale. Qu’une telle transformation ou qu’un tel renouvellement ne puisse pas donner lieu à un discours « philosophique » à proprement parler, et qu’un tel discours ne soit d’ailleurs pas effectivement mis en œuvre par Derrida constituent des problèmes, qui ne devraient néanmoins pas empêcher de lire son geste comme un effort pour continuer à penser, hors des présupposés inhérents à la langue de la métaphysique. D’autant qu’un tel effort, s’il n’aboutit pas dans le texte de Derrida, semble se poursuivre à travers le travail de Stiegler, qui a précisément pour fonction d’ « enchaîner à nouveaux frais » sur l’héritage poststructuraliste, en le confrontant à la question de la technique, que la philosophie traditionnelle comme la pensée postmoderne n’ont pu que refouler[13].
Nous tenterons donc d’abord de clarifier la fonction et les enjeux de la déconstruction de la philosophie entreprise par Derrida, afin de montrer que loin de conduire à la « mort de la philosophie », au « refus de l’histoire » ou à la « liquidation du sujet »[14] , son geste implique au contraire la mise en œuvre d’un nouveau discours, qui permette de repenser en profondeur les questions que les concepts d’histoire ou de sujet ont contribué à masquer. Si ces concepts doivent être abandonnés, ce n’est pas parce que l’on pourrait simplement s’en passer, mais parce qu’ils transportent avec eux un certain nombre de présuppositions problématiques, que leur transformation devrait parvenir à dépasser. Si Derrida n’élabore pas lui-même une conception non métaphysique de ce qui ne pourra dès lors plus être appelé « sujet » ou « histoire », peut-être est-ce parce que, comme le soutient Stiegler, sa pensée perpétue le refoulement de la question de la technique qui est à l’origine de la métaphysique elle-même[15]. La mise au jour de cette question dans le texte de Stiegler serait-elle alors susceptible de renouveler les questions de la subjectivité et de l’historicité, qui « semblent ne plus pouvoir être posées en ces termes de nos jours[16] » ?
I. La déconstruction aux limites de la philosophie.
Les conditions d’émergence et de fonctionnement du discours philosophique
Pour saisir les enjeux de la déconstruction des concepts de sujet et d’histoire, il semble nécessaire de resituer le geste déconstructif de Derrida par rapport à la tradition philosophique. Une telle question pose d’emblée problème, dans la mesure où la déconstruction ne s’apparente ni à la production d’un nouveau système philosophique prétendant rompre et dépasser les écueils des systèmes précédents, ni à une simple histoire de la philosophie, visant à déterminer l’enchaînement chronologique ou logique entre des doctrines. En effet, le geste de Derrida ne consiste pas à s’opposer à tel ou tel type de doctrine philosophique, pour en proposer une nouvelle (comme Kant tentant par exemple de dépasser les écueils du cartésianisme par sa philosophie critique, ou comme Hegel tentant de dépasser les écueils de l’idéalisme transcendantal par la dialectique spéculative). Il n’y a pas à proprement parler de « philosophie » derridienne, la plupart des textes de Derrida portent sur d’autres textes, et la déconstruction s’apparente ainsi parfois à un commentaire ou à une analyse des textes de la philosophie traditionnelle (ainsi que des sciences humaines ou de la littérature). Et pourtant, il ne s’agit pas non plus pour Derrida de faire de l’histoire de la philosophie au sens classique, c’est-à-dire de déterminer après coup des ruptures, des tournants ou des moments philosophiques, ou bien de proposer une interprétation originale d’un auteur en particulier. Bref, le travail de Derrida ne s’apparente ni à celui d’un philosophe, ni à celui d’un historien de la philosophie, ni à celui d’un spécialiste de philosophie (si tant est que ces trois types de « travaux » puissent être distingués). En quoi la déconstruction consiste-t-elle alors ?
S’il ne s’agit pour Derrida ni de produire une nouvelle philosophie, ni de faire de l’histoire de la philosophie, c’est que son geste consiste plutôt à déterminer les conditions d’émergence et de fonctionnement du discours philosophique[17]. Dès lors, le déploiement historique de la philosophie, qui avait pu apparaître comme une succession de théories s’opposant les unes aux autres (au sein d’un champ de bataille anarchique ou selon un progrès évolutif) apparaîtra comme un même « dispositif discursif », comme un « ensemble d’altérations réglées »[18] , un enchaînement de variations conceptuelles qui relancent de manière toujours différente, un certain nombre de schémas de pensée. Il s’agit en effet pour Derrida de saisir ce que l’on appelle habituellement la philosophie (l’ensemble des théories et des doctrines qui la caractérise) comme une « puissante unité historique et systématique[19] ». Unité historique, puisqu’il s’agit de montrer que ce type de discours n’a pu voir le jour qu’à un certain moment, dans un certain espace, au sein de certaines sociétés disposant d’un certain système d’écriture configurant un certain système de langue (l’écriture phonétique et linéaire et le système de langue alphabétique[20]). Et unité systématique, puisqu’il s’agit de montrer que le fonctionnement du système de langue engendré par ces techniques d’écriture implique une certaine logique et un certain nombre de présupposés (que Derrida qualifie de « phonologocentristes[21] »), qui commandent nécessairement la structure et la conceptualité du discours philosophique qui en est issu – et cela en dépit des divergences entre les doctrines, qui ne s’affrontent en fait que sur la base d’une axiomatique commune.
La stratégie de la déconstruction : du renversement au déplacement
C’est cette axiomatique commune du discours philosophique que la déconstruction a pour fonction d’ébranler, dans la mesure où selon Derrida, les présuppositions métaphysiques dont la langue philosophique est chargée sont profondément remise en question par les avancées des sciences humaines, qui ont fait trembler les fondements les plus assurés de notre conceptualité philosophique[22]. Même si tout penseur demeure pris dans la langue de la métaphysique, Derrida soutient qu’il reste toujours possible d’intervenir dans les textes, pour les travailler et les transformer de l’intérieur, en sollicitant l’organisation interne du discours philosophique et en retournant les notions fondamentales contre leurs propres présuppositions. Autrement dit, si personne ne peut en sortir, personne n’est pour autant obligé de résider passivement dans le champ clos des oppositions métaphysiques[23] : la déconstruction désigne précisément l’ « opération textuelle[24] » qui a pour fonction de réaliser cette transgression interne. Elle constitue donc moins un « au-delà de la métaphysique » qu’une « lecture transformatrice » de la philosophie. C’est pourquoi, tout en soulignant les limites du discours philosophique, Derrida affirme que « le passage au-delà de la philosophie ne consiste pas à tourner la page de la philosophie (…) mais à continuer à lire d’une certaine manière les philosophes[25] » : d’une certaine manière, car la lecture déconstructrice ne vise pas la découverte d’un signifié derrière la surface textuelle, mais plutôt la transformation des couples conceptuels et de la logique oppositionnelle qui commande les différents discours philosophiques, afin de les libérer des présupposés qu’ils transportent. La déconstruction n’est donc ni l’élaboration d’une nouvelle théorie philosophique ni la simple critique de l’entreprise philosophique : elle est une opération dans la langue de la philosophie. Déconstruire la philosophie traditionnelle ne revient pas à l’abandonner, mais à la lire différemment, ce qui implique inévitablement de la réécrire.
Derrida caractérise en effet la déconstruction comme une « pratique» ou une « stratégie du travail textuel », qui suppose toujours un double geste : une phase de « renversement », et une phase de « déplacement positif »[26]. Le renversement consiste à dévoiler les oppositions philosophiques classiques comme des hiérarchies violentes au sein desquelles l’un des deux termes conceptuels commande l’autre axiologiquement ou logiquement (l’idée / à la matière, l’intelligible / au sensible, le transcendantal / l’empirique, la parole / l’écriture) : ce que l’on prenait pour la « coexistence pacifique d’un vis-à-vis » se dévoile alors dans les textes même des auteurs comme une « hiérarchie violente », comme une « structure conflictuelle et subordonnante », maintenue en dépit des contradictions qu’elle engendre et des impensés auxquels elle oblige[27]. Mais Derrida ajoute que s’en tenir à cette phase revient encore à opérer sur le terrain et à l’intérieur du système déconstruit. Pour effectuer un véritable déplacement, il s’agit d’introduire dans ce texte ce que Derrida appelle une marque : une notion ou un terme qui ne se laisse plus comprendre dans le régime antérieur, au sein des oppositions conceptuelles classiques, mais qui permet au contraire de réinscrire les anciens concepts dans de nouvelles chaînes de significations, afin de changer la portée des questionnements[28]. Si, comme l’a montré Derrida à partir des travaux linguistiques de Saussure, un concept ne prend sens qu’en se différenciant des autres, ce sont les relations entre les concepts qu’il faudra modifier pour transformer leur contenu de signification. Rien ne sert de proposer de nouvelles définitions pour attribuer de nouveaux « signifiés » à d’anciens « signifiants » : ce sont les forces régissant l’économie des textes qui devront être ébranlées.
Qu’est-ce qu’un concept métaphysique ?
C’est pourquoi, malgré la radicalité de son geste critique, Derrida soutient qu’aucun concept n’est en lui-même métaphysique. Le caractère métaphysique d’un concept dépend en fait de la configuration textuelle dans laquelle il s’inscrit[29] : si un concept prend son sens au sein de la structure oppositionnelle classique qui repose elle-même sur les présuppositions phonologocentristes, alors il constitue un concept problématique, portant avec lui le désir de présence pleine qui caractérise la métaphysique de la présence. Mais s’il prend sens hors de cette structure oppositionnelle, au sein d’une configuration textuelle qui met en œuvre une autre logique, alors il faudra le reconnaître comme un « pas hors de la métaphysique ». Une fois le concept démarqué de ses relations habituelles avec les autres concepts, et réinscrit dans une nouvelle chaîne de signification, l’usage de son « vieux nom[30] » pourrait devenir inutile, voire problématique, dans la mesure où il porte avec lui toutes les présuppositions et les impensés que le nouveau texte invite à dépasser : au terme du double geste déconstructif, il apparaîtra alors nécessaire de renoncer aux anciens concepts, au risque de réintroduire le fond sémantique qu’ils transportent inévitablement avec eux. Mais cela ne signifie pas pour autant que la déconstruction d’un concept vise le simple abandon de ce concept : elle a au contraire pour fonction de faire apparaître les problèmes que ce concept empêchait de poser ou permettait de masquer, dans un discours dont la logique et la structure ont pour cela dû être transformées.
On comprend alors l’attitude ambiguë adoptée par Derrida par rapport aux concepts de sujet ou d’histoire. En effet, lui qui a marqué l’appartenance de ces concepts à la clôture de la métaphysique ne cessera pourtant de s’opposer à la doxa de la « fin de l’histoire[31] » ou de la « liquidation du sujet[32] », qui traversent son époque. Qu’il s’agisse de la question de la subjectivité ou de celle de l’historicité, la structure formelle du problème semble être la même. Dans les deux cas en effet, et conformément à sa position concernant la tradition philosophique en général, Derrida semble à la fois :
-montrer ce qui fait le caractère métaphysique des concepts de sujet et d’histoire (en mettant au jour les présupposés et le « fond sémantique » que ces concepts transportent) ;
-esquisser les exigences d’une nouvelle conception de ce qu’on appelait « sujet » et « histoire » ;
-affirmer la nécessité d’abandonner ces notions afin de réinscrire les questions dans de nouvelles configurations textuelles et d’ouvrir de nouveaux problèmes, hors des présomptions logocentristes qui caractérisent la métaphysique de la présence.
II. La déconstruction du concept de sujet.
La critique du concept métaphysique de sujet
Qu’est ce qui, selon Derrida, fait donc de la notion de sujet un concept métaphysique ? Vers quelle nouvelle conception dudit « sujet » la déconstruction de l’ancien concept fait-elle signe ? Et à partir de quelles catégories est-il alors possible d’appréhender ce qui avait traditionnellement été pensé sous le nom de « subjectivité » ?
Derrida reconnaît évidemment qu’il n’existe pas quelque chose comme une conception générale et homogène du sujet, parcourant toute la philosophie moderne[33], mais il précise que cela ne doit pas interdire pour autant de chercher certaines analogies ou ressources communes, certains prédicats indissociables des différentes figures du sujet, qui, une fois déconstruits, obligeraient à inquiéter l’unité même du concept et du nom[34]. Autrement dit, bien que le « je pense » kantien remette en question tout l’argumentaire de l’ontologie cartésienne, bien que le Dasein heideggérien se définisse par une déconstruction du cogito cartésien, bien que la conception d’autrui de Lévinas ou la théorie de l’inconscient de Lacan subvertissent les conceptions traditionnelles du sujet[35], Derrida soutient néanmoins que le cogito, le « je pense transcendantal », le Dasein, ou le sujet subverti, s’ils diffèrent sur leur contenu de signification, partagent une même fonction dans le discours et un certains nombres de traits formels. Selon Derrida, tout en s’opposant les uns aux autres, Descartes, Kant, Heidegger, Lévinas ou Lacan signent ainsi leur appartenance à un même dispositif discursif, à une même « tradition cartésienne ».
Selon Derrida, les différentes conceptions du sujet précédemment évoquées partagent au moins deux traits caractéristiques, qui témoignent de leur appartenance à la métaphysique de la présence : non seulement la notion même de sujet (ou celle qui prend sa place) transporte toujours avec elle un certain fond sémantique (elle implique toujours l’idée de stabilité, de présence permanente, de maintenance dans le rapport à soi, et signe ainsi une certaine relève de la métaphysique de la substance par une métaphysique de la subjectivité), mais surtout, elle demeure intrinsèquement liée, dans tous les discours, à la notion d’humanité, et sert à séparer radicalement l’homme du reste du vivant par une frontière une et indivisible. Si bien que même les discours qui refusent de penser le sujet comme origine absolue, identité à soi ou présence à soi d’une conscience, mais affirment une non coïncidence à soi ou un sujet constitué par l’appel de l’autre, continuent à lier la subjectivité à l’homme, et à la refuser à l’animal[36].
La lecture derridienne du texte heideggérien est paradigmatique de ce geste qui consiste à repérer une relève de la métaphysique ou de l’humanisme dans les textes qui en sont à première vue les plus éloignés. Derrida soutient ainsi que quand bien même le Dasein serait irréductible à une subjectivité, il occupe néanmoins la même place ou la même fonction originaire dans le discours que celle du sujet dans un dispositif ontologico-transcendantal classique (le Dasein constitue l’étant exemplaire, point de départ de l’ontologie fondamentale). Quand bien même le Dasein n’est plus défini à partir de la pensée, de la raison, de la conscience ou de ses vécus, il se caractérise néanmoins par une présence ou une proximité à l’être, un accès à l’en tant que tel, qui le définit en propre indépendamment de toute « existence comme vie[37] ». Bref, selon Derrida, Heidegger renoue ainsi avec le geste cartésien de « neutralisation » ou de « secondarisation » de la vie dans la définition du soi[38].
Ce qui s’apparente plus ici à un « effet de subjectivité » qu’à un « concept de sujet » sert en fait à affirmer une frontière entre l’homme et le reste du vivant, et à laisser une place libre « dans la structure même des discours, qui sont aussi des cultures, pour une mise à mort non criminelle[39] » du vivant en général, qui échappe à l’impératif éthique. Bien qu’ils bouleversent la métaphysique (déterminée comme onto-théologie ou ontologie) et l’humanisme traditionnel, Derrida soutient que les discours de Heidegger et de Lévinas demeurent des « humanismes profonds » : « tous les deux le sont, malgré les différences qui les séparent, en tant qu’ils ne sacrifient pas le sacrifice. Le sujet (au sens de Lévinas) et le Dasein sont des ‘hommes’ dans un monde où le sacrifice est possible et où il n’est pas interdit d’attenter à la vie en général, seulement à la vie de l’homme, de l’autre prochain, de l’autre comme Dasein.[40]». Il s’agit donc pour Derrida de mettre au jour, par-delà la diversité des doctrines, le maintien de la « structure sacrificielle » du discours philosophique, qui ne permet pas de penser une « responsabilité à l’égard du vivant en général »[41].
Vers une nouvelle problématique du « sujet »
La déconstruction du concept de sujet en appellera donc « à un droit plus exigeant encore, prescrivant, autrement, plus de responsabilité », une « responsabilité excessive », non pas « limitée, mesurée, calculable, rationnellement distribuable », mais « irréductible à la catégorie traditionnelle de sujet »[42]. Derrida soutient en effet que la déconstruction du concept de sujet engage « les grandes questions de la responsabilité éthique, juridique, politique, autour desquelles s’est constituée la métaphysique de la subjectivité ». Il ne pourra donc pas s’agir de simplement attribuer aux animaux les droits anciennement réservés aux « sujets » dits humains, alors que le concept même de droit ne doit son sens qu’à ses liens avec ceux de subjectivité ou d’humanité. Il s’agit moins pour Derrida de « rendre à l’animal » ce dont on l’a traditionnellement privé, que de réinscrire ce que l’on a traditionnellement déterminé comme cogito, sujet, conscience ou Dasein dans la vie[43], sans pour autant « effacer les ruptures et les hétérogénéités[44] ». Car l’idée de Derrida n’est évidemment pas d’affirmer une « continuité homogène » entre ce qu’on appelle l’homme et ce qu’on appelle l’animal » mais bien de contester leur opposition binaire, leur séparation par une seule frontière linéaire et indivisible, en élaborant des concepts qui « concernent différentiellement tous les vivants » et en mettant en œuvre une « autre logique de la limite »[45] .
Bref, il s’agit de restructurer le discours, afin de situer autrement la question de ce qui ne pourra plus dès lors être appelé un « sujet humain ». En effet, si Derrida « garde provisoirement ce nom comme index », il soutient néanmoins qu’à partir du moment où l’on ne voudra plus désigner par là une origine absolue du discours, une idée de permanence et de stabilité, un rapport ou une présence à soi, une auto-présentation de soi opposée à l’auto-motion ou à l’auto-affection qui caractérise le vivant, il deviendra difficile de conserver le terme de « sujet » sans « réintroduire ce qui est justement en question » et donner ainsi lieu « à des malentendus énormes »[46]. Il vaudra mieux, « une fois le chemin frayé, oublier un peu le mot » et tenter de « changer la portée » des questionnements[47].
C’est pourquoi Derrida avait mobilisé les notions de gramme, de trace, ou de différance au lieu de recourir aux concepts qui servent habituellement à distinguer l’homme des autres vivants : ces notions n’étaient pas réservées à l’homme ou à l’animal, mais avaient au contraire pour fonction de penser la possibilité de la « conscience intentionnelle » à partir du « double mouvement de protention et de rétention » caractérisant l’histoire de la vie. Derrida avait aussi mobilisé la notion de « singularité différante », qu’il distinguait de l’individualité constituée d’une substance une et identique à elle-même, afin de suggérer un rapport d’altérité à soi, dans lequel l’appel de l’autre précède l’identification d’un soi qui ne cesse de se différer. Une telle « singularité a-subjective[48] » devait substituer aux qualités de stance, de stabilité, de présence permanente ou de maintenance traditionnellement liées à la subjectivité, une « relative stabilisation de ce qui reste non stable », mais qui n’en implique pas moins une irremplaçabilité, une non-substituabilité ou une incalculabilité, engageant une « nouvelle détermination (post-déconstructive) de la responsabilité »[49].
Néanmoins, ces notions ne semblent pas avoir permis à Derrida d’opérer un véritable «déplacement positif de la question du sujet : en 1989, dans l’entretien sur « le sujet qui vient », la restructuration du discours demeure encore pour Derrida une « tâche qui reste à venir[50] », et en 1997, lors du colloque sur l’animal autobiographique, le langage inouï qui devait permettre de passer « la frontière de l’anthropocentrisme[51] » et de « s’orienter vers un autre type de responsabilité[52] » demeure encore un « rêve » à réaliser[53]. En dépit de cet inachèvement, le travail de Derrida sur la question du sujet semble tout de même permettre de formuler les exigences d’une conception non métaphysique ou non logocentrique du sujet. Contrairement au langage métaphysique qui impliquait de couper la subjectivité (substance pensante, je pense transcendantal, conscience, être-au-monde) du reste du vivant, réservant ainsi la responsabilité éthique et le droit aux « sujets humains », ce discours devraient permettre de penser une singularité différant de soi, constituée à partir de l’autre, et surtout de réinscrire ladite « subjectivité » dans le processus de la vie. Un tel discours sur ce qui ne mériterait dès lors plus le nom de sujet devrait ainsi ouvrir à une nouvelle conception de la responsabilité.
La suite de cet article sera publiée prochainement sous le titre « Penser dans l’après-coup de la postmodernité 2/2 ».
Elle concernera les deux questions suivantes :
III. La déconstruction du concept d’histoire
IV. L’avenir de la déconstruction
[1] B. Stiegler, États de choc. Bêtise et savoir au XXIème siècle, Paris, Mille et une nuits, 2012, p. 10 et p. 14-15.
[2] Ibid., p. 13, p. 16-17 et p. 28-29.
[3] Ibid., p. 13.
[4] T. Adorno et M. Horkheimer, Dialectique de la raison (1947), Paris, Gallimard, 1983.
[5] J.-F. Lyotard, La condition postmoderne, Paris, Minuit, 1979, p. 7.
[6] J.-F. Lyotard, « Une fable postmoderne », in Moralités postmodernes, Paris, 1993, p. 91.
[7] « Le débat est ouvert – il est international – depuis quelques années sur la question de la postmodernité. Le projet moderne d’émanciper l’humanité de l’ignorance, de la sujétion, de la misère en développant et répandant les connaissances, les techniques, les arts et les libertés, est-il encore d’actualité en cette fin de XXe siècle ? On peut en douter. Les démocraties occidentales nées du Siècle des lumières ont permis et accepté l’impérialisme et la guerre totale. Les recherches de pointe ont été promues par le régime nazi, dans des conditions parfois atroces. (…) L’enrichissement de l’Occident provoque le chômage au Nord et la misère au Sud. Le marché des médias crée le despotisme de l’opinion et le critère de la « réussite » atrophie tous les respects : celui de la vie, de la mort, de la nature, du sentiment du savoir, bref de l’homme. Il est clair cependant que le pouvoir de l’homme, depuis son corps jusqu’aux galaxies, ne cesse de s’accroître. Mais à quelle fin ? Le projet moderne se perpétue, mais dans l’inquiétude. », J.-F. Lyotard, « Argument 1 : la postmodernité », catalogue de l’exposition Les immatériaux.
[8] J.-F. Lyotard, « Une fable postmoderne », in Moralités postmodernes, op. cit. p. 93.
[9] J.-F. Lyotard, « Murs, golfes, systèmes », in Moralités postmodernes, op. cit., p. 77.
[10] « L’incertitude engendre en réaction, un désir de sécurité, de stabilité, d’identité. Ce désir prend mille formes ; il se déguise même sous le nom de postmodernité! », J.-F. Lyotard, « Argument 1 : la postmodernité », catalogue de l’exposition Les immatériaux.
[11] B. Stiegler, États de choc, Bêtise et savoir au XXIème siècle, op. cit., p. 13.
[12] B. Stiegler, États de choc, Bêtise et savoir au XXIème siècle, op. cit., p. 20 et note 1.
[13] B. Stiegler, États de choc, Bêtise et savoir au XXIème siècle, op. cit., p. 26-27.
[14] « …car je ne crois pas du tout à ce qu’on appelle couramment aujourd’hui la mort de la philosophie. » J. Derrida, Positions, Pais, Minuit, 1972, p. 14 ; « Si au cours des vingt-cinq dernières années, en France, les plus notoires de ces stratégies ont en effet procédé à une sorte d’explication avec «la question du sujet», aucune d’elles n’a cherché à ‘liquider’ quoi que ce soit. », J. Derrida, « Après le sujet qui vient » (entretien avec J.-L. Nancy) in Cahiers Confrontation, 20, hiver 1989 ; « Voilà pourquoi, en bref, je me sers si souvent du mot histoire, mais si souvent aussi avec des guillemets et des précautions qui ont pu laisser croire à un ‘refus de l’histoire’. », J. Derrida, Positions, op. cit., p. 81. « …je ne voulais pas abandonner l’histoire. La destruction du concept métaphysique d’histoire, pour moi, ne signifiait pas : il n’y a pas d’histoire. » J. Derrida, Politique et Amitié. Entretien avec Max Spinker sur Marx et Althusser, Paris, Galilée, 2011, p. 37.
[15] B. Stiegler, États de choc, Bêtise et savoir au XXIème siècle, op. cit., p. 26-27-28.
[16] B. Stiegler, États de choc, Bêtise et savoir au XXIème siècle, op. cit., p. 13.
[17] « Voyez-vous, ce qui m’a paru nécessaire et urgent, dans la situation historique qui est la nôtre, c’est une détermination générale des conditions d’émergence et des limites de la philosophie, de la métaphysique, de tout ce qui la porte et de tout ce qu’elle porte. ». J. Derrida, Positions, Paris, Minuit, 1972, p. 69.
[18] J. Derrida, L’Animal que donc je suis (1997), Paris, Galilée, 2006, p. 147.
[19] « Il y a là une puissante unité historique et systématique qu’on doit d’abord déterminer comme telle si l’on ne veut pas prendre des vessies pour des lanternes chaque fois qu’on prétend repérer des émergences, des ruptures, des coupures, des mutations, etc . » J. Derrida, Positions, op. cit., p. 69.
[20] « Ce développement, joint à celui de l’ethnologie et de l’histoire de l’écriture, nous enseigne que l’écriture phonétique, milieu de la grande aventure métaphysique, scientifique, technique, économique de l’Occident, est limitée dans le temps et dans l’espace, se limite elle-même au moment précis où elle est en train d’imposer sa loi aux seules aires culturelles qui lui échappaient encore. », J. Derrida, De la grammatologie, op. cit., p. 20 ; « Ce factum de l’écriture phonétique est massif, il est vrai, il commande toute notre culture et toute notre science, et il n’est certes pas un fait parmi d’autres. Il ne répond néanmoins à aucune nécessité d’essence absolue et universelle. », ibid., p. 45.
[21] « …l’histoire de la métaphysique qui, malgré toutes les différences et non seulement de Platon à Hegel (en passant même par Leibniz) mais aussi, hors de ses limites apparentes, des présocratiques à Heidegger, a toujours assigné au logos l’origine de la vérité en général : l’histoire de la vérité, de la vérité de la vérité, a toujours été, à la différence près d’une diversion métaphorique dont il nous faudra rendre compte, l’abaissement de l’écriture et son refoulement hors de la parole pleine. », ibid., p. 11.
[22] C’est que Derrida montre notamment dans en 1966 dans « La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines » (en suggérant que l’anthropologie de Lévi-Strauss et la découverte de la prohibition de l’inceste implique de questionner les catégories de nature et de culture, et toutes les oppositions métaphysiques qui leurs sont associées), ou en 1967 dans De la grammatologie (en suggérant que la linguistique de Saussure et la conception systématique de la langue qu’elle implique suppose de renoncer à l’exigence de signifié transcendantal qui caractérise la métaphysique occidentale). Voir « La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines » (1966) in L’écriture et la différence, Paris, Seuil, 1972 et De la grammatologie, Paris, Minuit, 1967.
[23] « Mais si personne ne peut en échapper, si personne n’est responsable d’y céder, cela ne veut pas dire que toutes les manière d’y céder soient d’égales pertinence. La qualité et la fécondité d’un discours se mesurent peut-être à la rigueur critique avec laquelle est pensé ce rapport à l’histoire de la métaphysique et aux concepts hérités. » J. Derrida, « La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines » (1966), in L’écriture et la différence, op. cit., p. 414.
[24] J. Derrida, Positions, op. cit. p. 11.
[25] J. Derrida, « La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines » (1966) in L’écriture et la différence, op. cit., p. 421. Derrida souligne.
[26] J. Derrida, Positions, op. cit., p. 56 et p. 88.
[27] Ibid., p. 57.
[28] « Le motif de la différance, quand il se marque d’un a silencieux, ne joue en effet ni à titre de concept ni à titre de mot. J’avais essayé de le démontrer. Cela ne l’empêche pas de produire des effets conceptuels et des concrétions verbales ou nominales. (…) Ne pouvant plus s’élever comme un maître mot ou comme un maître concept, barrant tout rapport au théologique, la différance se trouve prise das un travail qu’elle entraîne à travers une chaîne d’autre concepts, d’autres mots, d’autres configurations textuelles (…) Leurs effets ne se retournent pas seulement sur eux-mêmes par une sorte d’auto-affection sans ouverture, ils se propagent en chaîne sur un texte, de façon chaque fois différente ». J. Derrida, Positions, op. cit., p. 54.
[29] « Il a pu m’arriver de parler très vite de ‘concept métaphysique’. Mais je n’ai jamais cru qu’il y eut des concepts métaphysiques en eux-mêmes : aucun concept n’est métaphysique en soi hors de tout le travail textuel dans lequel il s’inscrit. », ibid., p. 78.
[30] Ibid., p. 96.
[31] « …je ne voulais pas abandonner l’histoire. La destruction du concept métaphysique d’histoire, pour moi, ne signifiait pas : il n’y a pas d’histoire. » J. Derrida, Politique et amitié, op. cit., p. 37.
[32] « Si au cours des vingt-cinq dernières années, en France, les plus notoires de ces stratégies ont en effet procédé à une sorte d’explication avec ‘ la question du sujet’, aucune d’elles n’a cherché à ‘liquider’ quoi que ce soit. », J. Derrida, « Après le sujet qui vient », op. cit.
[33] « Cela aurait au moins la vertu de désimplifier, de ‘déshomogénéiser’ la référence à quelque chose comme le Sujet. Il n’y a jamais eu pour personne Le Sujet, voilà ce que je voulais commencer par dire. », ibid.
[34] « Qu’est-ce que, dans une tradition qu’il faudrait identifier de façon rigoureuse (disons pour l’instant celle qui va de Descartes à Kant et à Husserl), on désigne sous le concept de sujet, de telle sorte qu’une fois certains prédicats déconstruits, l’unité du concept et du nom en soit radicalement affectée? », ibid.
[35] J. Derrida, L’animal que donc je suis, op. cit., p. 153
[36] « Pourquoi ai-je rarement parlé de ‘sujet’ ou de ‘subjectivité’, mais seulement, ici ou là, d’ ‘effet de subjectivité’ ? Parce que le discours sur le sujet, là même où il reconnaît la différence, l’inadéquation, la déhiscence dans l’auto-affection, etc., continue à lier la subjectivité à l’homme. Même s’il reconnaît que 1’‘animal’ est capable d’auto-affection (etc.), ce discours ne lui accorde évidemment pas la subjectivité – et ce concept reste alors marqué par toutes les présuppositions que je viens de rappeler. », J. Derrida, « Après le sujet qui vient », op. cit.
[37] J. Derrida, L’animal que donc je suis, op. cit., p. 153.
[38] Pour Descartes, l’indubitabilité de l’existence, l’auto-position et l’auto-manifestation du ‘je suis’ ne dépend pas de l’être en vie, mais de la pensée, de même que pour Kant, le « je pense transcendantal » n’est pas déterminé à partir de la vie organique. Sur ce point voir J. Derrida, L’animal que donc je suis, op. cit., p. 103-104, p.122 et p. 153.
[39] Ibid.
[40] Ibid.
[41] Ibid.
[42] Ibid.
[43] Voir J. Derrida, L’animal que donc je suis, op. cit., p. 217-219.
[44] « Il ne s’agit pas d’effacer les ruptures et les hétérogénéités. Je conteste seulement qu’elles donnent lieu à une seule limite oppositionnelle, linéaire, indivisible, à une opposition binaire entre l’humain et l’infrahumain. », J. Derrida, « Après le sujet qui vient », op. cit.
[45] J. Derrida, L’animal que donc je suis, op. cit., p. 144 et p. 51.
[46] J. Derrida, « Après le sujet qui vient », op. cit.
[47] Ibid., p. 92.
[48] J. Derrida, Politique et Amitié, op. cit., p. 86.
[49] J. Derrida, « Après le sujet qui vient », op. cit.
[50] « C’est ce qui conduit à reconnaître les processus de la différance, de la trace, de l’itérabilité, de l’ex-appropriation, etc. Ils sont à l’œuvre partout, c’est-à-dire bien au-delà de l’humanité. Un discours ainsi restructuré peut tenter de situer autrement la question de ce qu’est, peut être, doit être un sujet humain, une morale, un droit, une politique du sujet humain. Cette tâche reste à venir, très loin devant nous. », J. Derrida, « Après le sujet qui vient », op. cit.
[51] J. Derrida, L’animal que donc je suis, op. cit., p. 144.
[52] J. Derrida, « Après le sujet qui vient », op. cit.
[53] « Je rêvais d’inventer une grammaire et une musique inouïes pour faire une scène qui ne soit ni humaine, ni divine, ni animale, en vue de dénoncer tous les discours sur le dit animal, toutes les logiques ou axiomatiques anthropo-théomorphiques ou anthropo-théocentriques, la philosophie, la religion, la politique, le droit, l’éthique », J. Derrida, L’animal que donc je suis, op. cit., p. 93.












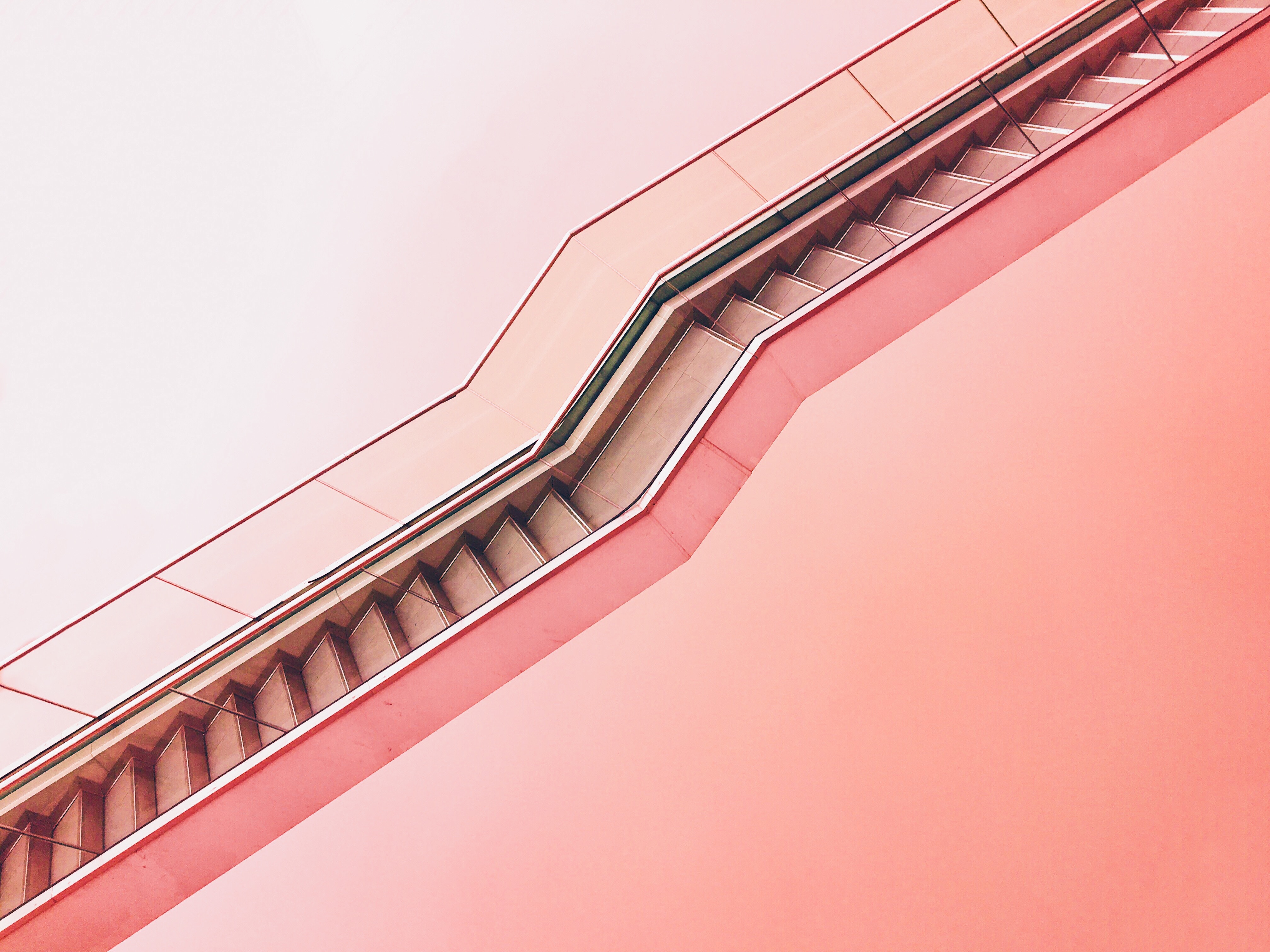


De l’analyse du déclin institutionnel de la crise de l’éducation:
il nous fait repenser le pouvoir financier et ses moyens punitifs d’éduquer à informer.
Il ne s’agit pas de postmodernité, mais d’un pouvoir mondial – néolibéralisme – qui rejoint les aspects les plus négatifs de la postmodernité.
Ces aspects sont: la post-vérité, l’absence d’un projet construit sur les valeurs de la culture.
La culture comprise comme une élaboration sociale et en conjonction avec les sujets actifs.
L’éducation doit faire avec la société où elle considère l’autre comme une exclusion sociale, une société individualiste qui coupe les liens humains,
ne peut pas éduquer, ne peut pas construire de nouvelles valeurs communautaires. Le positif de la postmodernité: la vérité absolue est tombée. Mais les institutions de punition autour du monde ont régné encore. En tant que chercheur en éducation, et le grand héritage de Michel Foucault et des grands sociologues français, c’est un plaisir
dialogue avec vous, parce que les droits sont atteints avec la lutte, la France est le berceau des grands intellectuels. Une fierté Rosario Argentine.
Bonjour,
Peut-être ceci pourrait-il vous intéresser…
https://www.youtube.com/watch?v=kBCDU_PnavQ
Cordialement