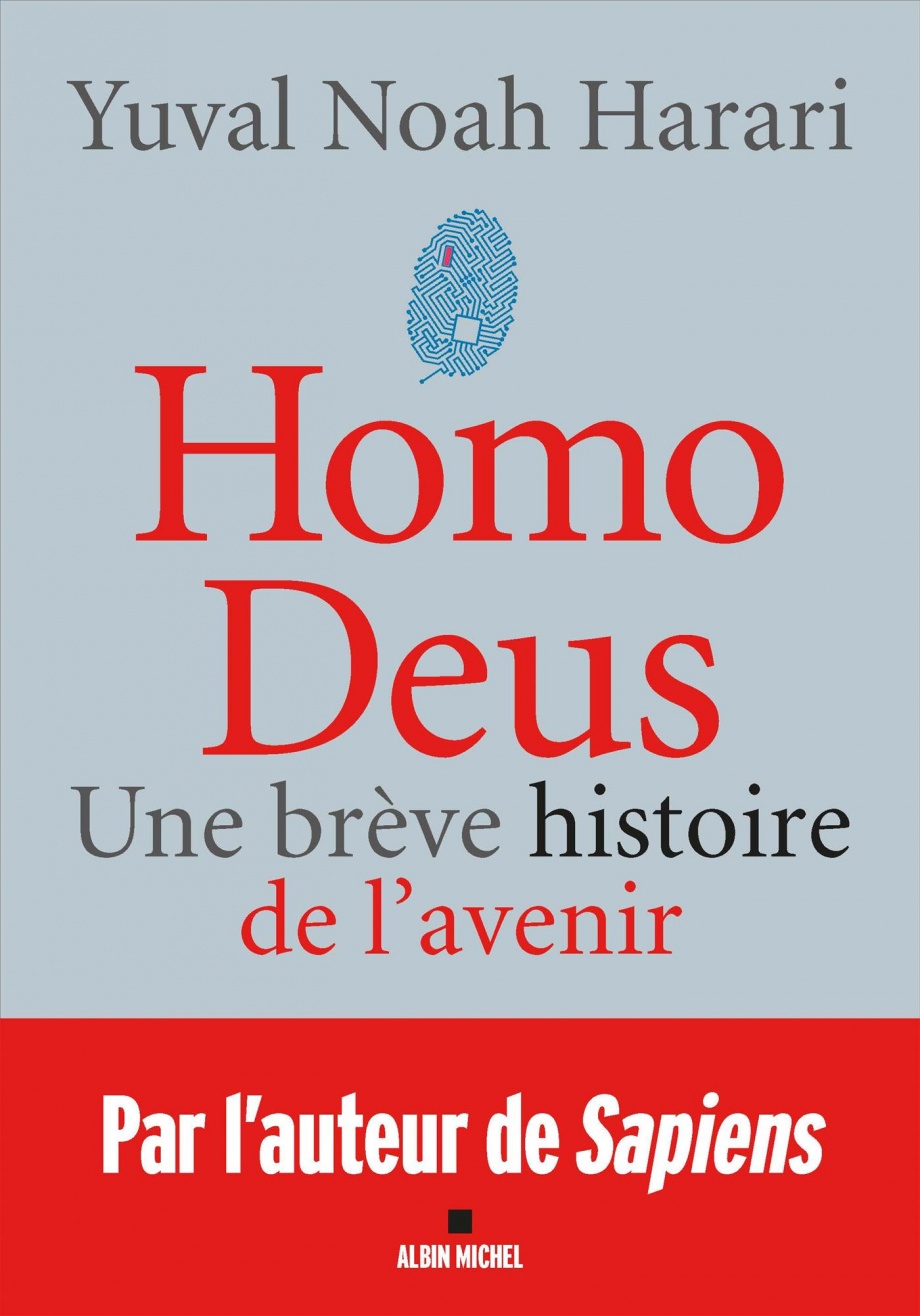Migration et justice climatique
Les changements climatiques sont depuis longtemps reconnus comme l’une des causes qui amènent les individus à se déplacer. Ce constat figurait déjà en bonne place dans la première théorie systématique des migrations formulée par Ravenstein en 1889.[1] Ce qui semble distinguer notre époque des autres sous ce rapport, c’est moins le phénomène lui-même que l’échelle à laquelle nous estimons qu’il s’intensifiera. En raison du réchauffement climatique, on prévoit que l’élévation du niveau de la mer de 0.3 à 0.8 mètre dans les prochaines décennies, par exemple, affectera quelques 146 millions de personnes pour la plupart dans les pays en développement ou en voie de l’être.[2] On pourrait en dire autant des pluies torrentielles, des inondations, des cyclones tropicaux, des sécheresses et de la désertification. Des millions de personnes seront également touchées par ces désastres naturels qui seront de plus en plus fréquents. Si l’on ne saurait présumer que tous ces individus décideront de migrer uniquement à cause des changements climatiques, il est raisonnable de croire qu’au moins certains d’entre eux, — les habitants des îles ou des pays situés quelques centimètres seulement au-dessus du niveau de la mer, comme les Maldives, Tuvalu et le Bangladesh, par exemple —, seront contraints de le faire en raison de la salinisation des sols. Cette situation serait certainement déplorable, mais elle ne serait pas alarmante, si le sort de ces individus n’était pas aggravé par les barrières économiques et politiques qui les empêchent de circuler librement.[3] L’histoire conserve en effet la mémoire des migrations de plusieurs populations. Mais les changements climatiques poussent les individus à se déplacer aujourd’hui dans un contexte politique encore largement dominé au niveau international par le système des États-nations en dépit de la mondialisation économique et de l’exception que constitue l’espace Schengen en Europe.

Source : Stock.Xchng
L’étude des migrations induites par les changements climatiques est très complexe, parce que ces deux domaines sont hautement interdisciplinaires et très politisés.[4] Les rares philosophes qui ont abordé cette question l’ont habituellement fait en référence aux exigences de la justice globale.[5] Leur discussion a porté sur trois enjeux particuliers : d’abord la question nominale du statut légal à attribuer aux individus concernés; ensuite, celle de la nature de leurs droits et des devoirs des États envers eux; enfin, celle du partage des responsabilités que les États pourraient avoir envers ces individus et leur portée. Tous ces enjeux ont en commun de présupposer un ordre institutionnel. Dans les lignes qui suivent, nous rappelerons d’abord les principales conclusions auxquelles ont mené cette discussion avant de montrer comment une excursion hors du cadre institutionnel pourrait permettre d’établir un véritable droit à la mobilité au lieu du droit à la relocalisation proposé par Mathias Risse.
1. Quel statut légal donner à ceux que le climat force à migrer ?
Comment devrait-on appeler les individus qui sont contraints de se déplacer en raison des changements climatiques ? Les expressions qui se sont imposées dans l’usage sont celles de «réfugiés environnementaux» et de «réfugiés climatiques».[6] L’emploi du terme politiquement très chargée de «réfugiés» a cependant donné lieu à de nombreuses critiques.[7] Tout d’abord, on a soutenu que l’association des mots «réfugiés» et «environnement» simplifiait à outrance les causes de la migration. D’autres ont ensuite contesté la pertinence de cette association parce qu’elle introduisait une dimension naturelle dans un domaine, celui du droit d’asile, qui est essentiellement politique. Enfin, certains ont dit craindre qu’une trop grande extension du concept de réfugié n’en dilue le sens légal précis et qu’elle incite les gouvernements à fuir davantage leurs responsabilités, contribuant ainsi à mettre en péril les «vrais» réfugiés politiques dont la situation est déjà précaire.
Face à ces critiques, on peut faire valoir que la reconnaissance des causes multiples des migrations humaines n’implique aucunement que certains individus ne soient pas forcés de se déplacer à cause des changements climatiques.[8] On peut donc admettre que certains d’entre eux migrent en raison de ces changements. Comme il est par ailleurs maintenant bien établi que les changements climatiques résultent en grande partie de l’activité économique des pays riches du Nord, plus précisément de la concentration des émissions de gaz carbonique engendrées par la combustion des carburants fossiles dans l’atmosphère, on peut légitimement associer ces changements et les personnes qui en sont victimes au domaine politique. Quand à la question de savoir s’il serait dangereux d’étendre le concept de réfugié, tel qu’il est défini par exemple dans la Convention de Genève de 1951, aux migrants environnementaux, on peut remarquer qu’il est loin d’être évident qu’une telle extension conduirait automatiquement à l’effacement de la distinction entre migrants politiques (ceux qui sont forcés de se déplacer) et migrants économiques (ceux qui choisissent volontairement de se déplacer). Car on pourrait avancer, à condition d’admettre la validité de l’argument précédent, que les réfugiés environnementaux relève d’un ordre de causalité distinct, soit celui de la société globale, alors que les réfugiés des autres catégories sont le plus souvent produits par des causes d’ordre local ou régional.[9] Quoiqu’il en soit de cette discussion sémantique, deux choses sont claires : 1-Les tentatives de mettre en circulation des expressions alternatives pour décrire la situation des personnes contraintes de se déplacer pour des raisons environnementales, telles que «migrants environnementaux», «mouvement de population induit par l’environnement» ou «personnes environnementalement déplacées» se sont heurtées à des difficultés similaires et elles ne sont pas parvenues à rallier tous les chercheurs, ce qui n’empêche pas certains d’entre eux de continuer à les employer.[10] Il faut donc temporairement faire le deuil du rêve d’une terminologie unique. 2-La question normative en jeu est bien celle de la meilleure manière de protéger ces individus. Par conséquent, on peut se demander quels sont leurs droits et quels sont les devoirs que les États ont envers eux ?
2. Droits des réfugiés environnementaux et devoirs des États
La fixation des droits et des devoirs des individus constitue un problème de justice sociale et la justice, Rawls nous l’a appris, est la première vertu des institutions. Puisque les changements climatiques sont un phénomène global, il pourrait être tentant de considérer la communauté internationale comme une tentative de coopération entre les peuples visant à répartir les coûts et les bénéfices des changements climatiques et de définir les droits des individus et les devoirs des États en conséquence. Rawls lui-même n’a jamais abordé directement la question des réfugiés environmentaux. Mais les erreurs qu’il commet dans sa théorie de la justice internationale sont très représentatives de celles qu’ont reproduit ceux qui s’en sont inspirés par la suite. Il vaut donc la peine de s’y arrêter brièvement pour comprendre quels sont les principaux obstacles à une reconnaissance des droits des migrants forcés de se déplacer par les changements climatiques.
Quand il imagine les représentants des peuples des nations du monde négociant en position originelle les principes de justice qui régiront leur future politique étrangère juste, Rawls part de deux présupposés. Il accepte d’abord l’ordre étatique, c’est-à-dire qu’il admet que chaque peuple est souverain en ce sens qu’il dispose de ses propres institutions sociales et politiques et qu’il possède son propre territoire. Autrement dit, il admet l’existence et la légitimité des frontières nationales. Il soutient ensuite que le choix des principes de justice doit lui-même respecter un autre principe, celui de la réciprocité, afin de pouvoir être entériné par les représentants de n’importe quel peuple raisonnable et/ou décent. Comme on le sait, la délibération qui s’ensuit conduit à l’adoption d’un ensemble de huit principes qui établiront autant de limites à l’exercice du droit à l’autodétermination. Mais aucun d’entre eux n’est un principe de justice distributive globale. À la place, Rawls défend un «devoir d’aider les autres peuples vivant dans des conditions défavorables qui les empêchent d’avoir un régime politique et social juste ou décent».[11] Cela serait-il suffisant pour donner des droits à ceux que le climat condamne à se déplacer ? Rien n’est moins certain.
Comme l’a souligné Derek Bell, même en adoptant une interprétation large des conditions défavorables pour inclure les changements climatiques, un devoir de ce type risque de ne pas être très utile, car l’aide en question serait destinée à aider les peuples aux prises avec des conditions défavorables à faire un meilleur usage de leur territoire et de leur environnement.[12] Rawls estime en effet que chaque peuple est responsable à perpétuité de son environnement et dans l’utopie réaliste qu’il envisage, les individus n’auraient plus aucune raison de vouloir migrer, puisque les causes de l’immigration disparaîtraient.[13] Les réfugiés climatiques n’auraient donc aucun droit d’être admis de manière permanente sur le territoire d’un autre État. À la défense de Rawls, on pourrait soutenir que les peuples menacés par l’élévation du niveau de la mer auraient toujours la possibilité de négocier des accords internationaux afin d’atténuer les effets des changements climatiques et/ou de mettre en place les mécanismes permettant de s’y adapter. Bien que tous les peuples diposerent alors de la garantie formelle d’être traités en tant que partenaires égaux pendant le déroulement de ces négociations[14], on peut craindre que l’accord final ne soit préjudiciable aux intérêts des peuples menacés, voire même à ceux des générations futures.[15] Le problème le plus évident est que tous les peuples n’auraient pas la même motivation à respecter un accord de ce type. Les pays riches du Nord étant les principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre auront tout intérêt à se comporter en passagers clandestins, puisqu’ils devront assumer la plupart des coûts liés à un tel accord. Les pays pauvres du Sud ou en voie de développement, plus touchés par les effets du changement climatique, sont aussi ceux qui profiteront le plus de cet accord. Par conséquent, ils seront également les plus motivés à le respecter. Mais sans un principe de justice distributive, les pays demeureraient toujours inégaux en termes de richesse et en termes d’environnement. Il y a donc lieu de croire que dans le cadre imaginé par Rawls, un accord international se conclurait inévitablement au détriment des intérêts des réfugiés environnementaux. Ceux qui se sont inspirés de cet aspect de la pensée de Rawls pour penser les conditions d’une justice climatique ont naturellement tenté de se prémunir contre cette conclusion. Mais l’attention quasi exclusive qu’ils ont accordée aux critères équitables d’une politique publique destinée à atténuer les changements climatiques a conduit ces auteurs à négliger les droits des réfugiés environnementaux.[16] Pour comprendre pourquoi, il faut revenir brièvement sur les prémisses du raisonnement de Rawls.
Nous l’avons vu, Rawls considère d’abord que les acteurs pertinents pour penser la justice internationale sont les États et les peuples plutôt que les individus. Appelons cette prémisse, l’étatisme. Du point de vue de son ordre étatique idéal, la circulation des individus entre les États est une anomalie vouée à disparaître. Ce parti-pris, qui présuppose que les migrations sont un phénomène exceptionnel dans l’histoire de l’humanité et que dans l’évaluation morale, il faut accorder la priorité aux préférences de ceux qui restent sur place, porte également un nom : c’est du sédentarisme.[17] Puisque les non-citoyens sont exclus du champ d’application de la justice internationale, les seuls devoirs que les États ont envers eux sont des devoirs d’aide naturels. Enfin, Rawls défend un procéduralisme dans la mesure où il croit que c’est l’équité de la procédure avec laquelle sont négociés les accords internationaux qui garantit celle de leurs résultats.
Les philosophes post-rawlsiens se sont beaucoup affrontés sur la question de la portée de la justice distributive. Ceux qui sont demeurés fidèles à Rawls ont tenté de renouveler la ségrégation morale qu’il établit entre les citoyens et les non-citoyens dans les relations internationales en s’appuyant principalement sur deux arguments : celui de la contrainte de l’État et celui de la réciprocité.[18] Mais la critique interne a démontré pour chacun d’eux que cette distinction était intenable.[19] Les rawlsiens non orthodoxes ont défendu pour leur part un principe de différence global se montrant ainsi d’emblée plus inclusivistes et ils ont reconnu le rôle de l’Occident dans le maintien des inégalités structurelles entre les pays à l’échelle mondiale.[20] Quelle que soit leur allégeance idéologique, le fait le plus remarquable est toutefois que ces philosophes aient presque unanimement repris l’hypothèse sédentariste de Rawls. D’où leur propension à soutenir que le devoir des États démocratiques libéraux envers les pays en développement en matière de justice distributive consiste principalement à allouer une aide matérielle ou financière locale.[21] Il n’est pas bien certain cependant que dans la situation où se trouvent les réfugiés environnementaux un meilleur exercice de leurs droits sociaux soit ce qui est le plus nécessaire. Ce sont plutôt leurs droits fondamentaux qui sont menacés. Pour mieux les prendre en considération, il faut accepter de lever l’hypothèse sédentariste de Rawls et sortir du carcan institutionnel.
3. Droit à la relocalisation ou droit à la mobilité ?
Dans l’histoire du libéralisme classique, au moins dans sa version déontologique, quand il s’agit d’établir les droits fondamentaux des individus, les penseurs expliquent comment est apparu l’ordre institutionnel légitime en partant de la propriété. C’est cette stratégie que Mathias Risse met en oeuvre pour défendre un nouveau droit, le droit individuel à la relocalisation, qui est en réalité un droit qualifié à l’immigration.[22] À première vue, une telle stratégie semble très prometteuse pour défendre les droits des réfugiés environnementaux, car elle fait appel aux individus plutôt qu’aux peuples et aux États. Mais, à la réflexion, on peut constater que Risse commet la même erreur que Rawls, ce qui limite la portée et la force du droit qu’il propose.
Dans sa démonstration, Risse suit le schéma usuel des philosophes du 17e siècle, mais s’appuie sur Grotius plutôt que sur les figures plus classiques de Locke ou de Kant. Il admet d’abord que la terre appartient collectivement à l’humanité. Ensuite, il déduit qu’en raison de cette dotation commune, tous les individus sont également co-propriétaires de la terre et possèdent un ensemble de droits naturels qui précisent leur statut à cet effet. Interprété dans le langage moral d’aujourd’hui, ce droit de co-propriété implique pour chaque individu en tant que membre de l’ordre global un droit à l’égale opportunité de satisfaire ses besoins fondamentaux dans la mesure où ceux-ci dépendent de l’accès aux ressources collectives. En conséquence, les individus doivent être protégés des interférences des autres dans leurs tentatives d’exercer ce droit et jouissent en ce sens non seulement du périmètre protecteur des droits revendicables (claims rights) mais également de l’immunité au sens hohlfeldien du terme. Toutefois, la simple existence du système des États à l’échelle internationale, compte tenu des pouvoirs qui s’y concentrent, peut menacer l’exercice des droits naturels des individus en les empêchant soit de satisfaire leurs besoins fondamentaux, soit de se déplacer. Sur la base d’un parallèle avec le droit de nécessité dans la pensée de Grotius, Risse déduit donc qu’il existe un droit compensatoire de relocalisation qui impose aux États deux devoirs moraux : celui de s’assurer que les nouveaux arrivants disposent des moyens d’assurer leur subsistance et celui de leur donner accès à la pleine citoyenneté plutôt que de leur attribuer le statut de réfugié. Risse juge en effet que ce statut ne serait acceptable que si les insulaires contraints de se déplacer en raison des changements climatiques disposaient d’une alternative à l’émigration. Or, de toute évidence, ce n’est pas le cas.
Cette défense serait impeccable si, avec le droit de nécessité de Grotius, elle ne reprenait pas à son insu le présupposé sédentariste que nous avons relevé chez Rawls. À l’instar de Grotius avant lui, Risse postule en effet un monde où la norme est encore de demeurer chez soi et où les individus ne se déplacent que dans des circonstances exceptionnelles. Son droit à la relocalisation est en conséquence un droit d’asile masqué. On peut s’en rendre compte en demandant si un tel droit autoriserait les réfugiés climatiques à immigrer dans le pays de leur choix. S’il s’agissait d’un véritable droit d’immigrer, en principe, la réponse devrait être oui. Dans les faits, Risse qualifie doublement l’exercice de ce droit. Il remarque d’abord que le devoir d’accueillir ces réfugiés, qui est indépendant de la contribution des pays aux changements climatiques, incombe uniquement dans l’ordre global aux États capables à la fois de satisfaire les besoins fondamentaux de leurs citoyens et ceux de nouveaux arrivants.[23] Il souligne ensuite que dans son application pratique, la responsabilité collective de cette mesure adaptive de lutte contre les changements climatiques exigerait un accord international sur une politique climatique pour déterminer quels pays doivent se charger de ce devoir. On pourrait alors, suggère-t-il, classer les pays en fonction de leur contribution aux effets des changements climatiques sur la base, par exemple, du principe pollueur/payeur et de leur capacité de payer, et leur attributer leur quote-part de responsabilité en conséquence. Les pays capables d’accueillir des réfugiés pourraient ensuite être sélectionnés pour se charger des habitants d’une île ou d’une région côtière particulière en fonction des liens qu’ils entretiennent déjà avec eux ou de leur capacité pratique. Ce qui fait problème avec cette proposition, ce n’est pas seulement l’équité du principe pollueur/payeur dans l’attribution des responsabilités entre les États, c’est aussi et surtout le fait qu’elle fasse intervenir le hasard alors que c’est précisément ce que la justice demande de neutraliser.
Pour éviter ces difficultés, il aurait mieux valu défendre un droit universel à la mobilité en s’appuyant sur le droit compensatoire des individus à la liberté d’association dans le scénario classique de Locke.[24] Une telle hypothèse présente au moins trois avantages : elle faciliterait les recours des réfugiés environnementaux qui pourraient alors faire valoir que l’existence de toutes les frontières (pas seulement celles des pays riches) violent leur droit fondamental de s’associer avec les personnes de leur choix (et celui de ces personnes d’en faire autant) alors que dans l’argument de Risse rien de garantit que les individus pourront aller là où ils le souhaitent; d’un point de vue descriptif, elle correspond mieux aux actions concrètes entreprises par le président de Kiribati, Anote Tong, donné par Risse en exemple dans son article, qui n’a pas attendu que ses citoyens possèdent un droit à la relocalisation pour demander à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande d’offrir à certains d’entre eux une formation professionnelle destinée à rendre leur émigration individuelle plus aisée[25]; elle permettrait de compléter l’attention quasi exclusive accordée aux institutions dans les études sur la justice climatique en dégageant un espace pour la libre entreprise et l’initiative individuelle. Certes, un droit à la mobilité n’empêcherait pas certains individus d’être contraints à se déplacer. Mais tous les réfugiés climatiques ne sont pas en quête d’une résidence permanente. Plusieurs d’entre eux migreront seulement de façon temporaire et même ceux qui devront éventuellement se relocaliser pourraient profiter d’un tel droit pour améliorer leurs chances de vie avant de choisir un endroit où s’établir. Cela ne règle pas, bien entendu, la question de l’offre équitable que les États devraient faire à ces personnes. Mais ce sera le sujet d’une autre étude.
Martin Provencher*
Chercheur, CREUM/Université de Montréal
* Remerciements à Dominic Desroches, Speranta Dumitru et Christian Nadeau.
[1] Cf. Pécoud, A. et al., « Migration and Climate Change : an Overview » Centre on Migration, Policy and Society, Working Paper No. 79, University of Oxford, 2010, p.2. On ne saurait donc soutenir que l’existence des réfugiés environnementaux est un phénomène nouveau comme l’avance Norman Myers. Cf. « Environmental Refugees : A Growing Phenomenon of the 21st Century », Philosophical Transactions of the Royal Society, 2005, B 357 (1420), p.609.
[3] Cf. PNUD, « Lever les barrières : mobilité et développement humain », Rapport mondial sur le développement humain 2009, Paris, Éditions La Découverte.
[4] Une difficulté supplémentaire pour la philosophie semble être que l’habitude de penser conjointement ces deux disciplines n’est pas encore prise. À titre d’exemple, mentionnons l’absence de référence aux migrations, aux réfugiés ou aux migrants environnementaux dans l’index de l’anthologie éditée récemment par Stephen M. Gardiner et al., Climate Ethics, New York, Oxford University Press, 2010.
[5] Les nationalistes libéraux ont également traité cette question en fonction des droits des groupes et, en particulier, des droits territoriaux sans nécessairement défendre une forme d’égalitarisme moral. Pour un exemple représentatif, cf. Nine, C., « Ecological Refugees, State Borders, and the Lockean Proviso », Journal of Applied Philosophy, Vol. 27, No 4, 2010, p.359-375.
[6] Cf. El-Hinnawi, E., Environmental Refugees, New York, United Nations Environment Programme, 1985, p.4 Nous citons d’après l’article de Derek Bell mentionné à la note 6 ; Myers, N. et Kent, J., « Environmental Exodus : An Emergent Crisis in the Global Arena » Washington, Climate Institute, 1995, p.18.
[7] Dans ce qui suit, nous reprenons les principales objections recensées par Bell, D.R., « Environmental Refugees : What Rights ? Which Duties ? » Res Publica, No 10, 2004, p.137-138 ; Pécoud, A., et al., Migration and Climate Change : an Overview, Centre on Migration Policy and Society, Working Paper No 79, University of Oxford, 2010, p.12-15 ; Juss, S.S., International Migration and Global Justice, Burlington, Ashgate, 2007, p.171-176.
[8] À moins de soutenir qu’aucune migration ne peut jamais s’expliquer à l’aide d’une seule cause. C’est l’opinion de Stephen Castles rapportée par Pécoud et al., ibid., p.13.
[9] C’est l’argument de R. Zetter dans « The role of legal and normative framework for the protection of environmentally displaced people » (2009) tel que rapporté par Pécoud et al., « Migration and Climate Change : an Overview » Centre on Migration, Policy and Society, Working Paper No. 79, University of Oxford, 2010, p.14
[11] Rawls, J., Paix et démocratie, Montréal, Boréal, 2006, p.52.
[12] Bell, D. R., « Environmental Refugees : What Rights ? Which Duties ? » Res Publica, 10, 2004, p.143. Dans ce paragraphe, nous reprenons l’essentiel de son analyse.
[13] Parmi ces causes, Rawls mentionne la persécution des minorités ethniques et religieuses, l’oppression politique sous toutes ses formes, la famine et la pression démographique. Cf. Rawls, J., Paix et démocratie, Montréal, Boréal, 2006, p.21-22.
[14] En vertu des deuxième et troisième principes parmi les huits qu’ils ont choisi de respecter sous le voile d’ignorance.
[15] Sur le thème des intérêts des générations futures, cf. Moellendorf, D., « Justice and the Assignment of the Intergenerational Costs of Climate Change », Journal of Social Philosophy, Vol. 40, No. 2, Été 2009, p.204-224 ; Vanderheiden, S., Atmospheric Justice, New York, Oxford University Press, 2008, p.81-142.
[16] La raison en est que dans le calcul des coûts des changements climatiques, c’est un raisonnement conséquentialiste qui prévaut. Il en résulte que les relocalisations d’individus sont réduites à une variable à évaluer parmi d’autres.
[17] Cf. Dumitru, S., « L’éthique du débat sur la fuite des cerveaux », Revue Européenne des Migrations Internationales, Vol 25, No 1, 2009, p.123-124.
[18] Pour l’argument de la contrainte, cf. Blake, M., « Distributive Justice, State Coercion, and Autonomy », Philosophy & Public Affairs, Vol. 30, 2001, p.257-296 ; Nagel, Th., « The Problem of Global Justice », Philosophy & Public Affairs, Vol. 33, 2005, p.113-147. L’argument de la réciprocité, lui-même présenté comme une critique de celui de la contrainte, a été soutenu par Sangiovanni, A., « Global Justice, Reciprocity and the State », Philosophy & Public Affairs, Vol. 35, No 1, 2007, p.3-39.
[19] Respectivement, Pevnik, R., « Political Coercion and the Scope of Distributive Justice », Political Studies, Vol. 56, 2008, p.399-411 ; Child, R., « Global Migratory Potential and the Scope of Justice », Politics, Philosophy & Economics, janvier 2011, en ligne.
[20] Cf. Beitz, Ch., Political Theory and International Relations, Princeton, Princeton University Press, 1999 ; Pogge, Th., World Poverty and Human Rights, Malden, Polity Press, 2002.
[21] Cf. Cavallero, E., « An immigration-pressure model of global distributive justice », Politics, Philosophy & Economics, No 5, 2006, p.97-127 ; Pogge, Th., « Migration and Poverty » in Goodin, R.E. et Pettit, Ph., (eds), Contemporary Political Philosophy, Malden, Blackwell, 2006, p.710-720.
[22] Risse, M., « The Right to Relocation : Disappearing Island Nations and Common Ownership of the Earth », Ethics and International Affairs, Vol. 23, No 3, 2009, p.281-300.
[23] Cf Risse, M., « The Right to Relocation : Disappearing Island Nations and Common Ownership of the Earth », Ethics & International Affairs, Vol 23, No3, 2009, p.291.
[24] Cf. Steiner, H., « Libertarianism and the Transnational Migration of People » in Barry, B. et Goodin, R.E., Free Movement, University Park, Pennsylvania State University Press, 1992, p.87-94.
[25] Cf. Risse, M., « The Right to Relocation : Disappearing Island Nations and Common Ownership of the Earth », Ethics & International Affairs, Vol. 23, No 3, 2009, p.281-282.