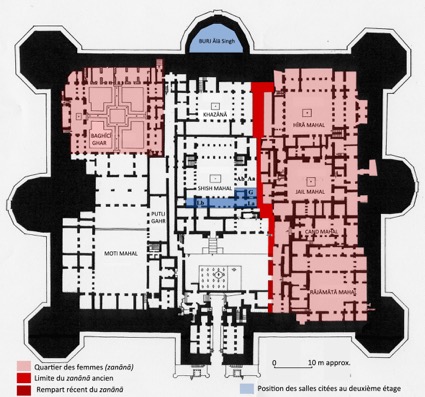Mafia de l’intolérance versus pollution culturelle : les artistes indiens et le gouvernement nationaliste hindou
Pascal Sieger est doctorant en anthropologie à l’EHESS (LAIOS/CEIAS) sous la direction de Marc Abélès et Caterina Guenzi. Il a vécu presque vingt ans en Inde du Sud où son travail de musicien lui a permis de côtoyer de très près la scène artistique contemporaine dont il a fait son domaine de recherche actuelle.
Introduction
La fin de l’année 2015 a été marquée en Inde par un débat public autour de la notion de tolérance dont la presse s’est largement fait l’écho. À l’origine de cette discussion figurent principalement deux événements : l’assassinat de M. M. Kalburgi, écrivain et représentant de la pensée rationaliste en Inde du Sud, par des extrémistes hindous et le meurtre, par une foule d’hindous en colère, d’un musulman soupçonné d’avoir tué une vache pour en consommer la viande à Dadri, non loin de New Delhi.
Aucun des ces deux événement qui ont eu lieu en l’espace d’un mois entre fin août et fin septembre 2015 n’a été formellement condamné par le gouvernement nationaliste hindou de Narendra Modi au pouvoir depuis mai 2014. En signe de protestation contre le manque de réaction de l’État indien, près de quarante écrivains récompensés par la prestigieuse Sahitya Akademi ont renvoyé leur prix à l’Akademi, en le faisant savoir par voie de presse. Peu à peu, d’autres artistes, des gens de théâtre et du cinéma ont également fait part de leur inquiétude au sujet de ce qu’Amartya Sen qualifie de « tolérance de plus en plus élevée pour l’intolérance »[1].
Fin 2015, j’étais, dans le cadre de ma recherche anthropologique sur les réseaux d’artistes en Inde, l’administrateur d’une résidence d’écrivains à Bangalore : Sangam House. Contre toute attente, la petite dizaine de résidents, écrivains d’Inde et d’ailleurs, dont j’avais la responsabilité s’est retrouvée impliquée dans ce débat que la presse a appelé « Award wapsi[2] ». En effet, le directeur du Bangalore Literature Festival où tous les écrivains étrangers de la résidence avaient été invités, avait déclaré publiquement être opposé à la réaction des artistes qui avaient renvoyé leurs prix.
Cet article joue sur diverses échelles et perspectives : de la proximité absolue dont j’ai eu la chance de bénéficier en tant qu’anthropologue immergé dans une communauté d’écrivains à la distanciation théorique qui est le propre de toute la littérature traitant des rapports de l’art au pouvoir en Inde et ailleurs. Il essaie de comprendre les enjeux du différend qui oppose de nombreux artistes contemporains et le gouvernement indien actuel autour de la question de la liberté d’opinion, de la liberté d’expression et par conséquent de la liberté artistique. Il est traversé par les problématiques qui hantent le discours intellectuel indien depuis l’indépendance : le post-colonialisme, la modernité et le cosmopolitisme.
Après avoir posé le décor et décrit la polémique autour de la tolérance et la protestation des artistes, je tenterai de faire le point sur les rapports des artistes à l’État aujourd’hui en Inde, sous l’angle de la négociation d’un « projet moderne » revendiqué par la communauté des artistes contemporains à l’aide de la théorie des régimes de l’art de Jacques Rancière. Le cas de l’écrivain tamoul Perumal Murigan, ex-résident de Sangam House, harcelé par un groupuscule proche du pouvoir nationaliste hindou et surtout le verdict de la Haute Cour de justice de Madras permettront ensuite de comprendre la manière dont le pouvoir en place a idéologisé le discours sur l’art. Il examinera également quelques-uns des moyens de pression dont il dispose pour contrôler la production artistique. La dernière partie s’intéressera à la notion de cosmopolitisme liée aux pratiques de l’art et la littérature de nos jours en Inde et à sa portée politique.
Crise au Bangalore Literature Festival
Autour de la table de la résidence règne une joyeuse animation ce 20 novembre 2015. Les écrivains s’arrachent le Hindu[3] du jour qui annonce la programmation du Bangalore Literature Festivali (ou BLF) et cite les participants en première page. Il n’est pas si fréquent pour un écrivain européen de voir son nom imprimé en couverture d’un quotidien indien, surtout s’il n’a jamais été publié en Inde !
Pourtant, au lieu de me réjouir avec les résidents, cette situation m’embarrasse. En tant qu’administrateur de la résidence Sangam House, il va falloir que je parle aux auteurs qui ont été invités à ce festival littéraire du contenu du message que m’a envoyé la veille Arshia Sattar, la fondatrice de la résidence.
Depuis 2014, je mène une recherche ethnographique sur les artistes contemporains en me focalisant sur les lieux de création en Inde du Sud et particulièrement dans la ville de Bangalore. Sangam House est l’un de ces lieux. Cette résidence d’écrivains accueille depuis 2006 chaque année pendant quatre mois, d’octobre à janvier, à proximité de Bangalore, une vingtaine d’écrivains dont une moitié vient d’Inde et l’autre moitié du reste du monde. Sélectionnés pour des séjours de deux à dix semaines suivant les financements dont ils bénéficient[4], ces écrivains vivent ensemble dans cet endroit où aucune production ne leur est demandée mais qui leur offre des conditions « idéales » pour l’écriture, au calme, nourris, logés et blanchis. Je suis l’administrateur de la résidence, ce qui consiste à accueillir les écrivains, à les accompagner tout au long du séjour pour qu’il se déroule le mieux possible et à organiser des lectures et des moments d’échanges entre les résidents.
Ce 20 novembre 2015, je sais que la réunion qu’Arshia et moi allons organiser avec les trois écrivains concernés par l’invitation du Bangalore Literature Festival risque de leur faire l’effet d’une douche froide au vu de la joie que leur avait procurée l’annonce de cette manifestation qui leur donnait l’occasion de lire des extraits de leurs ouvrages à un public indien. Pourtant, il nous faudra leur retracer l’historique des rapports tendus de la résidence avec le festival de littérature de Bangalore depuis sa création en 2012 marqué par un certain manque de considération pour les invités mais surtout leur parler des prises de position publiques de Vikram Sampath, l’un des deux co-fondateurs et directeurs du festival.
Alors que la polémique des Sahitya Akademi Awards bat son plein, que tous les jours des écrivains de renom renvoient leur prix de l’institution créée par Nerhu, demandant au gouvernement de condamner l’atmosphère d’intolérance religieuse croissante envers les critiques de l’hindouisme, Sampath, le directeur du BLF lui-même auteur de plusieurs ouvrages historiques, rédige un long article intitulé « Why I won’t return my Akademi Award »[5] sur un média très consulté en ligne. Il y écrit, entre autres :
Les écrivains qui, comme moi, ne sont pas d’accord avec cette manière de protester et d’exprimer son opinion sur les medias sociaux ont été taxés de communautarisme et traités de fascistes et de lèche-bottes du régime « despotique, intolérant et autoritaire » de Modi.*[6]
Sur le mode ironique, il regrette que les écrivains expriment avant tout leur opinion politique (et en profitent du même coup pour faire leur promotion) en rendant leurs prix. Il se moque par avance de ceux qui le traiteront de fasciste à la solde du gouvernement de Modi pour son refus de protester. Cependant, quelques jours plus tard, Sampath semble confirmer son soutien à la politique culturelle officielle. Il affiche en effet plus clairement ses opinions en signant une pétition rédigée par 53 historiens contre l’interprétation « gauchiste » de l’histoire indienne qui serait devenue hégémonique au sein du monde universitaire indien. Il associe son nom à ceux qui réclament une purge dans le milieu des historiens indiens et déclarent :
[…] nous condamnons l’hégémonie bien plus pernicieuse de l’école gauchiste d’ « histoire officielle », qui a donné à des générations d’étudiants indiens une image de l’Inde aliénée et faible et leur a enseigné le mépris pour leur héritage culturel. Les « valeurs et traditions de pluralité que l’Inde a toujours prôné dans le passé » sont justement celles que cette école n’a jamais mises en pratique.* [7]
L’allusion aux déclarations de Mahesh Sharma, ministre de la Culture de l’Union indienne est on ne peut plus claire, ce dernier avait déclaré un mois plus tôt :
Nous allons désinfecter tous les endroits du discours public qui ont été occidentalisés et où la culture et la civilisation indiennes doivent être remises à leur juste place – que ce soit dans l’histoire écrite ou au sein de notre héritage culturel ou même de nos instituts qui ont été pollués au fil du temps.
Le ministère de la culture chapeaute 39 institutions, y compris des musées nationaux et le Conservatoire d’Art Dramatique, mais nous n’avons jamais été à même de présenter notre héritage culturel indien correctement, nous allons totalement remodeler ces institutions une fois que nus auront mis en place une feuille de route.
Il est honteux que des étudiants indiens se rendant à l’étranger ne soient pas capables de réciter un seul couplet en sanskrit quand on leur demande. Et ceci, uniquement parce que nous ne sommes pas fier de notre langue ancienne et qu’elle ne fait plus parie des enseignements fondamentaux. Ne faut-il pas que cela change ? Il faut changer l’état d’esprit des gens.*[8]
Les déclarations et opinions de Vikram Sampath entrent de façon évidente en résonance avec la politique culturelle gouvernementale et son projet de refonte de la culture. Depuis l’arrivée au pouvoir en 2014 du BJP[9], on disait dans les milieux de la culture contemporaine en Inde que la politique culturelle de ce gouvernement était confiée au RSS[10], qui s’est donné pour mission principale de protéger le « dharma hindou » et de promouvoir l’hindutva (qu’on pourrait traduire par « hindouité »). La nomination de M. Sharma, pur produit de cette association, au poste de ministre de la Culture a bien entendu participé à la diffusion de cette idée. Cependant, avec ses déclarations de septembre 2015, plus aucun doute n’est permis. Le ministre présente ses priorités de « nettoyage du discours public occidentalisé » et de retour aux « valeurs indiennes » (c’est-à-dire hindoues, pour lui) notamment dans l’enseignement, avec une récriture de l’histoire – à laquelle V. Sampath, le directeur du festival de Bangalore semble souscrire comme en atteste sa signature à la pétition.

Crocodile in water tiger on land, collectif de dessinateurs anonymes commentant l’actualité, illustration en Common Licence[11]
Bien que la presse quotidienne que nous recevons à la résidence nous informe largement sur la polémique des Awards qui a droit à un article presque tous les jours, les écrivains étrangers, seuls invités à participer au festival, ne sont pas forcément au fait de la politique indienne. Arshia et moi décidons donc de les réunir, et nous comptons sur la présence de leurs collègues indiens pour nous aider à leur donner un aperçu des enjeux. Toutefois la décision de participer au BLF sera laissée à leur appréciation. Les organisateurs de Sangam House ont décidé pour leur part que le nom de la résidence ne serait pas associé à ce festival qui défend des valeurs contraires aux valeurs d’humanisme dont le comité de sélection des candidats à la résidence tient compte dans le choix des candidats[12].
Après une longue discussion, deux des écrivains estiment que leur statut d’étranger ne leur donne pas l’autorité de s’exprimer sur un problème politique indien et maintiennent leur participation. Le troisième écrivain, lui, refuse de prendre part à une manifestation dont les orientations politiques et éthiques vont à l’encontre des siennes. Il met également en avant le fait qu’il ne veut en aucun cas cautionner une idéologie qui a poussé son nouvel ami Perumal Murugan à arrêter d’écrire. Je reviendrai plus tard sur l’histoire de cet écrivain qui a été plusieurs fois un résident de Sangam House et dont le dernier séjour datait de mois d’un mois. Il était alors venu à la résidence pour se reposer de son année très dure en raison du harcèlement qu’il avait subi du fait de groupes liés au RSS et qui s’est soldé par son retrait du monde littéraire. La controverse autour des Sahitya Akademi Awards avait déjà commencé.
Les deux écrivaines indiennes qui suivent cette discussion, bien qu’elles n’aient pas été invitées au BLF (elles s’interrogent par ailleurs sur les raisons de la sélection uniquement étrangère), sont quant à elles très claires : elles ne voudraient pas participer à un festival aussi ostensiblement pro-gouvernemental surtout dans le contexte politique actuel.
Quelques jours plus tard, le mouvement a fait boule de neige et la presse nous apprend que de nombreux écrivains invités menacent de boycotter le Bangalore Literature Festival. Le 30 novembre 2015, les journaux annoncent la démission de Sampath de la direction du festival et mentionnent un de ses Tweets qui dit : « Took a painful decision 2 step down from @BlrLitFest that i started cos of tolerance mafia »[13]. Sa décision de se retirer du festival est entièrement imputée à ceux qu’il désigne avec l’expression « mafia de la tolérance » dont il s’estime la victime.
Le festival littéraire de Bangalore a malgré tout lieu les 5 et 6 décembre, dans une atmosphère très tendue, et nombre de débats publics tournent autour du sujet de la « tolérance » et de la liberté d’expression comme en témoignent les thèmes des débats « Are we heading towards an Intolerant India Today ? », « Tipu Sultan and the refashioning of History », « Manto in Times of Intolerance » ou « Eight Threats to the Freedom of Expression »[14]. On projette également lors de l’inauguration une communication de Taslima Nasreen sur la liberté d’expression. Pour les écrivains de Sangam House qui ont décidé de participer à la manifestation, le festival sera décevant : le public ne montre que très peu d’intérêt pour leurs travaux (qui n’ont pas été publiés en traduction anglaise) et leurs lectures. Ils ne sont pas invités aux discussions ou débats autour des sujets d’actualité et n’ont pas l’occasion de s’exprimer sur la situation politique ou d’avoir un discours critique.
Le discours accusateur de Vikram Sampath sur la « mafia de la tolérance » se répand dans le milieu des sympathisants à la cause nationaliste hindoue qui, à sa suite, affirment qu’en fait l’intolérance est du côté de ceux qui se présentent comme les défenseurs de la tolérance. Mais la polémique autour du Bangalore Literature Festival n’est qu’une manifestation parmi d’autres de la tension qui grandit entre les artistes contemporains indiens et le gouvernement de nos jours[15]. Elle a été reprise par bon nombre d’intellectuels et interroge les valeurs fondamentales de la société indienne.
Régime esthétique de l’art et modernité nationale hindoue
La notion de « tolérance » est depuis le début centrale dans le débat qui oppose les représentants de la politique culturelle officielle à une majorité d’artistes contemporains indiens. Sans prétendre faire la généalogie de ce concept, il convient de se pencher sur l’apparition de ce terme dans le discours public en Inde.
C’est au XVIIIe siècle, dans l’Europe des Lumières qu’apparaît la notion de tolérance en tant que qualité, telle que nous l’entendons aujourd’hui. Jusqu’alors, la tolérance était considérée comme une « faiblesse », un refus d’engager la lutte contre des idées ou des actes jugés répréhensibles. Le concept de tolérance a pris son sens actuel en premier lieu dans le domaine religieux pour définir la capacité à accepter d’autres croyances et d’autres pratiques que les siennes. La notion de tolérance s’est ensuite étendue à des domaines autres que la religion : les arts, les idées philosophiques ou politiques, etc. Elle est devenue peu à peu le synonyme du respect de la différence et une notion clé de l’humanisme. C’est dans ce sens qu’on utilise principalement le terme « tolérance » dans le discours public en Inde.
Dans un article intitulé « The Concept and Role of Tolerance in Indian Culture »[16], le philosophe indien Jamal Khwaja tente de suivre l’évolution de ce concept en Inde de la période classique à nos jours. Si, pour lui, une certaine tolérance qu’on trouve déjà dans le bouddhisme ou le jainisme ainsi que dans les épopées hindoues s’est développée grâce à de grandes figures comme Kabir ou Ramanuja, elle ne correspond jamais véritablement à la définition des Lumières qui est le résultat d’une histoire typiquement européenne. Bien qu’il termine son article par de nombreuses citations tirées de textes religieux ou d’exemples historiques démontrant qu’il y a toujours eu dans la société indienne des défenseurs de la tolérance et du respect des autres, il fait remarquer que le mot « tolérance » dans l’acception du XVIIIe siècle n’a pas d’équivalent exact en sanskrit, la langue des épopées, de la poésie et du théâtre classique, pas plus que dans les langues vernaculaires.
De fait, le débat autour de l’intolérance qui agite les médias à partir de la fin de l’année 2015 est principalement en anglais et éventuellement en hindi. Dans la plupart des interventions en langue indienne, dans la presse et à la télévision, les termes « intolerance » et « tolerance » restent en anglais. « Dire la tolérance »[17], reste en Inde un acte assujetti à l’emploi d’un concept occidental dont le sens a été défini par le Lumières.
Pour de nombreux artistes contemporains indiens avec lesquels je me suis entretenu, la notion de tolérance est directement liée à la modernité des Lumières dont ils se revendiquent sous l’expression « the spirit of Enlightenment »[18]. Cependant, on sent souvent dans leurs discours qu’ils ne font pas vraiment de distinction entre modernité artistique et modernité philosophique ou politique. L’idée de « régimes de l’art », développée par Jacques Rancière dans Le Partage du sensible permet d’y voir plus clair en comprenant le passage de l’artistique au philosophique et au politique. Pour Rancière, il existe trois régimes de l’art : le régime éthique (où l’art est au service de la religion et de la politique), le régime représentatif – ou mimétique – (où l’art est sous contrôle d’une instance culturelle qui lui donne un cadre normatif) et le régime esthétique (où l’art est émancipé, critique et innovant) Ce troisième régime est désigné également sous « l’appellation confuse de modernité » (Rancière 2000 : 33). Le XVIIIe siècle marque l’apparition du régime esthétique de l’art en Europe mais sans pour autant supprimer les autres qui continuent à coexister. Bien qu’élaborée pour étudier principalement l’art occidental, cette théorie permet de saisir ce qui attire les artistes contemporains indiens dans les Lumières. Pour ces artistes à qui s’applique parfaitement la phrase de Foucault : « La Critique, c’est en quelque sorte le livre de bord de la raison devenue majeure dans l’Aufklärung ; et inversement, l’Aufklärung, c’est l’âge de la Critique » (Foucault 2001 : 1386), il est primordial d’avoir le droit de s’exprimer librement et d’entretenir un dialogue critique avec les traditions, fondamental pour la modernité. Ce qui les oppose aujourd’hui à leur gouvernement, c’est que ce dernier refuse de défendre la liberté d’expression essentielle à un art critique, non seulement de ses traditions mais aussi de la société en refusant de s’exprimer contre les menaces proférées (ou les attaques) à l’encontre des artistes. Ce faisant, l’État indien se positionne contre le régime esthétique de l’art et révèle par la voix de son ministre de la Culture sa préférence pour un régime éthique, prônant les valeurs nationalistes hindoues.
Rejetant une vision occidentale de la modernité, les porte-paroles du nationalisme hindou mettent l’accent sur une modernité alternative, exempte de l’expérience de la colonisation ou de l’occidentalisation. Christiane Borsius, dans son ouvrage Empowering Visions montre de quelle manière le BJP a mis en place une stratégie de représentation d’une modernité typiquement indienne :
L’État indien laïc en soi est remis en question par les vidéos, il est accusé de n’être qu’une copie conforme de l’idée européenne d’État-nation totalement inadaptée au contexte indien et qui ouvre la porte à tous les outrages envers les droits des minorités, au crime et à la corruption. […] C’est ainsi que le BJP et ses alliés se sont fait une place de manière provocante dans la sphère publique et affirment leur volonté de repenser l’État-nation moderne et la société civile.* (Borsius 2005 : 9)
Cette modernité indienne (ou faudrait-il dire hindoue ?) est basée sur la référence à un « âge d’or » inventé par les nationalistes indiens de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Reprenant pourtant à son compte le concept d’Etat-nation issu de la modernité politique, le BJP propose une réinterprétation d’une modernité ancrée dans l’histoire indienne précoloniale, une modernité marquée du sceau de l’indianité dont il se veut le représentant. La nation d’« État indien » se cristallise autour de l’hindouisme considéré plus comme une culture que comme une religion. Cela permet de mettre en place tout un système juridique afin de défendre l’hindouisme, donc la culture commune à tous les Indiens, contre tous ses détracteurs qui deviennent ainsi des antinationalistes, des ennemis de l’État. Ainsi, le régime éthique de l’art (Rancière parle d’un « tournant éthique » apparaissant à la fin du XXe siècle et qui aurait tendance à interdire certaines représentations pour des raisons éthiques et à imposer de nouvelles normes) qui correspond à la politique culturelle du BJP est protégé par des lois et encadré par un système légal alors que le régime esthétique devient l’objet d’attaques et de poursuites en raison de sa vision critique et individualiste.
Publié le 12 janvier 2015, juste après l’attentat de Charlie Hebdo en France le 7 janvier, ce comic strip de Crodocile in water tiger on land critiquant les médias indiens nous rappelle que la liberté d’expression en Inde est loin d’être une affaire classée. M.F. Husain a dû s’exiler, Salman Rushdie est toujours l’objet d’une fatwa bien que sa tête ne soit plus mise à prix, Wendy Doniger n’ose plus mettre les pieds en Inde par peur d’être attaquée, et Dabhulkar a été assassiné par des terroristes. Illustration en Common Licence http://crocodileinwatertigeronland.tumblr.com/post/107872054770
Ainsi, comme le montre ce strip, le discours officiel peut-il s’attaquer aux intolérances des autres sans condamner celles qui se manifestent sur le territoire national. Ces dessins entrent en résonance d’une façon étonnante (les mêmes noms sont utilisés) avec un article du Telegraph de janvier 2015, juste après le suicide virtuel de l’écrivain Perumal Murugan, déjà mentionné plus haut, qui affirme :
Perumal Murugan n’est pas Charlie. Pas plus que ne l’est Taslima Nasreen. M.F. Hussain ne l’était pas non plus. Et la raison pour laquelle ils ne le sont pas n’a rien à voir avec leur fibre morale ou le courage de leurs convictions. Ils ne sont pas des héros de la liberté d’expression dans leur propres pays car personne ne soutient leur cause : ni le grand public, ni la loi et surtout pas l’État.*[19]
Dans le comic strip et cet article, c’est la vision de la modernité alternative telle que la conçoit le BJP qui est critiquée, une modernité « sélective » qui se bat pour la liberté d’expression hors du territoire national mais qui considère que les artistes peuvent devenir des menaces à l’ordre public s’ils sont en Inde. Revenons ici sur l’histoire de Perumal Murugan, cité par l’article du Telegraph, exemplaire en ce qui concerne les enjeux de cette bataille pour la modernité autour des régimes de l’art mais étonnante quant à son dénouement.
Perumal Murugan ou le droit de raconter les hommes
À la mi-décembre 2014, Perumal Murugan rentre juste de Sangam House où il a passé un mois en résidence pour écrire la suite d’un livre publié en tamoul quatre ans auparavant, Madhorubhagan. Ce livre vient d’être traduit en anglais sous le titre de One Part Woman, et il est prévu que le romancier aille en faire le lancement à la foire du livre de Madras en janvier 2015. C’est alors qu’un groupe proche du RSS exige le retrait de la vente de cet ouvrage qui heurterait les sensibilités de certaines communautés hindoues. Madhorubhagan raconte le calvaire d’un couple qui n’arrive pas à avoir d’enfant dans l’Inde du Sud rurale des années 1940. La scène centrale du livre décrit une fête religieuse au cours de laquelle les femmes dont les maris sont stériles s’accouplent à des inconnus qui deviennent, cette nuit-là, les incarnations du dieu Shiva. La description de ce rituel, confirmée par des études anthropologiques, offense à tel point les nationalistes hindous qu’ils procèdent à l’autodafé de son livre en place publique à Tiruchengode, la ville de naissance de Perumal Murugan. Ceux qui ont attaqué le livre lui reprochent de porter atteinte à la dignité des femmes hindoues et à la religion.
Suivent ensuite un harcèlement par téléphone et l’envoi incessant de lettres anonymes au domicile de l’écrivain. Puis ce sont des affichettes demandant son départ sur les murs de Namakkal, sa ville de résidence, la protestation d’autres organisations nationalistes et de défense des castes, le tout se couronnant par une journée de protestation générale le 9 janvier 2015 où tous les magasins de la ville tirent leurs rideaux de fer pour demander le retrait des livres de Perumal Murugan de la vente.
L’auteur de Madhorubhagan, pour apaiser les esprits, promet de retirer les livres qui sont sur le marché et de les faire retourner à l’éditeur, de couper les passages incriminés dans une prochaine édition, de changer le nom des lieux dont il est question. Il demande une réunion de conciliation avec les parties offensées, mais personne ne se présente à la réunion. Une plainte est déposée contre lui au tribunal demandant l’interdiction de son livre au Tamil Nadu. Pour apaiser les mécontents, P. Murugan propose même aux lecteurs mécontents de leur rembourser le prix du livre qu’ils peuvent brûler eux-mêmes et de dédommager son éditeur pour tous les livres retirés et invendus. Mais rien ne calme la colère de ses opposants.
Le 12 janvier 2015, l’écrivain tamoul efface sa page Facebook. L’auteur y avait déclaré la veille, dans ce qui sera son dernier acte littéraire jusqu’à ce jour : « Perumal Murugan, l’écrivain est mort. Comme il n’est pas Dieu, il ne pourra pas ressusciter. De plus, il ne croit pas en la réincarnation. Il mènera désormais une vie de professeur ordinaire, sous le nom de P. Murugan. Laissez-le tranquille. » Perumal Murugan n’a plus rien publié depuis ; il a déménagé à Madras avec sa famille pour retrouver l’anonymat et la tranquillité.
Il a fallu attendre plus d’un an et demi pour que la Haute Cour de Justice de Madras donne son verdict sur la demande d’interdiction du livre de Perumal Murugan. Mais, le 5 juillet 2016, le président de la cour, Sanjay Kishan Kaul a tenu à en faire un cas de jurisprudence exemplaire. Connu pour ses prises de position en faveur du peintre M.F. Husain lui aussi persécuté par des fondamentalistes hindous, le juge s’est posé en défenseur de la liberté d’expression et protecteur de la création artistique envers et contre toutes les pressions politiques.
Le texte entier du verdict rendu par la Haute Cour de Madras est disponible en ligne[20]. Depuis sa publication, il a été abondamment commenté et analysé, principalement par une presse de gauche qui y lit un appel à la résistance à l’idéologie officielle. Après avoir présenté les parties, plaignants et accusés, le juge commence la lecture de son verdict par cet exergue :
« Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. » a dit l’écrivain Voltaire (citation attribuée à Voltaire par S.G. Tallentyre dans The Friends of Voltaire, 1907)*[21]
Cette phrase attribuée à Voltaire est aujourd’hui l’une des plus citées dans le monde entier pour expliquer ce qu’est la tolérance. Que le juge Kaul choisisse d’ouvrir son discours avec cette citation sur la tolérance alors que cette notion est débattue depuis l’arrivée au pouvoir du BJP n’est certainement pas chose anodine. Il est remarquable qu’il se réfère à l’un des philosophes les plus célèbres des Lumières pour aborder ce sujet. Cette allusion à la modernité est immédiatement suivie de :
L’Inde a la chance d’avoir l’une des constitutions les plus modernes et les plus libérales. Elle reflète son héritage riche et varié tout en reconnaissant les principes modernes de la démocratie en se distinguant d’une société féodale.*[22]
Dans ces quelques lignes, le mot « moderne » apparaît deux fois et est associé aux concepts de liberté individuelle et de démocratie. Sanjay K. Kaul tient à ce que ce procès apparaisse clairement comme celui de la modernité opposée à la contre-modernité, désignée ici sous le nom de « société féodale » avec tous les sous-entendus à propos de l’obscurantisme dont ce terme est chargé. Son verdict est constellé d’allusions à la vision de l’histoire des nationalistes hindous, notamment lorsqu’il est question de niyoga, la tradition hindoue au cours de laquelle une femme dont le mari est stérile ou décédé fait appel à un autre homme pour avoir un enfant. Cette pratique, au centre du livre de Perumal Murugan, est une des raisons de la controverse sur Madhorubhagan, et c’est sa description qui est supposée porter atteinte à la dignité des femmes hindoues. Le verdict est on ne peut plus clair à ce sujet :
En tant que société, nous semblons plus embourbés dans la philosophie victorienne qu’inspirés par notre propre littérature et nos écritures. Ou peut-être n’existe-t-il qu’une petite secte qui pense de cette façon, mais elle vocifère tant et si bien qu’elle crée un véritable pandémonium. Le sexe n’était pas traité comme une chose condamnable mais en tant que partie intégrante de l’existence de notre civilisation. Les écritures sacrées indiennes comme le Mahabharata sont pleines d’exemples manifestes de relations sexuelles hors mariage […].*[23]
Après avoir fait remarquer qu’ils étaient sous l’influence du puritanisme victorien hérité du temps où l’Inde était une colonie de l’Empire britannique, le juge renvoie les plaignants à la lecture des épopées hindoues qui sont bien plus libérales en matière de liberté sexuelle que la morale des colons. Il répond également indirectement à Narendra Modi, le premier ministre de l’Union Indienne qui avait affirmé au cours de la visite d’un hôpital à Chennai (anciennement Madras) en octobre 2014 :
En réfléchissant bien, nous réalisons que le Mahabharata nous dit que Karna n’est pas né du ventre de sa mère. Ce qui signifie que la science génétique existait déjà à cette époque. C’est la raison pour laquelle Karna a pu être conçu hors du ventre de sa mère.*
Cette allusion à l’utilisation des épopées ou des Védas pour légitimer la « science hindoue » par le Premier Ministre (ce n’est pas une première : il a notamment affirmé que l’Inde était à l’origine de la chirurgie esthétique, invention attestée par le dieu Ganesh qui, dans le panthéon hindou, a un corps d’homme et une tête d’éléphant) fait irrémédiablement penser à ce que décrit l’historien Gyan Praksash :
L’idée d’une science hindoue a été formulée par la recherche orientaliste de la fin du XVIIIe siècle. Mais un siècle plus tard, les graines plantées par les orientalistes s’étaient transformées en d’autres fruits. La science hindoue ne satisfaisait plus que la soif de connaissance de l’Orient, elle a nourri l’idée d’une nation indienne moderne. En s’appuyant sur son statut de produit de la recherche universitaire, la notion de science hindoue a gagné de l’influence dans le cercle des réformateurs religieux. Les références à une médecine, des mathématiques, une astronomie et une chimie hindoues devinrent fréquentes dans la culture de l’élite. Des journaux et brochures allaient chercher dans le passé des contributions scientifiques attribuées aux Hindous en identifiant l’Inde à l’hindouisme et en démontrant la valeur transcendantale de l’hindouisme dans sa science. Kissory Chandra Mitra, un intellectuel bhadralok écrivit que les Védas décrivent tous les grands progrès médicaux des Hindous et montrent la haute estime dans laquelle la science et la pratique de la médecine étaient portées.* (Prakash 2009 : 99)
Prakash qualifie ce type d’invention de la tradition de « renversement de stéréotype colonial » ; en effet, pour prouver la supériorité de leur culture, les nationalistes ayant intériorisé les valeurs de leurs colonisateurs (progrès, science) développent le concept de « science indienne » qu’ils mettent en concurrence avec la science occidentale.
Ashis Nandy décrit très bien ce processus dans L’Ennemi intime lorsqu’il décrit les nationalistes hindous de la fin du XIXe siècle découvrant qu’il « existait dans l’hindouisme des traditions susceptibles de valoriser les traits occidentaux valorisés, mais qu’elles étaient perdues chez les hindous contemporains » (Nandy 2007 : 66), ce qui les autorisa à mettre en place une théorie « qui incitait à voir dans l’âge d’or de l’hindouisme une version ancienne de l’Occident moderne » (Nandy 2007 : 68). C’est à cette source que puise la théorie de la modernité alternative défendue par les nationalistes hindous au pouvoir en Inde aujourd’hui. Cette modernité alternative permet au nom de l’indianité et d’une authenticité indienne de rejeter l’universalité de la modernité des Lumières et ses principes humanistes issus d’une vision ethnocentrique de l’Europe qui, en même temps qu’elle donnait naissance à la modernité, étendait son territoire en colonisant le reste du monde.
On ne peut pourtant pas dire qu’un écrivain comme Perumal Murugan ou que tous les artistes ayant protesté contre l’intolérance croissante soient des produits d’une éducation occidentalisée ou eurocentrée. P. Murugan parle à peine l’anglais et écrit dans un dialecte tamoul ; il se sent cependant proche de Camus ou Prévert, il participe à des rencontres d’écrivains en Inde ou à l’étranger et est toujours ravi de pouvoir côtoyer les autres écrivains pour pouvoir échanger des idées et comparer les pratiques. Tous ces artistes sont liés par des valeurs communes, qui répondent à la définition du cosmopolitisme que donne l’historienne Margaret Jacob : « être cosmopolite renvoie à la capacité de vivre la rencontre avec des individus de nations, de croyances et de couleurs différentes avec plaisir, curiosité et intérêt et non avec méfiance, mépris ou une indifférence pouvant parfois virer à la répugnance »[24].
Cosmopolitisme contre fraternité hindoue
Le concept de cosmopolitisme a fait son apparition dans les sciences sociales il y a une dizaine d’années où il rapidement rencontré le succès, principalement au sein des études postcoloniales américaines dont une branche s’est d’ailleurs spécifiquement nommée depuis « études cosmopolites ». Walter Mignolo pose les bases de cette nouvelle réflexion sur le cosmopolitisme dans un article fondateur initialement paru dans la revue Public Culture en 2000 intitulé « The Many Faces of the Cosmopolis : Border thinking and Critical Cosmopololitanism ». Il tente de comprendre l’articulation du cosmopolitisme et de la globalisation en proposant le postulat suivant :
Partons du principe que la globalisation est un ensemble de dispositions destinées à gérer le monde alors que le cosmopolitisme est un ensemble de projets visant une convivialité planétaire.* (Mignolo 2002 : 157)
Alors que la globalisation serait un projet « par le haut », le cosmopolitisme serait un projet « par le bas », porté par des individus désireux d’en rencontrer d’autres, différents mais animés par la même curiosité et la même bienveillance, à la recherche d’une « convivialité planétaire ». N’est-ce pas là l’une des spécificités des artistes, en Inde ou ailleurs, toujours curieux de ce qui se fait ailleurs, désireux de découvrir des pratiques différentes de leur art ? Qu’ils se considèrent comme des artistes ancrés dans le local, comme Perumal Murgan qui raconte les histoires de son village tamoul, ou qu’ils revendiquent une double identité comme le plasticien Anish Kapoor qui se présente comme un Bombay wallah (habitant de Bombay), de plus en plus d’artistes sont capables de penser à partir de zones frontières (ce que Mignolo appelle border thinking), de regarder leur culture d’un point de vue extérieur, conséquence de la situation postcoloniale, mais également de porter un regard critique sur la « colonialité des pouvoirs », l’eurocentrisme qui marque le projet moderne et qui est encore aujourd’hui au centre de la globalisation. C’est en ce sens que l’on peut parler de « cosmopolitisme critique » (Mignolo 2002), et le verdict du procès de P. Murigan par S. Kaul en est un exemple parfait : prenant appui à la fois sur Voltaire et sur le Mahabharata, il joue avec les périphéries et les centres, « provincialisant » tour à tour l’Inde et l’Europe, faisant dialoguer différentes logiques.
Cette posture, on peut l’imaginer, ne rencontre pas l’adhésion des nationalistes hindous. Elle est à l’opposé de la doctrine de l’hindutva, qui hiérarchise les savoirs en mettant la science hindoue au sommet. Le cosmopolitisme est à l’inverse de la « fraternité hindoue » telle qu’elle est formulée par Rama Jois, idéologue de l’hindutva et membre du BJP dans un ouvrage intitulé Our Franternity :
Si nous sommes tous des enfants de Bharat Mata (Mère Inde) et donc des frères, il n’y a plus de raison de nous diviser selon la caste ou de sentiment de supériorité ou d’infériorité.*[25]
Jois lance un appel à la création d’une fraternité hindoue ou « fraternité de l’hindutva » contre tout ce qui peut menacer l’intégrité et la pureté hindoues : le christianisme et l’islam en particulier. Il va de soi que l’idéal cosmopolite des artistes qui vont au devant des autres, quels qu’ils soient, dans l’espoir de « rencontres joyeuses »[26] est à l’inverse de ce principe de fraternité exclusive. C’est autour de ce point, de cet ethos artiste antinomique à l’ethos nationaliste que se joue ce qui oppose fondamentalement le BJP au pouvoir et les artistes contemporains indiens. Il est dans la logique de la politique culturelle du BJP de ne pas défendre ces artistes cosmopolites qui soutiennent des valeurs que les nationalistes hindous estiment soit héritées d’un savoir exogène, soit dangereuses pour la pureté hindoue.
Est-ce un hasard ? Au moment où le nationalisme hindou refait son apparition sur la scène politique à la fin du siècle précédent (peu après la libéralisation économique de 1991), on voit fleurir en Inde des communautés et résidences d’artistes. Rien qu’à Bangalore, mon terrain de recherche, naissent One Shanthi Road, Jaaga et Bar 1 qui seront suivies de la résidence d’écrivains Sangam House. Alors que la doctrine nationale hindoue rencontre un succès public croissant qui va lui faire gagner les élections de 1998, les espaces de vie et de création artistique se multiplient. On assiste donc au développement d’une part d’un discours de plus en plus hostile aux influences « étrangères » et d’autre part à l’émergence d’espaces de convivialité réunissant des artistes de toutes origines ethniques et sociales qui font office d’« incubateurs de cosmopolitisme ». La manière dont Sangam House est présentée par ses fondateurs témoigne de cet état d’esprit :
En sanskrit, le terme « sangam » signifie littéralement « aller ensemble ». Dans la plupart des langues indiennes, sangam a pris de sens de « confluence », à la fois « la jonction de deux cours d’eau » et « coïncidence ». L’intention de Sangam House est de réunir des écrivains du monde entier dans un endroit ; ils pourront vivre et travailler en toute sécurité dans un environnement accueillant, espace devenu nécessaire pour de multiples raisons dans notre monde actuel.*[27]
La notion de convivialité d’écrivains du monde entier est essentielle au projet de Sangam House. J’ai déjà décrit ailleurs[28] à quel point la coprésence de ces gens de littérature d’origines très diverses était créatrice de « commun », un fonds d’affects, de langage et de pratiques issus de l’expérience partagée de la résidence. Mais ce n’est pas tout, on assiste aussi dans ces résidences à l’invention d’un cosmopolitisme critique qui est généré par la confrontation des points de vues au cours de tous ces moments de vie ensemble, par les échanges artistiques au cours des soirées de lecture où chacun des écrivains soumet aux autres son travail en cours.
Chacune des résidences d’artistes de Bangalore est à l’origine d’une « communauté affective » qui est, comme le décrit Appadurai, « un groupe d’individus qui se met à partager ses rêves et ses sentiments […] grâce aux conditions nouvelles de la lecture, du jugement critique et du plaisir collectif » (Appadurai 2005 : 37). Le vécu commun des artistes dans ces collectifs éphémères cimente des groupes, crée des réseaux de gens qui se retrouvent partout sur la planète au gré de leurs déplacements, souvent à l’occasion d’autres résidences. Pour Leela Gandhi, qui reprend l’idée de « communauté affective » dans Affective communities : Anticolonial Thought, Fin-de-Siècle Radicalism, and the Politics of Friendship, on peut même parler d’un « cosmopolitisme affectif » qui serait « la pratique éthico-politique d’un soi désirant inexorablement attiré par la différence »[29] (Gandhi 2006 : 17). Cependant, pour cette spécialiste du postcolonialisme, les amitiés qu’on peut nouer avec des étrangers dans ces communautés affectives peuvent présenter un danger pour les États, car elles peuvent être considérées comme une trahison contra patriam.
La prise de conscience de la multiplicité de centres et de périphéries des savoirs rendue possible par la convivialité des espaces de création artistiques est un vecteur non négligeable du développement du cosmopolitisme critique, qui refuse la hiérarchisation des connaissances et des cultures de la modernité/colonialité et des nationalismes. C’est de nos jours autour de cette problématique que se joue tout le débat autour de la tolérance et la lutte pour un choix de société qui oppose les artistes au gouvernement indien. Mais des réseaux se développent, nationaux ou transnationaux, et les communautés deviennent virtuelles. Grâce aux communications électroniques et aux réseaux sociaux, les artistes du Sud (et du monde entier) se rencontrent aujourd’hui virtuellement pour parler de leurs difficultés à s’exprimer, à créer librement et à faire connaître leurs œuvres, problèmes majoritairement liés à une situation postcoloniale. Heureusement pour eux, en Inde, ils sont soutenus par tout un réseau d’intellectuels eux-mêmes cosmopolites, enfants des années 1970 formés dans des universités indiennes ou occidentales, qui feront tout pour ne pas laisser l’intolérance s’installer[30].
Dans une conférence que Deleuze donna à la fondation Femis en 1987, le philosophe fit une réponse qui est restée fameuse à la question : quel rapport y a-t-il entre la lutte des hommes et l’œuvre d’Aristote ? :
Le rapport le plus étroit et pour moi le plus mystérieux. Exactement ce que Paul Klee voulait dire quand il disait « Vous savez, le peuple manque ». Le peuple manque et en même temps, il ne manque pas. Le peuple manque, cela veut dire que — il n’est pas clair, il ne sera jamais clair — cette affinité fondamentale entre l’œuvre d’art et un peuple qui n’existe pas encore n’est pas ne sera jamais claire. Il n’y a pas d’œuvre d’art qui ne fasse pas appel à un peuple qui n’existe pas encore[31].
Peut-être la lutte qui oppose les artistes et leur gouvernement en Inde tient-elle dans ce rapport mystérieux. D’un côté des artistes de plus en plus cosmopolites, ferments d’un peuple à venir qui ressemblera à leurs travaux, toujours à la frontière, toujours en mouvement, se déterritorialisant et reterritorialisant au gré des œuvres, et de l’autre côté des traditionalistes voulant imposer une nationalité, assignant une éthique aux œuvres pour les mettre au service d’un projet exclusif.
Malgré la place que le débat sur la tolérance a prise dans les médias et sur la scène publique, on est en droit de se poser raisonnablement la question de la réalité de la menace que représentent les artistes. Cette petite communauté peut-elle véritablement mettre en péril le projet nationaliste hindou ? On peut en douter. Cependant, elle résiste. Elle a une croissance rhizomique qui s’étend au-delà des frontières ; elle bénéficie également d’un relais médiatique, et c’est ce qui fait peur à un gouvernement qui tente d’avoir le contrôle total sur tout ce qui est dit et écrit.
[learn_more caption= »Bibliographie « ]
APPADURAI Arjun (2005) Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation, Paris, Petite Bibliothèque Payot
BROSIUS Christiane (2005) Empowering Visions. The politics of Representation in Hindu Nationalism, Londres, Anthem Press
CHAKRABARTY Dipesh (2001) Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference, New Delhi, Oxford University Press
DARDOT Pierre et LAVAL Christian (2014), Le commun, Essai sur la révolution au XXIe siècle, Paris, La Découverte
FOUCAULT Michel (2001) « Qu’est-ce que les Lumières ? » (1ère publication en 1984) dans Dits et écrits II. 1976-1988, Paris, Gallimard, pp. 1381-1397.
GANDHI Leela (2006) Affective communities : Anticolonial Thought, Fin-de-Siècle Radicalism, and the Politics of Friendship. Durham, NC and London, Duke University Press
GANESH Kamala et TAKKAR Usha (dir.) (2005) Culture and the making of Identity in Contemporary India, New Delhi, Sage Publications
GOMMANS Jos (2015) « Cosmopolitisme sud-asiatique et microcosme néerlandais à Cochin au VIIe siècle » dans C. Lefèvre, I. Zupanov et J. Flores (dir.) « Cosmopolitismes en Asie du Sud » Purusartha n°33, Paris, Éditions EHESS, pp. 97-119
HARDT Michael et NEGRI Antonio (2012), Commonwealth, Paris, Stock
JAIN B. K. (1997) « Pour une coexistence pacifique des incompatibles » dans Dire la tolérance, Paris, publication de l’UNESCO
MIGNOLO Walter (2002) « The Many Faces of the Cosmopolis : Border thinking and Critical Cosmopololitanism » dans Breckenridge C., Pollock S., Bhabha H. et Chakrabarty D. (dir.) (2002) Cosmopolitanism, Durham et Londres, Duke University Press
NANDY Ashis (2007) L’Ennemi intime, perte de soi et retour à soi sous le colonialisme, Paris, Fayard
PANIKKAR K.N. (1995) Culture, Ideology, Hegemony. Intellectuals and Social Consciousness in Colonial India, New Delhi, Tulika
PERUMAL MURUGAN (2013) One Part Woman, New Delhi, Penguin
PRAKASH Gyan (2009) Another Reason: Science and the Imagination of Modern India, Princeton University Press Princeton
RANCIÈRE Jacques (2011) Aisthesis. Scène du régime esthétique de l’art, Paris, Galilée
RANCIÈRE Jacques (2000) Le Partage du sensible. Esthétique et politique, Paris, La fabrique éditions
THAPAR Romila (dir.) (2015) The Public Intellectual in India, New Delhi, Aleph Book
[1] Amartya Sen, inteview à l’Hindustan Times de New Dehli datée du 13 février 2016
[2] Award signifie récompense en anglais, et wapsi signifie retour en sanskrit.
[3] Grand quotidien indien en anglais.
[4] Chacun d’entre eux bénéficie d’une bourse qui prend en charge tout son séjour et qui est attribuée par une institution publique ou privée ou des mécènes individuels.
[5] « Pourquoi je ne renverrai pas mon prix de l’Akademi » http://www.livemint.com/Leisure/Ztn7TNVzfcFEUwTcRtz4hJ/Why-I-wont-return-my-Akademi-award.html
[6] Toutes les citations suivies d’un astérisque sont des traductions de l’anglais par l’auteur.
[7] http://m.thehindu.com/news/national/historians-archaeologists-scholars-call-for-unbiased-and-rigorous-new-historiography-of-india/article7888794.ece
[8] The Telegraph daté du 25 septembre 2015, en ligne : http://www.telegraphindia.com/1150908/jsp/frontpage/story_41407.jsp#.V5HvsWURn3B
[9] Barathiya Janata Party ou parti du peuple indien.
[10] Le Rashtriya Swayamsevak Sangh ou association nationale des volontaires est considéré comme la base idéologique du BJP.
[11] « Citoyens, vous serez heureux d’apprendre que votre gouvernement a décidé de lutter contre le fléau de ka pollution culturelle. » http://crocodileinwatertigeronland.tumblr.com/post/129058030090
[12] À ce sujet voir SIEGER Pascal (2016) « Sangam House, résidence d’écrivains. Du collectif éphémère au commun nomade » dans Socio-anthropologie n° 33, Collectifs éphémères, Paris, Publications de la Sorbonne, pp. 61-74.
[13] « J’ai pris la pénible décision de me retirer du BLF que j’ai créé à cause de la mafia de la tolérance. » (Traduction de l’auteur)
[14] « L’Inde actuelle est-elle en passe de devenir intolérante ?», « Tipu Sultan et la révision de l’Histoire », « Manto à l’époque de l’intolérance », ou « Huit menaces pour la liberté d’expression ». (Traduction de l’auteur)
[15] À la même période s’est déroulée une grève des étudiants du prestigieux Film and Television Institute of India (FTII), qui protestaient contre la nomination d’un directeur de l’institut sur la base de son soutien au BJP plutôt que de ses compétences cinématographiques.
[16] « Le concept et le rôle de la tolérance dans la culture indienne » http://www.jamalkhwaja.com/jamalbooksite/Free_Downloads_files/The_Concept_And_Role_Of_Tolerance_In_Indian-1.pdf
[17] J’emprunte cette formule à une publication de l’UNESCO (Jain 1997) qui tente de démontrer l’universalité de ce concept.
[18] « L’esprit des lumières ».
[19] Article de Mukul Kesavan dans le Telegraph daté du 19 janvier 2015, en ligne : http://www.telegraphindia.com/1150119/jsp/opinion/story_9012.jsp#.V4c837QRnsE
[21] Ibid. p. 6.
[22] Ibid. p. 6.
[23] Ibid. p. 131.
[24] Citée par Jon Gommans (Gommans 2015 : 98)
[25] Rama M. Jois (1996) Our Fraternity, New Delhi, Suruchi Prakashan, p. 10.
[26] Expression employée par Spinoza et reprise par Hardt et Negri dans Commonwealth pour désigner des moments de socialisation produisant du politique.
[27] http://www.sangamhouse.org/the-idea consulté le 7 août 2016.
[28] P. Sieger 2016, op. cit.
[29] “the ethico-political practice of a desiring self inexorably drawn to difference”
[30] Voir Romila Thapar, The public Intellectual in India ainsi que tous les articles à propos de la tolérance en Inde dans l’hebdomadaire Economic and Political Weekly.