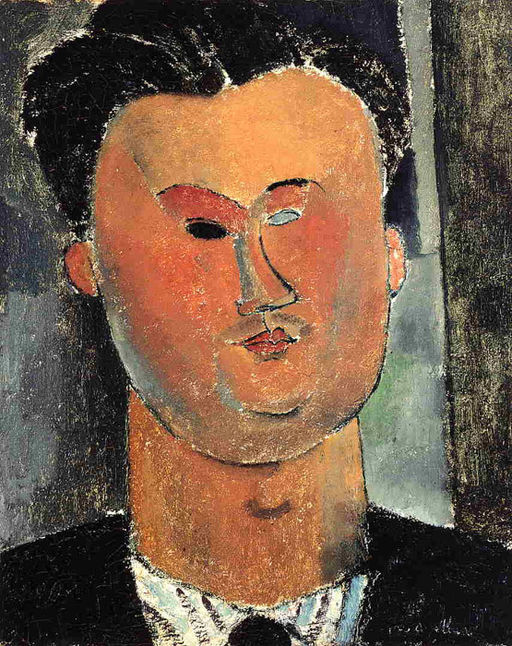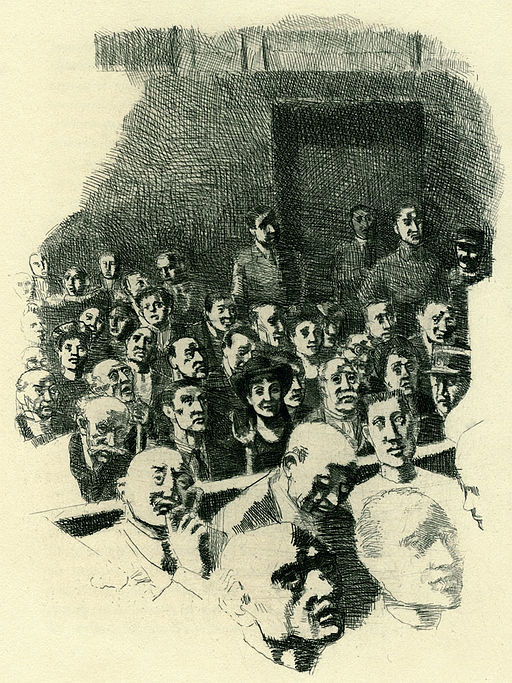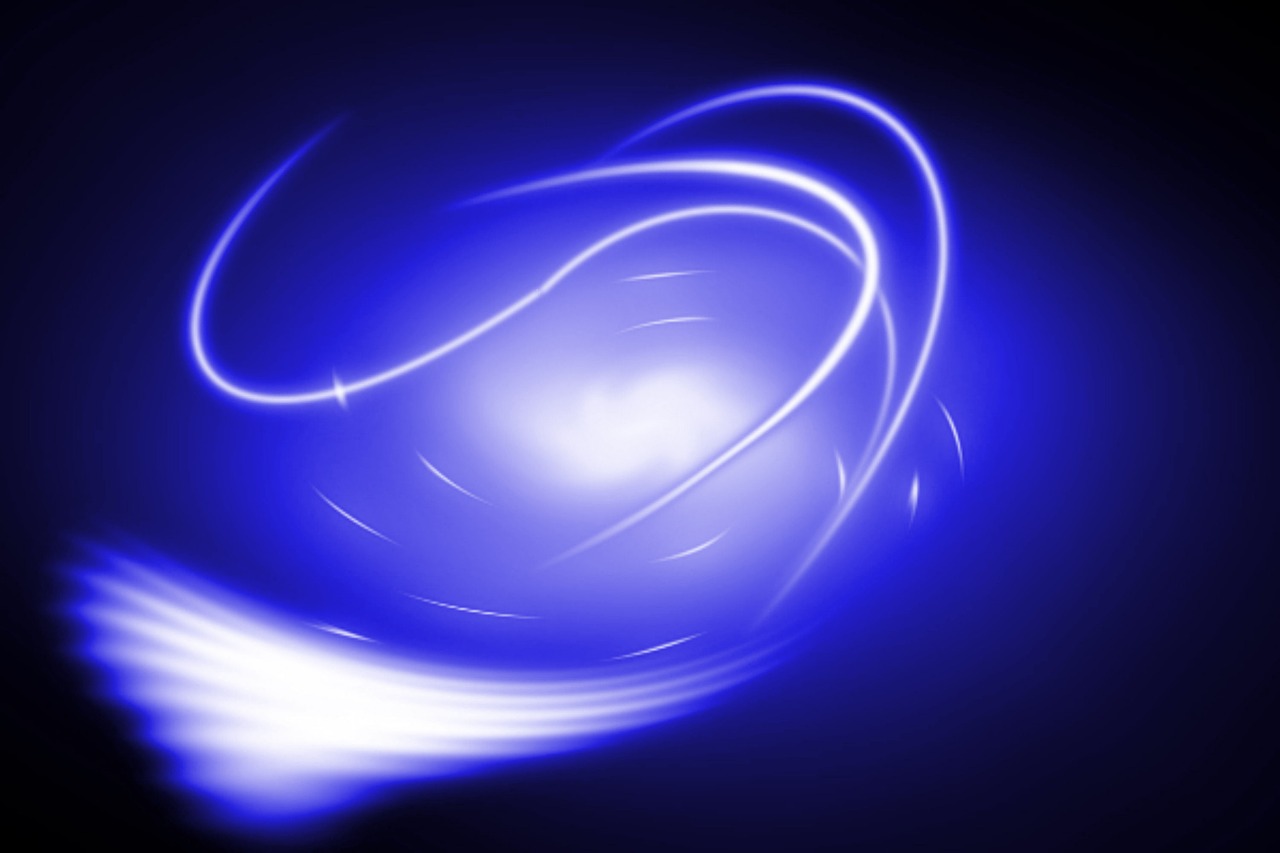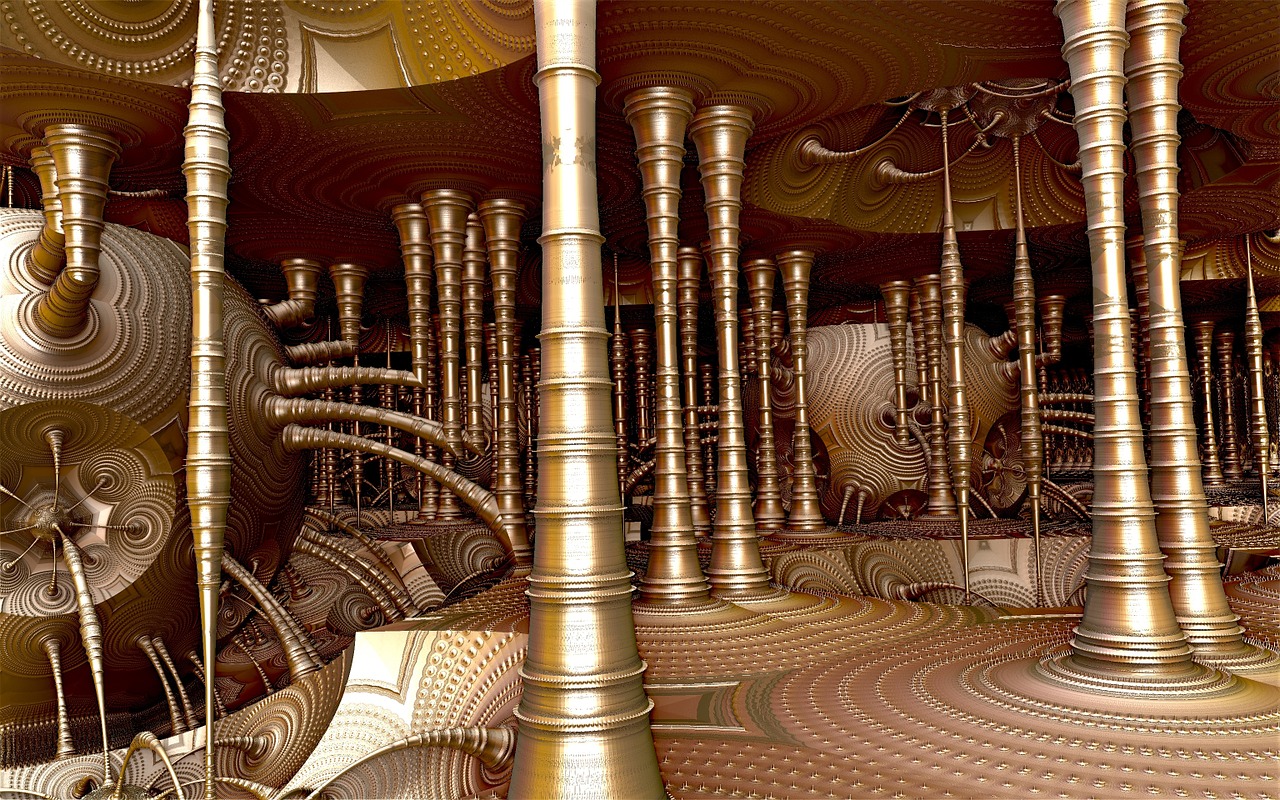Littérature et philosophie : du sens à la question
Maxime Plante, doctorant en sémiologie, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Résumé : Quand il ne caractérise pas la condition humaine, on a coutume de voir dans l’absurde l’échec du langage à communiquer son sens. La philosophie parvient-elle ainsi à penser tout ce qui donne à penser dans l’absurde ? Dans cet article, nous proposons de penser l’absurde à partir de la notion de poétique, non plus véhicule de sens, mais plutôt affliction et ouverture. Nous montrons que le poétique est ce moment de l’œuvre littéraire où le sens est livré à une radicale désorientation. Celle-ci rend possible un contact par lequel nous nous trouvons enfin libérés pour l’expérience de la transcendance comme pure possibilité d’une rencontre. Ce que l’absurde révèle n’est donc pas tant l’absence de sens de l’existence que la radicale étrangeté du monde. La philosophie – toute la philosophie – est-elle nécessairement fermée à cette expérience singulière ?
Abstract : When it doesn’t define the human condition, the common philosophical view is to think of the absurd as the failure of language to convey its meaning. Doing so, can philosophy think all that there is to think about the absurd? In this paper, we suggest that we can think the absurd with the idea of the poetic (le poétique), which isn’t a carrier of meaning, but a generator of affliction and openness. We show that poetic is the moment of the literary work where the meaning is subject to a radical disorientation. It enables a contact by which we find ourselves freed for the experience of transcendance as the pure possibility of an encounter. Therefore, what the absurd reveals isn’t so much the absence of meaning of existence, but the radical otherness of the world. Is philosophy – all of philosophy – really shut to that uncommon experience?
Dostoïevski écrivait avec une grande sensibilité que « si le monde permet le supplice d’un enfant par une brute, je ne m’oppose pas à Dieu, mais je rends mon billet[1]. » Cette phrase, placée dans la bouche d’Ivan Karamazov, dessine avec finesse les contours de ce qu’on appelle volontiers depuis Camus l’absurdité de l’existence humaine. Il n’est pas fortuit que la réflexion sur l’absurdité de l’existence ait été au départ une réflexion sur la justice. Mais une telle réflexion pouvait-elle éviter de devenir une interrogation théologique et ne pas mettre en jeu jusqu’à la bonté – sinon l’existence – de Dieu dès lors qu’il devenait impossible de faire l’impasse sur des événements si choquants et déchirants qu’ils blessaient en l’homme le sentiment d’équité le plus élémentaire ? Et puisque nous avions placé en Dieu la charge de la justice, était-il possible d’éviter sa chute comme source du sens de toutes choses lorsqu’il est devenu clair que même les principes théologiques ne pouvaient plus raisonnablement fournir une explication du réel sans se contredire eux-mêmes ?
On ne peut pourtant passer sous silence qu’il existe des figures de l’absurde qui semblent affranchies de la référence à la singularité de la condition humaine. Mais ces diverses figures – contradictions logiques, grammaticales ou syntaxiques – apparaissent dans la quotidienneté comme des erreurs, des exceptions, des imprévus gênants qu’il s’agit de conjurer et bannir le plus vite possible de l’espace dialogique et rationnel comme des irrégularités non significatives. Il peut être à cet effet utile de rappeler que le but premier des philosophies du langage et autres projets de langage formel fut d’éliminer la possibilité d’occurrence du non-sens et des propositions absurdes, ces dernières étant considérées comme problématiques dans la mesure où elles obscurcissent le terrain propre à l’entente, à la compréhension et à la pensée. Ainsi, lorsqu’on y regarde de plus près, il semble que toutes les figures de l’absurde se rassemblent et se rejoignent dans l’ostracisme qui les frappe et qui leur nie toute valeur positive ou créative. Dans tous les domaines, sauf peut-être celui au statut ambigu de l’humour, l’absurde devient la non-valeur par excellence, le discours halluciné, confus ou déraisonnable ; dans le meilleur des cas risible, sinon condamnable, toujours suspect.
Ainsi, l’absurdité « existentielle » et l’absurdité « logique » semblent se rassembler sous l’aspect paradigmatique de l’absence de sens. Par là on cherche à signifier deux choses à la fois : 1) l’absence absolue de signification et 2) l’absence de direction téléologique, de finalité inscrite et fixée. Ironiquement, on constate donc que l’absurde, qu’il soit existentiel ou logique, demeure subordonné au sein d’un système d’intelligibilité alors qu’il devait être cela même qui transgressait et qui remettait en question la toute-puissance du sens. La philosophie prétend de la sorte avoir épuisé la notion d’absurde. Mais, en vérité, a-t-elle fait autre chose que la neutraliser ? La philosophie parvient-elle véritablement à penser tout ce qui donne à penser dans l’absurde ? L’expérience de la littérature ne nous enseigne-t-elle pas qu’il y a quelque chose de l’absurde qui échappe à sa lecture proprement philosophique ? Quel est cet excès et vers quoi fait-il signe ?
Nous soutiendrons ici que l’absurde peut être pensé grâce à la notion de poétique. Cette notion, nous l’empruntons à Georges Bataille, pour qui elle est ce qui, dans l’œuvre, « peut s’ouvrir à la perte absolue de son sens[2] », ce qui « donne le commentaire [impossible] de son absence de sens[3] ». Le poétique n’est pas véhicule de sens, et l’absurde n’est a fortiori pas l’indice de son absence ; ils sont plutôt affliction et ouverture. Nous montrerons que le poétique est ce moment de l’œuvre littéraire où le sens est livré à une radicale désorientation. Celle-ci rend possible un contact qui n’est plus de l’ordre de la communication d’un message, mais par lequel nous nous trouvons enfin libérés pour l’expérience de la transcendance comme pure possibilité d’une rencontre. Ce que l’absurde révèle n’est donc pas tant l’absence de sens de l’existence que la radicale étrangeté du monde, qu’il y ait quelque chose comme le monde et non pas rien, et que cet « il y a » résonne pourtant comme une indépassable énigme. La littérature n’est-elle pas la confrontation inlassable avec cette situation énigmatique qui est la nôtre ?
Littérature et désorientation
Paul Celan disait du poème – mais nous l’affirmons aussi bien du texte en général – qu’il est comme une bouteille jetée à la mer, abandonnée aux caprices des vagues et des marées. Le texte est ainsi à la dérive, son avenir est incertain. Mais comme la bouteille que l’on a jetée à la mer y a été placée dans l’espoir qu’elle atteigne un jour le rivage de son destinataire – de tout destinataire – le texte a inscrit en lui-même sa possibilité essentielle, son destin étant d’être lu. Or, il est de ces lectures qui nous marquent plus sûrement que n’importe quel discours de raison. De ces lectures qui agissent plus sur le cœur que sur l’esprit. Ces lectures qui nous touchent, qui nous affectent, on pourrait presque dire : qui nous infectent. On se voit alors comme envahi par un corps étranger venant bouleverser l’équilibre précaire de nos esprits qui ne tolèrent pas l’instabilité d’un monde où notre sensibilité serait constamment mise à l’épreuve, écorchée.
En ce sens, la lecture fait toujours une place à la crainte de l’égarement. Ne pouvant supprimer cette crainte, le lecteur est toujours contraint de développer des stratégies pour rendre la lecture inoffensive. C’est pour cette raison que la lecture est pour nous tous avant tout expérience de sens : le sens est la boussole qui nous oriente à travers les méandres tortueux de l’œuvre. Grâce à lui, nous trouvons le fil de notre lecture, nous fixons un cap que nous pourrons résolument tenir pour traverser le livre d’une couverture à l’autre. Ce qui fait que, finalement, nous atteignons toujours notre destination. Le livre refermé, nous voilà arrivés à bon port. Pourtant la lecture peut également être une navigation en haute mer. Lorsqu’aucune terre ne se profile à l’horizon, lorsque la fureur des éléments rend impossible de tenir le cap, lorsque l’environnement est si hostile qu’il en rend nos instruments inutiles, le voyage n’est plus navigation, mais dérive. C’est qu’alors la lecture est radicale désorientation plutôt que suivi d’un sens.
Pourquoi une telle désorientation ? Blanchot suggère déjà une réponse en affirmant que le poétique est lié « à ce qui est « hors » du monde et [qu’] il exprime la profondeur de ce dehors sans intimité et sans repos[4]. » La lecture serait alors confrontation avec l’extérieur, ce qui signifie bien sûr confrontation avec ce qui nous est extérieur. Mais cette notion d’extérieur demeure pour le moment trop vague pour éclairer définitivement notre compréhension du poétique et de l’absurde. Cet état singulier correspond plus ou moins parfaitement à ce que Freud a nommé l’« inquiétante étrangeté » (das unheimliche) comme étant cette angoisse qui accompagne le sentiment que quelque chose de familier nous est soudainement étranger ou que quelque chose d’étranger comporte un je-ne-sais-quoi de familier. L’unheimlich ne se laisse pas saisir : l’angoisse nous tenaille, mais nous n’arrivons pas à mettre le doigt et à retrouver la trace de cette impression : on pourrait ainsi dire qu’il s’agit de l’impression de fuite en avant du sentiment[5]. C’est l’irréductibilité du sentiment qui allie, dans un même corps, le propre et l’étranger que traduit la notion d’unheimlich.
Cet état d’étrangeté ne peut être programmé. Cela est dû au fait que le poétique, pour utiliser les mots de Paul Celan, « comporte quelque chose qui déconcerte ». Allons plus loin : le poétique attaque par surprise, surprend, fait irruption de manière inattendue, il surgit et s’invite dans la lecture. La lecture poétique est donc ce contact violent avec l’extérieur, avec ce qui nous est inconnu mais qui pourtant nous interpelle souverainement, s’impose à nous. Ce contact traduit bien ce que Bataille disait de la poésie comme étant « l’essentiel, ce qui touche[6] ». Ce verbe, si simple en apparence est pourtant celui qui porte toute la charge du poétique. On notera, non sans une certaine ironie, que Bataille, après avoir cherché à définir l’essence de la poésie dans l’ensemble de son œuvre, y soit peut-être parvenu avec une formule aussi simple. S’il semble pauvre, le toucher possède en effet une richesse de sens insoupçonnée qui nous permettra peut-être de mieux comprendre l’effet poétique de la littérature en général et de l’absurde en particulier.
Toucher, poigne et poignée de main
Par définition, le toucher est contact et implique la rencontre de deux réalités, deux corps, deux surfaces. Ce fait est révélateur dans la mesure où il montre bien que l’expérience du toucher met en relation le même avec l’altérité. Contact de deux surfaces, le toucher exige donc plus qu’un être isolé pour s’effectuer. Ces surfaces ou corps finis sont d’emblée limités, dé-limités. Leur contact instaure un partage qui est à la fois mise en commun et délimitation de ce qui appartient à chacun. Il est d’ailleurs intéressant de constater que le terme « partage » contient en lui-même ce partage de sens. Le toucher engendre donc la limite ; il n’est pas fusion ou incorporation mais bien épreuve de la limite. L’être de la limite, l’être à la limite, ne s’éprouve donc que par la rencontre d’une autre limite. Le toucher permet de faire l’expérience de ce qui se trouve au point extrême et infime entre le connu et l’inconnu ; la limite dé-limite l’intérieur de l’extérieur.
Le toucher a plusieurs significations. Il est généralement entendu comme contact, frôlement ou effleurement, c’est-à-dire comme mouvement affectant superficiellement le corps touché. En géométrie, une droite qui touche en un seul point une courbe se dit tangente. La tangence exprime bien la superficialité et le caractère fuyant du toucher. Néanmoins, un autre sens révèle l’ambivalence du toucher. Être touché, ce n’est plus être affecté de façon superficielle, en surface, mais bien être traversé et transpercé de part en part par un trait fulgurant. Loin de demeurer en superficie, la blessure affecte en profondeur le corps touché. De fait, cela rend peut-être mieux compte de l’étymologie latine du verbe – toccare – qui signifie heurter, frapper.
Être touché traduit un contact. En un sens insolite, le poétique possède donc un effet « phatique » instituant d’emblée un rapport de « communication » entre le livre et le lecteur. On ne s’étonnera donc pas que Paul Celan[7], dans une lettre écrite à Hans Bender, dise qu’il ne « voit aucune différence entre une poignée de main et un poème[8]. » Le poétique, avant d’être un contenu figuratif ou métaphorique, est une simple interjection, un simple toucher se situant à un niveau « pré-dévoilant[9] » de l’expérience ; moment de saisissement, de serrement (de main). C’est un moment de pure rencontre qui signifie avant tout « venir au-devant de » l’autre, sans s’y attendre – une rencontre à laquelle on ne s’attend pas : n’est-ce pas ne pas s’attendre soi à se trouver là où l’on se trouvera bien pourtant ? – de manière fortuite, car au-delà de l’action fouineuse et fouisseuse du toucher se situe l’intransitif, le subir d’un être touché où la poignée de main du poétique est un « signe fait à l’autre, […], dire sans dit importants par leur inclinaison, par leur interpellation plutôt que par leur message[10]. »
C’est en cela que le poétique est phatique ; il n’est pas expressif ou informatif, son effet n’est pas dû à son contenu mais à son « irruptivité », car « To encounter a word – [a word that comes towards us] – means that it appears independent of any hermeneutic pretension, as a « thing », not as a sign[11]. » La « chose », informe, s’oppose au signe, sémiotiquement formé pour représenter un contenu. C’est la rencontre avec cette « chose » informe et non reconnaissable qui touche le lecteur, car « au cours d’une rencontre unique, donc irremplaçable, une étrangeté singulière vient se mêler indissociablement à une familiarité à la fois intime et déroutante, parfois inquiétante[12]. » Surpris et touché là où il s’y attendait le moins – en son être même – le Moi est transpercé par la fulgurance d’une rencontre.
Le poétique atteint donc mortellement le sujet. Il le blesse d’une blessure béante qu’il ne pourra pour un temps guérir. En quoi consiste une telle blessure ? Elle est d’abord affliction, au sens où l’on peut se dire affligé d’un mal ou d’une pathologie. Le lecteur serait en ce sens objet d’un pathos qu’il ne peut, par définition, contrôler ou même penser. Il faut refuser une lecture simplement psychologique ou psychologisante d’une telle dis-position. Il ne s’agit pas ici de faire croire que le poétique nous place dans un état d’inconscience ou que ses opérations ne s’effectuent que sur un mode inconscient. On pourrait croire au contraire – avec Blanchot d’ailleurs[13] – que l’atteinte du poétique ne suppose pas le passage à l’inconscient, mais la lucidité la plus extrême. René Char l’exprimait admirablement lorsqu’il écrivait que « la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil[14] », voulant peut-être par là marquer que la conscience de soi portée à sa limite est vécue comme une impossibilité de se dérober ou comme une double contrainte : l’impossibilité d’endurer la brûlure insoutenable du soleil et, tout à la fois, l’inexorabilité de cette douleur et l’impossibilité de s’y soustraire. C’est la lucidité et non l’inconscience qui retourne la conscience et dispose du sujet.
Exposition et communication
Dans la lecture le sujet s’expose au « coup » du poétique qui pourra le toucher et le faire tressaillir. Dans cette exposition s’exprime la vulnérabilité du sujet désarmé, à découvert, et son incapacité à se défendre contre les menaces qui pourraient venir du livre à sa rencontre. Être exposé, c’est aussi ne pas pouvoir se cacher, n’avoir aucun abri où se mettre à couvert. Cette exposition donnera ainsi la chance au livre de faire son effet sur le lecteur. Ce dernier, s’exposant, ne peut s’opposer au poétique et s’y fermer, car il ne contrôle pas ou plus la lecture. Le poétique a faussé sa boussole, elle est devenue inutile à son égarement et à son salut. Et comme la lecture poétique est le toucher ou l’être touché par l’impossible – cette rencontre que rien ne laissait présager – le sujet s’effrite à son contact. Libéré des logiques existentielles qui réglaient son être-au-monde et le pré-occupait, l’individu se tient dans l’ouvert. Cette ouverture peut-elle être le gage d’une nouvelle et tout autre communication. En quel sens ?
Si la communication évoque dès le départ l’idée d’être en relation avec, de partage et de mise en commun, il n’est pas certain que l’on doive se satisfaire d’une telle définition. Celle-ci a pour effet de faire de la communication non seulement l’outil par lequel on peut transmettre, mais également le résultat de la mise en commun. Ainsi, et c’est particulièrement évident depuis la Théorie de l’agir communicationnel d’Habermas, la communication ne vaut que si elle permet d’arriver à la victoire de la raison communicationnelle sous la forme du meilleur argument. La communication est donc également un état auquel on parvient lorsque toutes les idées ont été soupesées et évaluées, ce qui permet de les départager. Au terme du dialogue, la communication présuppose donc l’entente intersubjective, c’est-à-dire l’acceptation d’une norme commune issue non pas de la violence de la contrainte mais de la valeur « non coercitive du meilleur argument[15]. »
Le problème que cela pose est le suivant : la communication s’apparenterait alors à une communion. Or la communion, comme union de ceux qui partagent une même foi, suppose l’accord et la suppression des différences. En ce sens, la communion est le dépassement des différences et l’atteinte de l’harmonie dans la fusion des êtres par le partage d’un même principe. Pour cette raison, il peut sembler pertinent de suivre J.-L. Nancy et d’utiliser le terme de comparution plutôt que de communion pour souligner la spécificité de la communication qu’instaurent le poétique et l’état d’ouverture[16]. En effet, si la communion est suppression des différences dans un accord supérieur, la comparution est plutôt l’exposition des singularités de chacun. Une telle exposition ne suppose pas l’entente ou l’accord. À l’inverse, elle désigne la rencontre entre des différences dont l’incommensurabilité leur permet de se manifester dans toute leur plénitude. La communication ne sera alors plus vue seulement comme l’établissement et la sauvegarde d’un continuum ; elle ne tiendra plus à la seule condition d’éviter la rupture (du dialogue finalement) et on pourra voir dans la rupture du continuum de la communication une communication plus antique et plus puissante.
On doit donc refuser ici toute conception de la communication qui ferait d’elle le lieu d’une certaine mise en commun. La communication qui s’engage lors de la rencontre poétique qui dispose le sujet permet de découvrir un « lieu où la personne, dans le saisissement du moi – comme étranger à elle – se dégage[17]. » Le dégagement dont parle ici Celan témoigne de ce que le poétique nous jette dans l’ouvert et nous expose. Une telle ouverture permet ainsi de faire l’expérience de la communication comme expérience de la transcendance de l’autre. Face à lui on ne peut qu’« éprouver, dans le vide et le dénuement, la présence du dehors et, lié à cette présence, le fait qu’on est irrémédiablement hors du dehors […] [éprouver] que le dehors est là, ouvert, sans intimité, sans protection ni retenue […] mais qu’à cette ouverture même il n’est pas possible d’avoir accès[18]. » Éprouver qu’il est, d’une certaine manière, impossible de communier avec cet autre dont la proximité nous interpelle souverainement, mais qu’une distance aussi ténue qu’infranchissable nous empêche de rejoindre.
Littérature, altérité et métaphysique
L’expérience de ce non-rapport particulier avec l’altérité apparaît cependant ésotérique et demande à être explicitée. La poésie de Celan nous introduit bien à cette transcendance, même si nous demeurons désarmés pour la penser. « Qui » donc est cet autre ; quelle est cette transcendance ? Vaste question dont la littérature a tout avantage à ce qu’elle demeure ouverte. Il ne faut pas se hâter d’y donner une réponse, qu’elle soit morale, éthique ou logique. L’autre n’est pas tout à fait et immédiatement notre prochain, l’« Autrui » dont parle la Bible et qui, ultimement, nous renvoie à la transcendance du Dieu – le « Tout-Autre » – de l’Ancien Testament. L’autre n’est pas non plus simplement « ce qui diffère » ou « le différent ». Ces diverses significations ne nous donnent qu’une première approximation ; en vérité, elles sont encore trop vagues pour pouvoir rehausser notre compréhension de ce qui est en jeu dans l’altérité révélée par le poétique et l’absurde. Nous avions, du reste, dès le départ pris acte de l’incapacité de la philosophie à venir à notre secours. C’est en vertu de cette incapacité, d’ailleurs, que Camus caractérise la philosophie dans Le mythe de Sisyphe comme une variante du « suicide philosophique[19] ».
Cette conception de la philosophie comme quelque chose de trop « cérébral » et froid pour véritablement parvenir à saisir l’absurde qui s’affirme dans le foisonnement de la vie se trouve pourtant contestée radicalement, et de l’intérieur, par la pensée de M. Heidegger[20] qui aura peut-être le plus inspiré le mouvement existentialiste. À travers cette pensée, l’opposition entre la littérature et la philosophie devient, plus que jamais, sujette à caution. Pour lui, loin d’être hétérogènes, la littérature et la philosophie sont « du même ordre[21] » parce que toutes deux sont les seules qui, selon des modes certes différents, sont en mesure de dire le néant[22] et, ce faisant, de donner à penser. Nous ne pouvons approfondir ici le rapport insigne qui unit philosophie et littérature dans la pensée de Heidegger. Nous nous contenterons plutôt de montrer comment cette pensée ne se laisse pas réduire à un intellectualisme et permet de réconcilier l’expérience poétique, l’interrogation métaphysique et la vie quotidienne.
Quoi qu’on puisse en penser[23], Heidegger ne porte aucun jugement a priori négatif sur la vie quotidienne. Celle-ci, au contraire, est absolument centrale dans son analytique du Dasein, car elle est le seul accès possible à l’expérience et donc l’unique sol sur lequel fonder toute recherche[24]. Le discours du philosophe ne porte pas sur une expérience philosophique qu’il serait seul à effectuer. Il n’y a pas de séparation possible entre l’objet de la recherche philosophique et la vie « concrète ». C’est pour cette raison que, dans Être et temps, une des caractéristiques essentielles de l’homme[25], un de ses « existentiaux », sera son être-au-monde[26] (In-der-Welt-sein). Par là, Heidegger essaie de marquer deux choses. D’abord, l’impossibilité que nous avons évoquée d’une rupture entre l’homme et son monde, le fait inexorable qu’il se trouve en lui et qu’il ne peut « en sortir ». Ensuite, que cette présence dans le monde et son rapport à lui sont vécus sur le mode du souci, qui caractérise la manière dont l’homme se rapporte au monde et le comprend. Le terme de souci n’est pas à prendre au sens où l’on dit, par exemple, que « je me fais du souci » pour quelqu’un ou quelque chose. Si l’homme est souci, c’est parce que son rapport au monde est vécu sous le mode de la possibilité, où il doit à chaque fois décider le pour-quoi et l’en-vue-de-quoi de son rapport. En ce sens, l’homme est dans un commerce constant avec le monde et s’en préoccupe, c’est-à-dire qu’il l’envisage d’emblée pour… cela, comme…ceci et en-vue-de… tel usage déterminé.
La structure de préoccupation constitutive de l’homme pose cependant problème en ce qu’elle rend machinal son rapport au monde en le confinant à certains patrons de pensée et d’action déjà éprouvés et fixés par l’habitude. Cette manière qu’a l’homme de se préoccuper du monde est certes rassurante, car elle lui permet de faire l’économie d’un questionnement toujours renouvelé sur le pourquoi de son rapport au monde. Mais elle est aussi aliénante dans la mesure où l’homme en vient à ne plus « voir » l’altérité du monde en l’assimilant à quelque chose qui lui est familier. Toute l’histoire humaine, et précisément dans sa dimension historiale, est ainsi orientée de manière croissante vers une telle domestication du monde.
Or, on pourrait croire avec Heidegger que « les poètes et les penseurs » sont précisément ceux qui sont en mesure de nous rappeler à l’opacité du monde et de mettre en question la familiarité apparemment incontestable de notre rapport à lui. C’est ce qui nous semble émerger de la lecture de la conférence « Qu’est-ce que la métaphysique ? », remarquable tant pour la convergence de ses thèmes avec les nôtres que par le spectaculaire renversement de perspective auquel elle parvient. La conférence s’organise autour d’une situation fondamentale, celle de l’angoisse. Depuis Kierkegaard, l’angoisse est un motif récurrent, sinon central dans la littérature absurde ; il apparaît en outre solidaire de plusieurs thèmes constitutifs de cette littérature : solitude, exil, abandon, mort, athéisme, etc. Pourquoi une telle solidarité ? On pourrait croire que l’angoisse est cet état singulier de l’homme où tous ces phénomènes se trouvent ramenés à leur simplicité initiale. Blanchot exprime bien cette simplicité lorsqu’il écrit que :
…l’angoisse n’a pas de dessous mystérieux ; elle est toute dans l’évidence qui fait sentir qu’elle est là […] on pourra la décrire sous ses formes psychologiques les plus remarquables, on la mettra en rapport avec des notions métaphysiques fondamentales ; il n’y aura rien de plus dans tout ce fatras que dans les mots : je suis angoissé, et ces mots mêmes signifient qu’il n’y a rien d’autre que l’angoisse[27].
La pensée de la mort, le sentiment de la solitude, de l’abandon ou de l’exil nous mettent en présence de l’angoisse parce que celle-ci est l’élément simple sur lequel s’édifient ceux-là.
La littérature semble posséder le privilège de dire un tel état d’indigence précisément parce qu’elle est le lieu d’expression de l’écrivain. Le fait d’être « écrivain » ne renvoie pas simplement à une fonction que l’homme pourrait assumer de temps à autre, par plaisir ou par vocation. La littérature naît au contraire d’une exigence d’écrire confrontée à la vanité de cette entreprise, tout comme l’absurde naît de la « confrontation entre l’appel humain et le silence déraisonnable du monde[28]. » L’écrivain est celui qui a vécu cette nécessité et l’a éprouvée comme impossible. Cette sensation de pauvreté et de privation du langage dans le langage, c’est cela l’état de l’écrivain et c’est cela qui préside à la littérature comme expression de l’angoisse :
Le cas de l’écrivain est privilégié pour cette raison qu’il représente d’une manière privilégiée le paradoxe de l’angoisse. L’angoisse met en cause toutes les réalités de la raison, ses méthodes, ses possibilités, sa possibilité, ses fins, et cependant elle lui impose d’être là ; elle lui intime d’être raison aussi parfaitement qu’elle le peut ; elle-même n’est possible que parce que demeure dans toute sa puissance la faculté qu’elle rend impossible et anéantit[29].
La littérature trouve ainsi sa prééminence : elle est au plus près de l’expérience. Ce dont elle parle, elle l’a vécu dans sa chair.
Dans le recoupement de ce thème fondamental de l’angoisse, « Qu’est-ce que la métaphysique ? » apporte peut-être un éclairage complémentaire à l’expérience littéraire. Quelle est la spécificité de cet éclairage ? Pour Heidegger, l’angoisse est cette affection unique par laquelle le néant commence à se révéler à nous. Avant d’éclaircir le sens de ce terme, revenons sur nos pas. La conférence de Heidegger indique que l’angoisse est la mise à nu du caractère chancelant de l’existant (du monde), en tant que celui-ci nous échappe, devient insaisissable[30]. L’angoisse est en ce sens un néantir, elle initie un mouvement de répulsion et d’expulsion par lequel nous est révélée la distance de l’existant dans sa parfaite étrangeté jusqu’alors voilée. Le rapport de familiarité qui s’était établi presque naturellement avec le monde semble dorénavant ne plus aller de soi.
Quel rapport avec la vie concrète qu’exprime la littérature ? N’y a-t-il pas là encore négation de cette vie et scission entre l’expérience quotidienne et celle du philosophe ? Pas tout à fait. La négation dont il est question n’est pas l’opération du philosophe. Celui-ci ne fait d’une certaine manière que constater quelque chose qui se produit de façon exemplaire au sein de l’expérience concrète et universellement accessible qu’est l’angoisse. Dans sa réflexion sur cette expérience se produit un renversement de perspective qui engage jusqu’à notre rapport avec le monde. Avec l’angoisse, c’est en effet la structure primordiale de ce rapport au monde et la manière dont « nous sommes » en lui qui se trouvent mis en lumière d’une façon radicalement nouvelle, et précisément en tant que ce rapport fait question. Ce faire-question émane de la conjugaison d’une donnée nécessaire : la factualité de notre rapport au monde – « il y a » le monde et ce dernier nous est donné dans une proximité inexorable –, et de l’opacité de cette donation : l’immotivation radicale de ce même rapport – l’impossibilité de savoir pourquoi « il en est ainsi » et sa persistance comme énigme insondable.
Conclusion
La littérature et la métaphysique développent donc leur discours à partir de ce néant qui néanmoins donne à penser ; l’une à travers l’absurde et le poétique, dans l’ébranlement qu’ils provoquent en nous, l’autre à travers l’étonnement philosophique, entendu comme l’étincelle qui enflamme la pensée et la rejette dans l’étrangeté de sa condition en suscitant un questionnement vers le monde et vers l’être. L’absurde, le poétique et l’angoisse ne nous enseignent-ils pas finalement quelque chose du sens de la transcendance humaine, et du fait qu’il est nécessaire d’émerger hors du monde (en lui) pour soutenir un rapport authentique avec lui ? Ne serait-ce pas cela vivre – ek-sister[31]?
Bibliographie
Georges Bataille, Œuvres complètes, t. XI, Paris, Gallimard, 1988.
Maurice Blanchot, Faux pas, Paris, Gallimard, 1943.
———, L’espace littéraire, Paris, Gallimard, 1955.
Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, Paris, Gallimard, 1942.
Paul Celan, Le méridien, Saint-Clément-la-Rivière, Fata Morgana, 1995.
Jacques Derrida, L’écriture et la différence. Paris, Seuil, 1967.
———, Béliers : le dialogue ininterrompu : entre deux infinis, le poème. Paris, Galilée, 2003.
Fédor Dostoïevski, Les frères Karamazov. Paris, Gallimard, 1952..
Michel Foucault, « La pensée du dehors », Dits et écrits, t.1, Paris, Gallimard, 2001, p. 546-567.
Sigmund Freud, « L’inquiétante étrangeté ». L’inquiétante étrangeté et autres essais, Paris, Gallimard, 1985, p. 209-264.
Hans-Georg Gadamer, L’art de comprendre, t.2, Paris, Aubier-Montaigne, 1982.
Jürgen Habermas, « La complicité entre mythe et lumières : Horkheimer et Adorno », Le discours philosophique de la modernité, Paris, Gallimard, 1985, p. 128-156.
Martin Heidegger, « Lettre sur l’humanisme », Questions III et IV, Paris, Gallimard, 1966, p. 65-127.
———, « Qu’est-ce que la métaphysique ? », Questions I et II, Paris, Gallimard, 1968, p. 23-84.
———, Introduction à la métaphysique, Paris, Gallimard, 1980.
———, Être et temps, trad. E. Martineau, édition numérique hors-commerce, 1985..
Emmanuel Levinas, Paul Celan, de l’être à l’autre, Saint-Clément-la-Rivière, Fata Morgana, 2008.
Helmut Müller-Sievers, “On the Way to Quotation: Paul Celan’s ‘Meridian’ Speech”, New German Critique, no 91, Winter 2004, pp. 131-149.
Jean-Luc Nancy, La communauté désoeuvrée. Paris, C. Bourgois, 1986.
Jean-François Payette et Lawrence Olivier (dir.), Camus. Nouveaux regards sur sa vie et son œuvre, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2007.
[1] Fédor Dostoïevski, Les frères Karamazov, Paris, Gallimard, 1952, p. 343.
[2] Jacques Derrida, « De l’économie générale à l’économie restreinte », L’écriture et la différence, Paris, Seuil, 1967, p. 383.
[3] Ibid., p. 384.
[4] Maurice Blanchot, L’espace littéraire, Paris, Gallimard, 1955, p. 89.
[5] L’unheimlich doit être dissocié du phénomène de déjà-vu. À ce sujet, on peut consulter l’étude de Sigmund Freud, « L’inquiétante étrangeté », dans L’inquiétante étrangeté et autres essais, Paris, Gallimard, 1985, p. 209-264.
[6] Georges Bataille, Œuvres complètes, t. XI, Paris, Gallimard, 1988, p. 189.
[7] Nous sommes conscients que le passage de poétique au poème ne va pas nécessairement de soi. Nous nous sommes sentis autorisés à le faire parce que Celan discute généralement – notamment dans Le méridien – du poème dans sa forme idéale et non dans sa forme réelle. En ce qui concerne cette dernière, il nous semble que Celan serait d’accord pour dire que le poème réel n’est jamais de part en part poétique ni le poétique nécessairement poème.
[8] Emmanuel Lévinas, Paul Celan, de l’être à l’autre, Saint-Clément-la-Rivière, Fata Morgana, 2008, p. 15.
[9] Ibid., p. 17-18.
[10] Ibid., p. 25.
[11] Helmut Müller-Sievers, “On the Way to Quotation: Paul Celan’s ‘Meridian’ Speech”, New German Critique, no 91, (Winter 2004), p. 145.
[12] Jacques Derrida, Béliers : le dialogue ininterrompu : entre deux infinis, le poème, Paris, Galilée, 2003, p. 14.
[13] Voir entre autres « De l’angoisse au langage », dans Maurice Blanchot, Faux pas, Paris, Gallimard, 1943, p. 23-24.
[14] Cité dans Jean-François Payette et Lawrence Olivier (dir.), Camus. Nouveaux regards sur sa vie et son œuvre, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2007, p. 7.
[15] Jürgen Habermas, « La complicité entre mythe et lumières : Horkheimer et Adorno », Le discours philosophique de la modernité, Paris, Gallimard, 1985, p. 156.
[16] Au sujet de la notion de comparution, voir Jean-Luc Nancy, La communauté désoeuvrée, Paris, C. Bourgois, 1986, p. 72-74 et passim.
[17] Paul Celan, Le méridien, Saint-Clément-la-Rivière, Fata Morgana, 1995, p. 26.
[18] Michel Foucault, « La pensée du dehors », Dits et écrits, t.1, Paris, Gallimard, 2001, p. 526.
[19] Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe, Paris, Gallimard, 1942, p. 63-64.
[20] Convoquer Martin Heidegger si près de Paul Celan, poète juif de langue allemande – qui a ressenti l’exigence de dire dans la langue d’Auschwitz l’événement inouï qui se trouve ainsi nommé par une extraordinaire pénurie de langage – pourrait apparaître choquant. Rappelons que Heidegger ne s’est jamais véritablement exprimé sur son engagement national-socialiste et que Celan en fut à tout le moins déçu. Il serait pourtant trop simpliste des les opposer absolument ; pour Paul Celan aussi, Heidegger et le nazisme furent sûrement, pour utiliser les mots de Blanchot, « une blessure de la pensée » (Notre compagne clandestine), voire une « insupportable contradiction » (Lévinas).
[21] Martin Heidegger, Introduction à la métaphysique, Paris, Gallimard, 1980, p. 38. La parenté est par ailleurs réaffirmée dans Achèvement de la métaphysique et poésie (Paris, Gallimard, 2005, p. 107-108) et dans Qu’appelle-t-on penser ? (Paris, Puf, 1959, p. 139-140).
[22] Voir Albert Camus, Le mythe…, op. cit., p. 20-21.
[23] Ibid., p. 42.
[24] Martin Heidegger, Être et temps, trad. E. Martineau, édition numérique hors-commerce, 1985, p. 16-17. Disponible en ligne à l’adresse suivante : < http://nicolas.rialland.free.fr/heidegger/ > La pagination indiquée ici correspond la pagination originale de l’édition Niemeyer, donnée entre crochets dans nos traductions françaises.
[25] Par simplification, nous emploierons « homme » pour « Dasein », qui signifie plus précisément ce qui est homme dans l’homme et comment il l’est. Cette simplification appelle néanmoins à la plus grande prudence, ainsi que plusieurs l’ont déjà marqué. Voir par exemple l’avant-propos d’E. Martineau à Être et temps (op. cit., p. 7, note 9) et l’interprétation donnée par Heidegger dans l’Introduction à « Qu’est-ce que la métaphysique ? » (Questions I et II, Paris, Gallimard, 1968, p. 32).
[26] Martin Heidegger, Être et temps, op. cit., p. 54.
[27] Maurice Blanchot, Faux pas, op. cit., p. 20.
[28] Albert Camus, Le mythe…, op. cit., p. 46.
[29] Maurice Blanchot, Faux pas, op. cit., p. 12.
[30] Martin Heidegger, Questions I et II, op. cit., p. 60-61.
[31] Dans le passage du ex- au ek- de ek-sistence est donnée à lire, de façon condensée, toute la conception heideggérienne de l’être de l’homme : « L’homme est, et il est homme, pour autant qu’il est l’ek-sistant. […] Le monde est l’éclaircie de l’Être dans laquelle l’homme émerge du sein de son essence jetée. L’ »être-au-monde » nomme l’essence de l’ek-sistence au regard de la dimension éclaircie, à partir de laquelle se déploie le « ek- » de l’ek-sistence. Pensé à partir de l’ek-sistence, d’une certaine manière le « monde » est précisément l’au-delà à l’intérieur de l’ek-sistence et pour elle. » (Martin Heidegger, « Lettre sur l’humanisme », Questions III et IV, Paris, Gallimard, 1966, p. 110-111).