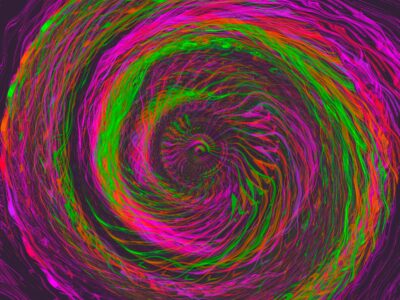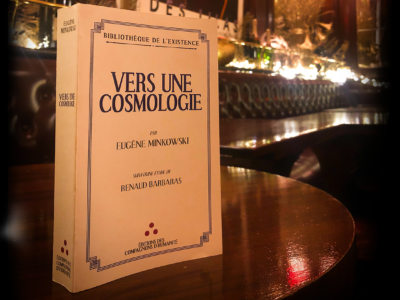L’image du morceau de cire (1)
La cire, une image qui donne à penser
Lors de l’introduction de cette rubrique, nous avons mentionné combien, dans le cas de la perception, l’image donne à penser. Cette affirmation n’était pas gratuite, quand bien même il est vrai que l’image peut se montrer fertile dans bien des champs de la philosophie. Mais cette particularité propre à la pensée de la perception, nous la mettions en avant pour une raison déjà exposée : le caractère toujours impliqué de cette dernière. Si la perception ne peut se penser sans être totalement coupée du terreau affectif qui est le sien, mais aussi de l’horizon d’un langage qui la décrit, l’image devient effectivement centrale pour penser cette dernière, en ce qu’elle permet à une représentation intellectuelle de la perception de se construire, tout en accueillant un sorte d’ouverture : cette expression de « donner à penser », que nous empruntons à Paul Ricœur [1], signifie en effet que l’image recèle une richesse dans laquelle l’interprétation pourrait puiser sans fin.

Source : Flickr – Andrew Wertheimer – CC
La première image que nous souhaiterions étudier est fameuse : il s’agit de l’image de la cire. Elle apparaît dans des textes majeurs de l’histoire de la philosophie de la perception. C’est d’abord la manière dont ces textes se saisissent de cette image de la cire pour penser la perception que nous souhaitons étudier. Mais nous tenterons également de mettre en évidence comment, autour de cette image de la cire, se structure une opposition centrale dans l’histoire des théories philosophiques de la perception. La cire, pensée pour sa capacité à être empreinte chez Aristote, est soumise chez Descartes à une dissolution. Cette dissolution de la cire semble caractéristique de ce que la pensée cartésienne opère quant à la théorie scolastique. C’est donc doublement que l’image de la cire donnerait à penser dans le cas de la perception : elle fournit aux philosophes une image pertinente pour penser leur objet, elle fournit à celui qui étudie l’histoire des théories philosophiques de la perception un repère révélateur d’un des tournants les plus importants de cette histoire.
Si l’image de la cire donne à penser, il faut dès lors assumer qu’elle n’a pas fini, avec Descartes, d’inspirer les philosophes qui pensent la perception. Nous proposerons donc de rattacher cette image aux réflexions de Deleuze concernant la peinture de Bacon : il semble en effet s’y révéler le fil conducteur qui permet à des philosophies opposées d’utiliser différemment une même image, la plasticité même de la cire, qu’il s’agirait de penser pour elle-même.
Aristote et la sensation comme empreinte
Le premier emploi de l’image de la cire que nous souhaitons étudier se trouve chez Aristote, dans deux textes fameux, que nous ne prétendons pas analyser ici de manière exhaustive. Une première occurrence peut être trouvée dans le Peri Psuché :
D’une façon générale, pour toute sensation, il faut comprendre que le sens est le réceptacle des formes sensibles sans la matière, comme la cire reçoit l’empreinte de l’anneau sans le fer ni l’or, et reçoit le sceau d’or ou d’airain, mais non en tant qu’or ou airain ; il en est de même pour le sens : pour chaque sensible, il pâtit sous l’action de ce qui possède couleur, saveur ou son, non pas en tant que chacun de ces objets est dit être une chose particulière, mais en tant qu’il est telle ou telle qualité et en vertu de sa forme. [2]
Si nous ne prétendons pas faire ici un commentaire détaillé de ce célèbre passage, tentons d’en dégager les points principaux quant à notre sujet : l’image de la cire. En premier lieu, quel est son statut logique dans l’énoncé d’Aristote ? La cire est ici convoquée au sein d’une analogie : la forme sensible est au sentant ce que l’empreinte est à la cire. L’analogie identifie donc celui qui sent à la cire qui reçoit l’empreinte (« réceptacle »). La cire sert donc de modèle pour penser le sujet de la perception, et ce qui se produit pour ce sujet lorsqu’il sent.
Mais pourquoi Aristote choisit-il précisément la cire ? La réponse s’impose aisément : dans le Traité de l’âme, le Stagirite essaie de tenir à distance deux positions opposées, et que nous pourrions résumer certes grossièrement. La première, matérialiste, affirme que la perception est un processus dont la logique repose sur l’objet, lequel s’imprime matériellement dans le sujet, ce processus matériel étant à l’origine de la sensation. Elle recourt elle-même à l’image de l’empreinte, mais pas nécessairement en convoquant l’image de la cire. Ainsi trouvons-nous chez un hériter de cette théorie Lucrèce, l’image de l’empreinte dans le plâtre, image qui, nous le verrons par la suite, a un sens tout autre que celle de la cire. L’autre tradition serait celle qui, comme la théorie soutenue par Platon dans le Timée, voit dans la perception un processus actif : le foyer de cette dernière est le sujet, qui produit des émanations rencontrant des objets. La cire permet à Aristote de se tenir à distance de ces deux théories, en adoptant une voie médiane : la perception est l’acte commun du senti et du sentant. La cire, matière plastique par excellence, est une image idéale pour penser une telle position théorique. Qu’est-ce, en effet, que la plasticité ? Il s’agit de la capacité d’un objet à changer de forme, et, de ce fait même, à garder forme. Capacité de déformation comme d’information, la plasticité extrême de la cire en fait une matière qui permet de penser le sujet sentant comme ce qui prend l’empreinte, mais qui est tout aussi bien capable de la recevoir. Ce thème de la puissance est en effet essentiel pour la théorie aristotélicienne de la perception, telle qu’elle est présentée dans le Traité de l’âme [3]. Elle permet de ne pas faire de la sensation un processus purement passif, puisque cette dernière suppose un sujet dont la puissance de sentir s’actualise.
La cire permet également de penser, toujours dans une voie médiane, la sensation comme transmission (perspective réaliste) sans pour autant la matérialiser (puisque c’est une forme sensible qui est perçue). L’image de l’empreinte dans la cire donne une figuration de cette transmission de forme, quand bien même, dans le cas précis de la cire, nous restons dans un processus matériel. Le lecteur doit en cela se déprendre de la ressemblance entre la cire et le sujet pour penser correctement l’analogie, et ne pas identifier l’or à la matière et la forme à la disposition des traits en relief.
Une autre occurrence de l’image de la cire dans le corpus aristotélicien confirme cette position générale et permet de l’approfondir. Il s’agit d’un extrait du Traité de la mémoire et de la réminiscence. L’analogie est reprise pour étudier non plus la sensation elle-même mais ce qu’Aristote appelle, et la complexité de la formule n’est pas anodine, « une sorte de type de la sensation » (ἡ οἷον τύπον τινὰ τοῦ αἰσθήματος), la mémoire, laquelle serait une perception par l’âme d’une sensation passée et qui a marqué son empreinte dans celui qui sent. Il n’est, encore une fois, pas notre objet d’étudier ici les difficultés posées par ce passage : elle sont nombreuses et Aristote en affronte un certain nombre dans les paragraphes suivants. Nous nous concentrerons ici sur les dernières phrases de cet extrait, dans lesquelles l’auteur traite des cas où l’empreinte est défectueuse :
Voilà pourquoi [450b] ceux qui par la violence de l’impression, ou par l’ardeur de l’âge, sont dans un grand mouvement, n’ont pas la mémoire des choses, comme si le mouvement et le cachet étaient appliqués sur une eau courante. Chez d’autres, au contraire, qui en quelque sorte sont froids comme le plâtre des vieilles constructions, la dureté même de la partie qui reçoit l’impression empêche que l’image n’y laisse la moindre trace. Voilà pourquoi les tout jeunes enfants et les vieillards ont très peu de mémoire. Ils coulent en effet, les uns parce qu’ils se développent, les autres parce qu’ils dépérissent. De même encore ceux qui sont trop vifs, et ceux qui sont trop lents, n’ont ordinairement de mémoire ni les uns ni les autres : ceux-ci sont trop humides, et ceux-là sont trop durs; par conséquent, l’image ne demeure point dans l’âme des uns et n’effleure pas l’âme des autres. [4]
Le défaut de mémoire viendrait d’un manque de plasticité de la part du sujet percevant : soit trop de déformation – la fluidité trop grande du support qu’évoque l’image de l’eau, soit pas assez – la rigidité du plâtre. Tout l’intérêt de ces quelques phrases pour notre étude est le recours à deux autres images, lesquelles permettent, en creux, de confirmer combien celle de la cire est pertinente pour penser la perception dans sa conception aristotélicienne. Si nous partons du contexte précis de ce recours à d’autres matériaux, nous pouvons en effet tenter une généralisation. Penser le sujet de la perception sur le modèle de l’eau, donc en accentuant le pôle du changement, de la fluidité, c’est prendre le risque de ne pas assez donner à l’extérieur, à l’information par l’objet du sujet qui perçoit. Inversement, penser le sujet qui perçoit sur le modèle du plâtre c’est manquer une fluidité minimale, et penser la perception comme empreinte sans prendre en compte le fait que cette empreinte a besoin d’un sujet capable de la recevoir. Nous retrouvons la dichotomie évoquée plus haut, et à l’égard de laquelle Aristote veut se tenir à l’écart : une position qui accorde trop au sujet et une position qui accorde trop à l’objet. Il n’est d’ailleurs pas anodin qu’un héritier de cette deuxième conception, Lucrèce, reprendra précisément l’image du plâtre dans sa théorie du simulacre, pour penser un phénomène optique comme l’inversion de l’image dans le miroir :
L’image dont la course a heurté le plan du miroir ne se retourne point ni ne revient indemne/ mais elle rejaillit tout droit en arrière,/ comme le ferait un masque de plâtre/lancé encore humide contre un pilier ou une poutre.[5]
Le masque de plâtre n’est certes pas, chez Lucrèce, une image du sujet. Il sert de comparaison pour penser le simulacre, comme enveloppe matérielle des choses. Cependant, n’est-ce pas précisément le problème d’une théorie atomiste de la perception que de ne pas penser suffisamment la manière dont le sujet reçoit cette enveloppe solide ? La transmission est, dans le cas de Lucrèce, un processus rigide. Aristote propose quant à lui une interprétation non matérielle de la sensation : dans la sensation, comme nous l’avons vu, c’est une forme qui se transmet, non la matière, de même que la cire ne retenait que la forme du sceau et non le fait qu’il soit en or ou en airain. Pour autant, son approche reste réaliste, puisqu’il s’agit bien, au sens propre, d’un processus d’information.
La cire prenant empreinte constitue donc une image opérante pour la théorie aristotélicienne de la perception, en ce qu’elle permet de concilier réalisme de la forme et refus d’une pensée matérialiste de cette dernière, en ce qu’elle concilie, par sa plasticité, le pôle de l’objet et celui du sujet, la déformation comme l’information.
Pauline Nadrigny
[1]L’expression fameuse de Paul Ricoeur, titre de son article, Le symbole donne à penser, est cependant employée ici hors de son contexte, sachant que l’auteur ne manque pas de distinguer le symbole de l’analogie, dont il sera notamment question ici.
[2] De l’âme, Livre II, chapitre 12.
[3] Ibid., chap.. 5.
[4]Traité de la mémoire et de la réminiscence, Chapitre I. chap. 6.
[5] Lucrèce, De Natura Rerum, Livre IV, par. 270