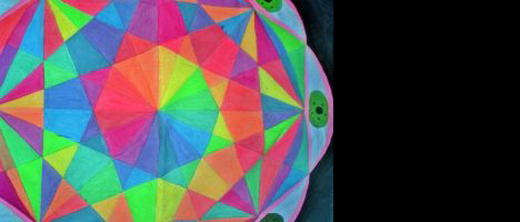L’identité de la personne malade d’Alzheimer face à la métaphore (1)
Un défi définitionnel et postural pour une reconnaissance historiale
Cette semaine thématique est organisée en partenariat avec l’Espace national éthique Alzheimer et la revue Implications philosophiques
Ce travail a été développé par Laura Lange dans le cadre de ses missions au sein de l’espace éthique Rhône-Alpes dirigé par le Professeur François Chapuis, comme de base de réflexion aux membres des groupes de travail thématiques « Neuro-Ethique » coordonné par le Professeur Nicolas Kopp, et « Vulnérabilité » coordonné par le Docteur Pascale Vassal.
Définitions médicales et neurologiques
La Maladie d’Alzheimer (MA) rejoint d’autres Maladies neuro-dégénératives Apparentées sous le sigle MAMA.
La MA représente désormais un problème de santé publique majeur en raison du nombre de patients, de l’absence de médicaments efficaces, de la perception souvent sinistre de cette maladie, de la dépendance et de la solitude qu’elle induit, notamment du fait d’un vocabulaire dévalorisant et stigmatisant, e.g., démence, dégénérescence, dépendance, etc. Ces maladies posent des questions à la biomédecine certes mais aussi aux sciences humaines en particulier philosophiques, juridiques et éthiques.
Diverses formes d’amnésie, en particulier des faits récents, se conjuguent à un jugement et une abstraction allant vers l’appauvrissement des manifestations cognitives telles qu’agnosies, apraxies, aphasies. L’annonce du diagnostic de MAMA est délicate ainsi que le moment d’organiser la « prise en charge ». Dans les formes familiales, le diagnostic et l’annonce peuvent être très précocement réalisés avant l’apparition des signes et la contrainte du type épée de Damoclès. L’évolution se fait vers la démence c’est-à-dire une altération plus ou moins globale des fonctions cognitives .Mais le (la) patient(e) garde souvent, malgré les troubles du jugement, de la parole et la perte d’autonomie, une capacité de communiquer avec les aidants et les aimants, par un langage infra verbal basé sur la persistance d’une certaine autonomie émotionnelle. La perte de mémoire des faits récents favorise la perte de continuité nécessaire à la conservation d’une identité suffisante. Avec l’agnosie spatiale, cette amnésie favorise une désorientation temporo-spatiale. L’agnosie des visages nuit à la communication empathique. Dans les MAMAs fronto-temporales existe un syndrome frontal de type désinhibition, troubles obsessifs compulsifs ou agressivité irréversible. Dans une autre MAMA, la maladie à corps de Lewy diffus, les manifestations peuvent être fluctuantes avec des hallucinations visuelles pouvant un certain temps évoquer une pathologie psychotique.

Source : Stock.Xchng
» Le premier défi…c’est celui de la clarté. L’emploi des mots est souvent flou ; on ne précise pas son vocabulaire ; pire on joue parfois sur l’ambiguïté. »
Guy DURAND, Introduction générale à la bioéthique. Histoire, concepts et outils.
Montréal Fides 2005, Des défis, page 71.
Approche philosophique et éthique
Avoir la maladie d’Alzheimer et/ou être malade d’Alzheimer.
C’est une alternative ou conjonctive[1] qui engage une réflexion à la fois sur la façon de penser le sujet malade et de panser la maladie.
La maladie d’Alzheimer atteint et altère le sujet. Phase de déséquilibre et de transformation, nous verrons qu’elle est une épreuve charnière et dialectique qui témoigne à la fois de variations et de permanence, de retrait et d’ouverture, d’oubli et de mémoire.
Dans ce contexte de « crise » où les modifications intellectuelles, de langage ou de mémoire chroniques du sujet malade d’Alzheimer mettent à rude épreuve sa capacité à faire des choix réfléchis et à mettre en récit l’histoire d’une vie ; assistons-nous à l’explosion et/ou l’implosion du sujet malade ? Plus précisément, assistons-nous à l’éclatement de ce qui caractérise une personne et/ou à l’effondrement de ce qui la constitue essentiellement ? La maladie d’Alzheimer relève-t-elle de l’expérience d’avoir sa personnalité bouleversée et/ou de l’histoire d’être annihilé dans son essentialité ?
Distinguer trois types d’identités, présentés selon l’ordre d’analyse proposé, nous permettra de proposer une herméneutique du sujet malade d’Alzheimer. Nous n’envisagerons pas les différents types d’identités biologique et médicale.
Premièrement, une identité de surface, qui vient du dehors. Une identité construite, socialement accessoire [statut, nom, rôle]. Selon ce qu’elle représente ou symbolise, nous verrons que l’identité sociale présume de la qualité d’un individu (« faible » ou « forte » personnalité, « capabilité »[2], intensité d’être).
Deuxièmement, une identité productrice d’une biographie [d’où je viens, qui je suis, ce que je fais, où je vais]. Cette identité subjective, nous l’attribuons à la personnalité. Originale et continue, elle rend compte de ce qui caractérise l’individu. Narrative, elle permet de se raconter, d’exprimer sa socialité en faisant récit des évènements vécus. Aussi, elle permet de se reconnaître dans une histoire. Paul Ricœur parle d’une identité narrative. Elle est l’« ipséité » c’est-à-dire le soi-même. Elle est aussi largement influencée par le contexte institutionnel au sein duquel elle évolue.
Enfin, l’identité de fond, qui vient du dedans. Fondamentalement propre à l’homme, elle est porteuse de valeurs. Permanente, elle est non confectionnée, non artificielle. Bien qu’elle soit ébranlable, elle demeure indissoluble du vivant du sujet. Elle est le même, une sorte d’invariant relationnel. Elle exprime l’autre comme personne essentielle toujours déjà en vie
On remarquera que cette déclinaison d’identités reprend, sans rigoureusement s’y confondre, les concepts ricoeuriens de socius, d’ipse et d’idem (ou mêmeté). En effet, lorsque nous reprendrons les concepts d’ipséité et de mêmeté, ceux-ci ne recouvriront pas littéralement les mêmes significations que chez Paul Ricoeur. Nous penserons par exemple le concept de mêmeté comme un invariant socle et source du concept d’ipséité. Notre argumentation suivra notamment le fil de l’enthousiasme ricoeurien tout en proposant une lecture personnelle de l’identité, construite à partir d’autres perspectives philosophiques, contextualisée à la problématique de la maladie d’Alzheimer.
Précision : Si étymologiquement le mot personne traduit en latin le masque, le rôle ou encore le personnage, nous puiserons ce concept au cœur de sa signification en nous demandant si derrière cette définition commune, le mot de personne ne revêt pas une profondeur invisible et intime qui rend possible le jeu social de l’être. Nous partirons du présupposé qu’il existe une dimension personnelle et intime du dénominatif de personne en résistant à la signification donnée à ce mot par le regard technique et institutionnel.
Ces deux derniers types d’identité, l’un propre à la personnalité [forme, ipséité] et, l’autre à l’essentiliaté [contenu, mêmeté] composent notre identité personnelle, origine de toute normativité éthique et morale. Nous préciserons la nature de cette composition dont l’identité essentielle est la partie fondamentale c’est-à-dire le nerf de l’identité personnelle.
Fort de ces trois identités, être une personne c’est tout à la fois se sentir soi, se sentir cet individu là et sentir l’autre. Mais en présumant de la qualité d’un individu, nous verrons comment l’identité sociale affecte l’identité personnelle, comment ce bloc d’apparence s’effrite suites aux aléas et accidents de la vie. Lorsque l’individu n’est plus en mesure de raconter avec raison et cohérence, de se raconter à travers le fil historique de sa vie et de communiquer son histoire à l’autre, est-il toujours une personne ? Indépendamment d’un pouvoir « mettre en récit », comment penser et reconnaître un pouvoir « être en récit » et « faire récit », permanent, humanisant, pansant ?
Dans les faits, nous verrons comment le changement constaté de la personne malade estampillée « Alzheimer » contribue à l’émergence d’une métaphore de la maladie qui traduit notre conception et perception de la maladie d’Alzheimer. Elle est considérée soit comme un mal de « surface » qui affecte la personnalité et parfois même jusqu’à la motricité, soit comme un mal fondamental qui affecte l’identité du sujet, auquel cas c’est le bloc entier de l’identité personnelle qui s’effondre.
Chacune des métaphores de la maladie renvoie à différentes postures de l’accompagnement. Nous en distinguerons trois : la posture institutionnelle, la posture du soignant aimant et la posture du soignant pratico-aidant.
Aussi, il s’agira de montrer comment chacune de ces postures d’accompagnement affecte la métaphore de l’identité de la personne malade
Tout au long de ce parcours réflexif, le concept de vulnérabilité nous accompagnera. La vulnérabilité étant tout à la fois expérience du soi et de l’ « hors de soi ». Elle est à la fois invitation à la métaphore ou imagination pour pallier le réel de sa condition et incitation à la mobilisation et compassion pour l’affecté.
La posture instituto-démentielle : L’identité sociale ou l’Alzheimer comme métaphore.
Le contexte institutionnel
Ricœur qualifie le contexte institutionnel ou social sous le pronom « il ». Cadre de références prometteur, ce « il » garantit l’équité dans la distribution des soins et permet le vivre ensemble. Menaçant, il subsume l’individu sous le collectif et pense le mal à l’échelle de la collectivité. Des politiques de soins sont engagées. Des protocoles de traitements et de soins sont institutionnalisés.
Dans ce contexte, la maladie prend une dimension sociale. Perçue par l’autre, hors du moi vulnérable, elle éveille la préoccupation et réveille sa disposition à l’action.
La première préoccupation de l’institution hospitalière est celle de l’efficacité du soin. La mobilisation est quête de résultats, recouvrement de la santé, restauration des potentialités.
Expression de liberté et d’autonomie, condition d’efficacité et de performativité, la santé est devenue dans notre société une valeur inédite. Elle est moins, ici, l’expression d’une bonne hygiène que l’expression d’une capacité à s’accomplir pleinement comme on l’entend[3], à se rendre maître de sa vie. L’autonomie est la valeur saine par excellence. Elle est la compétence dans l’évaluation des conséquences de son action c’est-à-dire la « capabilité » à maximiser par soi-même son bien-être.
Face à la valorisation de l’autonomie-compétence, que reste-t-il lorsque l’on est « incompétent » c’est-à-dire incapable de maximiser pas soi-même son bonheur ?
Il y a une construction psycho sociale de la vulnérabilité comme faiblesse, handicap, manque ou incompétence qu’elle soit motrice ou psychique. Sa prise en charge est moins l’expression d’une charité que celle d’une utilité à restaurer le pouvoir faire du sujet malade, à montrer l’efficacité d’un modèle coût-bénéfice et à préserver le fantasme de puissance éternelle du monde moderne. On agit promptement et efficacement pour contrôler l’altérité de la maladie, son entrée et sa sortie, panser la vulnérabilité et restaurer le pouvoir de productivité.
Mais, comment la quête d’efficacité et de résultats engagée par l’institution hospitalière, véritable « machine à guérir »[4] prend-t-elle en charge la vulnérabilité de ceux pour qui aucun recouvrement de la santé n’est possible ?
L’identité sociale
Tout individu au sein d’une institution a une identité sociale, comprenons un socius qui témoigne de sa fonction. Ricœur définit le socius[5] comme « l’autre anonyme pensé par l’intermédiaire de son métier ou de sa fonction sociale indépendamment de sa personnalité, de ses expériences ou de ses convictions privées ».
Lorsqu’un individu est handicapé au cours de son parcours de vie, le socius fonctionnel [statut, par ex. facteur] est remplacé ou complété par un socius conditionnel. Le handicap devient un statut assigné qui attrait à sa condition d’homme et subsume ou complète le socius fonctionnel préexistant. L’individu jouit d’une nouvelle identité sociale qui le représente collectivement et métaphoriquement : « invalide », « attardé », « dément » etc.
Derrière cette nouvelle identité, on suppute que la condition physique ou psychique de l’individu est affectée.
Lorsque le handicap est physique, l’individu perd sa capacité à se mouvoir (capacité qu’il a en commun avec les animaux) mais demeure dans la capacité proprement humaine de penser. L’identité sociale de l’individu handicapé physique, qui l’estampille « invalide », témoigne d’une atteinte à son enveloppe corporelle qui ébranle sa capacité à se mouvoir. Aussi, derrière l’étiquette « invalide », demeure intacte l’identité personnelle c’est-à-dire l’expérience d’avoir sa personnalité et l’histoire d’être dans son essentialité. Ce sont l’incapacité, l’invalidité, la vulnérabilité et la dépendance de l’individu handicapé physique qui sont socialement représentées.
A l’inverse, lorsque le handicap est psychique et selon les degrés, si demeure la capacité de se mouvoir bien que la motricité puisse en être affectée, la capacité de penser de l’individu est ébranlée jusqu’à pouvoir être quasi annihilée. Aussi, il est un fait que le sujet malade d’Alzheimer ne fasse preuve d’une pleine autonomie psychique. Affecté au niveau cognitif, il perd ses repères réflexifs et mémoriaux. La vulnérabilité psychique empêche l’autonomie de pensée qui consiste à pouvoir mener une réflexion de façon cohérente et rationnelle ainsi que l’autonomie décisionnelle qui permet de choisir, à partir de là, le meilleur pour soi. Alors, dans l’imaginaire collectif, l’autonomie de pensée du sujet malade n’est autre que le plus bas degré de l’autonomie ou autonomie de l’indifférence[6] qui traduit à la fois l’incapacité à différencier et le fait de choisir sans raison n’importe lequel des possibles. Donc, le sujet malade d’Alzheimer n’a que véritable autonomie celle de mouvement.
Capable de se mouvoir parfois tout à fait naturellement parfois plus difficilement, le sujet malade exprime son autonomie d’action. Cette autonomie étant de nature animale, elle est aussi un bas degré d’autonomie. Elle ne peut, à elle seule, constituer la personnification ou l’humanisation d’un être. Si d’un point de vue juridique, une personne est d’abord un corps, elle est aussi et surtout un esprit, une conscience, une mémoire, une personnalité, une manière d’être qui font l‘histoire. Aussi, dans l’imaginaire collectif, lorsque la personnalité du sujet est affectée comme c’est le cas avec la maladie d’Alzheimer, le statut de personne lui est destitué. Face à l’indifférence fantasmée des individus atteints par cette maladie, nous verrons que la posture institutionnelle adopte à son tour une posture de l’indifférence mais au sens littéral d’absence d’intérêt. Précisons le sens apporté à l’expression de « posture institutionnelle ». Elle est le terme générique exprimant un regard socialisant et globalisant que traduit aussi le pronom impersonnel « il ».
Si l’on s’en tient à la posture institutionnelle, le sujet malade d’Alzheimer a tous les torts. Non seulement sa pathologie l’empêche d’évaluer pleinement les conséquences de son action et donc de faire des choix qui lui permettent de maximiser son bien être, mais aussi il oublie et s’oublie. Dans le cas de la maladie d’Alzheimer, c’est précisément la capacité à se remémorer qui est affectée. Or, la perte de mémoire implique la perte de l’histoire d’une vie. L’incapacité à se remémorer implique l’impossibilité de raconter son histoire, de se mettre en récit, de récupérer le fil et révéler l’intrigue de son histoire. Aussi, le sujet malade d’Alzheimer ne guérira pas. Il est tout à la fois incompétent et condamné, méconnaissable et inguérissable.
Donc, derrière l’étiquette « Alzheimer : maladie de l’oubli », ce n’est pas la capacité formelle et animale à se mouvoir qui est affectée mais la capacité conditionnelle et proprement humaine à être une personne en mesure de témoigner de son histoire, qui est brisée. Affectée « holistiquement » par le regard institutionnel, aussi bien dans sa « personnalité » que de son « essentialité », l’identité personnelle est éclatée et subsumée au vide de l’inhumanité.
Socialement, l’Alzheimer est métaphore d’une pathologie du néant et de la finitude.
D’abord dans l’imaginaire populaire porté par le jeunisme ambiant, la maladie d’Alzheimer est synonyme de maladie de « vieux ». Bien qu’il soit vrai qu’elle concerne principalement les personnes âgées, elle peut être diagnostiquée chez des adultes encore jeunes. Associée à la vieillesse, elle est parfois associée à la déchéance, l’idée de ruine, d’effondrement, jusqu’à l’idée de mort. Les expressions telles que « mort dans la vie »[7], « mort sans cadavre » ou encore « veuves blanches » sont connues.
Ces attributions montrent bien comment la vitalité demeurant au cœur du sujet malade d’Alzheimer risque d’être effacée par les préjugés et confusions. Son identité personnelle jusqu’à son pouvoir être en vie sont préjugés. Aussi, la métaphore de la maladie engagée par le regard institutionnel pense le sujet malade d’Alzheimer à partir d’une conception empirique et holistique qui le subsume identitairement sous sa pathologie ou celles apparentées.
Qu’est- ce que le sujet a ? Alzheimer.
Qu’est-ce que le sujet est ? Alzheimer ou adjectifs apparentés comme métaphore [« dément », « déficient » etc.].
La singularité du vécu maladif est remplacée par le terme générique d’Alzheimer. Dans la parole comme dans le geste, la personne malade d’Alzheimer peut devenir le malade d’Alzheimer voire le Alzheimer. C’est sa maladie que l’on traite, elle qui est reconnue socialement. Le patient n’est que l’objectivation ou matérialisation de ce qui le vulnérabilise, le ronge et le détruit.
L’identité sociale peut avoir des répercussions dramatiques. En jugeant sa pathologie à partir de fantasmes et métaphores, elle prive l’être affecté du réel de sa condition. En identifiant le sujet malade à sa pathologie, la posture institutionnelle le distingue des biens portants et l’éloigne donc de moi. Désincarné, dépersonnifié, le sujet est vidé de son identité personnelle et privé d’un sujet dans le stigmate de sa situation, elle peut le conduire au mutisme, à l’isolement, la dépression jusqu’au suicide qui ne serait que l’actualisation du fantasme du zombi.
Maladie neurodégénérative, elle implique un accompagnement de la méconnaissance du sujet malade. Mais, l’accompagnement dispensé reconnaît le handicap tout en méconnaissant l’identité du sujet malade d’Alzheimer. Il prend en charge la dimension sociale du mal mais ne prend pas soin de sa dimension historiale [caractère historique propre à l’essentialité, à l’humanité]. Bien au contraire, l’institution stigmatise. Elle participe de la construction du sentiment de vulnérabilité. C’est le paradoxe de notre société qui génère de la souffrance sociale, psychique et même existentielle.
L’étiquette pointe du doigt l’autre affecté autant qu’elle me vise « Regardez ce que vous risquez si vous ne sollicitez pas votre activité cérébrale ». Cheminerait-on vers une responsabilité du mal subi ? Exposer et étiqueter la souffrance de l’autre en prévention de la souffrance possible, tel est aussi le message transmis.
La posture instituto-démentielle
De l’étiquette des mots, il n’y a qu’un saut à l’insouciance du mal être. C’est le saut de l’avoir au faire, du dossier du malade au panser son mal, du texte à l’action[8]. On prend en charge ce qui diffère, ce qui altère sans considération d’un « même » qui semble ne plus être. A l’affût de la différence, on cède à l’indifférence du mal être du patient, à l’insouciance de ce qui demeure caché mais existant.
La mystification du mot Alzheimer ou des maladies apparentées est finalement moins due au constat d’une finitude dans la vie ou d’un néant de l’être qu’au rejet de son mal qui m’affecte. La métaphore de la maladie d’Alzheimer témoigne de mon insouciance c’est-à-dire de mon absence de reconnaissance et de mon détachement vis à vis de l’autre. Elle témoigne aussi de ma violence à ne pouvoir le reconnaître dans sa mêmeté et de mon insolence à ne pouvoir entrer en relation avec lui. Parce que la vulnérabilité de l’autre nous renvoie à notre propre vulnérabilité, à la potentialité que nous avons aussi d’être diminué, fragilisé et de mourir. Parce que la vulnérabilité de l’autre soi-même nous ramène non pas au fait d’être potentiellement vulnérable mais à la certitude de l’être.
Plus qu’une pathologie de la finitude, la maladie d’Alzheimer est une pathologie de la relation et de la reconnaissance mais point seulement du côté du malade, ce que nous verrons. En effet, c’est aussi une pathologie sociale dont souffre la posture institutionnelle.
Obscurantisme du regard, mutisme du geste, la posture institutionnelle enfouit l’identité du malade sous les méandres de l’identité sociale. Dans le cas spécifique de la maladie d’Alzheimer ou des maladies apparentées, cela a d’inquiétant qu’elle enfouit non pas le pouvoir faire mais le pouvoir être de l’individu.
Face à la maladie de l’oubli, l’institution est en souffrance elle aussi. Infantilisation, distanciation et mépris sont des attitudes quotidiennes de fuite et d’oubli. Par celles-ci, le collectif institutionnel panse son mal. Il maintient le sujet malade dans la position de dépendant et échappe à toute comparaison possible avec lui. Cet évitement contemporain, cet oubli de l’oubli méconnaît le même derrière ce qui altère, incapable d’oublier l’étiquette, de se remémorer l’essentiel.
En réaction à ce rejet, la posture aimante cherche à reconstruire, à recoller les morceaux de l’identité. Comme Foucault, elle s’oppose aux pouvoirs qui imposent aux individus des formes d’identification ou métaphores sociales réductrices et destructrices. Elle témoigne que l’absence de guérison possible n’empêche pas l’accompagnement de la restauration d’un pouvoir faire et, plus encore, d’un pouvoir être. Ce n’est pas parce que le sujet malade d’Alzheimer est inguérissable que sa vie est désormais vide d’espérance. Face à la violence du stigmatisme, elle engage une lutte pour la reconnaissance de la permanence d’une identité personnelle du sujet malade d’Alzheimer. Face à l’oubli démentiel institutionnel qui sacrifie le « prendre soin » au bénéfice d’un « faire le soin », nous allons voir comment la mémoire passionnelle du soignant aimant et l’attention amicale du soignant pratico-aidant ramènent à l’essentiel.
Lire la suite
Auteur : Laura LANGE, doctorante en Philosophie, Chargée de mission à l’Espace Ethique Rhône-Alpes.
Co-auteur : Nicolas Kopp, Professeur de neuro-pathologie, Membre du Conseil Scientifique de l’Espace Ethique Rhône-Alpes, Coordonnateur du groupe de travail thématiques « Neuro-Ethique ».
[1] Notion grammaticale.
[2] Terminologie citée et traduite par Paul RICOEUR que nous devons à Amartya SEN.
[3] Définition de l’Organisation Mondiale de la Santé de 1946 « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. ».
[4] Référence au titre de l’ouvrage de Michel FOUCAULT, Les machines à guérir, Mardaga, avril 1995.
[5] RICOEUR Paul, « Le socius et le prochain » Revue Esprit, 1954.
[6] René DESCARTES voit dans le concept de liberté d’indifférence « le plus bas de gré de la liberté ».
[7] Expression de Jean MAISONDIEU.
[8] Titre de l’ouvrage de Paul RICOEUR, Du texte à l’action.