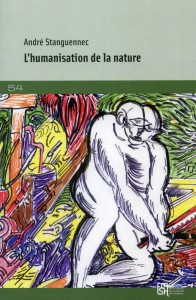L’humanisation de la nature
Recension de l’ouvrage d’André Stanguennec, L’humanisation de la nature, Paris, Éditions de la MSH, 2014 par Rémi Beau (Paris 1)
Après Les Horreurs du monde[1], André Stanguennec prolonge son travail phénoménologique en direction du monde naturel. Il explore, plus précisément, les différents versants de l’humanisation de la nature à la lumière d’une interprétation dialectique et réflexive. Renouant avec l’interrogation présocratique sur la phusis, l’auteur déploie ainsi l’hypothèse selon laquelle nous pouvons comprendre tant le devenir humain de la nature que son humanisation technique, juridique et morale, comme le résultat d’un processus orienté, constitué par le dépassement synthétique des contradictions internes éprouvées par ce qu’il décrit comme un « soi de la nature ».
Le devenir humain de la nature
La première mise à l’épreuve de cette hypothèse dialectique consiste à l’appliquer à la question de l’humanisation de la nature comprise au sens de son devenir humain. Comment comprendre l’apparition d’un soi humain dans l’histoire de la nature ? C’est la question que pose André Stanguennec dans le premier chapitre, en précisant qu’il s’agit là d’adopter une démarche herméneutique et non une approche scientifique. Essayer de comprendre le devenir humain de la nature, c’est proposer une interprétation qui, tout en tenant compte des explications scientifiques, décrivant chacune une partie de la réalité de cette humanisation, les dépasse ou les complète en les intégrant dans une compréhension de la totalité du monde ou du « tout mondain ». Tout en montrant pourquoi tant l’idéalisme hégélien que le matérialisme marxiste échouent à proposer une telle interprétation compréhensive, l’auteur défend ainsi la thèse de la « dialectique réflexive[2] » qui présente l’apparition d’un soi humain comme le fruit du dépassement des contradictions internes qui caractérisent le développement historique de la nature.
C’est à partir des travaux qui approchent le devenir de la nature en termes d’évolution systémique – Ludwig von Bertalanffy[3], Gilbert Simondon[4], Francisco Varela[5] – que l’auteur formule l’hypothèse qu’une même « interprétation régulatrice globale de nature dialectique » permet de comprendre tout à la fois le développement processuel de la nature (phusis) et, dans la continuité, la transition de la nature à la culture, du systémique naturel au systématique humain. Le cœur de cette hypothèse est que la dialectique processuelle de la nature met aux prises deux forces ou deux « dimensions fonctionnelles contradictoires et complémentaires » (p. 33) : l’une d’ordre ou de liaison, l’autre de désordre ou de déliaison. C’est cette première dimension qu’André Stanguennec décrit comme une forme de réflexivité que l’on trouve déjà à l’œuvre dans les systèmes naturels et qui le conduit à parler d’un soi de la nature. Suivant cette hypothèse, l’évolution est désormais comprise comme un processus continué de « dépassement régulateur constitutif » des systèmes naturels. Au gré de cette succession de déstabilisation et de régulations, les systèmes se complexifient, le soi naturel évolue vers des modes de fonctionnement supérieurs. C’est ainsi qu’apparaissent les systèmes vivants cellulaires et qu’émerge, ensuite, un soi ou un sujet humain qui serait donc un « mode supérieur du soi “systémique” » naturel.
Il faut, toutefois, en dire plus sur ce moment crucial de la dialectique réflexive qui permet de comprendre la transition entre le naturel et le culturel, l’apparition d’un soi non plus simplement « systémique », mais aussi « systématique », au sens où il est désormais capable, grâce au langage symbolique, de comprendre le monde dans sa totalité. Dans cette optique, André Stanguennec repart de l’hypothèse développée par Louis Bolk de la néoténie humaine et montre comment cette idée de l’indétermination instinctuelle de l’espèce humaine, reprise plus tard par Peter Sloterdijk[6], s’intègre au cadre interprétatif de la dialectique réflexive. Le devenir humain de la nature est ainsi pensé comme l’auto-dépassement réflexif d’un échec de l’évolution biologique.
Le deuxième chapitre de l’ouvrage s’intéresse de façon plus précise au rôle constitutif, pour le soi humain, de l’accès à la fonction symbolique. Dépassant la négativité d’un soi devenu indéterminé, le sujet se constitue dans le langage symbolique, qui se distingue précisément de la fonction sémiotique animale en ce qu’il est corrélé à la liberté de choix qu’ouvre cette indétermination et qu’il se détache de l’expression des besoins et des affects physiologiques. Parce que l’homme se caractérise par un déficit instinctuel, parce qu’il est un « animal malade[7] », il lui faut dire le monde dans sa totalité et lui donner sens. Cette constitution langagière définit un nouveau niveau de systématicité qui, s’il est bien en continuité avec l’évolution systémique de la nature, est aussi celui de l’accès à un mode de régulation qui échappe à la seule régulation fonctionnelle des systèmes, celui du « “sens” comme signification de la société et comme monde sensé ». Cela conduit l’auteur sur le terrain de l’analyse du phénomène social sur lequel il défend, à la suite de Jürgen Habermas[8] et contre le holisme systémique de Niklas Luhmann[9], l’idée qu’une rationalité communicationnelle est susceptible de s’opposer à la rationalité instrumentale du système. La société est un système génétiquement ouvert, c’est-à-dire qu’il peut être transformé par les individus-membres de ce système qui possèdent une « capacité de négation transformatrice ». Avec la transition de la nature à la culture s’ouvre ainsi une dialectique de l’intersubjectif et du systémique global.
L’accès à la fonction symbolique est aussi ce moment de la dialectique où le soi peut se retourner sur le processus qui a conduit à son apparition et s’interroger sur son sens : l’homme est-il la fin de l’évolution naturelle ? C’est ce principe anthropique que discute André Stanguennec en conclusion de la première partie, en commençant par décrire les différentes formes qu’il peut prendre. On peut décrire, en premier lieu, une forme faible de la thèse qui affirme que si l’homme est la raison de connaître l’univers – puisque sans l’homme, la science de l’univers serait elle-même impossible –, il n’est pas la raison d’être de l’univers naturel. Autrement dit, l’homme serait une « résultante évolutive » qui aurait pu ne pas exister. C’est à cette idée que s’oppose la forme forte du principe anthropique, qui affirme, au contraire, que l’homme est le produit d’une cause finale présente dans l’univers naturel. L’auteur va montrer comment l’hypothèse compréhensive qu’il a développée précédemment le rapproche d’une version non théologique ou cosmologique de cette forme forte. Il défend, en effet, l’idée selon laquelle le devenir humain de la nature n’est ni le simple produit d’un mécanisme adaptatif ou du hasard, ni l’aboutissement d’un dessein naturel conçu par un créateur divin, mais plutôt le résultat d’une finalité immanente à la nature. Cette forme de finalité minimale est une « tendance à la totalisation, à la complexification maximale des contenus de l’univers » (p. 67) qui oriente le processus de l’évolution naturelle et qui a produit l’homme.
L’humanisation technique de la nature
Le deuxième volet de l’humanisation de la nature que se propose d’étudier André Stanguennec renvoie à une signification sans doute plus intuitive de l’expression qui donne son titre à l’ouvrage, puisqu’il concerne la transformation technique de la nature. Soulignant les liens qui existent entre le logos et la technè, et rappelant après Bergson que la technique autant que le langage définit l’homme, l’auteur met en place la problématique qui sera celle de l’ensemble de cette deuxième partie. Comment la technique peut-elle être à la fois cette « humanisation continuée de la nature », cette médiation par laquelle l’homme s’approprie la nature et se constitue et, en même temps, être la source d’une aliénation de l’homme et, au fond, d’une déshumanisation ? Stanguennec analyse successivement les réponses à ce paradoxe proposées par Bergson, Heidegger et Marx, avant de proposer sa propre solution.
Pour Bergson, cette négativité de la technique est avant tout un problème d’orientation. Dans sa critique du machinisme, le philosophe dénonce la « frénésie » de valeurs matérielles qui habite les hommes et les a conduits à tourner la technique tout entière vers la maîtrise de la matière. Pour remédier à cette technicisation excessive de la nature qui conduit à une déshumanisation et à une dénaturation de l’âme, Bergson en appelle précisément à un « supplément d’âme », à une transcendance spirituelle. Pour sortir de ce rapport aliénant, il faut un nouveau mysticisme qui réinstaure le primat des valeurs spirituelles sur les valeurs matérielles et réoriente la technique, non plus vers la maîtrise de la matière, mais vers celle des expériences spirituelles. À cet appel en faveur d’une « surhumanisation spirituelle de la nature » (p. 83), l’auteur objecte que ce nouveau mysticisme, d’une part, est pour le moins protéiforme et que, d’autre part, il incite à une forme de conservatisme en plaçant les hommes dans une situation d’attente à l’égard des hypothétiques développements de la « science psychique ».
L’auteur analyse ensuite la critique heideggerienne de l’humanisation technique de la nature à l’époque contemporaine. Il montre à cette occasion que si elle diffère de celle que mena Bergson, notamment du point de vue de sa plus grande « radicalité ontologique », elle se heurte à des difficultés assez similaires. Heidegger déplore la perte d’un équilibre que l’on trouvait encore chez les Grecs entre deux formes de techniques : la technè épistémique et la technè poétique. Pour le philosophe allemand, l’histoire de la métaphysique du sujet est aussi celle de la réduction anthropologique de la technique, cette dernière n’étant plus dès lors qu’au service de la domination instrumentale de la nature. Soulignant le « préjugé continuiste » (p. 93) qui sous-tend cette histoire de la pensée dressée contre la volonté subjective, Stanguennec montre qu’en définitive Heidegger nous invite, lui aussi, à attendre un salut qui ne pourrait venir que d’une transcendance, cette fois, ontologique.
C’est qu’il manque, en réalité, tant chez Bergson que chez Heidegger une pensée des rapports sociaux de production où s’inscrit la technique, ce que l’auteur va rechercher dans l’analyse marxiste de l’aliénation sociale du travailleur. Contre une interprétation naturaliste qui puise dans les écrits du jeune Marx et chez Spinoza pour penser l’aliénation en tant que perte des rapports de production naturels[10], André Stanguennec soutient que Marx a développé une compréhension dialectique du traitement de la question de l’aliénation, soulignant que, s’il prend le contre-pied de Hegel, c’est pour « remettre sur ses pieds » la méthode dialectique, non en sortir. Pour Marx, le travailleur aliéné serait un sujet dont l’autonomie a été niée par l’instauration du mode de production capitaliste et qui sera restaurée par le dépassement de cette négation, auquel mèneront nécessairement les contradictions internes du capitalisme. Analysant cette voie marxiste de la désaliénation, l’auteur met en avant la façon dont elle ne remet pas véritablement en cause les « acquêts du capitalisme » (p. 109) concernant l’humanisation technique de la nature, à savoir la productivité et la croissance indéfinies. La critique marxiste de l’aliénation manquerait le fait que le capitalisme n’instaure pas simplement l’exploitation de l’homme par l’homme, mais aussi celle de la nature par l’homme. De ce point de vue, il nous semble qu’il aurait été intéressant de prolonger la discussion de la veine naturaliste écartée par l’auteur pour se demander dans quelle mesure elle permettait de remédier à cet oubli supposé de la question écologique par le marxisme.
De la sorte pour André Stanguennec, si Bergson et Heidegger pêchaient par excès de transcendance dans leur description de la sortie d’une humanisation technique de la nature, devenue problématique, l’analyse de Marx est trop immanente quand il affirme que l’instauration de la société communiste permettra le dépassement de l’expression de l’infinité des désirs singuliers qui conduit à l’exploitation de la nature. De ce point de vue, l’auteur maintient la nécessité d’une « transcendance juridique et dialogique de soi dans l’immanence d’une société civile demeurant conflictuelle » (p. 111), celle de l’État républicain qui limite les intérêts réciproques des individus par la loi. C’est dans ce sens qu’il va se tourner vers la question de la légalisation juridique de nos rapports à la nature, ainsi qu’à celle de leur dimension morale.
L’humanisation morale et juridique de la nature
Après avoir mis en évidence le contresens que représente la lecture de Darwin faite par Spencer et le darwinisme social, André Stanguennec propose une interprétation dialectique de l’émergence de la morale au cours de l’évolution de la nature. Comme le soutient Patrick Tort[11], la moralité doit plutôt être comprise à partir des travaux de Darwin comme un « effet réversif » de l’évolution, au sens où cette dernière a produit avec la morale un mode de régulation susceptible de s’opposer précisément à la régulation par la sélection naturelle. Il reste cependant à comprendre comment l’on est passé de ces mécanismes de régulation naturels à la normativité morale. L’auteur renoue ici avec la question du passage de la nature à la culture déjà analysé dans la première partie. Réaffirmant à cette occasion que ni le matérialisme darwinien, ni une thèse radicalement discontinuiste n’offrent de cadre interprétatif satisfaisant, il défend l’idée qu’une compréhension dialectique de la relation de continuité-discontinuité entre la nature et la culture ou la morale s’impose. Cette hypothèse conduit à penser qu’il y aurait une forme de téléologie pré-humaine ou pré-morale dans la nature. C’est muni de cette hypothèse que l’auteur se tourne vers la philosophie de Hans Jonas.
Si l’éthique de la responsabilité jonassienne[12] semble, en effet, permettre de penser l’humanisation morale de la nature dans le cadre interprétatif ouvert au chapitre précédent, Stanguennec montre qu’en réalité, par défaut d’anthropologie, l’ontologie biologique de Jonas ne permet pas véritablement de fonder une morale des relations de l’homme à la nature. Parce qu’il ne précise pas la façon dont les devoirs à l’égard des humains se distinguent en même temps qu’ils prolongent les devoirs à l’égard de la vie biologique, pas plus qu’il ne nous renseigne sur la signification précise de la vie authentiquement humaine, Jonas ne nous donnerait pas les ressources normatives susceptibles de guider la limitation de l’humanisation technique de la nature qu’il appelle pourtant de ses vœux. Pour Stanguennec, il faut compléter ce néofinalisme jonassien par une éthique de la discussion soucieuse de la mise en œuvre des conditions réelles d’accès à la discussion sur la limitation des techniques[13].
Dans un dernier chapitre, l’auteur s’intéresse à ce qu’il décrit comme la forme la plus extrême de l’humanisation morale de la nature, mais qui témoigne aussi paradoxalement de la volonté de mettre au jour une moralité qui ne se réfère pas exclusivement à l’humain, à savoir l’ensemble des théories très diverses, ici abordées conjointement, qui se proposent de reconnaître les droits ou la valeur morale de la nature ou des animaux. C’est, en premier lieu, l’hypothèse du contrat naturel de Michel Serres[14] qui est analysée. Après avoir soulevé des difficultés théoriques concernant, d’une part, la possibilité de définir une véritable subjectivité naturelle et, d’autre part, d’envisager les rapports entre les hommes et la nature sous l’angle de la réciprocité, André Stanguennec décrit la façon dont elle lui semble remobiliser, tout comme le courant de la deep ecology, la conception ancienne de la Mère-Nature. Suivant la lecture critique de Luc Ferry, tant le contrat naturel que la deep ecology ou les théories du droit animal sont renvoyés globalement à une forme de sacralisation de la nature incapable de dépasser les contradictions pratiques et théoriques qu’elle rencontrerait nécessairement. L’auteur conclut en argumentant en faveur du développement d’un « anthropocentrisme réflexif » (p. 160), qui reconnaît l’existence de droits et de devoirs moraux indirects à l’égard des animaux et s’applique à transformer notre communauté vitale avec la nature en communauté morale.
Ce dernier chapitre peut quelque peu décevoir le lecteur qui attendait, dans ce volet moral de l’humanisation de la nature, une analyse de l’éthique environnementale, l’argumentation ne nous semblant pas véritablement faire droit à la richesse et à la diversité des théories développées au sein de ce courant[15]. Il vient néanmoins clore avec cohérence un ouvrage entièrement traversé par l’idée de penser ensemble « l’unité de la continuité et de la rupture entre l’homme et la nature » (p. 164).
[1] André Stanguennec, Les Horreurs du monde, Paris, Les Éditions de la MSH, 2014.
[2] Par « dialectique réflexive », André Stanguennec désigne la voie philosophique qu’il a ouverte dans un essai d’ontologie fondamentale du soi en trois volumes, précisément intitulé La Dialectique réflexive, (Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2006, 2008 et 2013). Réunissant Kant et Hegel, la dialectique réflexive décrit le mouvement par lequel le soi se constitue réflexivement dans le monde.
[3] Ludwig Von Bertalanffy, Théorie générale des systèmes, Paris, Dunod, 1973.
[4] Gilbert Simondon, L’individu et sa genèse physico-biologique, Paris, PUF, 1964 ; Gilbert Simondon, L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information, Grenoble, Jérôme Millon, 2005.
[5] Francisco J. Varela, Autonomie et connaissance: essai sur le vivant, Paris, Le Seuil, 1989.
[6] Peter Sloterdijk, Règles pour le parc humain suivi de La Domestication de l’être: Pour un éclaircissement de la clairière, Paris, Éditions Mille et une nuits, 2000.
[7] André Stanguennec, Le Questionnement Moral de Nietzsche, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 2005.
[8] Jürgen Habermas, Théorie de L’agir Communicationnel: Rationalité de L’agir et Rationalisation de La Société, vol. 1, trad. Jean-Marc Ferry, Paris, Fayard, 1987.
[9] Niklas Luhmann, Politique et complexité: les contributions de la théorie générale des systèmes, trad. Jacob Schmutz, Paris, Éditions du Cerf, 1999.
[10] Franck Fischbach, Sans objet: capitalisme, subjectivité, aliénation, Paris, Vrin, 2009.
[11] Patrick Tort, La Pensée hiérarchique et l’évolution: les complexes discursifs, Paris, Aubier Montaigne, 1983 ; Patrick Tort, Darwinisme et société, Paris, PUF, 1992.
[12] Jonas Hans, Le Principe Responsabilité. Une Éthique Pour La Civilisation Technologique, Paris, Éditions du Cerf, 1990.
[13] Enrique Dussel, L’Éthique de La Libération à l’ère de la mondialisation et de l’exclusion. Brève architectonique d’une éthique matérielle et critique, Paris, L’Harmattan, 2003.
[14] Michel Serres, Le Contrat Naturel, Paris, Flammarion, 1992.
[15] Voir Catherine Larrère, Les philosophies de l’environnement, Paris, PUF, 1997 ; Gérald Hess, Éthiques de la nature, Paris, PUF, 2013.