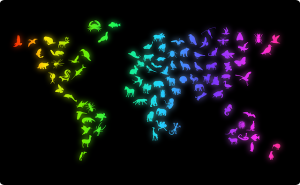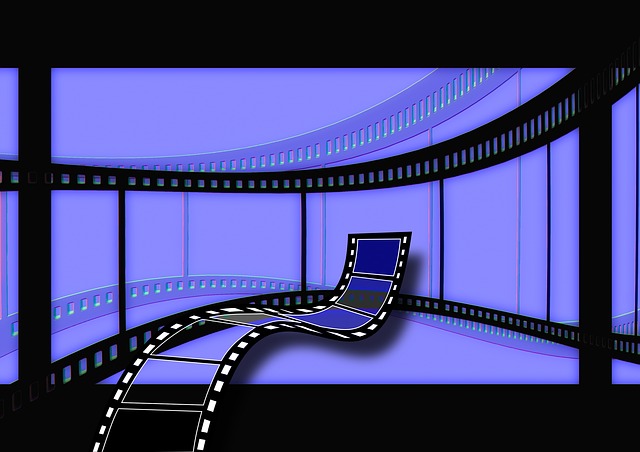L’étude du comportement animal à la lumière du concept de sympathie chez Bergson (I)
Mathieu Frerejouan, Agrégé de philosophie, professeur en lycée
Lorsque Bergson introduit le concept de sympathie dans le deuxième chapitre de L’Évolution créatrice, il le présente d’abord comme une simple hypothèse permettant d’expliquer l’instinct animal. En effet, ce dernier se comporte comme s’il connaissait l’organisme et le comportement des animaux d’une autre espèce que la sienne. Or, selon Bergson, cette connaissance ne peut s’expliquer ni comme une « habitude héréditairement transmise[1] », comme le suppose le néo-lamarckisme, ni par la « somme de différences accidentelles, conservées par la sélection[2] », comme le suppose le néo-darwinisme. Qu’elle explique l’instinct par l’habitude ou le hasard, « la science prétend résoudre complètement l’instinct soit en démarches intelligentes, soit en mécanismes construits pièce à pièce[3] », c’est-à-dire en des concepts qui sont par nature étrangers au vivant. L’insuffisance de ces explications amène alors Bergson à faire l’hypothèse d’une sympathie unissant les différentes espèces entre elles :
La connaissance instinctive qu’une espèce possède d’une autre espèce sur un certain point particulier a donc sa racine dans l’unité même de la vie, qui est, pour employer l’expression d’un philosophe ancien, un tout sympathique à lui-même[4].
Ce concept du « tout sympathique à lui-même », repris à la philosophie stoïcienne, met en avant l’idée d’une communication entre les parties de l’univers qui transcende le contact physique immédiat. Bergson reprend cette idée de sympathie universelle pour distinguer les relations entre les êtres vivants des relations entre les êtres inertes. En effet, dans la matière on ne saurait retrouver cette communication sans contact, celle-ci étant composée de parties distinctes ne communiquant que par l’intermédiaire des mouvements et des forces physiques. Au contraire, tout être vivant partage une origine commune qui se maintient entre eux, leur permettant de se connaître mutuellement de manière immédiate et interne. Le concept de sympathie se présente avant tout comme une hypothèse permettant d’expliquer la connaissance instinctive que possède un animal d’un autre.
Toutefois, le concept de sympathie ne peut être réduit à ce premier sens, qui occupe en fait une place secondaire dans l’oeuvre et la philosophie de Bergson. L’analyse que propose l’auteur de la sympathie ne révèle sa portée et son intérêt que lorsqu’il passe de l’instinct comme objet de science à l’instinct comme mode de connaissance. En effet, si le mode d’être de l’animal ne peut se réduire à des relations physiques avec son environnement, alors la manière dont l’animal doit être connu ne peut davantage se limiter à une observation extérieure ou à une analyse purement intellectuelle. Ce passage de la sympathie comme particularité de l’instinct à la sympathie comme mode de connaissance, et ses conséquences, apparaît notamment lorsque l’auteur compare la relation de l’animal à l’animal avec la relation du scientifique à l’animal. Pour Bergson, la connaissance que possède le Sphex de la Chenille, ne saurait se confondre avec celle de l’entomologiste qui « connaît la Chenille, comme il connaît tout le reste des choses, c’est-à-dire du dehors[5] », mais doit être comprise comme « une sympathie (au sens étymologique du mot) qui le renseignât du dedans, pour ainsi dire, sur la vulnérabilité de la Chenille.[6] » Ce qui est mis en avant dans cette comparaison entre le point de vue du scientifique et celui de l’animal ce n’est pas tant le lien métaphysique, qui reste sous-jacent, mais l’opposition entre un point de vue extérieur et intellectualisé, et un point de vue intérieur et vécu. C’est pourquoi, en définissant l’instinct comme sympathie, Bergson ne se contente pas de repenser la nature de ce dernier, il met aussi en évidence un autre mode de connaissance. Plus encore, dans la mesure où la sympathie désigne à la fois le mode d’être de l’animal et un mode de connaissance, celle-ci se présente comme une méthode dont nous ne saurions nous passer pour comprendre l’instinct animal. C’est pour cette raison que Bergson peut conclure que « l’explication concrète[7] » de l’instinct, « doit être cherchée dans une tout autre voie, non plus dans la direction de l’intelligence, mais dans celle de la sympathie[8]. »
L’intérêt de cette analyse de la sympathie comme mode de connaissance (et non plus comme simple explication de l’instinct) est qu’elle va à l’encontre de l’épistémologie classique des sciences du comportement animal. Bergson remet d’abord en question la manière dont la science définit l’animal. Pour lui, ce dernier ne se limite plus à un corps dont la physiologie est la seule science possible. En évoquant la possibilité d’une connaissance interne, Bergson intègre le psychisme animal dans le champ de la science, lequel a longtemps été rejeté, soit par crainte de l’anthropomorphisme, soit par négation pure et simple de l’existence d’un tel objet. Mais ce n’est pas seulement la délimitation du champ scientifique qui est remise en question par l’auteur, c’est aussi sa méthode. En effet, en critiquant le point de vue extérieur et intellectualisé que l’homme peut être tenté d’adopter face à l’animal, il montre les limites d’une science qui se limite à ce qui est immédiatement visible. Le concept de sympathie implique ainsi non seulement de redéfinir ce qu’est l’animal pour le scientifique, mais la méthode qui doit permettre à ce dernier de le connaître.
Toutefois, notre but ne sera pas simplement de souligner les conflits qui peuvent exister entre le concept bergsonien de sympathie et les sciences du comportement animal. En effet, une telle opposition ne rend justice ni à la philosophie de l’auteur, qui ne se réduit pas à une métaphysique étrangère à toute science positive, ni aux sciences du comportement animal, dont l’épistémologie diverse et parfois conflictuelle a su intégrer la possibilité d’une sympathie entre l’observateur et l’animal. Il s’agira plutôt pour nous de voir comment l’analyse bergsonienne peut mettre en évidence les limites d’une certaine épistémologie, encore présente aujourd’hui dans les sciences du comportement animal, et comment celles-ci intègrent et prolongent parfois le concept de sympathie en l’insérant dans une pratique effective de la science.
Le rejet de l’intériorité par l’épistémologie béhavioriste.
La question de savoir si celui qui étudie le comportement de l’animal peut et doit sympathiser avec l’animal observé est loin de faire consensus. Toute méthode impliquant une forme de sympathie, comme toute référence à la subjectivité animale, éveille en effet souvent la crainte d’une forme d’anthropomorphisme. L’origine de cette crainte, et de l’interdit qui pèse sur toute forme de sympathie entre l’humain observant et l’animal observé, peut être trouvée dans la psychologie béhavioriste de John Watson, qui a posé les bases de l’épistémologie de la psychologie animale. De fait, si celle-ci a fait l’objet de nombreuses critiques il n’en reste pas moins que le rejet de toute question relative à la subjectivité animale vient parfois de vestiges non reconnus du béhaviorisme. Le projet central de Watson est de faire de la psychologie une science naturelle, c’est-à-dire une science expérimentale. L’un des principaux présupposés du béhaviorisme est qu’une discipline ne peut prétendre à une forme de légitimité scientifique qu’à condition d’imiter les pratiques expérimentales des sciences naturelles :
La technique expérimentale, l’accumulation de faits réalisée grâce à elle, la tentative occasionnelle de regrouper ces faits dans une théorie et des hypothèses, tels sont nos procédés scientifiques. Jugé sur ces bases, le behaviorisme est une véritable science naturelle[9].
Si la psychologie, qu’elle concerne l’homme ou l’animal, veut prétendre à une forme de scientificité elle doit donc parvenir à soumettre son objet à la technique expérimentale. Pour lui conférer ce statut, Watson pose alors une règle fondamentale :
La règle, ou le principe, que le béhavioriste a toujours en face de lui est la suivante : puis-je décrire cette séquence de comportement que j’observe en termes de « stimulus et réponse » ?[10]
La raison de cette règle est que le « stimulus », c’est-à-dire l’excitation externe sentie par l’organisme, comme la « réponse », c’est-à-dire la réaction physiologique à cette excitation, sont des objets qui peuvent être directement observés, et dont l’intensité peut être mesurée. Concevoir le comportement en termes de « stimulus et réponse » c’est donc s’assurer que l’objet étudié peut faire l’objet de prédictions quantifiables et directement vérifiables. Par ce biais, Watson pose les conditions nécessaires à la constitution d’une étude expérimentale du comportement. Toutefois, pour que cette règle soit légitime il faut de plus supposer que tout comportement est de fait une réponse à un stimulus observable. En effet, si la cause des actions de l’animal se trouve dans des états mentaux internes ou dans des mécanismes innés, c’est pour Watson la possibilité même d’une science expérimentale qui est remise en cause. C’est pourquoi une autre règle fondamentale du béhaviorisme est que tout comportement résulte d’un apprentissage, c’est-à-dire de l’association par conditionnement d’un stimulus et d’une réponse.
Or, si une approche scientifique du comportement implique de se restreindre à ce qui est directement observable et quantifiable, alors tout ce qui relève de l’intériorité même du sujet doit être considéré comme se trouvant hors du champ de la science. C’est pourquoi Watson pose comme autre règle le rejet de tout ce qui relève de la subjectivité, au profit de ce qui est extérieur et quantifiable :
Afin de rendre homogènes le sujet et les méthodes, le behavioriste (…) élimina du vocabulaire scientifique tous les termes subjectifs tels que sensation, perception, image, désir, intention, et même pensée et émotion[11].
Ce rejet concerne avant tout la méthode introspectionniste, qui prétendait accéder à une connaissance des états mentaux humains par une observation du sujet par lui-même. Toutefois, ce rejet concerne aussi, par voie de conséquence, la connaissance par sympathie des états mentaux de l’animal. En effet, dans la mesure où nous ne pouvons observer directement les états mentaux d’un sujet extérieur, ce n’est que par analogie avec notre propre expérience que nous pouvons y accéder, de sorte que l’introspection reste le point de départ de sa connaissance. Cependant, l’explication du comportement animal à partir de nos états mentaux constitue alors, pour le béhavioriste, une double illusion. La première illusion est celle de l’anthropomorphisme, qui repose sur la projection d’états mentaux proprement humains sur des états mentaux différents par nature des nôtres. A celle-ci s’ajoute le fait que, quand bien même ces états mentaux seraient identiques aux nôtres, la connaissance que nous avons des nôtres par introspection relève déjà de l’illusion et d’une démarche qui ne respecte pas une méthodologie proprement scientifique. Ainsi, le rejet de toute forme de sympathie entre le psychologue et l’animal par Watson ne repose pas sur un simple principe de prudence, mais a son origine dans les principes les plus fondamentaux de l’épistémologie béhavioriste.
Anthropomorphisme et anthropocentrisme.
Si nous nous tournons maintenant vers l’analyse que propose Bergson de l’étude du comportement animal, nous observons tout d’abord que la question ne saurait se limiter à une simple opposition entre observation extérieure et sympathie. En réalité, Bergson n’est amené à s’interroger sur la légitimité de la sympathie, qu’après avoir observé les limites d’une connaissance du comportement animal qui réduit celui-ci à un ensemble de réflexes observables extérieurement. En effet, si la sympathie entre l’observateur et l’animal observé présente bien un risque d’anthropomorphisme, de manière symétrique la réduction du comportement animal à un réflexe conditionné tend à faire de l’intelligence humaine la mesure de l’animal, et de ce fait tombe dans l’illusion de l’anthropocentrisme. En d’autres termes, c’est en voulant désinvestir l’animal de tout ce qui nous semble anthropomorphique (ses états mentaux, ses émotions) que l’on aboutit à adopter un point de vue anthropocentré.
La raison de cette illusion, selon Bergson, s’explique par le fait que la décomposition du comportement en stimuli et réponses, ainsi que sa transposition en des termes observables et quantifiables, revient à « résoudre complètement l’instinct (…) en mécanismes construits pièce à pièce, comme ceux que combine notre intelligence[12]. » Ce que Bergson entend ici par mécanisme c’est tout processus qui peut se reproduire à l’identique, qui peut être mesuré et qui est réversible. Or, de fait, la conceptualisation du comportement animal en l’enchaînement d’un « stimulus » et d’une « réponse » en des termes prévisibles et mesurables confère à ce dernier toutes les caractéristiques d’un mécanisme. Certes, si l’on en reste à cette observation de Bergson, celle-ci ne fait que répéter le projet conscient et délibéré de Watson : retenir du comportement ce qui peut se prêter à des prévisions vérifiables par l’expérimentation, et donc retenir de ce dernier ce qui est prévisible, reproductible et mesurable. Mais, cette conception, selon Bergson, ne possède pas une entière légitimité car elle propose « à défaut d’une analyse réelle de l’objet, une traduction de cet objet en termes d’intelligence[13]. » Toute la question est alors de savoir pourquoi, selon ce dernier, traduire l’instinct en des termes proprement intelligibles n’équivaut pas à une connaissance réelle de l’instinct.
Une des thèses centrales de L’Évolution créatrice est sa critique de l’intelligence d’ordinaire entendue comme faculté destinée à une connaissance purement théorique du monde. Ce présupposé implique en effet que chacune des catégories propres à l’intelligence est adaptée, de manière a priori, aux objets qu’elle doit connaître. Or, comme le rappelle l’auteur, l’intelligence comme toute faculté et comme tout organe propre au vivant est le résultat d’un développement qui a pour seule finalité[14] d’agir sur son environnement, et non de le connaître. Par conséquent, les catégories de l’intelligence ne sont pas a priori conformes au monde qui nous entoure, mais uniquement à ce sur quoi nous devons agir. Ainsi, selon Bergson :
Si nous pouvions nous dépouiller de tout orgueil, si, pour définir notre espèce, nous nous en tenions strictement à ce que l’histoire et la préhistoire nous présentent comme la caractéristique constante de l’homme et de l’intelligence, nous ne dirions peut-être pas Homo sapiens, mais Homo faber. En définitive, l’intelligence, envisagée dans ce qui en paraît être la démarche originelle, est la faculté de fabriquer des objets artificiels, en particulier des outils à faire des outils et, d’en varier indéfiniment la fabrication[15].
La fonction première de l’intelligence n’étant pas la connaissance, au sens désintéressée du terme (ce qu’implique la caractérisation de l’homme comme Homo sapiens), mais la fabrication, ses catégories et son fonctionnement doivent être interprétés relativement à l’acte même de fabriquer et à la matière qui permet cet acte. C’est pourquoi l’intelligence, selon Bergson, tend naturellement à interpréter tout ce qui l’entoure dans une perspective mécaniste : il s’agit pour elle de retenir uniquement ce qui peut participer à la fabrication d’outils.
Cette redéfinition de l’intelligence a des conséquences profondes sur l’épistémologie, et dans notre cas sur l’épistémologie de l’étude du comportement animal. En effet, le choix de ne retenir du comportement animal que ce qui est extérieur, mesurable, prévisible, ne peut plus être considéré ni comme un choix neutre ni comme une garantie de connaissance. Au contraire, cela revient à traduire le comportement en des termes qui sont conformes à notre intelligence, sans s’interroger au préalable sur la conformité de celle-ci à son objet. Ainsi, le béhaviorisme ne pose pas les conditions permettant la connaissance de l’instinct, il impose au contraire à l’instinct des exigences qui réduisent celui-ci à l’image qu’il se fait de la science.
Cette réduction de l’objet aux attentes du sujet, propre à l’épistémologie béhavioriste, apparaît de manière claire dans un article de John Watson sur le rôle des sensations kinesthésiques du rat lors de son orientation dans un labyrinthe[16]. L’hypothèse de ce dernier est que pour s’orienter le rat ne fait usage que des sensations liées au corps et à ses mouvements, de sorte que la vue, l’odorat ou l’ouïe ne jouent aucun rôle direct. Pour mettre à l’épreuve son hypothèse Watson décide de neutraliser les autres sens de l’animal en lui retirant les yeux, le bulbe olfactif et les vibrisses. A la suite de cette opération il observe que l’animal cesse de se déplacer, et décide donc de l’affamer afin de le contraindre à se déplacer dans le labyrinthe. Une fois ces conditions expérimentales mises en œuvre, l’auteur observe que le rat « commença à ce moment à apprendre le labyrinthe et finalement devient l’automate habituel[17] », confirmant ainsi son hypothèse initiale. Face à cette expérimentation on peut se demander si l’auteur propose véritablement une analyse du comportement d’orientation du rat, ou ne créé pas au contraire des conditions expérimentales telles que le comportement corresponde à ses propres présupposés épistémologiques. Si de fait le rat se comporte de manière mécanique, répondant immédiatement à un stimulus (la faim) et s’orientant à partir d’un stimulus unique (les sensations kinesthésiques), on peut se demander si l’objet observé est encore à proprement parler l’animal étudié. Si l’on interprète cette expérience à la lumière de la conception bergsonienne de l’intelligence, il apparaît clairement que Watson a neutralisé tout ce qui dans le comportement ne pouvait être réduit à un mécanisme prévisible et reproductible, afin de faire du rat un « automate ». L’objet étudié n’est plus un être vivant à part entière, dont le comportement refusait de confirmer directement l’hypothèse initiale du psychologue, mais un mécanisme adapté aux présupposés épistémologiques du béhaviorisme et aux catégories de notre intelligence.
Cette critique opérée par Bergson de toute réduction du comportement à un réflexe mécanique se retrouve chez d’autres penseurs et scientifiques abordant la question du comportement animal, et consiste simplement à dénoncer le réductionnisme qui est à l’œuvre dans l’épistémologie béhavioriste. Toutefois, la critique bergsonienne va en un sens plus loin encore. Elle montre que cette réduction de l’instinct animal à un mécanisme a elle-même pour origine une forme d’anthropocentrisme. En effet, l’intelligence n’est pas seulement un produit de l’évolution, mais elle est aussi une faculté propre à l’espèce humaine. Par suite, réduire le comportement animal aux catégories de notre propre intelligence ce n’est pas seulement le réduire à un seul de ses aspects, c’est aussi projeter sur ce dernier des critères proprement humain. Comme le rappelle Bergson la réduction du vivant aux catégories de l’intelligence ne peut se faire que dans une perspective finaliste où l’homme apparaît comme la fin et l’achèvement de l’évolution :
Si notre biologie en était encore à Aristote, si elle tenait la série des êtres vivants pour unilinéaire, si elle nous montrait la vie tout entière évoluant vers l’intelligence et passant, pour cela, par la sensibilité et l’instinct, nous aurions le droit, nous, êtres intelligents, de nous retourner vers les manifestations antérieures et par conséquent inférieures de la vie, et de prétendre les faire tenir, sans les déformer, dans les cadres de notre intelligence. Mais un des résultats les plus clairs de la biologie a été de montrer que l’évolution s’est faite selon des lignes divergentes[18].
Sans se référer explicitement à l’œuvre d’Aristote, mais plutôt à la tradition philosophique qui en est issue, Bergson rappelle ici que la connaissance du vivant par l’intellect n’est cohérente que dans une perspective finaliste. En effet, si l’on considère que le vivant est organisé de manière hiérarchique, de sorte que la vie animale contient la vie végétale, et est elle-même contenue par la vie humaine, alors l’ensemble du vivant peut être connu rétrospectivement par l’homme. En d’autres termes, l’intelligence étant le but et l’achèvement du vivant, elle contient potentiellement en elle chacune des étapes précédentes et est donc adaptée à son objet. C’est pourquoi, selon Bergson, le passage d’une biologie aristotélicienne à une biologie évolutive et non hiérarchique ne change pas seulement l’objet de la biologie, elle en change de manière constitutive l’épistémologie. En effet, si l’intelligence n’est plus la fin de l’évolution, mais seulement une de ses branches, il n’y a plus d’homogénéité entre la faculté et son objet. Les catégories de l’intelligence humaine ne pouvant plus être considérées comme a priori conformes au reste du vivant, toute traduction de la vie en des termes intelligibles aboutit alors à une forme d’anthropocentrisme.
Ainsi, la conséquence de cette inscription de l’intelligence humaine dans une évolution non hiérarchisée du vivant est de mettre en évidence le paradoxe qui sous-tend l’épistémologie béhavioriste. En voulant rejeter hors du champ scientifique tout ce qui relève de l’anthropomorphisme, elle aboutit à réduire l’animal à l’image que s’en fait l’intelligence humaine, et tombe par là dans l’illusion de l’anthropocentrisme. Faire du comportement animal un mécanisme empêche peut-être toute projection d’émotions ou d’intentions proprement humaines, mais cela revient aussi à faire des cadres de l’intelligence humaine un a priori auquel le comportement animal devrait se rapporter et se conformer. La conséquence de cette inversion est que ce n’est pas seulement la critique du béhaviorisme du concept de sympathie qui perd son fondement épistémologique, c’est aussi la sympathie comme point de vue non anthropocentré sur l’animal qui devient nécessaire. En effet, ce n’est qu’en quittant le point de vue de l’intelligence humaine pour celui qui est propre à l’animal, en sympathisant avec ce dernier, que l’on peut se libérer de l’anthropocentrisme. Toute la question est alors de savoir si la compréhension du comportement animal à partir de la sympathie revient à sortir du cadre propre à la science, ou s’il s’agit seulement d’en repenser la pratique.
[1] Henri Bergson, L’Évolution créatrice, Paris, Puf, 2007, p.170, 1941.
[2] Ibid., p.169.
[3] Ibid., p.175.
[4] Ibid., p.168.
[5] Ibid., p.174.
[6] Ibid., p.175.
[7] Ibid., p.177.
[8] Id.
[9] John Watson, Le béhaviorisme, Paris, CEPL, 1972, p.21, 1924.
[10] Ibid., p.13.
[11] Id.
[12] Henri Bergson, L’Évolution créatrice, Op.Cit, p.175.
[13] Id.
[14] La conception bergsonienne de la finalité n’a pas besoin d’être interrogée ici dans la mesure où il s’agit seulement d’affirmer ici que la fonction de l’intelligence doit se comprendre en fonction de l’environnement sur lequel elle agit, ce que toute pensée qui biologise l’intelligence reconnaît, quel que soit le cadre théorique auquel elle appartient.
[15] Henri Bergson, L’Évolution créatrice, Op.Cit, p.140.
[16] John Watson, Kinaesthetic and Organic Sensations :Their Role in the Reaction in the White Rat in the Maze, Psychological Bulletin, Vol 4(9), Sep 1907, p.306. Pour une analyse plus complète de l’article et des rapports entre le psychologue et l’animal, voir Vinciane Despret, Penser comme un rat, Versailles, Quae, 2009, p.23.
[17] Nous nous appuyons sur la traduction que propose Vinciane Despret de cet extrait dans Penser comme un rat, Op.Cit, p.23.
[18] Henri Bergson, L’Évolution créatrice, Op.Cit, p.176.