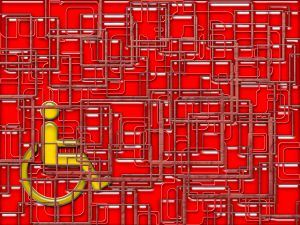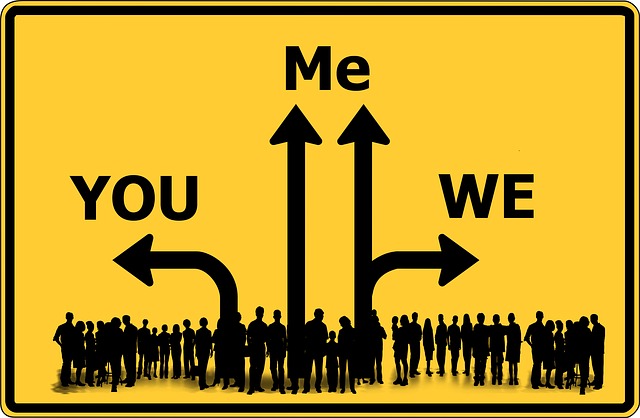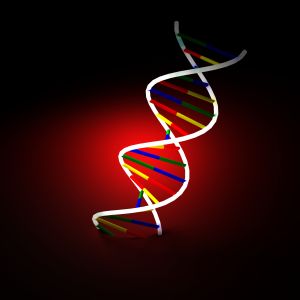L’éthique clinique comme expérience de démocratie
Véronique Fournier – Directrice du Centre d’éthique clinique de l’hôpital Cochin
Ce jour-là, l’histoire était la suivante (1). Une femme de 45 ans, s’était soudain retrouvée hospitalisée, non pas du fait qu’elle soit tombée malade, mais parce que sa mère avec qui elle vivait jusque là était morte brutalement. La fille avait été retrouvée seule chez elle, en fauteuil roulant, incapable d’expliquer son état et n’ayant visiblement pas les moyens de s’assumer au quotidien sans aide. Personne ne la connaissait, il n’y avait aucune famille, pas de proches, pas de voisins, pas même un médecin traitant qui l’aurait connue. Le gardien de l’immeuble ne savait d’elle que deux choses : son état moteur s’était aggravé progressivement, elle marchait encore 4 ou 5 ans auparavant, depuis 2 ans il lui fallait une canne pour se déplacer et cela ne faisait que quelques mois qu’elle ne se mouvait plus qu’en fauteuil roulant. Quant à sa capacité de communication, elle avait toujours été rudimentaire, disait-il ; et la mère lui aurait confié que sa fille souffrait de lourds problèmes psychiatriques.
L’hôpital avait été le premier recours. Faute de place dans le service de psychiatrie du secteur, la patiente s’était retrouvée hospitalisée en médecine. En bons professionnels, les médecins en charge en avaient profité pour faire le point global de son état. Ils s’étaient attachés à comprendre pourquoi elle ne marchait plus. Elle avait, disaient-ils, une maladie d’évolution progressive qui comprimait lentement la moelle épinière au niveau cervical. Si on laissait les choses aller, elle deviendrait tétraplégique. Ils proposaient une intervention chirurgicale pour dégager le canal médullaire et tenter d’enrayer cette évolution défavorable. Mais ils n’arrivaient pas à savoir ce qu’en pensait la patiente et s’inquiétaient de l’opérer sans son consentement. Fallait-il surseoir à toute intervention du fait qu’elle n’était pas capable de consentement éclairé ? Ou fallait-il l’opérer pour son bien présumé et prendre la décision pour elle, voire contre elle, car ils la sentaient plutôt réticente à l’idée d’une intervention. Mais avait-elle bien compris tous les enjeux de la décision ? Quant au psychiatre, appelé à la rescousse, il avait confirmé qu’elle était probablement profondément psychotique, et depuis longtemps, mais calme et ne nécessitant ni soins ni traitements psychiatriques particuliers. Poussé dans ses retranchements, il ne semblait pas très favorable à l’opération : « Respectons le peu qu’elle exprime », disait-il. L’argument ne convainquait pas les médecins. Ils l’estimaient un peu mou. Qu’en pensait le Centre d’éthique clinique ?
Le Centre d’éthique clinique est un service de l’hôpital Cochin à Paris, qui propose ce que l’on appelle classiquement une « consultation d’éthique clinique » (2). L’idée est d’offrir à ceux qui en ressentent le besoin : patients, proches, équipes soignantes, une aide et un accompagnement à la réflexion en cas de décision médicale difficile à prendre sur le plan éthique, car soulevant un conflit de valeurs. Le concept est né outre-Atlantique, à la fin des années 1970 (3). Sa transposition pour la première fois en France, à Cochin en 2002, s’est faite à partir du modèle développé par Mark Siegler au Mac Lean Center for Médical Clinical Ethics de l’hôpital de l’Université de Chicago (4). Sauf qu’en France, à la différence de ce qui se passait jusqu’à encore récemment à Chicago, la consultation d’éthique clinique a été dès l’origine accessible à égalité aux professionnels et aux patients ou à leurs proches, ces derniers pouvant en effet s’en saisir tout aussi directement et facilement que les précédents. C’est que le contexte d’implantation n’a pas été le même. Né d’un besoin exprimé par les médecins aux Etats-Unis, il a été conçu en France comme un dispositif d’application de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (5). De ce fait, la structure est historiquement liée à une dynamique visant à accorder plus de place qu’auparavant au patient, ainsi qu’à celui qui le représente dans la décision médicale.
Par ailleurs, toujours pour tenir compte et s’adapter à son propre contexte, l’inspiration française a quelque peu transformé le modèle initial américain. Le groupe d’éthique clinique s’est enrichi dès l’origine de membres issus de la société civile, aussi divers que possible, venus de tous horizons et ayant accepté de s’investir dans cette aventure et de s’entraîner pour cela en suivant un cursus de formation ad hoc. Nous sommes ainsi pour moitié des soignants et autres hospitaliers, et pour moitié des experts venus d’autres champs disciplinaires, notamment des sciences sociales et humaines – philosophes, juristes, sociologues, anthropologues, psychanalystes – mais aussi économistes, hauts fonctionnaires, représentants de patients, journalistes, etc. Notre parti pris est de nous positionner en tant que tiers, en internalisant chez nous le débat à propos de la décision difficile à prendre. Ici, le tiers n’est pas un personnage isolé, mais un collectif. Il se donne pour objectif d’aider les gens, le patient concerné ou ceux qui le représentent, ainsi que le médecin et l’équipe soignante qui l’ont en charge, à prendre ensemble la moins mauvaise des décisions, et à dépasser pour cela leurs clivages éventuels. Il ne s’agit pas de dire l’éthique. L’éthique est proposée comme un chemin de dialogue. L’hypothèse est qu’en s’engageant tous à ce niveau d’échange, chacun sera amené à considérer la position de l’autre comme une position a priori aussi respectable et défendable que la sienne au plan éthique, et donc digne d’être au moins envisagée et discutée.
Dans l’exemple qui nous occupe ici, la décision médicale en débat ne soulevait pas à proprement parler de conflit de valeur entre l’équipe soignante et la patiente. Elle interpellait les médecins qui ne savaient pas bien quelle était « la » bonne décision à prendre au plan éthique. Chez nous, les échanges furent vifs. Comme si chacun se sentait plus vivement interpellé encore qu’à l’habitude, du fait de l’impossibilité d’accès à la position de la première concernée, la patiente, et de sa situation de grande vulnérabilité.
Il y avait ceux, médecins souvent, qui considéraient comme un devoir de l’institution soignante d’opérer la malade. Elle avait eu la chance, disaient-ils, de croiser par hasard la médecine sur son chemin de vie. Il fallait lui offrir la possibilité de vieillir sans devenir tétraplégique, puisqu’on était arrivé à temps pour pouvoir l’éviter. Ce serait aggraver encore ses pertes de chance dans l’existence que de ne pas le faire et injuste, comparativement à tous ceux, en situation clinique équivalente, à qui on le proposait quotidiennement.
Il y avait ceux, à l’inverse, qui trouvaient que la médecine se mêlait de ce qui ne la regardait pas, qu’elle était bien prétentieuse à savoir mieux que tout le monde quel était le bien pour autrui. Ils faisaient remarquer que cette femme n’avait rien demandé, qu’elle ne s’était jamais plainte ni n’avait sollicité de soins, qu’elle n’avait pas l’air de souffrir et qu’elle était en quelque sorte, du fait des circonstances de son arrivée à l’hôpital et bien malgré elle, devenue prisonnière de la médecine, sans moyen de s’échapper. Etait-on sûre qu’elle évoluerait jusqu’à la tétraplégie, ne pouvait-on la laisser vivre sa petite vie tranquille, surtout si elle avait l’air plutôt contre l’intervention qui lui avait été expliquée ?
Un troisième groupe, composé de psy de tout poil et autres ralliés, croyait possible la restauration de ses capacités de discernement et plaidait pour une prise en charge psychiatrique intensive à cette fin. Il fallait travailler sa capacité à consentir, disaient-ils. Cela serait long, mais on avait le temps puisque la maladie somatique ne progressait que très lentement. C’était une patiente qui n’avait pas eu la chance de pouvoir être aidée jusque là par l’institution psychiatrique, or sa maladie la plus grave était la maladie psychiatrique, il était temps de lui offrir cette prise en charge et de compenser la perte de chance qui avait été la sienne à cet égard jusque là.
Enfin, pour d’autres encore, c’était le contexte social qui devait tenir la première place dans cette histoire. A quoi servirait d’opérer cette femme sans se préoccuper de son avenir social ? Savait-on où elle vivrait désormais et quelle serait sa vie ? La médecine avait bien une courte vue à ne s’intéresser qu’à ses vertèbres cervicales ! Son métier ne pouvait consister à ne s’occuper que de la maladie, elle avait un devoir social et politique plus vaste. Elle devait inscrire son action dans la lutte contre les situations de grande vulnérabilité et de grande inégalité. Utopie, répondaient les médecins, nous ne pouvons pas être responsables de la dimension psychosociale de cette histoire, nous ne savons pas faire, et à vouloir trop embrasser, le risque est de perdre de vue le meilleur intérêt au moins médical de la patiente …
L’éthique clinique telle que nous la concevons est une méthode. L’un des postulats qui la fonde est que sur de telles questions, aussi complexes, on réfléchit toujours mieux à plusieurs, et venus d’horizons divers. L’expertise, si expertise il y a, ne peut être que collective. Elle s’élabore grâce au regard de tous, car chacun, par les questions qu’il pose, incite à creuser toujours plus loin, à démultiplier ou à l’inverse à déminer les arguments. L’expertise se renouvelle aussi, en fonction de chaque contexte singulier. La façon dont est constitué le groupe d’éthique clinique cette fois-là en fait partie, autant que les éléments factuels qui composent le cas au plan clinique et médical. Enfin, la discussion collective permet d’être vigilant quant aux postures et projections que l’on peut avoir chacun, du fait de son histoire personnelle ou professionnelle, et aussi collégialement. Car, il est fréquent, face à des situations souvent très dramatiques, d’avoir des réactions abruptes, à l’emporte-pièce. Or, en matière d’éthique clinique, il n’est pas question de se contenter d’une position qui n’aurait pas été soupesée au trébuchet. Les conséquences en sont trop lourdes pour la personne dont il s’agit. En effet, les questions qui nous sont posées engagent le plus souvent un choix capital pour elle, de vie ou de mort, ou encore d’orientation significative pour sa vie future. Et même, si bien sûr, nous ne sommes pas décisionnaires et ne donnons qu’un avis consultatif, ceux qui nous saisissent comptent sur le sérieux de la démarche et s’appuient sur notre réflexion. Il faut donc que cette dernière soit à la fois ouverte mais rigoureuse, étayée par des référentiels solides, notamment d’ordre procédural, visant à garantir que la délibération collective est structurée et n’a omis d’investiguer aucune des dimensions éthiques importantes de la question posée.
Norbert Steinkamp et Bert Gordijn, dans leur revue critique des méthodes d’éthique clinique, classerait la nôtre avec celles qu’ils appellent de « pragmatisme clinique » (6).
Selon eux, l’éthique clinique pragmatique, dont les fondements ont été notamment théorisés par Mark Aulisio au nom de l’American Society of Bioethics and Humanities (7), présente à la fois les avantages et les inconvénients de l’approche clinique. Elle tire sa force du fait qu’elle est opératoire. Sa faiblesse vient du même fait : elle serait trop axée sur l’aide à la prise de décision, privilégiant pour cela la résolution du conflit et la recherche d’un consensus, éventuellement négocié, aux dépens de la compréhension, de l’interprétation et d’une prise de position claire sur la dimension morale contenue dans la question en débat. Elle serait de ce fait potentiellement dangereuse en cela qu’elle pourrait aboutir à promouvoir un consensus moins-disant en termes éthiques.
Steinkamp et Gordijn opposent ce premier type de méthodes, à d’autres qui toutes se sont développées en Europe et partagent un même choix, consistant à considérer que leur objet principal doit être l’analyse de la dimension morale de la question posée, et non l’aide à la décision médicale proprement dite. Ici, l’objet n’est plus de répondre à la question : quelle décision dois-je prendre, mais à la question : quelle est la valeur morale de la décision que je m’apprête à prendre. C’est sur cette base que se sont développées par exemple la méthode herméneutique, conceptualisée par Bruno Cadoré, et qui continue d’inspirer l’approche d’éthique clinique proposée par le Centre d’éthique médicale de la faculté catholique de Lille, ou la méthode dite de délibération morale, mise au point par l’équipe de Guy Widdershoven et Bert Molewick du Centre d’éthique et philosophie de la santé de l’université d’Amsterdam aux Pays Bas. Toutes sont des méthodes à destination exclusive des soignants et souvent animées par des philosophes, ou des soignants ayant acquis une expertise philosophique. Il s’agit d’offrir aux équipes un accès à une réflexion sur le sens de leur métier, grâce à l’expertise d’un facilitateur ad hoc, que l’on nomme éthicien, et qui aide à décrypter, derrière la question en débat, les règles et les principes éthiques en cause et leur articulation (8).
On voit que sous le vocable d’éthique clinique se déclinent non seulement des modes opératoires mais aussi des objectifs très différents. D’autant que chacun, même s’il s’inspire d’une même famille méthodologique, a développé son propre outil, en l’adaptant à son contexte et à sa trajectoire de pensée. A Cochin, si nous nous sentons globalement plus proches de nos collègues américains qu’européens dans la méthode, il n’en reste pas moins que nous avons construit au fil des ans une certaine spécificité dans l’exercice.
Cette spécificité est plurielle, mais l’un de ses aspects les plus frappants est la dimension particulièrement démocratique, au sens politique du terme, que nous avons donné dès l’origine à la méthode. Nous n’en avions pas conscience à l’époque, mais une collègue américaine, venue nous aider pendant quelques mois à l’ouverture du Centre l’avait, elle, immédiatement perçu, tellement la différence d’ambiance était manifeste avec ce qu’elle connaissait outre-Atlantique : « Tout est tellement politique et collectif en France », soupirait-elle, avec l’air de penser que c’était à la fois une immense richesse mais que cela compliquait fortement l’exercice.
Si l’on en revient à notre histoire du jour, elle est illustrative de ce constat : notre débat a été bien au-delà de la stricte question de savoir avec quelle décision les médecins seraient le plus en accord avec eux-mêmes à titre professionnel au plan éthique ou moral et pourquoi. La question qui nous a principalement occupés a été celle de savoir si la dimension morale de la situation qui nous était exposée n’était pas ailleurs que dans la décision chirurgicale en débat. Ne s’agissait-il pas plutôt d’approfondir les interrogations suivantes : qui était vraiment cette patiente, comment se faisait-il qu’un individu puisse ainsi rester si longtemps inexistant socialement, ne fallait-il pas repenser complètement sa prise en charge, à la fois médicalement mais surtout au plan psychiatrique et aussi social, dans une vue non seulement de court terme mais aussi de moyen-long terme ; mais était-ce là ce que la patiente voulait, quel était son meilleur intérêt et quel était le rôle social voire politique de la médecine dans cette affaire. Comme souvent, le poids dans la discussion des non médecins et des arguments non médicaux a été considérable, ainsi que la fougue mise par chacun dans sa prise de position, comme s’il s’estimait pour partie responsable de la décision qui allait être prise concernant cette jeune femme, et ce faisant comptable de son avenir.
Probablement ce fonctionnement très atypique de l’exercice d’éthique clinique, si l’on en croit ce qui se passe ailleurs, est-il assez typiquement français. En optant pour une composition aussi résolument ouverte et pluridisciplinaire du groupe d’éthique clinique, m’inspirant en cela de la logique contenue dans le modèle de Chicago, je n’imaginais pas que le résultat aboutirait à quelque chose de si radicalement différent. Le groupe s’est emparé à sa façon de l’exercice et l’a fait sien ; il l’a rendu moins médical, moins académique, et à l’inverse, plus citoyen, plus politique.
Au-delà d’être citoyen et politique, l’exercice est aussi l’occasion d’un renouvellement inattendu de l’expérience démocratique. Je caractériserai celui-ci triplement. En premier lieu, le renouvellement est dans le rééquilibrage de l’engagement citoyen au profit de l’individu plutôt que du collectif que permet la démarche. Sa vocation casuistique y aide. La question qui nous est posée concerne toujours un individu, confronté à une situation clinique particulière, nécessitant de l’aide. La première étape du travail consiste à aller à la rencontre de la personne concernée, en tant qu’elle est unique et singulière au plan clinique, historique et culturel ; on aura pris les moyens de cette rencontre, on s’en sera imprégné, on la restituera le plus fidèlement possible avant de s’engager dans les débats, afin que la réflexion soit toujours au plus incarnée ; l’exigence est peut-être plus forte encore lorsque précisément la personne dont il s’agit est incapable de s’exprimer pour elle-même. Ce réajustement au profit de l’individu est d’autant plus intéressant que dans notre contexte culturel, ce dernier disparaît encore trop souvent et facilement derrière l’imperium de la collectivité.
Le deuxième élément de ce renouvellement démocratique est l’engagement que suppose de la part de chacun des membres du groupe d’éthique clinique la participation à l’exercice. On l’a dit, tous le prennent très à cœur. Il s’agit en quelque sorte pour eux d’assumer par là une certaine forme de responsabilité citoyenne. Ils participent à ce qu’ils ressentent comme une élaboration commune et exigeante de la pensée au service d’un objectif noble qu’ils sont contents de servir: l’aide à autrui en difficulté, et ceci au travers d’une méthode de travail exigeante mais stimulante , dite de délibération éthique. L’expérience est constitutive de lien et de cohésion sociale entre tous ceux qui y participent. La force qui s’en dégage sur ce plan conduirait presque à proposer de s’en inspirer dans d’autres secteurs de la vie sociale.
Enfin, il y a un troisième élément de renouveau démocratique que permet l’exercice d’éthique clinique, comme il s’est construit à Cochin. Il permet d’accéder à une connaissance intime et concrète de la façon dont la société évolue au plan de ses valeurs et de ses priorités éthiques. Car les histoires singulières qui nous sont apportées le sont parce qu’elles défrayent la chronique à l’instant où elles surviennent, elles réclament une réponse qui pour une raison ou pour une autre ne s’impose pas ou doit être réinventée. Si elles arrivent jusqu’à nous, c’est que précisément elles remettent en question la réponse morale évidente que leur faisait les équipes soignantes jusque-là. Tant et si bien que l’expérience d’éthique clinique ainsi conçue est un lieu d’observation unique des questions éthiques qui travaillent la société en profondeur, ainsi que des réponses qui leur sont apportées (9).
C’est ainsi qu’au fil des ans, le Centre d’éthique clinique est progressivement devenu un véritable outil de démocratie sanitaire et qu’il fonctionne moins aujourd’hui comme une instance éthique classique que comme une instance citoyenne dont l’éthique est la méthode.
Références bibliographiques
(1) L’observation a été maquillée pour respecter la confidentialité.
(3) Voir le rapport intitulé « l’éthique clinique », Rapport de la mission pour le développement de l’éthique clinique en France, coordonné par V. Fournier, Ministère de la Santé, janvier 2002.
(4) M. Siegler a créé le Mac Lean Center for Medical Clinical Ethics en 1984 et le dirige depuis ; voir site http//medicine.uchicago.edu/centers/ccme/index.htm
(5) Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
(6) N. Steinkamp and B. Grodijn, « Ethical case deliberation on the ward. A comparison of four methods”, Medicine, Health care and Philosophy, 2003, 6,p. 235-246.
(7) M.P. Aulisio and al., “Health Care Ethics Consultation : Nature, Goals, and Competencies”, Annals of Internal Medicine, Volume 133, 4 July 2000, Number 1, p. 59-69.
(8) Véronique Fournier, « L’éthique clinique », in Médecine, santé et sciences humaines, Ed. Les Belles Lettres, Août 2011, Chapitre 41, pp 297-301.
(9) Véronique Fournier, « L’éthique clinique comme observatoire de valeurs sociales émergentes », in L’éthique clinique et les normes, Ed.Cécile Defaut, Mars 2013, pp 39-55.