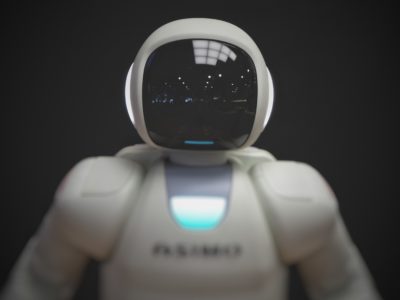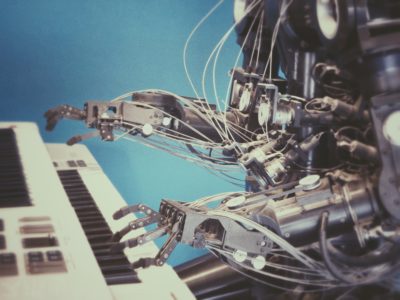L’éthique à l’épreuve de la fin de vie (2)
Eric Fourneret – Philosophe Centre de recherche Sens, Éthique et Société (CERSES) Université Paris-Descartes
L’expérience éthique qui se montre mais ne se dit pas.
Comme on l’a suggéré dans la partie précédente, les progrès de la biomédecine ont créé des nouveaux défis pour la pensée morale. La question de l’euthanasie est emblématique de cet embarras qui accompagne tout autant les personnes malades, leur famille que les professionnels de santé. Au moins pour une raison : ces questions ne divisent pas d’un côté les « bons » et de l’autre les « mauvais ». Chacun a de bonnes raisons de vouloir que soit légalisée l’euthanasie ou de s’y opposer. Mais les enjeux cliniques, politiques et évidemment moraux, posés à notre société par ces situations de fin de vie, méritent que l’on s’interroge sur les moyens de la philosophie morale pour nous aider à voir plus clair.
Pour cela, il est nécessaire tout d’abord de souligner le contexte dans lequel se posent ces questions. Ce n’est pas seulement celui de l’extraordinaire développement de la biomédecine, c’est aussi celui de la postmodernité qui présente un homme relativisant la raison au gré de ses sentiments et de ses émotions[1]. C’est encore le contexte de personnes prises dans le quotidien de leurs pratiques et qui doivent, bon gré mal gré, prendre soin des plus vulnérables d’entre nous. Pour ces tiers qui apportent leur aide à autrui (famille, proches, professionnels de santé), la temporalité de l’action soignante (ou de l’action du care), ne correspond pas toujours à celle de la réflexion. En d’autres termes, l’abstraction d’une certaine philosophie morale ne saurait satisfaire au tout des exigences éthico-pratiques que connaissent les personnes directement impliquées par les situations médicales complexes.
Ce faisant, on peut comprendre le besoin de plus en plus pressant d’associer au travail conceptuel et théorique une démarche empirique et interdisciplinaire. Interdisciplinaire, car l’ouverture de la philosophie à d’autres champs des sciences humaines et sociales se révèle d’une extraordinaire richesse pour la pensée morale. C’est le cas, par exemple, de la sociologie interactionniste pour penser la relation médicale. Empirique, ensuite, car la démarche consistant à produire ses propres données – au moyen, par exemple, d’entretiens qualitatifs semi-dirigés – permet de constituer un matériau parfaitement en adéquation avec les implications philosophiques et éthiques du sujet de recherche. Ceci étant précisé, quelle philosophie permet de tenir ensemble toutes ces exigences ?
L’importance des enjeux dans la prise en charge médicale d’une personne attire logiquement notre regard sur les choix et les actes. En réalité, il est possible de contester que le point de départ de l’éthique dans ces situations complexes soit la question de savoir ce qu’il faut faire. Autrement dit, il ne s’agit pas de montrer que les actes et les choix ne sont pas une préoccupation pour la pensée morale convoquée au chevet de la personne malade, mais de montrer que cette question – bien que pratique, mais aux réponses trop théoriques – succède à une autre. En d’autres termes, elle ne serait pas première.
Dans le domaine de la philosophie morale, un style récent a montré toute l’importance des pratiques concrètes et des compréhensions partagées. De quoi s’agit-il ? Nous avons déjà fait allusion à Wittgenstein, nous y revenons ici pour souligner que toute règle générale, toute théorie morale et tout principe cardinal, supposent une compréhension commune sur leur application. L’intérêt de cette philosophie est d’avoir mis au centre de la pensée le souci du sens des mots ordinaires, et de mettre l’accent sur le fait que le langage éthique « dépend d’une forme de vie partagée et des pratiques d’une communauté à l’intérieur de laquelle nous trouvons les termes de notre expérience éthique », comme le décrit Williams commentant Wittgenstein[2]. Pour Williams, cette approche a le mérite de faire surgir d’autres concepts éthiques que les classiques termes de « bon », de « juste », de « devoir », d’« obligation ». Ainsi, alors que le théoricien de la morale posera la question de savoir « Qu’est-ce que la dignité ? » ou « Qu’est-ce qu’une vie qui vaut la peine d’être vécue ? », le souci pour les compréhensions partagées permet de s’intéresser à des énoncés (mais aussi des pratiques), qui sortent du cadre de la logique, du rationnel, ou tout simplement du sens.
Soit l’exemple de l’énoncé suivant au chevet d’une personne mourante : « Quand je serai mort, j’irai mieux ». Le professionnel de santé se pose évidemment la question du sens de cette phrase selon l’idée que tout ce qui est dit possède un sens. Mais pour un philosophe analytique, comme pouvait l’être Moore à sa façon, le sens de cet énoncé ne va pas de soi : du point de vue logique, il ne semble pas valide. En effet, si la condition pour que cette personne se sente mieux consiste à être morte, son décès supprime en même temps tous les états d’existence possibles dont celui d’être mieux. Pour un penseur analytique de tels énoncés ne sont pas valides puisqu’ils ne peuvent être ni vrai, ni faux : une personne ne pouvant pas être en même temps dans un état de mieux être (qui suppose une vie biologique supportant la conscience de cet état), et être décédée.
Un partisan d’une théorie utilitariste, mettant l’accent sur la satisfaction des préférences personnelles (ici, les préférences sont les normes et permettent des prescriptions, qui ne sont pas nécessairement universelles, en vue de leur satisfaction[3]), soulignerait que l’énoncé « Quand je serai mort, j’irai mieux » a du sens, sans mettre un point d’honneur sur la logique de l’énoncé. Cela aurait du sens parce que la personne estimerait que la réalisation de sa préférence compte pour elle : ce qui est important étant que l’état de choses désirable qu’elle préfère soit réalisé.
Il est important de rappeler que les situations de fin de vie où la personne mourante se trouve souvent dépendante de l’aide d’autrui, impliquent alors la présence bienveillante d’un tiers pour réaliser l’état de choses désiré. En premier lieu, il faut convenir que si cette personne présente estime qu’il lui faut satisfaire cette préférence, c’est qu’elle estime en même temps que n’importe qui d’autre à sa place devrait le faire. En d’autres termes, même si Hare admet l’idée que les préférences personnelles ne conduisent pas nécessairement à une prescription universelle, le raisonnement pratique semble toutefois y conduire. D’autre part, le problème avec la satisfaction des préférences est qu’elle implique une capacité rationnelle en mesure de comparer l’intensité des préférences. L’utilitarisme, quelle que soit sa forme, suppose alors un calcul, rappelons-le, que la personne en fin de vie n’est plus toujours capable de faire ; l’attitude de celui qui avance vers sa mort de façon stoïque correspond si peu à ce que les professionnels de santé peuvent voir au quotidien. De fait, ce calcul revient donc souvent à autrui avec toutes les difficultés techniques que cela implique, comme la détermination des critères rationnels pour se penser soi-même dans le choix d’un autre. On imagine combien cela peut être difficile d’adopter le point de vue de l’autre ; un point de vue qui dépend d’une histoire différente de la nôtre et dont on ne possède, dans le meilleur des cas, que quelques bribes.
Pour un partisan de la philosophie de Wittgenstein, la pensée s’égare en cherchant à corriger les erreurs des énoncés ordinaires. Croire, parce qu’un énoncé serait un non-sens, qu’il n’est pas porteur d’une dimension éthique est une vision réductrice de l’expérience morale. C’est là tout le nécessaire de la distinction fondamentale, faite par Wittgenstein, entre sens et non-sens. Pour le philosophe autrichien, le sens d’un énoncé est qu’il peut être qualifié de vrai ou de faux après vérification avec la réalité (par exemple, l’énoncé « Il pleut » a du sens puisqu’il peut être dit « vrai » ou « faux » au moyen d’une vérification). En revanche, le non-sens est un énoncé qui ne peut être qualifié de vrai ou de faux. Or, pour Wittgenstein, l’éthique est justement le lieu des énoncés du non-sens. Car pour lui, cette distinction n’est pas celle entre ce qui est important et ce qui ne l’est pas. Ainsi, dans les situations complexes du soin, comme celles énumérées ci-dessus, qu’une personne dise « Quand je serai mort, j’irai mieux », ne signifie pas qu’elle ne nous montre pas quelque chose d’important. Cela permet de comprendre toute la différence entre dire et montrer, en ce que montrer, c’est représenter l’irreprésentable[4]. La douleur, la souffrance sont justement ces expériences qui ne se partagent pas. Même si l’on peut reconnaître que telle personne souffre, ce que l’on sait de sa souffrance ne ressemble en rien à la souffrance éprouvée par cette personne : ni la compassion, ni l’empathie, ni la sympathie ne sont les copies exactes de l’expérience de la souffrance d’autrui. Ce que montrent de tels énoncés du non-sens, c’est un rapport au monde et à autrui. Ainsi, ce que la philosophie morale doit faire, selon Wittgenstein, ce n’est pas établir des règles générales ou des principes abstraits ; c’est comprendre nos manières, particulières et partagées, de montrer notre rapport au monde et à autrui, mais surtout, notre manière de montrer ce qui est important dans une situation (notre conception personnelle de la vie). Ainsi, si l’on s’accorde à penser que la relation paternaliste en médecine n’est pas une relation respectueuse de la personne malade dès lors que celle-ci souhaite être actrice des questions relatives à sa santé, la relation médicale ne peut faire l’économie de la conception personnelle de la vie. Un tel objectif, qui peut apparaître aux premiers abords très abstrait, suppose en réalité une pensée morale qui descende au concret des situations particulières. Loin de penser qu’il faille donner des cours de logique à la personne en fin de vie en proie à d’horribles souffrances, on peut légitimement penser combien il serait préférable de former des professionnels de santé qui ne se réduiraient pas à des techniciens du soin. Ce que tendent à montrer les fins de vie, c’est l’importance des perceptions à la particularité des situations. En d’autres termes, l’enjeu est de comprendre qu’il y a autant à entendre et à voir qu’à raisonner : le souci pour autrui n’est pas qu’une affaire de sensibilité au sens psychologique du terme, c’est aussi l’affaire d’une sensibilité éthique.
L’attention au particulier.
Nous sommes partis de la citation de Nowell-Smith « ‘Que dois-je faire ?’ », et nous avons contesté cette tentation de réduire la pensée morale à cette seule question en soulignant l’importance des conceptions particulières de la vie, autrement dit en mettant l’accent sur ce qui est important et qui ne se dit pas toujours d’une manière signifiante. Ce faisant, Nowell-Smith ne se trompe pas sur le rôle du philosophe :
La philosophie morale est une science pratique ; son but est de répondre aux questions de la forme « Que devrais-je faire ? ». Mais on ne peut pas donner de réponse générale à ce type de question. Le mieux que puisse faire le philosophe moral est de dresser un portrait de divers types de vie à la façon de Platon et demander quel type de vie vous voulez vraiment mener. Mais ceci est une tâche dangereuse à entreprendre. Pour le type de vie que vous devez vouloir mener, il dépendra du type d’homme que vous êtes. Les décisions et les impératifs ne suivent pas logiquement les descriptions psychologiques ou biologiques ; mais la sorte de vie qui sera satisfaisante pour un homme devant les autres dépendra du type d’homme qu’il est.[5]
Si Nowell-Smith reste attaché à la question de savoir ce qu’il faut faire – mais nous n’avons récusé cette question que dans son statut communément admis de « Commencement de la pensée morale » – l’idée d’une exploration de la diversité des conceptions de la vie encourage à aller bien au-delà des divisions de la philosophie. C’est typiquement ce qu’entreprend Martha Nussbaum à travers ses analyses de la littérature anglo-saxonne, telles ses analyses sur les œuvres d’Henry James[6]. En montrant que les romans détiennent aussi une portée morale, la philosophe invite à prendre conscience de ce qui est important dans des textes qui ne sont pas d’abord philosophiques. En ce sens, Martha Nussbaum attire l’attention sur diverses conceptions de la vie – comme le supposait Nowell-Smith – mais ici des conceptions peintes par des écrivains. Sa motivation s’inscrit dans les limites de la philosophie à dire certaines conceptions du monde dans un langage technique et philosophique inadapté à rendre compte de l’irrégularité de la vie[7]. Cette même attention se retrouve dans la pensée morale de Cora Diamond qui souligne l’ampleur de l’attention aux détails dans le quotidien même de nos vies :
Reconnaître les gestes, les manières, les habitudes, les tours de langage, les tours de pensée, les styles de visage, comme moralement expressifs – d’un individu ou d’un peuple. La description intelligente de ces choses fait partie de la description intelligente, aiguisée, de la vie, de ce qui importe, de ce qui fait la différence, dans les vies humaines[8].
L’idée essentielle est le déplacement de l’attention sur des objets ordinaires, sur des expressions, sur des formes de vie, et non plus sur des actes et des choix. Ce déplacement n’est pas anodin pour le philosophe moral puisque son matériau pour la réflexion s’enrichit de tout ce que la vie peut contenir : la littérature classique et contemporaine, la littérature populaire, les témoignages de vie, le cinéma, mais aussi les rencontres au quotidien, les expériences de la vie ; et du coup, le philosophe moral peut prendre conscience de son aveuglément, de ce qui lui échappait jusqu’alors. Car ce que chacun explore individuellement au quotidien – et parfois, sans le savoir – sont les grandes notions de la philosophie. L’œuvre de l’écrivain français Camus, par exemple, explore l’ « absurde » qui était déjà un sujet de réflexion pour Kierkegaard[9]. Ainsi, Meursault, dans L’étranger, explore tout autant l’exil que cet absurde de l’existence lorsqu’il se retrouve en prison, après avoir brisé le silence de la plage sur laquelle il avait abattu « un arabe »[10].
Semblablement, cette femme de 56 ans[11], porteuse d’une tumeur du sein très évoluée, et qui refuse tous les traitements, explore aussi cette absurdité. Devenue paraplégique suite à une compression médullaire métastatique, elle refuse les traitements qui peuvent soulager sa douleur qui devient, avec l’évolution de la maladie, de plus en plus insoutenable. Les professionnels de santé continuent de lui apporter les soins du quotidien, telle que la toilette. Mais la manipulation de cette femme malade – et en fin de vie – est difficilement vécue par les soignants qui savent fort bien la douleur que provoquent même les plus petits déplacements sur le lit. Ici, chacun fait l’expérience de l’absurde, du divorce avec le monde parce qu’on ne le comprend plus : l’absurde pour cette femme de mourir à 56 ans et qui se révolte en disant « non » aux traitements, jusqu’à ceux qui peuvent enlever la douleur, et en même temps, acceptant sa condition mortelle par le désir d’en finir avec la vie ; l’absurde pour les professionnels de santé de devoir soigner, tout en faisant mal, alors même qu’ils sont là pour apaiser quand il n’y a plus rien à espérer. Dans cette situation, chacun pousse son rocher en haut d’une colline dont il retombera assurément chaque jour ; et chaque jour, chacun redescendra le chercher en sachant toute l’absurdité de ces vains efforts parce que l’idée qu’autrui se fait du monde n’entre pas dans la compréhension qu’individuellement nous nous en faisons.
Il n’y pas ici de grands principes ou de grandes règles générales qui permettent de comprendre exactement le non-sens de ces situations et qui échappent à la logique, aux arguments, à la démonstration. Car suffit-il qu’une pensée soit argumentée, justifiée, démontrée, pour persuader que l’intérêt le meilleur est là, et qu’il faut alors agir de telle façon ? Est-ce en démontrant rationnellement à cette femme malade que son refus pour les traitements contre la douleur était une « mauvaise chose » pour son confort, un « mal » et une « injustice » pour les professionnels, est-ce ainsi qu’il eût été permis de dépasser son scepticisme ? S’il fallait lui faire entendre raison, de quelle raison parle-t-on en réalité ? Et cependant, ce que montre cette femme par son attitude, par ses expressions du visage, tel son grand sourire pour cacher les grimaces que les infirmières apercevaient juste avant d’entrer dans sa chambre, ce qu’elle montre c’est quelque chose en rapport avec sa manière de vivre et qui échappe à la considération en terme de « bien » et de « mal », de « juste » et d’ « injuste ». Elle montre une vision personnelle de la situation qui n’appelle pas de notre part un jugement, comme si nous devions rendre un verdict ; mais notre compréhension, car devant le vulnérable, la question ne se pose pas de savoir qui nous voulons pour voisin.
Pour cette raison, Martha Nussbaum[12] substitue à la question « Que faut-il faire ? », celle de savoir « Comment faut-il vivre ? ». Cette dernière question devient son point de départ de la pensée morale, comme l’envisageait déjà Bernard Williams :
Si c’est là le juste commencement de l’éthique, comme je le prétends, et s’il est vrai également que la pensée éthique doit conduire à des considérations sociales et même politiques, surgit inévitablement une question concernant la relation de la personne individuelle, qui soulève cette question éthique pour elle-même, avec la société à laquelle elle appartient […][13].
Pour Martha Nussbaum, il ne fait donc aucun doute que les conceptions particulières de la vie ont une portée morale et proposent un ensemble de réponse sur la manière de vivre. Encore faut-il se doter d’une philosophie à la mesure de la particularité de nos vies. La conception aristotélicienne de l’éthique présente, pour Nussbaum, toutes les caractéristiques d’une telle philosophie. S’il ne sera pas question ici d’entrer dans le détail de la présentation faite par la philosophe américaine, on peut toutefois en retenir les quatre points saillants.
En premier lieu, il s’agit de retenir l’incommensurabilité des objets de valeurs[14]. En d’autres termes, les conceptions personnelles de la vie ne diffèrent pas seulement par leur quantité, mais aussi par leur qualité. De fait, il semble exclu de pouvoir les ramener toutes à une métrique unique. Ce qui conduit naturellement à la priorité donnée au particulier[15]. Ainsi, à la différence de la philosophie analytique qui tend, comme Wittgenstein l’a montré, à généraliser, il s’agit ici de ne pas forcer l’application de règles générales, mais d’être attentif à toutes les caractéristiques d’une situation donnée (le contexte). Ce faisant, il est aisé de comprendre que les compétences requises ne sont plus seulement des compétences intellectuelles, mais aussi des capacités de perception, d’attention aux détails importants dans les situations particulières : d’une part, ces capacités permettent d’être mieux préparé aux situations nouvelles pour lesquelles les grands principes et les règles générales préétablies ne suffisent pas[16] ; d’autre part, ces capacités permettent une attention au contexte qui se révèle souvent plus complexe que sa généralisation.
En deuxième lieu, il s’agit de retenir la valeur morale des émotions[17]. L’idée essentielle est que tout raisonnement rationnel suppose un rôle pour les émotions, car celles-ci soutiennent parfois des conceptions de la vie. Les exclure sous le prétexte d’une recherche de l’objectivité morale reviendrait à exclure une part de l’homme dont le rôle dans nos façons de concevoir et de conduire nos vies est fondamental.
Enfin, c’est la pertinence éthique des évènements incontrôlés[18]. En d’autres termes, c’est une prise de conscience que la vie se laisse facilement bousculer par les surprises, à l’image de cette patiente de 56 ans qui, par son refus de toutes les aides, renverse les habitudes soignantes jusqu’à provoquer chez les professionnels de santé le sentiment d’être des « bourreaux ».
Cette façon de concevoir la pensée morale n’est pas spécifiquement élaborée pour les situations complexes de fin de vie. Mais au regard de ce que l’on vient de présenter, il apparaît clairement qu’il n’existe pas de science morale spécifique : toutes nos expériences de vie sont des expériences morales. En revanche, le rôle joué par la conception personnelle que chacun se fait de la vie est fondamental au chevet de la personne mourante. Pour cette raison, l’attention au particulier se révèle une aide précieuse pour la compréhension de notre embarras dans certaines situations. Mais on semble supposer une tension avec la théorisation, c’est-à-dire entre la réflexion et la pratique. Il n’est pas certain que les ressources de la philosophie morale pour affronter les nouveaux défis de la fin de vie soient dans le choix de l’une ou l’autre option. Bien au contraire, la philosophie morale semble avoir beaucoup à gagner, nullement dans l’alternative, mais dans sa mutation. Il n’est pas absurde, en effet, de placer une croyance optimiste dans l’articulation entre l’attention au particulier et une approche plus théorique. C’est à ce titre que la conception aristotélicienne se révèle intéressante puisqu’elle n’exclut pas l’universel, à la condition aussi d’être assistée des autres approches philosophiques, telle la philosophie analytique. Ainsi, la fin de vie qui interroge chaque individu dans son rapport au monde et aux autres invite à explorer d’abord diverses conceptions personnelles de la vie, l’éthique se présentant ainsi comme une aventure dans laquelle nos certitudes et nos croyances peuvent être perdues. La question de savoir ce qu’il faut faire viendrait après.
[1] B Perrier, « Introduction », in M. Maffesoli, B. Perrier, L’homme postmoderne, Paris, François Bourin Éditeur, 2012, p. 7.
[2] B. Williams, op. cit., p. XIV.
[3] R. M. Hare, Moral thinking, New York, Oxford University Press, 1981.
[4] L. Wittgenstein, Conférence sur l’éthique, suivi de Notes sur des conversations avec Wittgenstein de Frédérich Waismann (1929), trad. J. Fauve, Paris, FolioPlus Philosophie, 2008.
[5] Nowell-Smith, op. cit., p. 319, « Moral philosophy is a practical science ; its aim is to answer questions in the form ‘what should I do ?’. But no general answer can be given to this type of question. The most a moral philosopher can do is to paint a picture of various types of life in the manner of Plato and ask which type of life you really want to lead. But this is a dangerous task to undertake. For the type of life you must want to lead will depend on the sort of man you are. Decisions and imperatives do not follow logically from psychological or biological descriptions ; but the sort of life that will in front be satisfactory to a man will depend on the sort of man that he is » (trad. EF).
[6] M. Nussbaum, La connaissance de l’amour. Essais sur la philosophie et la littérature (1990), trad. S. Chavel, Paris, Cerf, 2000, « La fêlure dans le cristal. “La Coupe d’or” de James et la littérature comme philosophie morale », p.191-223.
[7] Ibid., p. 15.
[8] C. Diamond, L’esprit réaliste, Wittgenstein, la philosophie et l’esprit (1991), trad. E. Halais et J.-Y. Mondon, Paris, PUF, 2004, p. 507.
[9] S. Kierkegaard, Traité du désespoir, (1949), trad. K. Ferlov, J. – G. Gareau, Paris, Gallimard, « Folio », 2009.
[10] A. Camus, L’Étranger (1942), Paris, Gallimard, « Folio », 1971.
[11] Situation clinique discutée dans le cadre du Groupe de réflexion éthique sous la responsabilité du Dr. Pierre Basset, Centre Hospitalier de Chambéry, avril 2013.
[12] M. Nussbaum, op. cit., p. 44.
[13] B. Williams, op. cit., p. XVII.
[14] M. Nussbaum, op. cit., p. 63.
[15] Ibid., p. 64.
[16] Ibid., p. 64-68.
[17] Ibid., p. 68.
[18] Ibid., p. 73.