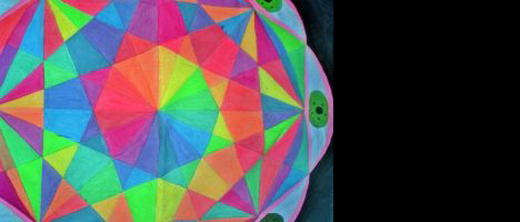L’essentiel est que tu continues à me regarder comme une personne.
Cette semaine thématique est organisée en partenariat avec l’Espace national éthique Alzheimer et la revue Implications philosophiques
La question de l’identité de la personne face à la maladie d’Alzheimer s’est brusquement imposée à moi en ce jour où pour la première fois mon épouse ne me reconnaît plus. C’était en septembre 1994.Visiblement angoissée, elle me demande soudain :
Où est Jean ?
Le cœur chaviré, je lui réponds :
– Mais c’est moi !
– Tu n’es pas Jean. Il faut appeler Catherine.
J’appelle Catherine et passe la communication à Janine.
– Tu as vu Jean ? Il n’est pas là. Je suis très inquiète.
– Mais, maman, il est à côté de toi.
– Ce n’est pas lui
– Je viens, maman[1].
Janine avait alors 70 ans et moi, 64.
La maladie de Janine venait de franchir un nouveau palier. Aux troubles de la mémoire, qui toutefois ne nous avaient pas empêchés de vivre quasi normalement, venaient s’ajouter les troubles cognitifs. Plus rien ne serait plus comme « avant ».

Photographie : Jean Witt - Janine Juillet 2009
Quelques jours après l’hospitalisation de Janine pour un bilan neurologique en octobre 1994, au cours d’une promenade, elle me dit :
– Je regarde le paysage. Je vois qu’il est beau. Mais il ne me touche pas,
car autre chose me touche. J’ai peur.
– Qu’est-ce qui te fait peur ?
– Ma tête. (Elle pleure). Je suis foutue, je le sais[2].
Dans les premières années de sa maladie, les moments de lucidité, douloureux, étaient assez fréquents, comme en ce jour de mai 1996 :
Je n’en peux plus.
C’est fini
Je ne peux plus me rattraper.
Maintenant je suis foutue, moulue.
Moulue. Moulue. Moulue[3] !
Chute vertigineuse que celle où on tombe sans pouvoir se rattraper. Et moi, l’accompagnant, pouvais-je rattraper Janine ? La rattraper, au début je l’ai essayé de toutes mes forces, mais c’était peine perdue car ma tentative consistait à vouloir la ramener sur les rives du réel. Nous avions des discussions comme celle-ci[4] :
31 mars 1995
– Où est mon mari ? C’était un intellectuel. Il était gentil.
Il s’appelait Jean. Tu ne sais rien ?
– C’est moi, Jean, ton mari.
– Mais non ! j’en ai marre d’être tout le temps remise à ma place. Trouve-moi mon mari, il s’appelle Jean Witt.
– Je t’ai dit que c’était moi […] Je m’appelle Jean Witt.
– Mais ce n’est pas toi. Quand je crois quelque chose, je le crois. Je ne peux pas me mentir à moi-même. Il ne faut dire que la vérité
Un peu plus tard dans la même journée :
– J’étais samedi avec mon mari à la cathédrale de Strasbourg.[5] Il y avait beaucoup de lumière. Les vitraux étaient magnifiques.
– Oui, c’est avec moi que tu as visité la cathédrale. Mais tu ne veux pas ou tu ne peux pas me croire.
– Sûrement pas, je serais folle.
Le soir, le thème de la cathédrale revient. Je renonce à lui parler de moi ou plus exactement, je renonce à la forcer à me reconnaître comme étant son mari, car je lui aurais signifié, en effet, qu’elle devenait folle, je l’aurais obligée à se mentir à elle-même, ce qui l’aurait extrêmement troublée.
Quand on veut reprendre avec utilité, et montrer à un autre qu’il se trompe, il faut observer par quel côté il envisage la chose, car elle est vraie ordinairement de ce côté-là, et lui avouer cette vérité, mais lui découvrir le côté par où elle est fausse. Il se contente de cela, car il voit qu’il ne se trompait pas et qu’il manquait seulement à voir tous les côtés[6].
Donc, quand Janine me reparle de notre visite à la cathédrale, je lui réponds que les vitraux sont beaux et qu’ils représentent des scènes évangéliques. Elle me répond fort justement :
– Et dire qu’il y a tant de gens qui passent à côté sans voir. C’est dommage !
Il suffisait que j’observe par quel côté Janine envisageait la chose et elle était effectivement vraie de ce côté-là et que je lui avoue cette vérité. Il fallait que je me contente de cela et renonce à lui faire découvrir le côté par où elle était fausse. En effet, lui faire avouer cette vérité que j’étais Jean, son mari, cela était impossible. C’est comme si j’avais essayé de lui extorquer un aveu, je lui aurais fait violence. Je ne l’aurais pas accompagnée.
Ne pouvant changer son regard sur moi, il a fallu que je change mon regard sur elle.
Au-delà du vrai et du faux, voir sa vérité humaine. Au-delà de la vérité formelle, voir sa vérité existentielle et toute sa beauté. Comprendre son amour pour Jean, alors même qu’elle ignore que c’est moi[7].
Voir la vérité existentielle de Janine consistait à être attentif à la façon dont elle envisageait sa maladie.
Elle disait :
Je voudrais être comme tout le monde.
Ah ! non, pas ça ! Je veux être normale.
J’ai quand même le droit d’être comme les autres.
Je veux redevenir moi-même.
Tu crois que je vais redevenir normale ?
Jean, aide-moi !
Et un peu plus tard :
Je suis une idiote.
Une idiote intelligente.
C’est ça le pire[8] !
L’identité de la personne face à la maladie d’Alzheimer dépend de son rapport à la vérité, vérité entendue dans le sens où la définissait Thomas d’Aquin : Adaequatio rei et intellectus, l’adéquation entre la pensée et la chose. Je ne pouvais imaginer au couvent d’étude des dominicains dans les années 1950, qu’un jour je serai confronté d’une manière dramatique, existentielle à cette question-là. Ne plus être normal n’est-ce pas avoir un rapport faussé, inadéquat avec le réel ? Devenir idiote, devenir folle. Mais Janine n’est pas une idiote, puisqu’elle est une idiote intelligente. D’où ce cri de détresse :
Je veux redevenir moi-même.
Une autre fois elle dira :
Je voudrais être ce que je ne suis plus.
Etre soi-même, voilà comment Janine définissait elle-même l’identité de la personne. Perdre cette identité, c’est ne plus être ce que l’on était.
Et ce pathétique appel à l’aide :
Jean, aide-moi !
Mais comment l’aider ? Comment l’aider à garder malgré tout son identité ? En faisant silence en moi-même afin d’entendre ses paroles qui toujours sonnaient juste :
J’ai des cris dans la bouche.
Ils ne sont pas fous.
Ils sont normaux
dans l’état où je suis[9].
Si son état n’est pas normal, ses cris sont normaux. Ses cris et plus généralement ses sentiments et ses pensées sur son état. Ses paroles étaient en parfaite adéquation avec la maladie d’Alzheimer telle qu’elle la vivait.
La grandeur de l’homme est grande en ce qu’il se connaît misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable. On n’est pas misérable sans sentiment : une maison ruinée ne l’est pas. Il n’y a que l’homme de misérable. Pensée fait la grandeur de l’homme[10].
Oui, Janine est grande car elle n’est pas un arbre. Elle connaît son état comme on connaît quelque chose quand on l’a mangé. Je lui dis :
– Je suis avec toi.
– Mais tu n’es pas moi, avec cette souffrance dans la poitrine.
– Mange un peu, Janine.
– Quand on n’a pas goûté quelque chose, on ne sait pas ce que c’est. Ce que j’ai, c’est très dur[11] !
Une maison en ruine, saisissante métaphore de la maladie d’Alzheimer qui déconstruit pierre après pierre la personne malade, lui faisant perdre progressivement la mémoire, le langage, les idées et les savoir-faire. Oui, Janine était grande par la conscience douloureuse du processus de perte causé par un cerveau en ruine :
J’ai tant de capacités que je ne peux plus exercer.
Tu dois souffrir avec moi qui deviens de plus en plus minus.
Rappelle-toi ce que j’ai été.
Je ne suis plus rien.
Qui m’a dépouillée de ce que j’avais ?
Qui m’a dépouillée de mes idées ?
Etre dépouillé, c’est comme ôter ses vêtements.
Je sais tout. J’ai tout compris.
C’est une horreur[12].
Janine, dans sa chambre, se met à marcher le long des bords du tapis :
Qu’est-ce que je suis ?
Regarde ce que je fais :
Je suis un bout de viande qui tourne.
Il y a encore de la peau, les os et des choses comme ça,
mais il n’y a plus de femme [13] !
Une personne qui tient un tel langage, n’est-elle vraiment plus rien ? Non, car elle a tout compris. Janine est grande par le sentiment et la pensée. Mais aussi par le langage. Bruno Frappat, ancien directeur de La Croix a écrit :
Jean Witt a noté les paroles de son épouse qui, souvent, sont d’une beauté mystérieuse, relevant d’une poésie involontaire[14].
Aussi ai-je mis en exergue à mon livre cette citation d’un psaume :
Mon cœur a frémi de paroles belles[15].
Petit à petit son langage se déconstruit, symbole de la déconstruction de ce qu’elle était :
4 août 1996
Ils sont trois titres.
Et ce qui marque la chaîne,
tout ça, ça fait des bêtises.
Tu ne comprends rien, hein ?
Moi-même je n’y comprends rien.
Il y a encore une table.
Mais ils sont roses.
Je ne sais pas ce qu’ils font.
Et moi non plus, je ne sais pas ce que je fais.
Bientôt je n’oserai plus parler.
Je perds mon langage[16].
Etonnant mélange de suites de mots qui n’ont aucun sens et de réflexions cohérentes et adéquates sur cette misère qu’est pour Janine la perte du langage.
Mais l’étonnant était aussi sa capacité de rire au sujet de son étrange parler.
Août 1997. J’écris ceci dans mon journal :
Ma chérie, tu étais sereine presque toute la journée. Tu riais, même des mots que tu ne trouvais pas ou qui ne voulaient rien dire. Tu disais :
Il manque quelque chose là-dedans.
Et tu pointais l’index sur le front[17].
Les malades d’Alzheimer font face à la maladie avec leur identité propre, leur personnalité, leur culture.
Janine était une femme active et souffrait d’autant plus de la perte de ses savoir-faire :
J’étais si dynamique.
J’ai fait les choses avec plaisir.
Et maintenant je ne suis plus rien.
Je ne suis plus utile à personne.
Je suis hors service.
Je suis Madame rien du tout.
Toi tu es riche. Tu as des choses à faire…
Moi, je suis une pauvre.
Si au moins on me demandait de faire quelque chose, je pourrais le faire[18]…
Comme elle est riche dans sa pauvreté et grande dans sa misère ! Alors que l’identité de sa personnalité s’effrite, une autre identité, simplement humaine, apparaît. Alzheimer la dépouille, lui ôtant ses vêtements et la laissant dans la nudité de son humanité ! Elle a eu ce mot :
Me voici, moi la pauvre[19].
Voici l’identité de Janine… en résonance avec le «Voici l’homme que Pilate¸ désignant Jésus, adresse à la foule[20].
En même temps Janine m’interpelle au sujet de mon accompagnement, moi qui suis riche car ayant des choses à faire. Or la chose essentielle que j’avais à faire consistait justement à l’accompagner en l’aidant à faire quelque chose pour qu’elle ne soit plus Madame rien du tout. Donne-moi quelque chose à faire était sa demande récurrente.
Janine aimait la musique, que nous écoutions quasi quotidiennement : Mozart, Beethoven, Bach… elle disait :
Écoute ça. C’est beau !
L’âme de Janine, vierge du passé et du futur, affleurait sur son visage dans un présent pur. Il y avait un accord parfait – pour ne pas dire adéquat – entre elle et la musique à laquelle elle s’identifiait. Cela a duré pendant douze ans. Son identité singulière apparaissait aussi universelle que la musique de Mozart.
Par-dessus tout, Janine aimait Jean son mari. Etre la femme de Jean lui était aussi essentiel que d’être une femme. Elle tenait à cette double identité qu’Alzheimer a ébranlée. Le Où est Jean ? , j’allais l’entendre comme des variations sur un même thème.
3 septembre 1996, Janine va sur le perron :
Jean ! Jean !
Viens vite, viens vite.
Coucou, coucou.
Je vais guetter.
Guetter, guetter.
Elle revient vers moi :
Tu n’as pas vu Jean ?
Je suis morte de douleur
Je ne veux pas le perdre[21].
Elle parlait avec les accents de la bien-aimée du Cantique des cantiques de la Bible :
Sur ma couche, la nuit, j’ai cherché
celui que mon cœur aime.
Je l’ai cherché, mais ne l’ai point trouvé[22] !
29 octobre 1995 :
Où est Jean ?
Vous ne savez pas où il est ?
C’est un homme merveilleux !
Je ferai toute la ville pour le retrouver[23].
Et elle partait me chercher dans tout le village :
Je me lèverai donc, et parcourrai la Ville.
Dans les rues et sur les places,
je chercherai celui que mon cœur aime[24].
Comme me l’a dit une amie : Elle vous a ouvert son jardin secret. Ses yeux étant empêchés de me reconnaître, Janine a fait de moi le confident à qui elle a raconté son amour pour Jean….C’est pourquoi j’ai mis en exergue de mon livre cette deuxième citation :
Alors je te ferai le don de mes amours[25].
L’identité de Janine, comme femme et comme femme de Jean n’a jamais été autant mise en lumière que par l’obscurité d’Alzheimer. Mais ce fut comme un long chant du cygne.
Chant du cygne : dernière œuvre d’un poète, d’un musicien etc… avant de s’éteindre[26].
Aujourd’hui, en ce début de 2012, Janine ne sait plus qu’elle n’est plus rien et donc n’en souffre plus. Cela fait déjà cinq ans qu’elle est totalement dépendante. Elle passe à présent le plus clair de son temps dans un lit médicalisé où elle reçoit les soins infirmiers liés à cette dépendance, à commencer par la toilette du matin, à laquelle je participe.
Sa peau est belle, m’a dit une infirmière, c’est parce que vous la nourrissez et l’hydratez bien.
En sauvant la peau de Janine, vais-je aussi sauver son identité ?
Janine ne parle plus, même pas l’alzheimer devenu un flux de syllabes répétitives d’où émergent quelques paroles claires. Mais si elle a perdu son langage, elle n’a pas perdu son visage, et ce visage quasi sans rides dit son identité. Regardant une photographie d’elle prise l’été 2009, j’ai écrit dans mon journal :
Ton sourire éclaire mes pages d’écriture.
J’écris à la lumière de ton visage.
Une amie à qui j’ai envoyé cette photographie m’a écrit :
Merci pour cette nouvelle image rayonnante de Janine. Cela me rappelle comment nos deux fils, alors encore bébés, rayonnaient lorsqu’ils voyaient mon visage au-dessus de leur berceau ou de leur landau.
Janine sourit à mon visage comme le bébé à sa mère. Le visage de Janine n’est certes plus celui d’avant la maladie. Alzheimer l’a volé. Mais il y a ce nouveau visage dans l’immédiateté d’une présence pure. Je pense au petit livre de Christian Bobin sur la maladie d’Alzheimer de son père, qui se termine par ces mots : Il a dans les yeux une lumière qui ne doit rien à la maladie et qu’il faudrait être un ange pour déchiffrer[27].
Certes, Janine ne reconnaît plus mon visage comme étant celui de son mari. Mais elle entend ma voix et répond aujourd’hui encore à ma présence par un sourire, voire une esquisse de sourire. Il importe de lui parler gaiement. Janine n’a pas oublié qu’elle aimait rire.
Janine ayant perdu la mémoire a perdu par là-même ce que Ricœur appelait je crois l’identité narrative. A-t-elle perdu pour autant toute son identité ? Un bébé, qui n’a pas encore d’histoire, quelle identité a-t-il sinon celle qu’il vit face au visage de sa mère ou de son père ? Et si identité narrative il y a, c’est celle que lui racontent ses parents. De même, il me semble que Janine n’a pas perdu son identité relationnelle de visage à visage, de Je à Tu, même si c’est sur un mode très ténu. Elle est encore là.
Une amie m’a même écrit :
Cette façon que vous avez de raconter la vie de Janine, de nouveau, tissera désormais sa propre identité narrative.
Qu’ai-je fait depuis le début de ces pages sinon raconter la vie de Janine et dire comment je la vois ? Comment tu me vois ? était une de ses questions récurrentes. Alors je lui rappelais ce qu’elle avait fait dans sa vie, notamment professionnelle.
Elle me répondait :
Tu vois, je n’étais pas nulle.[28]
Mais le soir en lui écrivant, je me demandais :
Qui es-tu, toi à qui j’écris ?
Je sentais intuitivement que je devais continuer à lui écrire, car si j’avais cessé, j’aurais cessé de l’aimer. Si j’avais cessé de lui parler-en lui écrivant le soir et en lui parlant le jour- elle aurait cessé d’exister pour moi comme une personne […] Combien de fois ne m’a-t-elle pas dit : Parle-moi […]. Elle a même eu ce mot admirable :
-Je m’appelle Janine pour que tu puisses me parler. […][29]
Mais qui est Janine?
Je ne sais plus qui je suis a-t-elle dit souvent. Voilà donc la réponse. Comment saurais-je qui elle est ? Et moi qui lui écris, est-ce que je sais qui je suis ?[30]
Par sa maladie d’Alzheimer Janine m’a fait voir que l’identité de la personne humaine consiste in fine dans son inconnaissabilité. Dans ce sens l’identité de la personne humaine est une non-identité. L’identité de la personne est irréductible à quoi que ce soit.
Janine l’a revendiqué pour elle un certain soir de juin 1995. Il est 20 heures. Il fait bon dans notre jardin. Mais Janine est couchée. Je lui dis :
– J’ai du chagrin parce que je te vois couchée toute la journée.
– Je me suis levée
– C’est juste.
Tu m’as aidé à ranger le bois.
– Je n’étais pas tout à fait nulle.
Tu devrais te réjouir, tu peux faire ce que tu veux.
– Oui, c’est vrai.
Mais j’aurais aimé te voir plus souvent debout.
– L’essentiel est que tu continues à me regarder comme une personne.[31]
Aujourd’hui ou Janine ne peut plus se lever du tout, ni m’aider à ranger le bois, ou elle ne parle plus et ou dans tous les domaines elle est tout à fait nulle, cesserais-je de la regarder comme une personne ? Si vraiment je cessais de la regarder comme une personne parce qu’elle ne peut plus rien faire, je réduirais son identité à l’exercice de ses capacités.
Mais dans le dialogue cité plus haut elle me fait justement comprendre que même tout à fait nulle, l’essentiel est que je la regarde comme une personne. En effet, elle m’a dit cela seulement quand la deuxième fois je lui dis que j’aimerais la voir debout. Elle cesse alors d’argumenter au sujet de ses capacités et me signifie que je dois la regarder inconditionnellement comme une personne. Janine serait-elle une personne dans la mesure où elle peut encore se lever et ranger du bois ?
La ruine du cerveau entraînerait-t-elle celle de la personne en tant que telle ? Une approche purement clinique de la maladie donnerait-elle accès à l’essentiel, pour ne pas dire l’essence d’une personne. Cette considération inconditionnelle, essentielle, de la personne de Janine n’empêche évidemment pas d’être attentif aux signes par lesquels elle se manifeste encore comme une personne. Le signe par excellence est son sourire. Un arbre ne sourit pas. Le sourire de Janine, même si elle ne fait que l’esquisser, est l’épiphanie de son être. Il a encore la clarté d’une étoile qui nous guide vers elle. Et même si son sourire s’éteint, Janine reste Janine, jusque dans son silence.
En méditant dans ma cellule du soir -c’est ainsi que j’appelle ma chambre à côté de la sienne- je lui ai écrit :
Je te vois dans la lumière à laquelle tu m’as conduit.
Comment, à travers les ténèbres d’Alzheimer, Janine m-a-t-elle conduit à cette lumière ? Comment en accompagnant Janine, ma propre identité a-t-elle été ébranlée et transformée ? Répondre à ces questions constituerait un deuxième volet sur l’identité de la personne face à la maladie d’Alzheimer centré cette fois-ci, non sur le malade, mais sur l’accompagnant¸ et plus généralement sur ce que les malades d’Alzheimer nous disent sur nous-mêmes.
Jean Witt
[1] Jean Witt La Plume du silence /Toi et Moi…et Alzheimer. Les presses de la Renaissance Paris 2007 p. 34.
[2] Op.cit. 41.
[3] Op.cit. p. 287.
[4] Le sous-titre de mon manuscrit était Dialogue avec une Alzheimer.
[5] Nous habitons dans un village à 20 km de Strasbourg.
[6] Pascal Pensées Ed. Gallimard-La Pléiade p. 1114.
[7] Op.cit. p. 23.
[8] Op.cit. pp. 46 et 47.
[9] Op.cit. p. 31.
[10] Pascal Op.cit. p. 1156.
[11] Op.cit. p. 25.
[12] Op.cit. p. 152.
[13] Op.cit. p. 26.
[14] La Croix du 24 janvier 2008.
[15] Psaume 45,2.
[16] Op.cit. p. 140.
[17] Op.cit. p. 177.
[18] Op.cit. p. 199.
[19] Op.cit. p. 229.
[20] Evangile selon Jean 19,5.
[21] Op.cit. p. 107.
[22] Cantique des cantiques 3,1.
[23] Op.cit. p. 117.
[24] Cantique des cantiques 3,1-2.
[25] Cantique des cantiques 7,13.
[26] Larousse de la Langue Française. Librairie Larousse 1979.
[27] Christian Bobin La présence pure. Ed. Le temps qu’il fait. 1999.
[28] Op.cit. p. 98.
[29] Op.cit. p. 194.
[30] Op.cit. p. 163.
[31] Op.cit. p. 198.