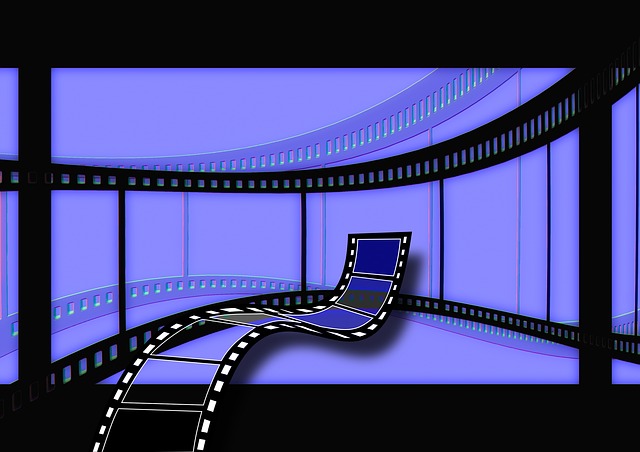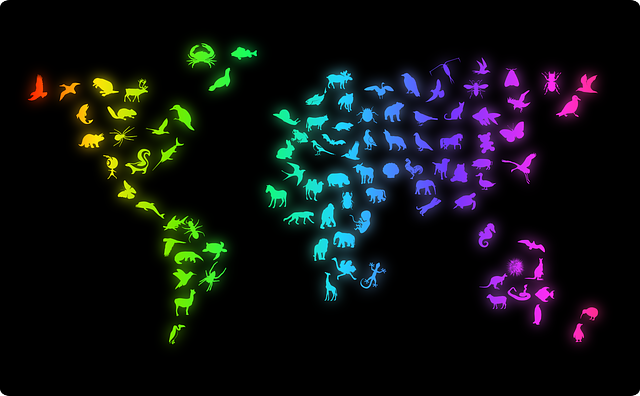L’Essai sur les données immédiates de la conscience, un nouveau modèle (I)
Samuel Ducourant, Elève de l’ENS Rue d’Ulm
« J’inventai la couleur des voyelles! A noir, E blanc, I rouge, O bleu, U vert. […] Je réservai la traduction. »
Arthur Rimbaud, « Délires », Une Saison en Enfer (1873).
L’Essai sur les données immédiates, parce qu’il est présenté dans un cadre académique et sous forme de thèse, parce que Bergson y opère une critique de la pensée dite cartésienne, enfin parce qu’il pose les jalons d’une pensée qui se veut l’alternative du raisonnement analytique, est intimement lié à la science. Celle-ci y est attaquée, jusqu’à ses fondements, dans sa prétention à s’appliquer à l’expérience intérieure. La succession des trois chapitres voit la cible devenir de plus en plus précise, de plus en plus fondamentale. C’est d’abord l’habitude de comparer des termes incommensurables, puis la croyance en un temps compris comme un milieu vide et homogène, enfin le principe d’identité, qui sont tour à tour questionnés, dans leur efficacité à représenter le vécu.
Mais cette critique explicite n’est jamais suffisante : l’affirmation d’une autre manière de penser la suit de près. Tout se passe comme si, parallèle aux objets scientifiques, s’étendait un nouveau monde, seulement entr’aperçu jusqu’alors ; et, rivale de l’esprit cartésien, la durée permet de se rapporter à ce monde.
J’appelle modèle la représentation formelle d’une manière de se rapporter à un objet. L’aspect formel assure la possibilité de l’expression : grâce à sa forme, toujours traduisible en un langage, je puis évoquer, critiquer, enseigner, et donc exprimer, cette manière de penser.
La manière de se rapporter à implique non seulement différents types de connaissances et de pensée, mais encore la sensation et l’action.
L’objet, enfin, peut être phénomène ou idée, c’est-à-dire externe ou interne.
Il est important d’accepter, dès le départ, une définition si large, qui remette déjà en question l’opposition entre sujet et objet, car elle permet de prendre en compte la grande variété des éléments étudiés par Bergson, ainsi que la façon originale dont ces éléments s’organisent.
Il est bien légitime de lire l’Essai à l’aune de cette notion élargie de modèle : dès l’Avant-propos, l’« assimilation » entre un objet et sa représentation (ici, entre des états de conscience et le langage) est qualifiée de « grossière image », de « traduction illégitime ». Toute la confusion qui entoure les données immédiates vient du voile symbolique qui nous en sépare. C’est donc bien la représentation du réel, nécessaire à sa compréhension, et donc l’efficacité du langage, qui est en jeu ici.
A cet enjeu, vient s’en ajouter un autre, qui lui est intimement lié, et dont on découvrira l’insistante présence tout au long de cette étude : il n’est pas évident que le premier Bergson ait cru en la scientificité d’un tel modèle. En effet, le statut de ce modèle alternatif n’est pas, d’avance, précisé : la durée prétend-elle être une alternative scientifique au modèle cartésien, ou une alternative à tout discours scientifique ? En d’autres termes, consiste-t-elle véritablement en une connaissance, et si c’est le cas, peut-on la dire scientifique ? Ou, au contraire, n’est-elle qu’un langage sans signification, intraduisible ? Des réponses à ces questions dépend l’utilisation qu’on pourra, à la fin, faire de l’Essai dans les sciences actuelles.
Pour éviter de tomber dans une modélisation vague des propositions de l’Essai sur les données immédiates, il est nécessaire (I) d’aborder ce texte sur un plan technique, c’est-à-dire d’étudier les éléments dont il est fait, et leur organisation. Ces éléments ne sont, rigoureusement, pas des idées, ni des arguments, mais d’abord des mots, des phrases, c’est-à-dire des manières de parler. C’est pourquoi je veux élaborer, en premier lieu, un style bergsonien. Cela donnera les outils pour (II) modéliser la durée, et en comprendre les rapports avec le modèle cartésien. Ces deux étapes sont le nécessaire préalable à (III) une discussion sur les liens entre le modèle de pensée bergsonien et la science d’aujourd’hui.
I. Manières de parler
1. De subtiles insertions sémantiques
Pour sa thèse de doctorat, Bergson adopte un style apparemment académique. Ce cadre ne l’empêche pas de torturer le langage scientifique : la rigueur et la précision, sur lesquelles il insiste, ne sont pas synonymes de l’immobilité conventionnelle dont il accuse le langage scientifique. Au contraire, une fois distinguées du formalisme, autre forme de précision, elles permettent d’opérer des distinctions éclairantes ; et ce sont ces distinctions qui appellent de nouveaux termes. On peut apercevoir assez clairement ce passage, par exemple, dans l’analyse de la différence d’intensité entre deux sensations[1].
Je veux montrer que le processus d’argumentation, qui tend à exposer l’erreur au grand jour, est solidaire de l’introduction de termes neufs, non-conventionnels. L’argumentation repose sur la mise en place d’une situation, introduite formellement : « supposez […] que j’éprouve une sensation S. » Le fait d’assigner à la sensation une lettre introduit le formalisme mathématique : c’est se donner la possibilité d’insérer la sensation dans une équation. C’est surtout se permettre d’affirmer que S et S’ ne sont pas la même sensation : il y a bel et bien quelque chose de différent entre les deux : . Mais en opposant la différence quantitative à ce quelque chose, Bergson introduit des termes non-quantitatifs : « S a changé ; il est devenu S’ » (je souligne). Ici, le formalisme craque : pour vraiment rendre compte du passage d’une sensation à une autre, il est nécessaire de changer de vocabulaire, de remplacer ΔS par « les états S et S’ par lesquels on passe », c’est-à-dire de nier implicitement la commensurabilité entre deux manières de parler.
Ainsi Bergson met-il en scène à la fois l’incapacité du modèle quantitatif à représenter le réel, et la nécessité d’adopter un autre langage, c’est-à-dire une autre manière de se rapporter aux objets. Le formalisme de la psychophysique ayant révélé sa faiblesse, il est possible d’abandonner ses « supposez », ses assignations et ses équations, pour adopter un modèle où « vous vous apercevrez » des progrès qualitatifs.
Cette insertion de nouveaux termes relève de la proposition, discrète, d’une autre manière de se rapporter au réel. En effet, chaque situation mise en scène par Bergson permet d’introduire un nouveau terme ou de l’ancrer : ainsi apparaissent les notions d’« acte de pensée », de « profondeur » ; ainsi une manière de penser l’hétérogénéité, traduite par les termes de « changement », de « devenir », de « progrès » ; ainsi, enfin, le remplacement de la causalité par la « suggestion » puis par la « préformation. »
2. Naviguer entre les écueils du langage conventionnel
Mais on le sait : « la pensée demeure incommensurable avec le langage. » La critique du langage frappe de la même sentence tous les formalismes, jusqu’au langage naturel, jusqu’à cette langue qu’écrit Bergson. Comment, alors, l’Essai n’est-il pas seulement l’aveu d’un échec ?
Après les avoir congédiés, ce sont toujours les mêmes mots que l’auteur utilise. On aura été, par exemple, frappé de lire, dès les premières pages : « comme si l’on pouvait encore parler de grandeur là où il n’y a ni multiplicité ni espace ! », frappé de l’abandon de la grandeur, qu’elle soit mesurée ou comparée. Combien ne le sera-t-on pas au moment de voir réapparaître ces mêmes traductions qu’on avait crues illégitimes ! Car sans cesse revient, après cette critique, par exemple, l’expression « de plus en plus » (33 occurrences).
Ce serait oublier, pourtant, que le sens de ces mots a, explicitement, changé une bonne fois pour toutes. En effet, insérés entre guillemets au moment d’étudier l’effort[2], ces mots sont arrachés à leur définition commune. Lorsqu’on lira, à l’avenir, que « plusieurs états de conscience s’organisent entre eux, se pénètrent, s’enrichissent de plus en plus », on comprendra sans peine qu’il ne s’agit pas d’une gradation quantitative, mais d’une succession d’hétérogénéités. L’introduction de nouveaux termes, quand elle est possible, permet d’expliciter ces changements.
Mais ce nouveau langage ne l’est pas entièrement : ce sont toujours, à la fin, des mots que je lis dans l’Essai, et ces mots semblent avoir un sens précis, immobile, solide. C’est à cette apparence que s’oppose Bergson, par des rappels successifs : parler de « mille éléments divers » n’implique pas, malgré les apparences, la notion de nombre, puisque ces éléments « se pénètrent, sans contours précis, sans la moindre tendance à s’extérioriser les uns par rapport aux autres. » Malgré son apparence numérique, l’expression « mille éléments divers » n’a pas les propriétés d’un nombre. Nous assistons à l’incessante contradiction du langage par lui-même.
Bref, Bergson se positionne au croisement de deux refus : (1) le refus de découper le réel en unités numériques, c’est-à-dire de perdre l’accès immédiat à la conscience. C’est encore le refus de tout formalisme, et donc, en définitive, du langage. Mais (2) il refuse tout autant le silence. Entre ces deux écueils, nous n’avons pas les mains liées : il est possible d’assouplir le langage. C’est possible en caractérisant la durée comme « succession sans extériorité réciproque», c’est-à-dire en formant ce qui ressemble bien(du point de vue du modèle cartésien) à un oxymore ; c’est possible en accumulant les distinctions (entre unité numérique et identité d’un acte au premier chapitre, puis entre espace et durée, enfin entre chose et progrès).
3. Torturer les conventions stylistiques
C’est possible, enfin, à condition d’accepter que le langage est assez plastique pour représenter adéquatement la conscience. Cette plasticité pose problème au scientifique, habitué à un langage analytique, hérité d’Euclide et de Descartes. Mais on aura beau tourner Bergson en ridicule pour son style, bien beau et trop peu signifiant : si le langage scientifique est celui qui sait à la fois rendre compte du réel et être à la portée de la rationalité, alors, si peu conventionnel qu’il soit, l’Essai est bel et bien un ouvrage scientifique, puisqu’il évite avec succès lesdits écueils.
J’ai tenté jusqu’ici de proposer une rapide étude des termes qu’emploie Bergson ; je veux maintenant l’étendre à la structure des arguments, et proposer une analyse stylistique[3] de l’Essai. Cela pour comprendre si, oui ou non, la structure de ce langage est commensurable avec celle des états de conscience.
Ce qui frappe, à la lecture linéaire de l’Essai, c’est la circularité : pour vraiment comprendre la distinction d’intensités au premier chapitre, il faudrait avoir déjà lu l’étude du nombre, au deuxième. Car c’est toujours le même reproche lancé au psychophysicien et au déterministe, toujours le même acte de l’esprit qui consiste à transformer le phénomène en chose extérieure, distincte, mesurable, inscrite dans une série causale. Si, malgré la diversité, il est toujours question, de près ou de loin, de l’accès aux données immédiates de la conscience, pourquoi ne pas s’être contenté du deuxième chapitre, qui condense cet enjeu dans une analyse des habitudes numériques suivie de la critique générale de l’espace ? Pourquoi, sinon pour des raisons qui ne sont pas philosophiques, ne pas s’être contenté de l’essentiel ?
Cette question est légitime de la part d’un lecteur habitué à des textes précis, formalisés, et qui n’aime pas perdre son temps à tourner autour de l’objet étudié sans l’atteindre. Elle revient à la question suivante : pourquoi n’avoir pas formalisé la pensée de la durée en une proposition claire, distincte, et qui n’aurait eu besoin, pour valoir, ni de tant d’images, ni de si longues analyses critiques ? Finalement, pourquoi n’avoir pas, tout simplement, écrit comme un scientifique ?
Malgré son pessimisme affiché quant à l’efficacité du langage, je crois qu’il est possible de lire le style global de Bergson comme une affirmation réaliste : la forme du langage a quelque chose à voir avec celle du réel étudié. Si celui-là est conforme aux cadres du discours mathématisé, celui-ci ne pourra qu’avoir la forme d’un objet extérieur, distinct. Derrière cette affirmation se trouve la réponse : si le langage de l’Essai prend le temps des retours et des délais, c’est parce qu’il parle d’un réel qui, lui aussi, prend le temps, retient et prépare.
On le voit : dès la première page, Bergson n’hésite pas à remettre à plus tard des arguments majeurs : « nous examinerons plus loin cette dernière thèse » (ce sera fait, p. 45 à 54), « nous le montrerons en détail un peu plus loin » (p. 2 et 3). De telles annonces sont souvent implicites : au moment d’étudier le sentiment esthétique, Bergson affirme qu’« il semble qu’il faudrait revivre la vie de celui qui l’éprouve pour l’embrasser dans sa complexe originalité », ce qui sera prouvé en détail dans l’étude de la prévision : « il n’y a pas de différence sensible entre prévoir, voir et agir ». Ailleurs, ces préparations sont franchement dissimulées. Par exemple, Bergson, après avoir étudié la sensation de chaleur, et montré une fois encore la distinction entre les deux intensités, coupe court : « nous n’insisterons pas davantage », et invite chacun à « s’interroger scrupuleusement. » Cette invitation, qui a valeur en soi, prépare aussi le passage sur les deux aspects du moi, le moment d’écarter « le voile que nous interposions entre notre conscience et nous », en « brisant les cadres du langage. »
Ces préformations, plus ou moins discrètes, ne relèvent pas d’une maladroite organisation démonstrative : elles sont la formulation, c’est-à-dire la mise en forme, d’une propriété des états de conscience, qui, sans perdre leur existence et valeur propre, « se préparent les uns les autres », non pas par causalité, mais par un phénomène de « suggestion », fondé, lui-même, sur l’interpénétration.
On peut être la dupe de cette forme nouvelle, croire qu’il n’y a ici que littérature et non pas connaissance rigoureuse ; on peut prendre au pied de la lettre l’incommensurabilité entre mots et états de conscience. On peut, au contraire, prendre au sérieux l’existence même de l’Essai, et comprendre que la pensée n’est pas incommensurable à tout langage. Grâce à la scrupuleuse rigueur d’un style qui évite les définitions et évolue sur la crête des caractérisations successives, sans jamais y mettre un point final, le langage bergsonien représente adéquatement la structure des états de conscience.
Cette efficacité repose sur une condition, satisfaite dans la totalité des cas, mais néanmoins essentielle : les mots, traductions illégitimes quand ils sont isolés, doivent être considérés ensemble. En effet, ces changements syntaxiques, cette circularité, ces préformations, n’ont de sens qu’en la présence d’une conscience, qui se souvient. C’est à cette condition qu’on peut éviter l’écueil du langage, et néanmoins acquérir une idée claire de ce qu’est la durée. De plus, la résonance entre la conscience et les mots est le signe de la connaissance effectivement transmise. De là résultent les appels fréquents à « interroger scrupuleusement », « soigneusement », la conscience ; de là, l’utilisation de la deuxième personne, pour frapper la conscience du lecteur, qui a tout loisir, en bon scientifique, de refuser l’expérience en s’agrippant, là où ils ne sont pas, aux cadres du langage. Ces invitations sont le rappel des conditions nécessaires de toute connaissance.
4. Une entreprise scientifique ?
Mais peut-on encore parler de connaissance, alors que le refus des définitions est explicite[4] ? Et cette durée, quelle connaissance en avons-nous, sinon une imprécise impression ?
Il faut rappeler que le refus ne vient jamais seul : si les définitions sont introuvables, si le formalisme imité des mathématiques craque constamment sous les exemples, il n’en reste pas moins que les éléments étudiés sont rigoureusement caractérisés, par distinctions et reformulations successives.
Les distinctions successives qui résultent de la critique donnent une forme de plus en plus précise aux états de conscience. Précise, elle n’enferme pourtant pas les éléments dans des cadres, puisque, justement, sa précision vient de la succession, et non des retranchements. Ces distinctions ont un résultat bien précis : la durée est distincte de l’espace (ce qui la caractérise une première fois), mais n’est pas pour autant distincte (c’est sa caractérisation essentielle). Inétendue, elle n’en a pas moins positivement un mode d’existence qui lui est propre.
Ainsi peut-on comprendre encore mieux la circularité, c’est-à-dire la répétition des mêmes arguments appliqués à des exemples différents : les nombreux exemples développés, au premier chapitre par exemple, sont toujours des situations où l’intensité relève d’un changement qualitatif. Leur énumération fait office d’une suite de distinctions, de plus en plus précises. Cette précision croissante, ne relève pourtant pas, contrairement à la distinction scientifique, de la restriction graduelle à un domaine, mais plutôt de la représentation dudit mode d’existence : l’énumération générale présente à la fois le monde de la conscience, dans sa diversité et ses interpénétrations, et la grande efficacité du nouveau modèle, qui refuse de dé-finir. C’est bien une connaissance précise que nous finissons par avoir de la durée ; elle n’a, simplement, pas les frontières, c’est-à-dire la forme, d’une connaissance mathématique.
La prétention au statut de connaissance est visible par l’étude des comparaisons que fait Bergson entre les théories scientifiques de son temps et le modèle de la durée. Ces comparaisons s’opèrent sur une seule échelle : celle de la scientificité, pensée comme capacité d’expliquer un phénomène d’une manière simple, c’est-à-dire sans engendrer d’« insurmontables » ou « inextricables » difficultés. En montrant que la durée a bien sa place sur la balance de l’efficacité, on verra qu’elle prétend en effet au statut de connaissance.
Parallèle à la circularité que j’ai mise en lumière, se développe une argumentation plus conventionnelle : Bergson examine de près les pensées associationistes (psychophysique, physique, école d’Elée, partisans ou détracteurs du libre-arbitre). Il met même en scène un dialogue dans lequel il prend leur défense. C’est toujours pour arriver à la preuve de leur inefficacité : soit, dans le cas de l’intensité, l’hypothèse la plus subtile « ne résout pas davantage le problème » ; soit les équations de Fechner comportent un « vice de […] raisonnement » ; soit tous les héritiers de Kant, sont condamnés à « dégager de mieux en mieux l’absurdité de l’hypothèse fondamentale » ; soit, à la manière de Leibniz et Spinoza, on affirmera plus ou moins clairement une liaison qu’« on ne démontre pas, [qu’]on ne démontrera jamais » ; soit, enfin, partisans comme détracteurs du libre arbitre arrivent à des arguments qui revêtent une « forme puérile. » Remarquons que ces sentences concernent seulement la forme logique de l’argument. C’est donc que, sans même parler de sa capacité à représenter effectivement le réel, le discours scientifique conventionnel s’interdit, dans le cas des états de conscience, l’accès au statut de modèle.
Si Bergson critique ces théories, il n’en résulte pas que la durée, elle, soit un modèle efficace. Simplement, cette confrontation permet d’affirmer qu’il se situe bien dans une entreprise scientifique de recherche de représentations adéquates ; et ce, malgré les assouplissements qu’il opère sur le langage. Ainsi le premier mérite théorique qu’on peut accorder à Bergson est-il de faire la genèse de l’erreur : celle-ci naît de « l’illusion par laquelle on confond succession et simultanéité, durée et étendue, qualité et quantité. » Son second mérite est de formuler les thèses de ses adversaires, ce qui permet non seulement d’isoler l’erreur et de proposer une autre manière de parler, mais surtout d’insérer formellement l’Essai dans le dialogue scientifique.
Conclusion partielle : les prétentions de la durée
Ainsi, je crois avoir montré que l’Essai est le lieu de changements sémantiques, rendus signifiants par un style d’argumentation global non-conventionnel, où critique scientifique et affirmations interpénétrées se croisent. En d’autres termes, d’une part Bergson met en place un langage qui a vocation à représenter le mode d’existence des états de conscience, d’autre part il inscrit ce langage dans l’entreprise scientifique de connaissance.
C’est pourquoi il est possible de penser ce texte comme la proposition d’un nouveau modèle. Ceci explique l’insistance de Bergson sur la dualité : il y a, selon lui, deux espèces d’intensité et de multiplicité, deux aspects du moi, deux pans du réel (l’un où règne l’extériorité sans succession, l’autre fait de succession sans extériorité) et, en définitive, deux manières de s’y rapporter (l’espace comme acte de distinction, la durée comme compréhension).
[1] Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, Chapitre 1, « La psychophysique », Paris, Puf , « Quadrige », 2007. pp. 48-49.
[2]Ibid., p. 18 : « Essayez, par exemple, de serrer le poing « de plus en plus » ». On pourra répéter l’argument avec l’expression « d’ici là », elle aussi mise entre guillemets, p. 86, et avec « plusieurs », p. 91, « croître » et « diminuer », p.169.
[3] Je m’inspire ici de la méthode de Gilles Gaston Granger, présentée dans son Essai d’une philosophie du style, Paris, Odile Jacob, 1988.
[4] Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, op. cit ., p. 152 : « Sans pour cela définir la liberté » ; et dans la conclusion, p. 173 : « Toute définition de la liberté donnera raison au déterminisme. »