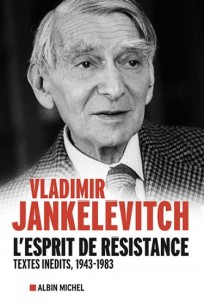Vladimir Jankélévitch, L’esprit de résistance
Recension de l’ouvrage de Vladimir Jankélévitch, L’esprit de résistance. Textes inédits, 1943-1983, textes réunis et présentés par Françoise Schwab, avec les contributions de Jean-Marie Brohm et Jean-François Rey, Paris, Albin Michel, 2015. Recension rédigée par Elisabeth Grimmer, MAPP, Université de Poitiers.
« N’écoutez pas ce qu’ils disent, regardez ce qu’ils font. » Cette maxime bergsonienne[1] est aussi celle de Vladimir Jankélévitch (1903-1985) ; n’est-elle pas même, a fortiori, la maxime de celui dont la vie et l’œuvre ont été marquées durablement par l’expérience de la Seconde guerre mondiale ? C’est ce que montrent, chacun à sa manière, les cinquante documents – articles, discours, entretiens, lettres – rassemblés sous le titre révélateur « L’esprit de résistance » par Françoise Schwab. L’historienne continue par là son infatigable travail pour rendre accessibles au grand public des textes introuvables, sinon inédits, du philosophe, dont elle fut une amie proche. Nous lui devons non seulement l’édition de recueils philosophiques et musicaux, notes de cours et lettres de Jankélévitch, ainsi que l’édition de son diplôme d’études supérieures[2], mais encore un premier recueil historique qui témoigne du combat que le philosophe a mené dans l’après-guerre, et bien au-delà, en faveur de l’imprescriptibilité des crimes nazis. L’holocauste n’est pas un crime comme les autres : c’est un crime contre l’humanité, visant l’homme en tant qu’homme, son être[3]. Cette singularité appelle à un travail de mémoire que continuent les documents du présent ouvrage. S’il s’agit de ce qu’on appelle communément des « écrits de circonstance », et qu’il faut donc les lire dans leur temps, ils constituent également une leçon de philosophie parmi les plus belles : l’obligatoire engagement du philosophe dans la vie, ou sa responsabilité.
On ne peut en effet séparer l’engagement philosophique et l’engagement politique, la pensée et la vie de Jankélévitch. Toute son œuvre est une critique du savoir abstrait, purement hypothétique. Il ne s’agit pas de conjuguer le verbe « s’engager », pas plus que de s’engager à s’engager, mais de s’engager pour de bon, c’est-à-dire s’engager effectivement[4]. En d’autres termes, il faut faire comme on dit : « seul compte l’exemple que le philosophe donne par sa vie et dans ses actes »[5]. C’est un tel manque d’engagement que Jankélévitch n’a jamais cessé de reprocher à ses « collègues » allemands. Heidegger, notamment, ne semblait avoir rien à dire sur ce qui s’est passé (p. 156). Mais notre liberté ne tolère pas qu’on s’abstienne. Elle nous engage et nous engage plus précisément en personne : nous devons prendre parti, et l’abstention même devient une prise de position dans ce contexte[6].
Le choix de documents fait par Françoise Schwab confirme de manière exemplaire qu’il ne s’agit pas là de mots vides. Il couvre toute la deuxième moitié de la vie de Jankélévitch, depuis la profonde rupture qu’y constitue la guerre jusqu’aux années 1980. Né de parents juifs russes, naturalisé français à l’âge d’un an, le philosophe a été destitué de ses fonctions universitaires à deux reprises (en juillet 1940, parce qu’il ne possédait pas la nationalité française à titre originaire, puis une deuxième fois en décembre, en raison des lois sur le statut des Juifs), avant de rejoindre la Résistance aux côtés de son beau-frère Jean Cassou. Il devient alors un devoir moral pour lui de témoigner des souffrances qui lui ont été épargnées[7]. Les grands thèmes de la philosophie de Jankélévitch traversent ainsi les cinq chapitres qui composent l’ouvrage : « La Résistance », « Face à l’antisémitisme, au racisme et au totalitarisme », « L’oubli interdit », « Israël : fidélités », « Faut-il pardonner ? ». L’édition respecte la chronologie des documents à l’intérieur des différents chapitres introduits respectivement par Jean-Marie Brohm, Jean-François Rey et Françoise Schwab qui est aussi l’auteur de l’avant-propos. Des notes de bas de page renseignent sur les personnes et organismes cités dans les textes et ajoutent quelques précisions historiques. Une postface de Jean-François Rey sur les (autres) engagements politiques de Jankélévitch, des repères biographiques, ainsi qu’une bibliographie complètent cette édition.
Le premier chapitre rend hommage aux résistants : les intellectuels juifs (Georges Politzer, Valentin Feldman, Albert Lautman, …) et les fusillés du Mont-Valérien (François Cuzin, Jacques Decour, …), comme tous ces autres qui se sont engagés dans la Résistance au péril de leur vie (parmi lesquels les lycéens de Buffon et Jean Cavaillès). Il ne s’agit pas seulement de se rappeler leur courage. D’une part, Jankélévitch entreprend d’esquisser les traits d’une « conscience juive », dont la marque essentielle est, selon lui, « la précarité de l’existence » (p. 55). D’autre part, il cherche à dégager le sens propre de la Résistance que nous retrouvons dans ses ouvrages philosophiques : « résister, c’est d’abord dire non », et ce refus est inséparable de la morale en tant que « sommet de la philosophie » (p. 95). Plus encore, la morale commence par le refus qui est acte ; un vouloir-ne-pas s’opposant au ne-pas-vouloir de l’abstention, toute proche déjà de la complicité au mal.
Un article paru anonymement en 1943, intitulé « Psycho-analyse de l’antisémitisme », ouvre le deuxième chapitre. Jankélévitch y interroge la spécificité de l’antisémitisme, avant tout sa dimension passionnelle, seule à même d’expliquer le sadisme des bourreaux. Les Juifs ne sont pas persécutés « pour ce qu’ils font mais pour ce qu’ils sont » (p. 128). Les autres documents poursuivent cette analyse de la haine de l’Autre, en distinguant notamment antisémitisme et racisme. Ce dernier se fonde sur la dissemblance seule, alors que le premier se fonde également sur la ressemblance : « l’autre n’est un autre que parce qu’il est un peu le même » (p. 141). L’antisémitisme est d’autant plus complexe que la différence est ici à peine saisissable : il haït l’essence même de l’homme. Jankélévitch fait ainsi ressortir le lien étroit qui existe entre le problème de l’altérité et l’universellement humain dans la mesure où les hétérogénéités (entendons en premier lieu les minorités) ne peuvent s’épanouir que sur un fond homogène, la reconnaissance de leur humanité commune.
Le chapitre trois montre la lutte de Jankélévitch contre l’oubli de ce qui s’est passé. Le crime insondable de l’holocauste, sa méchanceté gratuite, demande une méditation inépuisable, en même temps qu’il déjoue toutes les catégories juridiques. Il n’est alors pas seulement imprescriptible, mais aussi l’affaire de nous tous (et non pas la seule affaire des Allemands) : « le passé, comme les morts, a besoin de nous ; il n’existe que dans la mesure où nous le commémorons » (p. 207). L’indulgence envers les crimes inexpiables, pour ne pas dire la complaisance au nazisme, rend d’autant plus pressant le devoir de se souvenir et de se souvenir inlassablement. Jankélévitch salue donc les actions de Beate et Serge Klarsfeld contre l’impunité des criminels. Et il s’oppose surtout à toute confusion de l’extermination de six millions de Juifs, ou sa banalisation. L’holocauste n’est pas un simple cas particulier dans l’histoire, mais une entreprise absolument unique : « Auschwitz ne se compare à rien » (p. 228).
La fidélité de Jankélévitch à ses convictions, de même que son déchirement, ressort encore davantage du chapitre suivant. Israël est « la conscience du monde d’aujourd’hui » (p. 245), mieux, sa mauvaise conscience. Il est le principe d’inquiétude (comme d’ailleurs d’espoir) ; une dette contractée par les autres nations « pour tout ce qu’ils n’ont pas fait ; pour tout ce qu’ils auraient dû faire » (p. 246). Mais à côté, il y a aussi la réalité historique et politique de ce jeune État, dont Jankélévitch suit de près l’évolution. Ce n’est pas seulement sa fidélité, mais la vérité même, qui est alors déchirée : « c’est le déchirement de la vérité qui explique le déchirement de l’homme », ou encore « il n’y a pas à chercher une stabilité qui n’existe pas en ce monde… » (p. 262). La vérité (humaine) est sanglante ; elle est même ensanglantée, la vigilance restant toujours de mise.
Le dernier chapitre, quant à lui, s’ouvre sur une conférence donnée en 1965, intitulée « Introduction au thème du pardon ». Elle diffère peu, dans son fond, du livre que Jankélévitch publia deux ans plus tard sur le même sujet. Le pardon pardonne, non pas ce qui est excusable, mais ce qui est précisément inexcusable, inaugurant une ère nouvelle. L’essence même du pardon est de dire que « rien n’est impardonnable » (p. 293). Et pourtant, la question de savoir sous quelles conditions le pardon est finalement possible se dessine aussi dans ce texte ; puis elle se trouve au cœur du document suivant. C’est l’absence du moindre signe de regret de la part de l’Allemagne que déplore Jankélévitch ; une demande de pardon tant attendue par le philosophe qui réaffirme donc l’impossibilité pour lui de pardonner à la place des victimes : « j’en suis absolument incapable et je dis : je n’en ai pas le droit, je ne le ferai jamais et je l’ai dit très nettement, à plusieurs reprises » (p. 315-316).
Ainsi, Jankélévitch oppose son indignation morale au mal, et plus encore au « scandale de l’indifférence »[8] qui suivit le crime ontologique de l’holocauste. Le constat dressé par le philosophe, comme le remarque Frédéric Worms[9], n’est pas facile : « l’amour est plus fort que le mal, et le mal est plus fort que l’amour, ils sont plus forts l’un que l’autre »[10]. C’est un débat infini ! L’esprit de résistance témoigne de cette « difficile liberté » (pp. 25 et 271) qui fut alors la sienne : « s’il était difficile de parler pour Vladimir Jankélévitch, écrit Françoise Schwab, il était encore plus difficile pour lui de se taire » (p. 272). L’indignation seule nous permet de passer de la spéculation à la praxis : « l’engagement dans l’effectivité du faire »[11], avec tous les risques que cela comporte pour notre personne. L’intransigeance de Jankélévitch à l’égard de l’Allemagne, son refus de pardonner, lui a souvent été reprochée, même si la réponse donnée, en 1980, à la lettre de Wiard Raveling montre que l’ouverture restait à tout moment possible pour lui : « Je suis ému par votre lettre. J’ai attendu cette lettre trente-cinq ans. Je veux dire une lettre dans laquelle l’abomination est pleinement assumée et par quelqu’un qui n’y est pour rien »[12]. La question n’est pourtant pas d’adhérer (grammaticalement) aux positions de Jankélévitch, mais de garder un esprit critique ; non pas de faire ce qu’il a fait, mais comme il a fait.
C’est dans l’exercice de l’acte libre que notre liberté peut devenir libératrice non seulement pour nous, mais encore pour les autres[13]. Et cette exigence d’authenticité fait toute l’actualité de l’ouvrage aussi pour le siècle qui est le nôtre.
[1] Cf. Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932), Paris, Presses Universitaires de France, 2008.
[2] Vladimir Jankélévitch, Sources, Paris, Seuil, 1984 (édition en liaison avec l’auteur) ; Vladimir Jankélévitch, La musique et les heures, Paris, Seuil, 1988 ; Vladimir Jankélévitch, Premières et dernières pages, Paris, Seuil, 1994 ; Vladimir Jankélévitch, Penser la mort ?, Paris, Liana Levi, 1994 (réédition en 2003) ; Vladimir Jankélévitch, Philosophie morale, Paris, Flammarion, 1998 ; Vladimir Jankélévitch, Liszt. Rhapsodie et Improvisation, Paris, Flammarion, 1998 ; Vladimir Jankélévitch, Cours de philosophie morale, Paris, Seuil, 2006 ; Vladimir Jankélévitch, Une vie en toutes lettres. Lettres à Louis Beauduc, 1923-1980, Paris, Liana Levi, 1995 et Vladimir Jankélévitch, Plotin, Ennéades I, 3. Sur la dialectique, Paris, Cerf, 1998 (édition avec Jaqueline Lagrée).
[3] Vladimir Jankélévitch, L’imprescriptible. Pardonner ? Dans l’honneur et la dignité, Paris, Seuil, 1986, p. 22. Il s’agit de deux textes parus respectivement en 1971 et 1948.
[4] Vladimir Jankélévitch, Le je-ne-sais-quoi et le Presque-rien 3. La volonté de vouloir, Paris, Seuil, 1980, p. 65.
[5] Vladimir Jankélévitch, Le paradoxe de la morale, Paris, Seuil, 1981, pp. 32-33.
[6] Vladimir Jankélévitch, Le je-ne-sais-quoi et le Presque-rien 3. La volonté de vouloir, op. cit., p. 45.
[7] Vladimir Jankélévitch et Béatrice Berlowitz, Quelque part dans l’inachevé, Paris, Gallimard, 1978, p. 67.
[8] Ibid.
[9] Frédéric Worms, La philosophie en France au XXe siècle. Moments, Paris, Gallimard, 2009, p. 411.
[10] Vladimir Jankélévitch, Philosophie morale, Paris, Flammarion, 1998, p. 1148 (Le Pardon).
[11] Vladimir Jankélévitch, Le paradoxe de la morale, op. cit., p. 32.
[12] « Lettre de Vladimir Jankélévitch du 5 juillet 1980 », in Magazine littéraire (Vladimir Jankélévitch), no. 33, 1995, p. 57.
[13]> Vladimir Jankélévitch, Le je-ne-sais-quoi et le Presque-rien 1. La manière et l’occasion, Paris, Seuil, 1980, p. 102.