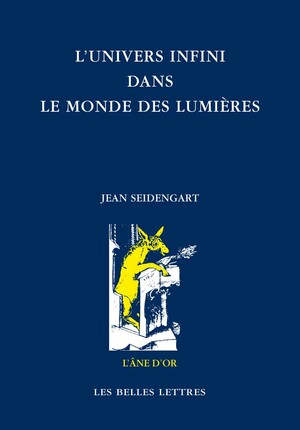Les réminiscences de la tradition naturaliste
dans la structure institutionnelle du champ scientifique français.

L’irruption de l’œuvre épistémologique de J.C. Passeron dans le champ français suscite de nombreuses interrogations, notamment parce qu’il se considère comme l’instigateur d’une « rupture » paradigmatique en France, tout du moins comme une œuvre visant à reposer la question de la signification même du travail du sociologue, voire de la valeur des « vérités » sociologiques, et, surtout, de la conception même des sciences sociales, en s’appuyant sur Weber. Lorsqu’il évoque cette intolérance paradigmatique qui est pour lui le signe d’une conception positiviste latente qui sous-tend tous les débats scientifiques, il soulève un problème qui est moins le fait d’individus isolés qu’un phénomène collectif propre à tout un champ scientifique. C’est pourquoi il est nécessaire d’aller chercher dans la structure institutionnelle des disciplines des sciences sociales françaises des éléments susceptibles d’alimenter l’hypothèse que certains comportements trahissant une attitude naturaliste spontanée à l’égard des sciences sociales puissent avoir été orientés par le fonctionnement institutionnel du monde scientifique français.
L’idée qui préside aux développements qui vont suivre est directement issue de la sociologie de la science : c’est l’idée que les produits que livre la science n’apparaissent pas uniquement pour eux-mêmes, que son développement n’est pas seulement le fait de bonnes idées et de chercheurs brillants, mais qu’ils sont étroitement liés à la structure et au fonctionnement, au contexte institutionnel dans lequel se déroule la vie scientifique. Bien sûr, un système institutionnel n’est pas « naturaliste », les institutions ne « pensent » pas ; seuls les individus qui les constituent peuvent développer des approches, des visions de la science, elles plus ou moins naturalistes. Par contre, ces postures intellectuelles individuelles en adéquation avec une certaine conception naturaliste des sciences sociales peuvent être relayées et entretenues par le fonctionnement institutionnel de la discipline en question. « Un savant est un champ scientifique fait homme »[1], c’est-à-dire qu’un système institutionnel résonne en chaque individu par le biais de l’ « habitus », et joue un rôle dans la construction de ses schèmes de perception, d’évaluation, et de ses catégories de pensée, qui conditionnent pour une part ses choix idéologiques, scientifiques, mais aussi son attitude face à ses pairs.
Kuhn, dans son ouvrage La structure des révolutions scientifiques[2], mettait à bas l’idéal positiviste d’une science en progrès constant, évolutive, intrinsèquement cumulative. A cette conception, il opposait l’existence de paradigmes se succédant chronologiquement selon une alternance de périodes de « science normale » et de « révolutions ». Une période de science « normale » était caractérisée par un paradigme, définissant les problèmes, énigmes et méthodes légitimes, déterminant le pensable et l’impensable. Ce paradigme (ou « matrice disciplinaire ») est accepté par la majorité des savants, et tend à s’imposer à tous les autres comme « norme » ou « contrainte sociale » (au sens durkheimien). Kuhn ne revendiquait aucune application de ses thèses aux sciences sociales. Au contraire, il estimait que les sciences sociales n’étaient pas soumises à ces révolutions paradigmatiques, et que plusieurs paradigmes coexistaient toujours. Pourtant, en France, les différentes théories des sciences sociales ne semblent pas prendre la forme de cette coexistence pacifique, ou de cette concurrence libre entre paradigmes s’affrontant légitimement pour la reconnaissance de leur supériorité dans l’étude de faits sociaux donnés. De nombreux mécanismes sociaux entravent la libre concurrence d’approches théoriques divergentes, donnant un aspect structurellement plus monopolistique que pluraliste au champ sociologique français. L’hégémonie incontestée d’une école sur le reste du champ n’a certes pu être constatée que durant la période durkheimienne, et pourtant, le champ tend historiquement à la domination d’une école, relégant délibérément les autres approches dans la non science. Surtout, le « modèle » de la lutte durkheimienne pour la reconnaissance de sa discipline, l’agressivité avec laquelle il avait pu mener les débats scientifiques qui l’opposaient à Tarde, par exemple, ont perduré bien au-delà de Durkheim et de son groupe. L’idéal naturaliste d’unification des sciences sociales, à l’instar des sciences de la nature, autour d’un paradigme, d’une approche et d’une méthodologie uniques est entretenu par les structures sociales du champ, les rapports sociaux qu’il favorise, en l’occurrence des rapports très conflictuels de tentative de domination d’un courant sur les autres ou de renversement de cette domination. Ainsi, l’idéal naturaliste est entretenu par la structure sociale du monde scientifique, qui s’accomode mal du pluralisme, par le biais des représentations collectivement produites et reproduites et du fonctionnement routinier du champ scientifique, incorporés dans l’habitus de chaque membre du champ.
1. Du centralisme politique au monopolisme scientifique : le terreau idéal pour des rapports conflictuels.
Au contraire de Kuhn, qui présentait une vision strictement endogène du changement paradigmatique, il faut ici analyser les changements au sein des différentes disciplines des sciences sociales comme intrinsèquement liés à des mécanismes sociaux découlant de la structure sociale du champ scientifique. Même si Bourdieu a tendance à universaliser ses propos, et à proposer une théorie générale du champ, et en l’occurrence du champ scientifique, il faut préciser que cette théorie est issue de ses travaux sur l’université française[3] (en particulier Homo academicus, 1984), et que, même si pour une grande part elle est susceptible de s’appliquer également à d’autres champs universitaires étrangers, il n’en reste pas moins qu’elle s’applique, dans le détail, à la France mieux qu’à aucun autre pays. Il faut ici tenter de déterminer les spécificités du champ scientifique français, et ses mécanismes sociaux, qui engendrent une tendance à la domination monopolistique de certains courants sur un « marché » des théories scientifiques particulièrement impur et imparfait.
1.1. Le champ scientifique comme champ de lutte pour le « monopole de l’autorité scientifique ».
L’image irénique de la « communauté scientifique », animée par l’idéal d’une science mûe par l’intérêt intrinsèque et immanent de la vérité scientifique, « monde d’échanges généreux dans lequel tous les chercheurs collaborent à une même fin, »[4] est particulièrement trompeuse. La science ne se déroule pas selon les règles de la science pour la science : il existe une illusion de l’ « art pour l’art » dans le champ scientifique, qui n’est pas seulement le fruit des propriétés intrinsèques de la science prise en elle-même. Au contraire, le champ scientifique est animé par une concurrence entre ses membres, lutte dont l’objet est social tout autant que scientifique : la recherche de la reconnaissance, de l’autorité scientifique, ou, en d’autres termes, l’accumulation de capital scientifique ayant pour enjeu le monopole de la compétence scientifique légitime, intérêts souvent occultés au nom de l’idéal scientifique du désintéressement[5].
1.1.1. Le champ scientifique comme champ de forces et de luttes.
Le champ scientifique, en tant que champ social, est un champ de forces où s’exerce en permanence le jeu des positions, des dispositions (habitus), déteminant la structure des rapports de force, et surtout un champ de lutte pour transformer ces rapports.[6] Dans le champ, en effet, chaque agent est en relation avec tous les autres agents, directement ou indirectement, par le biais d’équipes de recherches ou de laboratoires. Ces relations créent l’espace du champ, et le dotent d’une structure.
« Ce sont les agents (…) définis par le volume et la structure du capital spécifique qu’ils possèdent, qui déterminent la structure du champ qui les détermine, c’est-à-dire l’état des forces qui s’exercent sur la production scientifique, sur les pratiques des savants. »[7]
C’est l’accumulation de capital scientifique, forme particulière de capital symbolique, qui détermine pour une grande part les positions objectives de chaque agent (son « poids » social) par rapport aux autres, le pouvoir d’action qui lui sera conféré. Selon la position occupée par un agent dans le champ, il pourra disposer de plus ou moins de liberté d’innovation, ou sera amené à produire des recherches plus ou moins subversives. Autrement dit, c’est la structure de la distribution du capital scientifique qui détermine la structure du champ, c’est-à-dire les rapports de force entre agents scientifiques. D’autre part, la répartition du capital scientifique étant forcément inégale, ce dernier est l’enjeu d’une lutte de concurrence.
« Le champ scientifique comme système des relations objectives entre les positions acquises (dans les luttes antérieures) est le lieu (…) d’une lutte de concurrence qui a pour enjeu spécifique le monopole de l’autorité scientifique inséparablement définie comme capacité technique et comme pouvoir social, ou si l’on préfère, le monopole de la compétence scientifique, entendue au sens de capacité de parler et d’agir légitimement (c’est-à-dire de manière autorisée et avec autorité) en matière de science, qui est socialement reconnue à un agent déterminé. »[8]
L’obtention de cette compétence scientifique est directement liée à la reconnaissance que lui accordent ses pairs. Ce capital détermine sa position, mais permet également à celui qui en accumule suffisamment de changer les règles du jeu, de modifier les « modes » au sein du champ scientifique, de changer les règles d’acceptation ou d’élimination de nouveaux entrants dans le champ scientifique, de nouvelles idées, de paradigmes concurrents. En effet, le champ n’est pas figé, statique, et les positions objectives ne sont jamais données une fois pour toutes, car il est aussi le lieu d’un « jeu dans lequel les règles du jeu sont elles-mêmes mises en jeu », car les agents se livrent à une lutte provoquée par la répartition inégale des différents capitaux, pour conserver ou subvertir les rapports de force dessinés plus haut. Ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, c’est que le capital scientifique peut prendre deux formes bien distinctes, le capital scientifique pur, et le capital institutionnel, l’un pouvant être considéré comme un capital d’autorité proprement scientifique, pouvoir « intellectuel », et l’autre comme un capital de pouvoir sur le monde scientifique, pouvoir « temporel »[9].
1.1.2. Libre concurrence et types de capitaux.
La concurrence entre agents (et donc entre les idées qu’ils représentent) serait « libre » si la hiérarchie des positions était purement déterminée par l’accumulation de prestige scientifique, de distinctions universitaires liées à des travaux originaux, bref, si les agents et les idées dont ils sont porteurs étaient hiérarchisés en fonction de la qualité intrinsèquement scientifique des recherches, et que les rapports de forces institués entre agents pouvaient être subvertis et inversés selon des critères purement scientifiques. Mais le capital scientifique, catégorie générale, est en réalité le reflet d’une multiplicité de types de reconnaissance, de types de pouvoir sur la structure du champ. Dans le champ scientifique, différents statuts peuvent conférer différents types de pouvoir : Tout d’abord, il existe des critères de pouvoir universitaire, conféré par l’appartenance à l’Institut, au conseil national des universités (CNU), positions de doyen ou de directeur d’UFR, directeur d’institut (appartenance au jury des grands concours, ENS, agrégation). Ensuite, on trouve des critères de capital de pouvoir scientifique : direction d’un organisme de recherche, d’une revue scientifique, enseignement dans une institution d’enseignement de recherche, participation au directoire du CNRS, aux commissions du CNRS au Conseil supérieur de la recherche scientifique. Plus délicat à déterminer, le capital de prestige scientifique joue également un rôle : appartenance à l’Institut, distinctions scientifiques, doctorats honoris causa, traductions en langues étrangères, participation à des colloques internationaux. Enfin, le capital de notoriété intellectuelle est le reflet de l’intégration du champ scientifique dans un champ intellectuel et culturel plus vaste : appartenance à l’Académie française, mention dans le Larousse, apparitions à la télévision ou à la radio, collaborations à des quotidiens, des revues intellectuelles, des publications en collection de poche, etc. On peut réduire ces catégories à deux types généraux de capital scientifique : le capital scientifique « pur » et le capital institutionnel. Le capital scientifique pur est le capital savant à proprement parler. Il s’acquiert par la qualité des travaux et des recherches effectuées, par des inventions, des découvertes dont la qualité purement scientifique est reconnue par les pairs de la discipline, et confère une autorité proprement intellectuelle. Le capital institutionnel, lui, n’est pas obtenu par une découverte scientifique ou une capacité reconnue à mener des recherches innovantes, mais par l’occupation de positions importantes dans les institutions scientifiques. Il est un « capital de pouvoir sur le monde scientifique »[10], qui est accumulé par des voies qui ne sont pas scientifiques, mais institutionnelles. La direction d’un centre de recherches, l’appartenance à des commissions scientifiques, à des comités de lecture de revues scientifique, l’exercice de responsabilités dans les structures administratives de la recherche (doyen de faculté, recteurs d’académie, etc…) en sont les manifestations les plus courantes. La structure des rapports de force entre agents dans le champ est donc à la fois déterminée par une espèce de capital proprement scientifique, mais également par la possession de titres issus d’une hiérarchie administrative et institutionnelle. Ce qui importe ici, c’est de remarquer que ce n’est pas uniquement la qualité scientifique des recherches menées qui importe dans la détermination de la hiérarchie scientifique.
« Les jugements sur les capacités scientifiques d’un étudiant ou d’un chercheur sont toujours contaminées, à tous les niveaux du cursus, par la connaissance de la position qu’il occupe dans les hiérarchies instituées. »[11]
Il existe donc, dans le champ scientifique, une dualité des principes de domination. La conservation ou la subversion des rapports de force en place ne sont pas le fruit unique de la reconnaissance interne des scientifiques entre eux, et surtout pas en sciences sociales. Il ne s’agit bien évidemment pas ici de dire que les considérations purement scientifiques ne jouent aucun rôle, ni d’ailleurs qu’elles sont reléguées au second rang. Mais, dans le champ scientifique, la « visibility » d’un chercheur, et donc de ses travaux de recherche, le crédit qui est susceptible de lui être accordé et son poids symbolique sur le reste du champ sont d’autant plus forts que ce chercheur est plus doté en capital. Non seulement la structure du champ scientifique tend à se reproduire, accordant du crédit à ceux qui en ont déjà, mais elle pousse qui plus est les agents à accorder cette reconnaissance au nom de critères qui ne sont pas purement scientifiques, mais également temporels.
Claire Saillour (Université Paris IV)
[1] P. BOURDIEU, Science de la science et réflexivité, cours du collège de France, Paris, Raisons d’agir, 2001, p. 84
[2] Cf. T.S. KUHN, La structure des révolutions scientifiques, Paris, Flammarion, 1972 [1962].
[3] Les premiers articles appliquant directement et systématiquement son approche en terme de champ au monde de la science datent de 1975 : « La spécificité du champ scientifique et les conditions sociales du progrès de la raison », Sociologie et Sociétés, Vol 7, n°1, pp. 91-118, puis « Les catégories de l’entendement professoral », Actes de la recherche en sciences sociales, n°3, pp. 68-93 ; puis, en 1976, parut son article « Le champ scientifique », Actes de la recherche en sciences sociales, n°2-3, pp.88-104. Mais son étude la plus conséquente sur l’université française paraît en 1984 sous le titre Homo Academicus, aux Editions de minuit.
[4] P. BOURDIEU, Science de la science et réflexivité, Op.cit., p. 92
[5] Cf. Ibid., p. 107.
[6] Ibid., p. 69.
[7] Ibid.
[8] P. BOURDIEU, « Le champ scientifique », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n°2-3, 1976, pp. 88-104, p. 89.
[9] P. BOURDIEU, Science de la science et réflexivité, Op.cit., p. 113
[10] P. BOURDIEU, Science de la science et réflexivité, Op.cit., p. 113.
[11] P. BOURDIEU, « Le champ sicentifique », Op.cit., p. 89